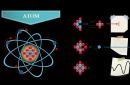4. Cavité buccale : coupes, parois, messages.
La cavité buccale (cavum oris) est le début de l'appareil digestif. En avant, il est limité par les lèvres, en haut par le palais dur et mou, en bas par les muscles qui forment le fond de la cavité buccale et la langue, et sur les côtés par les joues. La cavité buccale s'ouvre par une fissure buccale transversale (rima oris), délimitée par les lèvres (lèvres). Ces derniers sont des plis musculaires dont la surface externe est recouverte de peau et la face interne est tapissée d'une membrane muqueuse. Par le pharynx (rauces), plus précisément l'isthme du pharynx (isthmus faucium), la cavité buccale communique avec le pharynx. La cavité buccale est divisée en deux parties par les processus alvéolaires des mâchoires et des dents. La partie antérieure est appelée vestibule de la bouche (vestibulum oris) et constitue un espace arqué entre les joues et les gencives avec des dents. La partie postérieure interne, située médialement par rapport aux processus alvéolaires, est appelée cavité buccale proprement dite (cavum oris proprium). En avant et sur les côtés, elle est limitée par les dents, en bas par la langue et le fond de la cavité buccale, et en haut par le palais. La cavité buccale est tapissée de muqueuse buccale (tunica mucosa oris), recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Il contient un grand nombre de glandes. La zone de la membrane muqueuse attachée autour du col des dents sur le périoste des processus alvéolaires des mâchoires est appelée la gencive (gencive). Les joues (buccae) sont recouvertes de peau de l'extérieur et de l'intérieur - par la muqueuse buccale, qui contient les canaux des glandes buccales, et sont formées par le muscle buccal (m. buccinator). Le tissu sous-cutané est particulièrement développé dans la partie centrale de la joue. Entre les muscles masticateurs et buccaux se trouve le corps graisseux de la joue (corps adipeux buccal). La paroi supérieure de la cavité buccale (palais) est divisée en deux parties. La partie antérieure - le palais dur (palatium durum) - est formée par les apophyses palatines des os maxillaires et les plaques horizontales des os palatins, recouvertes d'une membrane muqueuse, le long de la ligne médiane de laquelle passe une étroite bande blanche, appelée le « couture du palais » (raphe palati). Plusieurs plis palatins transversaux (plicae palatinae transversae) s'étendent à partir de la suture. En arrière, le palais dur passe au palais mou (palatium molle), formé principalement par les muscles et l'aponévrose des faisceaux tendineux. Dans la partie postérieure du palais mou, il y a une petite saillie de forme conique, appelée langue (luette), qui fait partie de ce qu'on appelle le rideau palatin (velum palatinum). Le long des bords, le palais mou passe dans l'arc antérieur, appelé arc palatoglosse (arcus palatoglossus) et se dirigeant vers la racine de la langue, et le palais postérieur - palatopharyngé (arcus palatopharyngeus), allant jusqu'à la membrane muqueuse de la paroi latérale de le pharynx. Dans les dépressions formées entre les arcs de chaque côté se trouvent les amygdales palatines (tonsillae palatinae). Le palais inférieur et les arcs sont formés principalement par les muscles impliqués dans l’acte de déglutition. Le muscle qui tend le rideau palatin (m. tensor veli palatini) est un triangle plat et étire le palais mou antérieur et la section pharyngée du tube auditif. Le point de départ se situe sur la fosse naviculaire et le lieu d'attache se situe sur l'aponévrose du palais mou. Le muscle qui soulève le rideau palatin (m. Levator veli palatini) soulève le palais mou et rétrécit l'ouverture pharyngée du tube auditif. Il commence à la face inférieure de la partie pétreuse de l'os temporal et, s'entrelaçant avec les faisceaux du muscle du même nom de l'autre côté, s'attache à la partie médiane de l'aponévrose du palais. Le muscle palatoglosse (m. palatoglossus) rétrécit le pharynx, rapprochant les arcs antérieurs de la racine de la langue. Le point de départ est situé sur le bord latéral de la racine de la langue, et le lieu d'attache est sur l'aponévrose du palais mou. Le muscle palatopharyngé (m. palatopharyngeus) a une forme triangulaire, rassemble les arcs palatopharyngés, remontant la partie inférieure du pharynx et du larynx. Il commence sur la paroi arrière du pharynx inférieur et, à partir de la plaque du cartilage thyroïde, s'attache à l'aponévrose du palais mou.
Le palais mou est constitué d'une lame fibreuse aponévrose palatine (aponévrose palatine), auquel sont attachés les muscles du palais mou. En avant, l'aponévrose s'attache au palais osseux. membrane muqueuse recouvre le palais mou au-dessus et en dessous. La membrane muqueuse tapissant le palais mou du côté de la cavité buccale est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé et du côté de la cavité nasale - un épithélium cilié à plusieurs rangées. De nombreuses glandes muqueuses se trouvent dans la sous-muqueuse. Par endroits, les corps des glandes muqueuses se situent entre les faisceaux de muscles du palais mou. Les canaux excréteurs des glandes s'ouvrent sur la surface buccale du palais.
Le bord postérieur du palais mou au milieu présente une saillie pendante - langue palatine (luette palatine). Les deux surfaces de la luette chez l'adulte sont recouvertes d'un épithélium pavimenteux stratifié. Latéralement à la luette, le bord postérieur du palais mou forme de chaque côté une paire d'arcs palatins, qui sont des plis de la membrane muqueuse dans lesquels sont intégrés des muscles. devant, arc palatoglosse (arcus palatoglossus) s'étend de la partie médiane du palais mou jusqu'à la surface latérale de l'arrière de la langue. dos, arc palatopharyngé (arcus palatopharyngeum), va à la paroi latérale du pharynx.
Entre les arcs palatoglosse et palatopharyngé, une dépression triangulaire se forme - fosse amygdale (fossa tonsillaris). La partie inférieure de la fosse amygdale est plus approfondie, on l'appelle sinus des amygdales (sinus amygdalien). Dedans se trouve amygdale palatine(Fig. 103). Il y a une petite empreinte au-dessus de l'amygdale - fosse supra-amande (fossa supratonsillaris).
Les muscles suivants sont situés dans le palais mou (Fig. 104).
1. Muscle qui tend le voile du palais(m. tenseur vali palatini) part de la base externe du crâne en trois faisceaux : devant provient de la fosse naviculaire de l'apophyse ptérygoïdienne et de sa plaque médiale, moyenne - de la surface externe des parties cartilagineuses et membraneuses du tube auditif et de la surface temporale inférieure de la grande aile de l'os sphénoïde en dedans des ouvertures épineuses et ovales, arrière - de la colonne vertébrale de l'os sphénoïde. Les fibres musculaires sous la forme d'une plaque musculaire plate de forme triangulaire descendent vers le bas et vers l'avant jusqu'au crochet de l'apophyse ptérygoïdienne et, n'atteignant pas 2 à 10 mm avant celui-ci, passent dans un tendon de 2 à 6 mm de large qui, se jetant sur le crochet, se divise en deux parties - l'extérieur et l'intérieur. La partie externe du tendon plus petit, va à fascia bucco-pharyngé, partiellement attaché à la surface postérieure du processus alvéolaire. Partie intérieure les tendons, plus épais, en forme d'éventail, se dilatent et passent dans aponévrose palatine. Lorsque les muscles droit et gauche se contractent, le palais mou est étiré (tendu). Entre la surface du crochet de l'apophyse ptérygoïdienne et le tendon du muscle se trouve un petit sac sec (bourse m. tensoris veli palatini).
Cavité buccale, situé au bas de la tête, est le début du système digestif. Cet espace est limité d'en bas par les muscles de la partie supérieure du cou, qui forment le diaphragme (inférieur) de la bouche, au-dessus se trouve le palais, qui sépare la cavité buccale de la cavité nasale. Sur les côtés, la cavité buccale est limitée par les joues, devant - par les lèvres et derrière par une large ouverture - par le pharynx, la cavité buccale communique avec le pharynx. Dans la cavité buccale se trouvent des démangeaisons, la langue et des flux de grandes et petites glandes salivaires qui s'y ouvrent. La cavité buccale est divisée en une section antérieure plus petite - le vestibule de la bouche et la cavité buccale elle-même. Le vestibule de la bouche est délimité en avant par les lèvres, sur les côtés par la face interne des joues, en arrière et sur la face médiale par les dents et les gencives. À l’intérieur des gencives et des dents se trouve la véritable cavité buccale.
Cavité buccale. 1. Lèvre supérieure (lat. Labium superius) 2. Gencives (lat. Gingiva) 3. Palais dur (lat. Palatum durum) 4. Palais mou (lat. Palatum molle) 5. Luette (lat. Uvula palatina) 6. Palatal amygdale (lat. Tonsilla palatina) 7. Isthme du pharynx (lat. Isthmus faucium) 8. Grandes molaires (lat. Dentates molares) 9. Petites molaires (lat. Dentates premolares) 10. Canine(s) (lat. Dentes canini ) 11. Incisives (lat. Dentes incisivi) 12. Langue (lat. Lingua)
Des gommes sont les processus alvéolaires de la mâchoire supérieure et la partie alvéolaire de la mâchoire inférieure, recouvertes d'une membrane muqueuse. Le vestibule et la cavité buccale proprement dite communiquent par un espace étroit entre les dents supérieures et inférieures.
fissure buccale limité aux lèvres supérieures et inférieures, reliées latéralement de chaque côté par la commissure labiale (commissure des lèvres). La base des lèvres est le muscle circulaire de la bouche. La membrane muqueuse des lèvres dans le vestibule de la bouche passe aux ortostes alvéolaires et à la partie alvéolaire de la mâchoire, forme le frein de la lèvre supérieure et le frein de la lèvre inférieure.
Joues sont basés sur le muscle buccal. Entre le muscle et la peau se trouve une accumulation de tissu adipeux - le corps graisseux de la joue, ou masse graisseuse de Bish, qui est la plus développée chez les nourrissons. À cet âge, la masse graisseuse épaissit la paroi de la cavité buccale, contribue à réduire l’effet de la pression atmosphérique sur la cavité buccale et facilite la succion.
Sur la muqueuse de la joue, à la veille de la bouche, s'ouvre le canal excréteur de la glande salivaire parotide. L'embouchure de ce conduit se situe au niveau de la deuxième molaire supérieure et forme parfois papille de la glande parotide.
Dents
Dents(dentes) - formations anatomiques importantes situées dans les alvéoles dentaires des mâchoires. Selon les caractéristiques de structure, de position et de fonction, on distingue plusieurs groupes de dents : incisives, canines, petites molaires (prémolaires) et grandes molaires (molaires).
Les incisives sont conçues principalement pour saisir la nourriture et la mordre, les crocs - pour l'écraser, les molaires - pour frotter, broyer la nourriture. Malgré la division des dents en différents groupes, toutes les dents ont un plan structurel commun. La dent est constituée d'une couronne, d'un collet et d'une racine.

Couronne de la dent, la partie la plus massive, dépassant de la gencive, présente plusieurs surfaces. Surface linguale couronne face à la langue, surface vestibulaire (faciale)- vers le vestibule de la bouche, la surface de contact - vers la dent adjacente. Surfaces de mastication, ou surface de fermeture, les dents similaires des mâchoires supérieure et inférieure se font face. À l’intérieur de la couronne se trouve la cavité de la couronne. Contenant de la pulpe et continuant dans le canal radiculaire.
Racine de dent est situé dans l'alvéole dentaire, aux parois de laquelle il est relié par un type particulier de synarthrose - par martelage. Chaque dent a d'une (incisives, canines) à deux ou trois (molaires) racines. À l’intérieur de chaque racine se trouve un canal de la dent, également rempli de pulpe. La racine de la dent se termine par un sommet comportant un trou à travers lequel une artère, un nerf pénètre dans la cavité de la dent et une veine en sort.
Entre couronne et racine col de la dent recouverte par la muqueuse gingivale.
La substance de la dent est constituée de dentine, d’émail et de cément. La dentine constitue la majeure partie de la dent et du canal radiculaire. La couronne de la dent est recouverte d'émail à l'extérieur et la racine est recouverte de ciment. Dans les alvéoles dentaires, les racines des dents sont étroitement fusionnées avec le périoste des alvéoles.

Dents de chien : 1, 2, 3 - incisives, 4 - canines, 5 - prémolaires, 6 - molaires
Les premières dents apparaissent chez les enfants âgés de 5 à 7 mois et à l'âge de 2 à 2,5 ans, leur nombre atteint 20. Ce sont des dents de lait. Chez les enfants de 5 à 7 ans, les dents de lait commencent à tomber et des dents permanentes apparaissent à leur place. Chez un adulte, il y a normalement 32 dents dans les alvéoles dentaires.
Chaque moitié de la mâchoire supérieure et chaque moitié de la mâchoire inférieure possède 8 dents permanentes : 2 incisives, 1 canine, 2 petites molaires.
incisives avoir une large couronne aplatie avec une surface coupante. La couronne des incisives supérieures est plus large que celle des incisives inférieures. La racine des incisives est simple-conique ; au niveau des incisives inférieures, la racine est pressée sur les côtés. Selon leur localisation par rapport au plan médian, on distingue les incisives latérales et médiales.
crocs avoir une couronne conique, pointue. La racine est unique, longue, comprimée sur les côtés. La racine des canines inférieures est plus courte que celle des supérieures. Parfois, la racine des canines inférieures est bifurquée.
Petites molaires (prémolaires) sont derrière le chien. La couronne des prémolaires du côté de la surface masticatrice est ronde ou ovale et comporte deux tubercules masticateurs. La hauteur de la couronne est inférieure à celle des canines. La racine des prémolaires est unique, de forme conique ; la racine de la prémolaire supérieure est parfois bifurquée.
Grosses molaires (molaires) situé derrière les prémolaires. La couronne des grosses molaires est généralement de forme cubique, il y a 3 à 5 tubercules sur la surface de mastication. Les grandes molaires de la mâchoire supérieure ont 3 racines inférieures -2. La taille des molaires diminue d’avant en arrière. La troisième molaire (dent de sagesse) est la plus petite.
Langue
La langue humaine est formée de tissu musculaire strié (strié) recouvert d'une membrane muqueuse. La langue est impliquée dans le traitement mécanique des aliments, dans l'acte de déglutition, dans la perception du goût, dans l'articulation de la parole. Il est situé dans la cavité buccale et est un organe musculaire aplati qui s'étend d'avant en arrière. En avant, la langue se rétrécit pour former le sommet de la langue. L'apex passe en arrière dans un large et épais le corps de la langue, derrière lequel se trouve racine du langage.
La membrane muqueuse de la langue est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié (pavimenteux) non kératinisé. La membrane muqueuse du dos et des bords de la langue est dépourvue de sous-muqueuse et est directement fusionnée avec les muscles. La partie antérieure de l'arrière de la langue est parsemée de nombreuses papilles, excroissances de la lamina propria, recouvertes d'épithélium. Les humains ont quatre types de papilles : filiforme, fongiforme, cannelée et foliée. Surtout, il y a des papilles filiformes à l'arrière de la langue, elles donnent à la langue un aspect velouté.
Papilles filiformes et coniques- les plus nombreuses, localisées de manière diffuse au niveau de tout l'arrière de la langue, ont une longueur d'environ 0,3 mm. papilles fongiformes sont situés principalement au sommet et le long des bords de la langue. Leur base est rétrécie et leur sommet est élargi. Ces papilles mesurent 0,7 à 1,8 mm de long et 0,4 à 1,0 mm de diamètre. Dans l'épaisseur de l'épithélium des papilles fongiformes se trouvent des papilles gustatives (3-4 dans chaque papille), qui ont une sensibilité gustative.
Papilles de gouttière, ou papilles, entourées d'une tige, au nombre de 7 à 12, sont situées sur le bord du corps et la racine de la langue, en avant du sillon frontalier. Les papilles de gouttière mesurent 1 à 1,5 mm de long et 1 à 3 mm de diamètre. Les papilles en forme de gouttière ont une base étroite et une partie libre élargie et aplatie. Autour de la papille se trouve une dépression annulaire (sillon) qui sépare la papille de la crête épaissie qui l'entoure. De nombreuses papilles gustatives sont situées dans l'épithélium des surfaces latérales de la papille en forme de creux et de la crête qui l'entoure.
Papilles foliaires sous forme de plaques plates de 2 à 5 mm de long, chacune située sur les bords de la langue ; ils contiennent également des papilles gustatives.
Muscles de la langue. Parmi les muscles de la langue, appariés, striés, il existe des muscles propres et des muscles qui prennent naissance sur les os du squelette (muscles squelettiques). Les muscles intrinsèques de la langue commencent et se terminent dans la langue, tandis que les muscles squelettiques ont une origine osseuse.
| Muscle | Commencer | pièce jointe | Fonction | innervation |
| Menton- | Menton- essieu inférieur sa mâchoire |
pourboire et base de langue |
Tire la langue en avant et |
Supérieur guttural |
| Sublingual- | corps et douleur corne de shoi sublinguale |
Latéral une partie de la langue |
Tire la langue vers le bas et vers l'arrière |
Nerf laryngé inférieur |
| muscle styloglosse | Processus styloïde de l'os temporal | Côté et bas de la langue | Tire la langue d'avant en arrière |
Propres muscles de la langue . Le muscle longitudinal supérieur est situé sur les côtés du sillon médian de la langue, sous sa muqueuse. Ce muscle commence au niveau de la racine de la langue et se termine à son extrémité. Lorsqu'il est contracté, le muscle longitudinal supérieur raccourcit la langue et relève sa pointe.
muscle transverse de la langue représenté par des faisceaux présents entre les muscles longitudinaux supérieurs et inférieurs depuis le septum fibreux de la langue transversalement jusqu'à ses bords. Le muscle rétrécit la langue, soulevant son dos.
muscle vertical la langue est située principalement dans les parties latérales de la langue, situées entre la membrane muqueuse du dos et la surface inférieure de la langue. En se contractant, il aplatit la langue.
Muscles squelettiques de la langue. Muscle géniolingual commence sur l'épine mentonnière de la mâchoire inférieure, en forme d'éventail vers le haut et vers l'arrière sur les côtés du septum de la langue et se termine dans son épaisseur. Lors de la contraction, il tire la langue vers le bas et vers l'avant.
Le muscle hyoïde-lingual provient de la grande corne et du corps de l'os hyoïde, se termine dans les parties latérales de la langue. Déplace la langue vers le bas et vers l'arrière.
Le muscle styloglosse commence sur l'apophyse styloïde de l'os temporal, avance, médialement et vers le bas, se faufilant latéralement dans l'épaisseur de la langue. Avec une contraction unilatérale, il déplace la langue sur le côté.
Innervation. L'innervation motrice des muscles de la langue est réalisée par le nerf hypoglosse (XII paire). L'innervation sensible de la membrane muqueuse dans les deux tiers antérieurs de la langue est réalisée par les terminaisons du nerf lingual (du nerf mandibulaire - la troisième branche du nerf trijumeau, paire V), dans le tiers postérieur de la langue - par les terminaisons du nerf glossopharyngé (paire XI), et une branche se rapproche de la membrane muqueuse de la racine de la langue à partir du nerf laryngé supérieur (du nerf vague, paire X). L'innervation du goût dans le tiers postérieur de la langue est réalisée par le nerf glossopharyngé et dans les deux tiers antérieurs - du nerf facial à travers la corde tympanique, dont les fibres font partie du nerf lingual.
Approvisionnement en sang. Le sang circulant dans la langue provient de l'artère linguale (de l'artère carotide externe), qui se ramifie vers les capillaires, formant un réseau dense dans la langue. Le sang veineux coule vers la veine du même nom, qui se jette dans la veine jugulaire interne.
glandes buccales
Les glandes de la bouche comprennent de petites et grandes glandes salivaires. Les glandes salivaires mineures sont situées dans l'épaisseur de la membrane muqueuse et de la sous-muqueuse de la cavité buccale. Leur taille varie de 1 à 5 mm. Selon le principe topographique, les glandes sont les glandes labiale, buccale, molaire (située à proximité des molaires), palatine et linguale. Les grosses glandes salivaires sont situées à l'extérieur des parois de la cavité buccale, mais s'y ouvrent à l'aide de canaux excréteurs.
Toutes les glandes salivaires sont d'origine ectodermique et possèdent une structure alvéolaire ou alvéolaire-tubulaire complexe. Les glandes salivaires ont un corps (section principale, sécrétoire) et un canal excréteur. Le corps est représenté par le parenchyme et le stroma.
Les glandes salivaires remplissent une fonction exocrine. Elle consiste en la libération régulière de salive dans la cavité buccale. La salive contient de l'eau (environ 99 %), du mucus (mucine), des enzymes (amylase, maltase), des substances inorganiques, des immunoglobulines. La salive hydrate les aliments, humidifie la membrane muqueuse de la bouche. Les enzymes salivaires décomposent les polysaccharides en disaccharides et monosaccharides (glucose).
Glande salivaire parotide hammam, sécrétion de type séreux. La glande a une forme irrégulière, recouverte d'une fine capsule à l'extérieur. La masse de la glande est de 20 à 30 g. La glande est située en avant et en bas de l'oreillette, sur la surface latérale de la branche de la mâchoire inférieure. Elle s'ouvre devant la bouche au niveau de la deuxième molaire supérieure.
Innervation : sensible - branches parotides du nerf auriculaire temporal, sécrétoire (parasympathique) - fibres du nerf auriculaire temporal (du nœud de l'oreille), sympathique - du plexus carotide externe.
Approvisionnement en sang: branches parotides des surfaces de l'artère temporale, écoulement veineux - dans la veine mandibulaire.
Glande salivaire sous-maxillaire narnaya, type de sécrétion mixte, possède une fine capsule. Il est situé dans la région du triangle sous-maxillaire du cou. Le canal sous-maxillaire (Wartons) de la glande avance, est adjacent à la glande salivaire sublinguale et s'ouvre à la bouche sur la papille sublinguale, à côté du frein de la langue.
innervation : sécrétoire (parasympathique) - fibres du nerf facial - de la corde tympanique et du nœud sous-maxillaire, sympathique - du plexus carotide externe.
approvisionnement en sang : branches glandulaires de l'artère faciale. Écoulement veineux : veine sous-maxillaire.
glande salivaire sublinguale hammam, sécrétion à prédominance muqueuse. Il est situé sur le muscle maxillo-facial, directement sous la muqueuse du plancher buccal. Grand conduit hyoïde - Le canal excréteur principal s'ouvre au niveau de la papille sublinguale.
Innervation : sécrétoire (parasympathique) - fibres du nerf facial, passant par la corde tympanique et le nœud hyoïde, sympathique - provenant du plexus carotide externe.
Approvisionnement en sang: artères sublinguales et mentales. Écoulement veineux : veines sublinguales.
Ciel
Ciel subdivisé en dur et mou. Les apophyses palatines des os maxillaires reliées entre elles, auxquelles sont attachées derrière les plaques horizontales des os palatins, forment la base osseuse du palais dur.

Ciel doux rejoint le bord postérieur du palais dur. La base du palais mou est la plaque de tissu conjonctif (aponévrose palatine) et les muscles du palais mou, recouverts du côté des cavités nasales et buccales par une membrane muqueuse. La partie antérieure du palais mou est située dans un plan horizontal, le bord postérieur librement pendant du palais est appelé rideau palatin. Sur le bord libre du rideau palatin se trouve un processus arrondi - la luette palatine. À partir des bords latéraux du rideau palatin, commencent deux plis - les arcs. L'arc palatoglosse descend jusqu'au bord latéral de la racine de la langue. L'arc palato-pharyngé postérieur descend jusqu'à la paroi latérale du pharynx. Entre les arcs se trouve la fosse des amygdales. Il contient l'organe du système immunitaire - l'amygdale palatine.
Caractéristiques liées à l'âge de la cavité buccale, de la langue, des glandes salivaires et du palais.
Cavité buccale le nouveau-né est petit. Le vestibule est délimité de la cavité buccale par ce qu'on appelle le bord gingival, et non par les processus alvéolaires. Les lèvres sont épaisses, la muqueuse est recouverte de papilles. Sur la surface interne des lèvres se trouvent des crêtes transversales. La partie intermédiaire (zone de transition) est étroite, le muscle circulaire de la bouche est bien développé.
Ciel solide plat, situé au niveau de la voûte du pharynx, le palais mou est court, situé horizontalement. Le rideau palatin ne touche pas la paroi pharyngée postérieure, ce qui assure une respiration libre lors de la succion. La membrane muqueuse du palais dur forme de faibles plis transversaux et est pauvre en glandes.
Langue chez un nouveau-né, il est épais, large, court, inactif. Il occupe toute la cavité buccale. En bouche fermée, elle s'étend au-delà des bords des gencives et atteint les joues. Les papilles de la langue sont prononcées, l'amygdale linguale est peu développée. Avec l'avènement des dents de lait, puis au cours de la première enfance, on observe une augmentation significative de la taille des apophyses alvéolaires de la mâchoire supérieure, la partie alvéolaire de la mâchoire inférieure et la cavité buccale. Le ciel dur semble se lever.
amygdale palatine chez un nouveau-né, il est petit (jusqu'à 7 mm), cependant, avec la bouche ouverte, il est clairement visible, car il est faiblement recouvert par l'arc antérieur. Chez les enfants, l'amygdale est relativement grosse. Il atteint sa taille maximale (28 cm) à l'âge de 16 ans.
Glandes salivaires le nouveau-né est peu développé. Ils poussent particulièrement vite après 4 mois, au cours des 2 premières années. À l'avenir, les glandes s'allongent et leurs conduits deviennent plus ramifiés. Le canal de la glande salivaire parotide est situé plus bas que chez l'adulte, s'ouvrant au niveau de la première molaire.
Joues chez l'enfant, ils sont convexes en raison de la présence d'un corps graisseux arrondi entre la peau et le muscle buccal bien développé. Avec l’âge, le corps adipeux s’aplatit et recule, derrière le muscle masticateur.
La cavité buccale proprement dite , cavum oris proprium, est délimité d'en haut par un palais dur et partiellement mou, d'en bas par la langue et les muscles qui composent le fond de la cavité buccale, en avant par la dentition et les gencives. La paroi arrière de la cavité buccale elle-même est formée par le palais mou qui, lorsqu'il est contracté, peut limiter l'ouverture - le pharynx, à travers laquelle la cavité buccale communique avec le pharynx.
Avec les dents fermées, la cavité buccale elle-même a la forme d'un espace, avec la bouche ouverte, elle a une forme ovoïde irrégulière. Il existe des différences prononcées entre les individus et les âges dans la forme de la cavité buccale elle-même. Les bouches brachycéphales sont plus larges, plus hautes et plus courtes que les bouches dolichocéphales, qui sont étroites, basses et longues.
Chez les nouveau-nés et les enfants jusqu'à 3 mois, la cavité buccale est très petite, courte et basse en raison du faible développement des processus alvéolaires inférieurs et du corps de la mâchoire inférieure. Avec le développement des processus alvéolaires et l'apparition des dents, la cavité buccale s'agrandit et acquiert la forme d'une cavité adulte vers l'âge de 17-18 ans.
Ciel solide. Le palais dur, palatum durum, comprend le palais osseux, le palatum osseum (le processus palatin de la mâchoire supérieure et la plaque horizontale de l'os palatin, voir la section Os du crâne facial de cette édition) et les tissus mous qui recouvrent il, et constitue un septum séparant la cavité buccale de la cavité nasale (Fig. 81). Ainsi, le palais dur présente deux surfaces : la orale, face à la cavité buccale, et la nasale, qui est le fond de la cavité nasale.
Riz. 81. Le ciel après ablation de la membrane muqueuse. 1 - palais dur ; 2 - grande artère palatine ; 3 - l'embouchure du canal de la glande salivaire parotide ; 4 - crochet ptérygoïdien ; 5 - muscle sollicitant le rideau palatin ; 6 - membrane muqueuse de la cavité buccale ; 7 - muscle qui soulève le rideau palatin ; 8 - constricteur supérieur du pharynx ; 9 - muscle palatoglosse ; 10 - muscle du roseau ; 11 - muscle palato-pharyngé ; 12 - dos de la langue ; 13 - arcade dentaire inférieure ; 14 - pharynx; 15 - amygdale palatine; 16 - suture ptérygo-mandibulaire ; 17 - muscle buccal; 18 - glandes palatines ; 19 - gomme; 20 - arcade dentaire supérieure
En fonction de la hauteur des processus alvéolaires de la mâchoire supérieure, du degré de concavité du palais dur lui-même (à la fois dans les directions transversale et sagittale), une voûte, ou dôme, de la paroi supérieure de la cavité buccale de différentes hauteurs est formé. Chez les personnes ayant un crâne dolichocéphale, une face étroite et haute, la voûte palatine est haute, chez les personnes ayant un crâne brachycéphale et une face large, la voûte palatine est plus plate (Fig. 82). Chez les nouveau-nés, le palais dur est généralement plat. Au fur et à mesure que les processus alvéolaires se développent, la voûte du ciel se forme. Chez les personnes âgées, en raison de la perte des dents et de l’atrophie des processus alvéolaires, la forme du palais redevient plate.
La surface osseuse du palais dur est inégale, il y a un certain nombre de trous, canaux, sillons et élévations dans l'os. Au milieu, à la jonction des apophyses palatines, se forme une suture du palais dur, raphé palati. Chez les nouveau-nés, les processus palatins de la mâchoire supérieure sont reliés entre eux par une couche de tissu conjonctif. Ensuite, chez les enfants, il se produit la formation de saillies osseuses du côté des processus palatins, se développant les unes vers les autres. Avec l'âge, la couche de tissu conjonctif diminue et la couche osseuse augmente. Vers l'âge de 35-45 ans, la fusion osseuse de la suture palatine se termine et la jonction des processus acquiert un certain relief : concave, lisse ou convexe. Avec une forme convexe de la suture palatine au milieu du ciel, une saillie de différentes tailles est perceptible - le rouleau palatin, torus palatinus. Parfois, ce rouleau peut être situé à droite ou à gauche de la ligne médiane. La présence d'une crête palatine prononcée complique grandement la prothèse de la mâchoire supérieure. Les processus palatins de la mâchoire supérieure, à leur tour, fusionnent avec les plaques horizontales des os palatins, formant une suture osseuse transversale. Cependant, cette couture n’est généralement pas visible à la surface du palais dur. Le bord postérieur du palais dur a la forme d'arcs, reliés par des extrémités médiales et formant une saillie - l'épine nasale postérieure, spina nasalis postérieure.

Riz. 82. Différences dans la forme du ciel (d'après E. K. Semenov). a - haute voûte du ciel ; b - voûte plate du ciel ; c - ciel étroit et long ; d - palais large et court
La membrane muqueuse du palais dur est recouverte d'un épithélium pavimenteux kératinisé stratifié et est étroitement reliée au périoste presque partout. Dans la région de la suture palatine et dans les zones du palais adjacentes aux dents, la couche sous-muqueuse est absente et la membrane muqueuse est directement fusionnée avec le périoste. Dans les zones situées en dehors de la suture palatine, il existe une couche sous-muqueuse pénétrée par des faisceaux de tissu conjonctif fibreux qui relient la membrane muqueuse au périoste. De ce fait, la muqueuse du palais est immobile et fixée aux os sous-jacents. Dans les sections antérieures du palais dur, dans la couche sous-muqueuse entre les trabécules du tissu conjonctif, se trouve du tissu adipeux et dans les sections postérieures du palais, il y a des accumulations de glandes muqueuses. À l'extérieur, au point de transition de la membrane muqueuse du palais dur aux processus alvéolaires, la couche sous-muqueuse est particulièrement bien exprimée et de gros faisceaux neurovasculaires du palais se trouvent ici (voir Fig. 81).
La membrane muqueuse du palais dur et mou diffère par la couleur. Au palais dur, il est rose pâle, tandis qu'au palais mou, il est rouge rosé. La membrane muqueuse du palais dur forme une série d'élévations. A l'extrémité antérieure de la suture palatine longitudinale, à proximité des incisives centrales, est bien visible la papille incisive, papilla incisiva, qui correspond au foramen incisif situé dans le palais osseux, foramen incisiuum. Dans cette ouverture s'ouvrent les canaux incisifs, sapa-les incisivi, dans lesquels passent les nerfs naso-palatins. Cette zone est le site d'administration de solutions anesthésiques en vue de l'anesthésie locale du palais antérieur.
Dans le tiers antérieur du palais dur, sur les côtés de la suture palatine, se trouvent les plis transversaux de la membrane muqueuse, plicae palatinae transversae (de 2 à 6). Les plis sont généralement courbés et peuvent être interrompus et divisés. Chez les enfants, les plis transversaux sont bien exprimés, chez les adultes ils sont lissés et chez les personnes âgées ils peuvent disparaître. Le nombre de plis, leur longueur, leur hauteur et leur tortuosité sont différents. Le plus souvent, il y a 3 à 4 plis. Ces plis sont des rudiments des plis palatins, qui chez les animaux carnivores contribuent au traitement mécanique des aliments. À 1-1,5 cm médialement du bord gingival de la 3ème molaire, de chaque côté, il y a une projection de la grande ouverture palatine, et directement en arrière de celle-ci - la petite ouverture palatine du grand canal palatin, canalis palatinus major, à travers laquelle les vaisseaux sanguins et les nerfs palatins. Dans certains cas, la projection de la grande ouverture palatine peut se situer dans la 1ère ou la 2ème molaire, ce qui est important à prendre en compte lors de l'anesthésie et des interventions chirurgicales.
Au bord postérieur du palais dur, sur les côtés de la ligne médiane, se trouvent les fosses palatines, les fovéoles palatines. Parfois, le trou n’est que d’un côté. Ces fosses, constituant une bordure avec le palais mou, sont utilisées par les dentistes pour déterminer les limites d'une prothèse amovible.
L'apport sanguin au palais dur est assuré principalement par les grandes et petites artères palatines, qui sont des branches de l'artère palatine descendante. La grande artère palatine pénètre dans le palais par la grande ouverture palatine et s'étend vers l'avant, donnant des branches aux tissus du palais et des gencives. La partie antérieure du palais dur est alimentée en sang par l'artère incisive (une branche de l'artère postérieure de la cloison nasale). Le sang du palais dur circule dans les veines du même nom : le grand palatin - dans le plexus veineux ptérygoïdien, la veine incisive - dans les veines de la cavité nasale.
L'écoulement de la lymphe des tissus du palais dur s'effectue à travers les vaisseaux lymphatiques efférents passant sous la membrane muqueuse des arcs palatins dans les ganglions lymphatiques de la paroi latérale du pharynx et dans les ganglions cervicaux supérieurs profonds.
L'innervation du palais dur est due aux gros nerfs palatins et ioso-palatins (de la deuxième branche du nerf trijumeau).
Ciel doux. Le palais mou, palatum molle, forme principalement la paroi postérieure de la cavité buccale. Seule une petite zone du palais mou antérieur appartient à la paroi supérieure. La grande partie postérieure du palais mou pend librement vers le bas et vers l'arrière, appelée rideau palatin, velum palatinum. Cependant, la position et la forme du palais mou changent en fonction de son état fonctionnel. Ainsi, dans un état détendu, par exemple avec une respiration calme, le palais mou pend verticalement vers le bas. Dans ce cas, il existe une séparation presque complète de la cavité buccale de la partie buccale du pharynx et de la cavité nasale. Au moment de l'acte de déglutition, le palais mou, montant, se redresse horizontalement, tout en isolant la cavité buccale et la partie buccale du pharynx de la cavité nasale. Chez les personnes ayant un crâne brachycéphale, le palais mou est aplati et se situe presque horizontalement. Chez les individus ayant une forme de crâne dolichocéphale, le palais mou descend plus verticalement. Le palais mou des nouveau-nés est formé de deux moitiés qui grandissent ensemble après la naissance. La langue peut être fendue. Chez les nouveau-nés et les nourrissons, le palais mou se trouve horizontalement en raison de la faible hauteur de la cavité buccale.
Les tailles du palais mou sont différentes individuellement et varient en longueur de 30 à 75 mm, avec une moyenne de 35 à 50 mm, et en largeur de 25 à 60 mm. Chez les nouveau-nés, le palais mou atteint une longueur de 25 à 40 mm et une largeur de 30 à 50 mm. La longueur de la langue à cet âge est en moyenne de 7 mm.
Le palais mou est constitué d'une plaque fibreuse - l'aponévrose palatine à laquelle sont attachés les muscles du palais mou et la membrane muqueuse qui le recouvre d'en haut et d'en bas. La plaque fibreuse située en avant est attachée au palais dur. La membrane muqueuse tapissant le palais mou du côté de la cavité buccale est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé et du côté de la cavité nasale - un épithélium cilié à plusieurs rangées. Les deux surfaces de la langue chez les adultes sont recouvertes d'un épithélium pavimenteux stratifié, mais chez les nouveau-nés, l'épithélium cilié est toujours conservé sur sa surface arrière, qui est ensuite remplacée par une surface plate. À la frontière de ses propres couches et de la sous-muqueuse du palais mou se trouve une couche très développée de fibres élastiques. De nombreuses glandes muqueuses se trouvent dans la couche sous-muqueuse. À certains endroits, les corps des glandes muqueuses se trouvent entre les faisceaux de muscles du palais mou. Les canaux excréteurs des glandes s'ouvrent sur la surface buccale du palais.
Le bord postérieur du palais mou au milieu présente une saillie pendante, appelée langue, luette. Latéralement à la luette, le bord postérieur du palais mou forme de chaque côté une paire d'arcs palatins, qui sont des plis de la membrane muqueuse dans lesquels sont intégrés des muscles. L'arc palatin-lingual antérieur, arcus palatoglossus, s'étend de la partie médiane du palais jusqu'à la surface latérale de la partie postérieure de la langue. L'arc palatopharyngé postérieur, arcus Potatopharyngeus, va jusqu'à la paroi latérale du pharynx. Entre les arcs palatoglosse et palatopharyngé, une dépression triangulaire se forme - la fosse des amygdales, la fosse amygdalienne. La partie inférieure de la fosse des amygdales est plus profonde et s'appelle le sinus des amygdales, sinus amygdalien. Il contient l'amygdale palatine (voir section La cavité buccale proprement dite, cette édition). Au-dessus de l'amygdale, il y a une petite dépression - au-dessus de la fosse amygdale, la fosse supratonsillaris.
Le palais mou contient les muscles suivants (Fig. 83).
1.Muscle qui tend le palais mou, m. tensor veli palatini, provient de la base externe du crâne en trois faisceaux : antérieur - de la fosse scaphoïde du processus ptérygoïdien et de sa plaque interne, médian - de la surface externe des parties cartilagineuses et membraneuses du tube auditif et du surface inférieure de la grande aile de l'os sphénoïde médialement à partir des trous épineux et ovales, en arrière - à partir de l'épine angulaire de la grande aile. Les fibres musculaires sous la forme d'une plaque musculaire plate de forme triangulaire descendent vers le bas et vers l'avant jusqu'au crochet de l'apophyse ptérygoïdienne et, n'atteignant pas 2 à 10 mm avant celui-ci, passent dans un tendon de 2 à 6 mm de large qui, se jetant sur le crochet, se divise en deux parties - l'extérieur et l'intérieur. La partie externe du tendon, plus petite, passe dans le fascia bucco-pharyngé, se fixant partiellement à la surface postérieure du processus alvéolaire. La partie interne du tendon, plus épaisse, en forme d'éventail, se dilate et passe dans l'aponévrose palatine. Avec la contraction des muscles droit et gauche, un étirement (tension) du palais mou se produit. Entre la surface du crochet de l'apophyse ptérygoïdienne et le tendon du muscle se trouve un petit sac synovial, bourse synoviale m. tensoris voile palatini.
Le muscle qui tend le palais mou, dans la zone allant de la base du crâne au crochet de l'apophyse ptérygoïdienne, se situe entre la plaque interne de l'apophyse ptérygoïdienne et la surface médiale du muscle ptérygoïdien interne. Dans ce cas, les deux muscles sont généralement (dans 74 % des cas) bien ajustés l'un contre l'autre. Moins souvent (chez 26 %), il y a une couche de fibres entre eux.

Riz. 83. Muscles du palais mou. 1 - muscle sollicitant le rideau palatin ; 2 - muscle qui soulève le rideau palatin ; 3 - crochet ptérygoïdien ; 4 - muscle palatoglosse ; 5 - muscle du roseau ; 6 - muscle palato-pharyngé
Fonction : étire le palais mou et l'aponévrose palatine et élargit en même temps la lumière du tube auditif.
2.Le muscle qui soulève le palais mou, m. levator veli palatini, commence en deux faisceaux à partir de la face inférieure de la partie pétreuse de l'os temporal antérieure au canal de l'artère carotide interne et à partir du tiers postérieur de la partie cartilagineuse du tube auditif. Le début d’un muscle peut être à la fois musculaire et tendineux. Les deux faisceaux musculaires initiaux forment un ventre musculaire de forme cylindrique ou légèrement aplatie, situé médialement en m. tenseur veli palatini. L'abdomen musculaire est généralement entouré de fibres et, par conséquent, les processus purulents qui commencent près de la pyramide de l'os temporal peuvent descendre à travers la fibre jusqu'au fond du ciel. Parfois, un muscle peut avoir deux parties séparées par des fibres. La longueur du muscle qui soulève le palais mou est liée à sa taille. Chez les personnes ayant un palais mou court, ce muscle est long et avec un palais mou long, il est plus court. Le muscle qui soulève le palais mou y pénètre dans le sens transversal entre les couches du muscle palatopharyngé et est divisé en trois faisceaux : antérieur, moyen et postérieur. Le faisceau antérieur s'entrelace avec les fibres du muscle palatopharyngé et passe dans l'aponévrose palatine. Le faisceau médian, le plus développé, se connecte aux fibres du même muscle de l'autre côté et forme le bord postérieur du palais mou. Le faisceau postérieur, ainsi que les fibres du muscle palatopharyngé, vont à la luette.
Fonction : soulève le palais mou et participe, avec les autres muscles du palais, à séparer la cavité nasale de la partie buccale du pharynx, et rétrécit également l'ouverture pharyngée du tube auditif.
3.Muscle palato-pharyngé, m. le palatopharyngé, partant de la couche sous-muqueuse de la paroi pharyngée postérieure et de la surface interne et du bord postérieur du cartilage thyroïde, remonte dans l'épaisseur du sillon palatopharyngé. La longueur du muscle palato-pharyngé dépend de la forme du crâne. Chez les brachycéphales, il est plus long (35-40 mm) que chez les dolichocéphales (20-35 mm). Le muscle a une forme triangulaire, se dilatant à mesure qu’il s’approche du palais mou. La largeur de sa partie initiale est de 2 à 14 mm et près du ciel de 10 à 22 mm. Plus le palais mou est large, plus le muscle palatopharyngé est large. Au bord postérieur du muscle élévateur du palais, le muscle palatopharyngé est divisé en deux couches : antérieure et postérieure. Les fibres de la couche musculaire antérieure sont situées en avant (ou en dessous avec un palais surélevé) de m. levator veli palatini, et l'arrière - derrière (ou au-dessus) de ce muscle. La couche avant forme 2 faisceaux : externe et interne. Le premier est faiblement exprimé et passe dans le fascia bucco-pharyngé, le second, le principal, longe la surface buccale du palais mou et se connecte aux fibres du muscle du même nom de l'autre côté, ainsi qu' avec les fibres m. élévateur veli palatini. Une partie des fibres de ce faisceau passe dans l'aponévrose palatine. La couche postérieure du muscle palatopharyngé est divisée en fonction de la largeur du palais mou en 3 à 5 faisceaux : avec un palais étroit, il y a 3 à 4 faisceaux, avec un palais large - 5 faisceaux de fibres musculaires. Les faisceaux de la couche postérieure du muscle vont à la fois vers le palais mou et vers les organes voisins. Ainsi, le premier faisceau musculaire est attaché à la surface inférieure-postérieure du tube auditif cartilagineux, le second - à la surface postérieure du crochet de l'apophyse ptérygoïdienne, le troisième - passe à l'arrière de m. levator veli palatini, le quatrième (rare) - va à l'épine nasale postérieure, le cinquième - va au muscle de la luette.
Fonction : diversifiée en raison de la complexité de la structure musculaire. Il soulève le pharynx, la langue, le larynx, rétrécit l'espace palatopharyngé, rapproche les arcs palatins, tire le palais mou vers le bas et vers l'arrière jusqu'à ce qu'il touche la paroi arrière du pharynx et élargit la lumière du tube auditif.
4.Muscle palatolinguistique, m. palatoglosse, naît du muscle transverse de la langue et remonte dans l'épaisseur de l'arc palatoglosse antérieur. Dans la partie supérieure de la voûte plantaire, le muscle s'épaissit et se dilate jusqu'à 9 mm et, au niveau de la face postéro-inférieure du palais mou, se divise en deux faisceaux : le faisceau antérieur, qui pénètre dans le ciel au bord antérieur du palais mou. . levator veli palatini, et postérieur, entrant dans le ciel au bord postérieur de ce muscle. La longueur du muscle varie de 23 à 33 mm ; le plus souvent, il atteint 27-29 mm.
Fonction : rétrécit le pharynx et abaisse le palais mou.
5.Muscle lingulaire, m. les luettes, non appariées, partent de l'épine nasale postérieure et en partie de la membrane muqueuse du fond de la cavité nasale, se trouvent d'abord en dessous et vont en arrière et en bas, atteignant le bord postérieur du palais mou et pénètrent dans la luette. La forme du muscle est ovale, la longueur en fonction de la longueur du palais mou est de 23 à 37 mm, la largeur est de 1,5 à 4,5 mm.
Fonction : soulève et raccourcit la langue.
Zev. Zev, isthmus faucium, est une ouverture qui relie la cavité buccale à la cavité pharyngée. Il est délimité d'en haut par le bord postérieur du palais mou et de la luette, sur les côtés par les plis palatins, et d'en bas par la face supérieure de la racine de la langue. La taille et la forme du pharynx dépendent du degré de contraction des muscles du palais mou et de la langue. En cas d'augmentation significative de la taille des amygdales palatines (ce qui arrive chez les personnes souffrant d'amygdalites fréquentes), les parois latérales du pharynx sont formées par les surfaces internes des amygdales, tandis que le pharynx se rétrécit. Dans la région du pharynx, il existe un anneau lymphoïde constitué des amygdales pharyngées, linguales et tubaires (voir la section Gorge de cette publication).
L'apport sanguin au palais mou est assuré par les petites et grandes artères palatines et les fines branches des artères de la cavité nasale. L'écoulement veineux passe par les veines du même nom jusqu'au plexus veineux ptérygoïdien et aux veines du pharynx.
Les vaisseaux lymphatiques du palais mou transportent la lymphe vers les ganglions lymphatiques péripharyngés, pharyngés et cervicaux profonds supérieurs.
L'innervation du palais mou se produit avec de petits nerfs palatins dus au plexus pharyngé, a m. tensor veli palatini - du nerf mandibulaire.

Riz. 84. Différences dans la structure des muscles du plancher buccal (selon V. G. Smirnov). a, b - les muscles du plancher de la cavité buccale chez les dolichocéphales sont étroits et longs, vus de haut en bas ; c, d - les muscles du plancher buccal chez les brachycéphales sont larges et courts, vus de haut en bas. 1 - muscle maxillo-facial (vue de dessus) ; 2 - muscle menton-hyoïde; 3 - suture tendineuse du muscle maxillo-facial ; 4 - muscle maxillo-facial (vue de dessous) ; 5 - ventre antérieur du muscle digastrique ; 6 - os hyoïde
Plancher de la bouche . Le fond de la cavité buccale, ou sa paroi inférieure, est formé d'une combinaison de tissus mous situés entre la langue et l'os hyoïde. La base du fond de la cavité buccale est le diaphragme de la bouche, diaphragma oris, qui consiste en une paire de muscles maxillo-hyoïdiens. Au-dessus se trouvent sur les côtés de la ligne médiane le muscle génio-hyoïdien, ainsi que les muscles de la langue, en commençant par l'os hyoïde (voir la section Muscles de l'os hyoïde, cette édition). Ensemble, ils forment la base musculaire du plancher buccal (Fig. 84).
1.Muscle maxillo-facial, m. mylohyoideus, hammam, plat, trapézoïdal, commence sur la face interne de la mâchoire inférieure le long de la linea mylohyoidea. En règle générale, la ligne maxillo-hyoïdienne longe la mâchoire à droite et à gauche de manière asymétrique, de sorte que le niveau du début des muscles droit et gauche peut ne pas être le même. De plus, la position de ce muscle par rapport au bord supérieur du processus alvéolaire est différente selon les zones. Ainsi, au niveau de la canine et de la 1ère prémolaire, le début du muscle maxillo-hyoïdien est situé à une distance de 18-29 mm du bord supérieur du processus alvéolaire et de 6-18 mm du plan de la base de la mâchoire, et au niveau des 2e-3e molaires - à 7-18 mm du bord du processus et à 16-22 mm de la base de la mâchoire. Par rapport au sommet des molaires, le début du muscle se situe en dessous des 5 premières dents et au-dessus des 6-8ème dents. Les fibres musculaires sont dirigées de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur et d'avant en arrière jusqu'à la ligne médiane, où elles forment une suture tendineuse, raphé tendinei, allant de la surface interne du menton au corps de l'os hyoïde. Les fibres de l'arrière du muscle, commençant entre les 1ère et 3ème molaires, sont attachées au corps de l'os hyoïde.
La longueur du muscle le long de la ligne de suture varie de 38 à 57 mm et la largeur de 30 à 50 mm. Avec un arc de mâchoire étroit et long, la longueur du muscle est grande et la largeur est plus petite, avec un arc large et court, vice versa. L'épaisseur du muscle augmente vers l'arrière et atteint 4 à 6 mm chez l'adulte.
De petits espaces peuvent apparaître entre les faisceaux musculaires, à travers lesquels des accumulations purulentes peuvent se propager depuis la cavité buccale, ainsi que des kystes de rétention des glandes salivaires sublinguales. Le plus souvent, ces espaces sont situés au centre du muscle au niveau de la 2e molaire, en retrait de 20 à 30 mm médialement de la mâchoire, et dans les zones antérieures du muscle au niveau des canines près de la mâchoire. De plus, il existe un écart entre le bord postérieur des muscles maxillo-facial et hyoïde-lingual.
2.Muscle génio-hyoïdien, m. geniohyoideus, hammam, a la forme d'un triangle dont le sommet est dirigé vers la mâchoire inférieure et la base - vers l'os hyoïde. Les fibres musculaires commencent par un court tendon rond provenant de la colonne vertébrale interne et descendent et reculent pour s'attacher au corps de l'os hyoïde. La longueur du muscle est de 35 à 60 mm, la largeur au point d'attache est de 10 à 25 mm. L'épaisseur du muscle est de 3 à 10 mm, le plus souvent de 5 à 7 mm. Avec une mâchoire étroite et longue, le muscle est long et étroit, avec une mâchoire large et courte, il est court et large.
Fonction : les deux muscles soulèvent l'os hyoïde et, avec un os hyoïde fixe, abaissent la mâchoire.
La membrane muqueuse qui tapisse le fond de la bouche passe ici de la langue. Ainsi, le fond de la cavité buccale est recouvert d'une membrane muqueuse en avant, en partie sur les côtés de la langue, entre celle-ci et les gencives de la mâchoire inférieure. Aux endroits de transition de la membrane muqueuse, un certain nombre de plis se forment.
1.Frein de la langue, frenulum linguae, est un pli vertical de la membrane muqueuse qui s'étend de la surface inférieure de la langue jusqu'au fond de la bouche. En avant, ce pli atteint la surface buccale de la gencive.
2.Plis hyoïdes, plicae sublinguales, se trouvent sur les côtés du frein de la langue le long des élévations (rouleaux) formées par les glandes salivaires sublinguales. Les petits conduits de ces glandes s'ouvrent ici. Aux extrémités médiales des crêtes se forment des tubercules - papilles salivaires sublinguales, caroncules sublinguales, sur lesquelles s'ouvrent les canaux des unimandibulaires et les grands canaux des glandes salivaires sublinguales. En avant des papilles salivaires, près de la mâchoire inférieure, se trouvent les conduits des petites glandes salivaires incisives, glandulae incisivae, qui se trouvent derrière les incisives sous la membrane muqueuse.
Une caractéristique de la structure de la membrane muqueuse du fond de la cavité buccale est la présence d'une couche sous-muqueuse bien développée, constituée de tissus conjonctifs et adipeux lâches. La membrane muqueuse se rassemble facilement en plis, car elle est faiblement connectée aux tissus sous-jacents. Sous la membrane muqueuse du fond de la cavité buccale, les muscles et les organes sous-jacents se trouvent un certain nombre d'espaces cellulaires.
1. Les espaces cellulaires latéraux du plancher de la cavité buccale sont limités d'en haut par la muqueuse, passant ici de la langue à la gencive, d'en bas par le muscle maxillo-hyoïdien, de l'intérieur par la langue et de l'extérieur par le muscle maxillo-hyoïdien. mâchoire inférieure. Dans ces espaces se trouvent les glandes salivaires sublinguales entourées de fibres. Les processus suppuratifs sont souvent localisés ici.
2. L'espace intermusculaire interne est impair, situé entre les deux muscles menton-linguaux. Fait de tissu conjonctif lâche.
3. Les espaces intermusculaires externes sont appariés, formés entre les muscles menton-lingual et hyoïde-lingual.
4. L'espace intermusculaire inférieur n'est pas apparié et se situe entre le muscle mâchoire-hyoïde et le ventre antérieur mm. digastriques.
5. Les espaces cellulaires sous-maxillaires sont appariés, formés de l'extérieur par la surface interne de la mâchoire inférieure sous la ligne mylohyoïde, et de l'intérieur par la division du propre fascia ou du 2e fascia du cou. Une plaque de lignes de fascia m. mylohyoideus, et le second va superficiellement jusqu'à la glande salivaire sous-maxillaire et est attaché au bord de la mâchoire inférieure. Cet espace cellulaire contient la glande salivaire sous-maxillaire, les ganglions lymphatiques, les vaisseaux et les nerfs. Les processus suppuratifs qui se forment dans cet espace sont plus ou moins isolés. Cependant, avec l'accumulation de pus, il peut se propager le long du canal de la glande dans l'espace cellulaire latéral correspondant du plancher buccal.
L'apport sanguin au plancher buccal est assuré par les artères linguales, faciales et thyroïdiennes supérieures. L'écoulement du sang se produit dans les veines correspondantes.
Les vaisseaux lymphatiques des tissus du plancher buccal suivent jusqu'aux ganglions cervicaux profonds et au menton.
Innervation - due aux nerfs lingual, hyoïde, maxillo-hyoïdien (branche n. alveolaris inférieure), ainsi qu'aux branches du nerf facial (abdomen postérieur m. digastricus, m. styloglossus).
Cavité buccale(cavum oris) est la section initiale et étendue du tube digestif (Fig. 53). Il fait la distinction entre le vestibule et la cavité buccale proprement dite.
vestibule de la bouche Il s'agit d'un espace en forme de fente délimité de l'extérieur par les lèvres et les joues, de l'intérieur par les dents et les processus alvéolaires des mâchoires. Dans l'épaisseur lèvres Et joues des muscles mimiques sont posés; à l'extérieur, ils sont recouverts de peau et du côté du vestibule de la cavité buccale - d'une membrane muqueuse. La membrane muqueuse des lèvres et des joues passe aux processus alvéolaires des mâchoires, tandis que sur la ligne médiane, elle forme des plis - les freins des lèvres supérieures et inférieures. Sur les processus alvéolaires des mâchoires, la membrane muqueuse est étroitement fusionnée avec le périoste et est appelée gencive (gencive).
La cavité buccale proprement dite limité d'en haut solide Et palais mou, bas - diaphragme de la bouche, avant et côté dents Et processus alvéolaires, et derrière à travers pharynx communique avec le pharynx.
Ciel solide sépare la cavité buccale de la cavité nasale ; il est formé par les apophyses palatines des os maxillaires et les plaques horizontales des os palatins et est recouvert d'une membrane muqueuse.
Ciel doux est situé en arrière du palais dur et est une plaque musculaire recouverte d'une membrane muqueuse. La partie postérieure du palais mou, rétrécie et située le long de la ligne médiane, est appelée luette. Dans le palais mou, on distingue un muscle qui tend le palais mou, un muscle qui soulève le palais mou et un muscle de la langue ; ils sont composés de tissu musculaire strié.
diaphragme buccal, ou le fond de la cavité buccale, est formé par les muscles maxillo-hyoïdiens. Au fond de la cavité buccale, sous la langue, la membrane muqueuse forme un pli - le frein de la langue.
Sur les côtés se trouvent deux élévations : les papilles salivaires, sur lesquelles s'ouvrent les conduits des glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales.
Zev- une ouverture qui fait communiquer la cavité buccale avec le pharynx. Il est délimité en haut par le palais mou, en bas par la racine de la langue et sur les côtés par les arcs palatins. De chaque côté se trouvent deux arcs : palatoglosse et palatopharyngé. Ils représentent les plis de la membrane muqueuse, dans l'épaisseur desquels se trouvent les muscles du même nom avec les arcs. Ces muscles abaissent le palais mou.
Entre les arcs se trouve un évidement - le sinus, dans lequel le amygdale palatine. Au total, une personne possède six amygdales : deux palatines, une linguale, une pharyngée et deux tubaires. L'amygdale linguale est située dans la membrane muqueuse de la racine de la langue, et les amygdales pharyngées et tubaires sont situées dans la membrane muqueuse du pharynx (voir ci-dessous). Chaque amygdale est constituée de tissu lymphoïde qui forme des nodules (follicules) de différentes tailles. En eux, la multiplication des cellules - les lymphocytes. Les amygdales jouent un rôle barrière (protection contre les microbes nocifs pour l'organisme).
Toutes les amygdales constituent ce qu’on appelle l’anneau lympho-épithélial. Le pharynx lors d'un examen médical est examiné chez chaque patient, en particulier chez les enfants, car dans la région du pharynx dans de nombreuses maladies (amygdalite, scarlatine, etc.), il y a des changements.
Langue
Langue(en latin - lingua, en grec - glossa) est un organe musculaire recouvert d'une membrane muqueuse (Fig. 54). La langue est divisée en pointe, corps et racine. La racine de la langue est attachée à l'os hyoïde, le corps et la pointe sont libres. La surface supérieure de la langue est appelée le dos.

Les muscles de la langue sont divisés en muscles propres et en muscles à partir des os. Les muscles propres de la langue sont constitués de fibres musculaires situées dans trois directions : longitudinale, transversale et verticale ; lorsque ces muscles se contractent, la forme de la langue change. Trois paires de muscles de la langue partent des os : le géniolingual, le hyoïde-lingual et le poinçon-lingual. Tous se terminent dans l’épaisseur de la langue. Grâce à l’action de ces muscles, la langue peut avancer et reculer, monter et descendre.
La membrane muqueuse à l'arrière de la langue forme de nombreuses excroissances - des papilles. Il en existe quatre types : filamenteux, en forme de champignon, entourés d'un rouleau et en forme de feuille. Les papilles filiformes ont une sensibilité tactile (percevoir le toucher). Tous les autres bourgeons sont des papilles gustatives. Les papilles donnent à la langue un aspect velouté. Dans de nombreuses maladies (par exemple gastro-intestinales), l'apparence de la membrane muqueuse de la langue change, ce qui est pris en compte lors du diagnostic.
Dans la membrane muqueuse de la racine de la langue, il y a une accumulation de tissu lymphoïde - l'amygdale linguale.
Caractéristiques linguistiques. La langue est l’organe du goût et possède également une sensibilité à la température, à la douleur et au toucher. À l'aide de la langue, les aliments sont mélangés lors de la mastication et poussés lors de la déglutition. Chez l’humain, le langage participe également à l’acte de parole articulée.
Dents
Dents(dentes) sont situées dans la cavité buccale et sont fixées dans les cellules (trous) des processus alvéolaires des mâchoires. Trois parties se distinguent dans chaque dent : la couronne, le collet et la racine (Fig. 55). La couronne de la dent fait saillie dans la cavité buccale, la racine est dans le trou. Le cou est la partie rétrécie de la dent située à la frontière entre la couronne et la racine ; il est recouvert de gommes. À l’intérieur de la dent se trouve une cavité passant dans le canal radiculaire. La cavité de la dent est remplie de ce qu'on appelle pulpe dentaire (pulpe); il est formé de tissu conjonctif lâche contenant des nerfs et des vaisseaux sanguins.

La dent est constituée de trois substances : la dentine, l’émail et le cément. Dentine appelée substance fondamentale, puisque la majeure partie de la dent est construite à partir de celle-ci. Dans sa structure, la dentine ressemble quelque peu à l’os, mais elle est plus résistante. Émail recouvre la couronne de la dent c'est le tissu le plus dur du corps humain, contenant 98,5 % de sels inorganiques. Ciment couvre la racine et le col de la dent ; dans sa structure, il se rapproche encore plus de l'os que la dentine.
Entre la racine de la dent et la paroi cellulaire du processus alvéolaire se trouve une petite couche de tissu conjonctif appelée parodontale(périmentum). Les fibres de collagène parodontales forment un ligament qui renforce la dent.
Selon la forme, on distingue les incisives, les canines, les petites et les grandes molaires. Les incisives ont une couronne en forme de ciseau, tandis que les canines ont une couronne conique ; les petites molaires ont 2 tubercules masticateurs sur la couronne, les grandes molaires ont 4 à 5 tubercules. Les incisives et les crocs sont conçus pour mordre les aliments, les molaires pour les broyer. Les dents ont un nombre différent de racines : incisives et canines - une chacune, petites molaires - une, parfois deux, grandes molaires : inférieures - deux, supérieures - trois racines. Chez l'homme, les dents éclatent deux fois, selon la distinction entre les dents de lait et les dents permanentes.
Dents de lait 20. Chaque moitié de la dentition supérieure et inférieure comporte 5 dents : 2 incisives, une canine et 2 molaires. Les dents de lait éclatent entre 6 mois et 2 ans et demi dans l'ordre suivant : incisives moyennes, incisives latérales, premières molaires, canines et deuxièmes molaires. La rapidité de la poussée dentaire est l'un des signes du développement normal de l'enfant. Dans certaines maladies, comme le rachitisme, la poussée dentaire est retardée.
Il y a 32 dents permanentes. Le nombre de dents est généralement indiqué par la formule dentaire. Pour les dents permanentes, cela ressemble à ceci :
Cela signifie que sur chaque moitié de la dentition supérieure et inférieure se trouvent 2 incisives, 1 canine, 2 petites molaires et 3 grandes molaires. La troisième grande molaire s’appelle la dent de sagesse.
Les dents permanentes éclatent entre 6, 7 et 14 ans. L'exception concerne les dents de sagesse, qui éclatent entre 17 et 30 ans et sont parfois complètement absentes. Les premières dents permanentes font éruption, les premières grosses molaires (entre la 6e et la 7e année de vie). L'ordre d'éruption des dents permanentes est le suivant : premières grandes molaires, incisives moyennes, incisives latérales, premières petites molaires, canines, deuxièmes petites molaires, deuxièmes grandes molaires, puis dents de sagesse.
Glandes salivaires
Dans la muqueuse buccale, il existe de nombreuses petites glandes (labiales, buccales, palatines, linguales) ; ils sécrètent un secret contenant du mucus à la surface de la muqueuse. De plus, il existe trois paires de grosses glandes salivaires - les glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales, dont les conduits s'ouvrent également dans la cavité buccale.
glande parotide(glandula parotis) est située en dessous et en avant du conduit auditif externe. Le canal de cette glande longe la surface externe du muscle masticateur, puis perce le muscle buccal et débouche dans le vestibule de la bouche sur la muqueuse buccale.
glande sous-maxillaire situé sous le diaphragme de la bouche dans la fosse sous-maxillaire. Le canal de cette glande se situe sur la surface supérieure du diaphragme de la bouche et s'ouvre dans la cavité buccale elle-même, sous la langue, sur la papille salivaire.
glande sublinguale situé sous la langue sur le diaphragme de la bouche, il est recouvert d'une membrane muqueuse qui forme un pli sur la glande (pli sublingual). La glande possède un grand conduit et plusieurs petits. Le grand canal excréteur s'ouvre avec le canal de la glande sous-maxillaire sur la papille salivaire, les petits canaux s'ouvrent sur le pli sublingual.
La sécrétion des glandes salivaires s'appelle la salive.