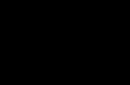Mémoire immunitaire- la capacité du système immunitaire à répondre à la pénétration secondaire de l'Ag avec le développement rapide de réactions spécifiques comme une réponse immunitaire secondaire. Cet effet est réalisé par les lymphocytes T et B stimulés, qui ne remplissent pas de fonctions effectrices. Le phénomène de la mémoire immunitaire se manifeste par des réactions humorales et cellulaires. Les cellules mémoire circulent au repos et, lors d’un contact répété avec l’Ag, elles forment un vaste pool de cellules « présentant l’Ag » (à ne pas confondre avec les cellules du système macrophage-monocytes impliquées dans la réponse primaire). La mémoire immunitaire peut persister longtemps, soutenue principalement par T- cellules de mémoire.
Effet booster
Effet booster- le phénomène de développement intensif de la réponse immunitaire à un coup secondaire d'Ag [de l'anglais. booster, renforcer]. Il est utilisé pour obtenir des sérums thérapeutiques et diagnostiques avec des titres AT élevés (sérums hyperimmuns) à partir d'animaux immunisés. Pour ce faire, les animaux sont immunisés avec Ag puis reçoivent une injection de rappel répétée. Parfois, une vaccination répétée est effectuée plusieurs fois. L'effet booster est également utilisé pour créer rapidement une immunité lors de vaccinations répétées (par exemple, pour prévenir la tuberculose).
Prévention vaccinale
Effet mémoire immunitaire constitue la base de la prévention vaccinale de nombreuses maladies infectieuses. A cet effet, la personne est vaccinée puis (après un certain intervalle) revaccinée. Par exemple, la prévention vaccinale de la diphtérie comprend des rappels répétés à intervalles de 5 à 7 ans.
1)
préservation à long terme de l'antigène dans le corps. Il existe de nombreux exemples : l'agent pathogène encapsulé de la tuberculose, les virus persistants de la rougeole, de la polio, de la varicelle et certains autres agents pathogènes restent longtemps, parfois tout au long de la vie, dans l'organisme, maintenant le système immunitaire sous tension. Il est également probable qu’il existe des APC dendritiques à longue durée de vie, capables de stocker et de présenter l’antigène pendant une longue période.
2) lors du développement d'une réponse immunitaire productive dans l'organisme, une partie des lymphocytes T ou B réactifs à l'antigène se différencie en petites cellules au repos, ou cellules de mémoire immunologiques. Ces cellules se caractérisent par une spécificité élevée pour un déterminant antigénique spécifique et une longue espérance de vie (jusqu'à 10 ans ou plus). Ils sont activement recyclés dans le corps, distribués dans les tissus et les organes, mais retournent constamment à leur lieu d'origine grâce aux récepteurs à tête chercheuse. Cela garantit la disponibilité constante du système immunitaire à répondre de manière secondaire à un contact répété avec l’antigène.
Le phénomène de mémoire immunologique est largement utilisé dans la pratique de la vaccination des personnes pour créer une immunité intense et la maintenir longtemps à un niveau protecteur. Ceci est accompli par 2 à 3 vaccinations lors de la primo-vaccination et des injections répétées périodiques de la préparation vaccinale - revaccinations.
Cependant, le phénomène de mémoire immunologique a aussi des côtés négatifs. Par exemple, une tentative répétée de greffe de tissu qui a déjà été rejeté une fois provoque une réaction rapide et violente : crise de rejet.
34. Tolérance immunologique, ses types. Paralysie immunologique .
L’état d’insensibilité à ses propres antigènes est appelé tolérance immunologique naturelle. La présence d'une tolérance naturelle de l'organisme à ses propres antigènes est une condition nécessaire au développement de la capacité de répondre aux antigènes étrangers. La tolérance immunologique naturelle aux auto-antigènes s'établit dans chaque organisme au cours de la période embryonnaire en raison du contact d'éléments du système immunitaire en développement avec les auto-antigènes. La perte de tolérance immunologique naturelle aux auto-antigènes crée les conditions préalables au développement de réactions auto-immunes, et les perspectives de création artificielle ou de restauration d'une tolérance immunologique permettent de trouver de nouvelles façons de traiter les maladies auto-immunes et la transplantation d'organes et de tissus incompatibles. La tolérance immunologique est considérée comme l’opposé de l’immunité active – « l’immunité avec un signe moins ».
36. Vaccins vivants, tués, chimiques, anatoxines, synthétiques et recombinants modernes. Principes de production, mécanismes d'immunité créée, adjuvants. La vaccination apporte une réponse immunitaire spécifique avec la formation d’un système immunitaire anti-infectieux actif grâce à la mobilisation de la mémoire immunitaire. syv et les immunoglobulines fournissent un humour passif immuno-immédiat car administrer des anticorps et des immunoglobulines prêts à l'emploi. Vacc-yaobesp-et prof-ku.Vacc 1ère génération - rage, tularémie, ulcère des sinus, peste, oreillons, rougeole, polio Tué- tuer les micro-organismes par la chaleur, les rayons UV ou les produits chimiques - contre la coqueluche, la leptospirose, les tiques. ence En tué, seuls quelques déterminants peuvent induire l'immunité. En tant qu'Ag, vous pouvez utiliser à la fois des corps entiers de m.o. et des composants individuels - polysaccharide pneumococcique b. et fractions immunologiquement actives – hépatite B. En cas d'immunité similaire à post-infectieuse, l'utilisation est dangereuse car chez les personnes immunodéprimées, en particulier chez les enfants, le virus peut persister sous la forme. Les affaiblis conservent complètement la composition Ag de l'agent pathogène et durent plus longtemps - BCG pour la tuberculose professionnelle, pour la fièvre typhoïde, ils sont utilisés mutants affaiblis avec une virulence réduite. Vaccins de 2ème génération - chimiques, ils sont moins réactogènes, comme le choléra (anatoxine cholérogène + LPS, extrait des virions cholériques). Anti-grippe - sous-unité, comprend l'hémagglutinine et la neuroménidase. Pour augmenter l'utilisation de l'immunogénicité adjuvants Anatoxines– traitement au formol, perte de toxicité et capacité à induire l'antitoxine At-pour spetsef professionnel tétanos, diphtérie, c'est-à-dire avec des exotoxines. Hépatite B génétiquement modifiée en cours de développement. Recombinant-grippe, hépatite B, tétanos - introduction de gènes de virus pathogènes dans le génome du virus vaccinal et dans le génome
37. Principes de l'immunoprophylaxie et de l'immunothérapie - vaccins, sérums, immunoglobulines La vaccination apporte une réponse immunitaire spécifique avec la formation d’un système immunitaire anti-infectieux actif grâce à la mobilisation de la mémoire immunitaire. syv et les immunoglobulines fournissent un humour passif immuno-immédiat car Des Abs et des immunoglobulines prêts à l'emploi sont administrés. Vaccin de 1ère génération - rage, tularémie, ulcère des sinus, peste, oreillons, rougeole, polio Tué- tuer les micro-organismes par chauffage, rayons UV ou produits chimiques - contre la coqueluche, les gonocoques, la leptospirose, les tiques. ence En tué, seuls quelques déterminants peuvent induire l'immunité. En tant qu'Ag, vous pouvez utiliser à la fois des corps entiers de m.o. et des composants individuels - polysaccharide pneumococcique b. et fractions immunologiquement actives – hépatite B. Les vivants - par exemple, les antirabiques créent En cas d'immunité similaire à post-infectieuse, l'utilisation est dangereuse car chez les personnes immunodéprimées, en particulier chez les enfants, le virus peut persister sous la forme. Les affaiblis conservent complètement la composition Ag de l'agent pathogène et durent plus longtemps - BCG pour la tuberculose professionnelle, pour la fièvre typhoïde, ils utilisent un mutant affaibli avec une virulence réduite, la poliomyélite. Vaccins de 2ème génération - chimiques, ils sont moins réactogènes, comme le choléra (anatoxine cholérogène + LPS, extrait des virions cholériques). Anti-grippe - sous-unité, comprend l'hémagglutinine et la neuroménidase. Pour augmenter l'utilisation de l'immunogénicité adjuvants hydroxyde d'aluminium, gâteaux aluminium-potassium, phosphate d'aluminium. Anatoxines des exotoxines-traitement au formol, perte de toxicité et capacité à induire l'antitoxine At-pour le tétanos professionnel spécifique, la diphtérie, c'est-à-dire avec des exotoxines. 1IE unité immunogène-quantité minimale d'anatoxine, qui, lors de l'ajout de sérum 1AE, donne la première floculation initiale, qui se produit avec une quantité minimale de composants dans les plus brefs délais. 1AE quantité minimale de solution d'antitoxine, qui inactive le nombre défini du DLM, le prochain immunologique neutronique se produit. Hépatite B génétiquement modifiée Les MO de cartographie du génome qui contrôlent les déterminants Ag nécessaires sont transférés dans le génome d’autres MO. et cloner, réalisant l'expression de ces gènes dans de nouvelles conditions. Anti-idioptique, liposomal en cours de développement. Recombinant-grippe, hépatite B, tétanos - introduction de gènes de virus pathogènes dans le génome du virus vaccinal et dans le génome de la salmonelle.
MÉMOIRE IMMUNOLOGIQUE - la capacité du corps à répondre par une réponse immunitaire accélérée et renforcée lors d'un contact répété avec un antigène précédemment introduit. La mémoire immunologique persiste pendant plusieurs mois et, lorsqu'elle est exposée à certains antigènes, pendant des années. Les cellules à mémoire immunologique sont des lymphocytes T et B stimulés par cet antigène, les lymphocytes T étant d'une grande importance. Les cellules mémoire immunologiques font partie des cellules filles qui entrent dans un état de repos après deux ou trois divisions stimulées par l'antigène des lymphocytes T et B.
Les lymphocytes forment deux populations - les lymphocytes T et B, qui diffèrent par l'ensemble des récepteurs situés à leur surface et remplissent des fonctions différentes.
Les lymphocytes T subissent une maturation dans le thymus et remplissent la fonction d'immunité cellulaire. Les lymphocytes T reconnaissent les cellules porteuses d'antigènes étrangers et les détruisent après un contact direct (attaque), et remplissent également la fonction de régulation de la réponse immunitaire.
Lymphocytes B – Chez les mammifères, la maturation des lymphocytes B se produit dans la moelle osseuse. Les lymphocytes B sont responsables de la composante humorale de l'immunité : la production d'anticorps. Après un stimulus antigénique, le lymphocyte B se transforme en lymphoblaste, cellule capable de se diviser. Certains lymphoblastes se différencient en lymphocytes B mémoire, l’autre partie se transforme en plasmocytes qui produisent des anticorps.
La tolérance immunologique est un phénomène opposé à la réponse immunitaire et à la mémoire immunologique. Elle se manifeste par l'absence de réponse immunitaire productive spécifique de l'organisme à un antigène en raison de l'incapacité de le reconnaître. Contrairement à l'immunosuppression, la tolérance immunologique présuppose l'insensibilité initiale des cellules immunocompétentes à un antigène spécifique. La découverte de la tolérance immunologique a été précédée par les travaux de R. Owen (1945), qui a examiné des veaux jumeaux fraternels. Le scientifique a découvert que ces animaux, au cours de la période embryonnaire, échangent des germes de sang à travers le placenta et qu'après la naissance, ils possèdent simultanément deux types de globules rouges - les leurs et les autres. La présence d'érythrocytes étrangers n'a pas provoqué de réaction immunitaire ni d'hémolyse intravasculaire. Le phénomène s’appelle la mosaïque érythrocytaire. Cependant, Owen n'a pas pu lui donner d'explication. Le phénomène réel de tolérance immunologique a été découvert en 1953 indépendamment par le scientifique tchèque M. Hasek et un groupe de chercheurs anglais dirigés par P. Medawar. Hasek, dans des expériences sur des embryons de poulet, et Medavar, sur des souris nouveau-nées, ont montré que l'organisme devient insensible à l'antigène lorsqu'il est introduit au cours de la période embryonnaire ou postnatale précoce.
La tolérance immunologique est causée par des antigènes, appelés tolérogènes. Il peut s'agir de presque toutes les substances, mais les polysaccharides sont les plus tolérogènes.
La tolérance immunologique peut être congénitale ou acquise. Un exemple de tolérance innée est l’incapacité du système immunitaire à répondre à ses propres antigènes. La tolérance acquise peut être créée en introduisant dans l'organisme des substances qui suppriment le système immunitaire (immunosuppresseurs), ou en introduisant un antigène pendant la période embryonnaire ou dans les premiers jours après la naissance de l'individu. La tolérance acquise peut être active ou passive. La tolérance active est créée en introduisant un tolérogène dans l’organisme, qui forme une tolérance spécifique. La tolérance passive peut être provoquée par des substances qui inhibent l'activité biosynthétique ou proliférative des cellules immunocompétentes (sérum antilymphocytaire, cytostatiques, etc.). La tolérance immunologique est spécifique : elle s'adresse à des antigènes strictement définis. Selon le degré de prévalence, on distingue la tolérance polyvalente et fractionnée. Une tolérance polyvalente se produit simultanément à tous les déterminants antigéniques qui composent un antigène particulier. La tolérance fractionnée ou monovalente est caractérisée par une immunité sélective contre certains déterminants antigéniques individuels. Le degré de manifestation de la tolérance immunologique dépend de manière significative d'un certain nombre de propriétés du macroorganisme et du tolérogène. Ainsi, la manifestation de la tolérance est influencée par l'âge et l'état d'immunoréactivité de l'organisme. La tolérance immunologique est plus facile à induire pendant la période de développement embryonnaire et dans les premiers jours après la naissance ; elle se manifeste mieux chez les animaux ayant une immunoréactivité réduite et possédant un certain génotype. Parmi les caractéristiques de l'antigène qui déterminent le succès de l'induction de la tolérance immunologique, il est nécessaire de noter le degré de son étranger à l'organisme et la nature, la dose du médicament et la durée d'exposition de l'antigène à l'organisme. Les antigènes les moins étrangers à l'organisme, ayant un faible poids moléculaire et une grande homogénéité, ont la plus grande tolérogénicité. La tolérance aux antigènes indépendants du thymus, par exemple les polysaccharides bactériens, se forme le plus facilement. La dose de l'antigène et la durée de son exposition sont importantes dans l'induction de la tolérance immunologique. Il existe une tolérance aux doses élevées et faibles. La tolérance aux doses élevées est provoquée par l’introduction de grandes quantités d’antigènes hautement concentrés. Dans ce cas, il existe une relation directe entre la dose de la substance et l’effet qu’elle produit. La tolérance aux faibles doses, au contraire, est provoquée par une très petite quantité d’antigène moléculaire hautement homogène. La relation dose-effet est dans ce cas une relation inverse.
Tous les lymphocytes B induits par un antigène ne subissent pas une différenciation complète. Certains d'entre eux, après plusieurs cycles de division, cessent de se multiplier et forment un sous-clone de cellules mémoire (environ 1 000 cellules mémoire sont formées à partir d'une cellule B, et les cellules mémoire sont formées de la même manière à partir de lymphocytes T). Les cellules mémoire déterminent la durée de l’immunité acquise. Au contact répété de cet antigène, elles se transforment rapidement en cellules effectrices. Dans le même temps, les cellules B mémoire assurent la synthèse d'anticorps plus rapidement, en plus grande quantité et avec une affinité plus élevée pour les anticorps d'une autre classe d'immunoglobulines - les IgG au lieu des IgM.
Au cours de la formation des cellules mémoire, une nouvelle recombinaison des gènes de la chaîne H se produit : le tandem de gènes V x D x J est transféré du gène C à l'un des gènes CH - y, a, e. Il a été établi qu'il y a sont des T-helpers qui déterminent la direction du changement de classe Ig.
Lors de la différenciation antigène-dépendante des lymphocytes B, le mécanisme des mutations somatiques des gènes V est également utilisé. Elles surviennent avec une fréquence 10 000 fois supérieure à la fréquence des mutations spontanées et se limitent à un certain stade de différenciation, à savoir la période de transition de la production d'IgM à la production d'IgG. Grâce à ces mutations, un ajustement maximal de la structure du centre actif de l'anticorps au déterminant antigénique est assuré.
Ainsi, les événements les plus importants dans la différenciation des lymphocytes B sont :
1) assemblage du gène de l'immunoglobuline à partir de ses fragments contenus dans l'ADN des cellules embryonnaires ; 2) l'émergence de nouvelles variantes de gènes Ig au cours de la différenciation ; 3) une épidémie de mutations somatiques à un stade de différenciation strictement défini. À la suite de ces événements, de nombreux clones génétiquement stables de cellules produisant des anticorps se forment (probablement pas moins de 108).
Le schéma général de l'origine et de la différenciation des lymphocytes T et B et des macrophages à partir des cellules souches originales est présenté dans la Fig. 71.
Riz. 71. Schéma de l'origine et de la différenciation des cellules effectrices du système immunitaire (OMS, 1978).
HSC - cellule souche hématopoïétique de la moelle osseuse ; LSC - cellule souche lymphoïde ; PTC – précurseur des lymphocytes T ;
PBC – précurseur des cellules B ; TE - Effecteurs T ; Tn - T-assistants ; Ts - T-suppresseurs ; CFUc - précurseur hématopoïétique des macrophages ; PC - cellule plasmatique ; EC - cellule épithéliale ; THF - facteur humoral thymique.
Selon ce schéma, une cellule dérivée de la moelle osseuse (CSH) génère deux types de progéniteurs : une cellule souche lymphoïde (LSC), à partir de laquelle sont dérivées des cellules progénitrices de lymphocytes T (PTC), des cellules progénitrices de lymphocytes B (BPC) ; et une cellule qui est le précurseur des globules rouges, à partir de laquelle dérive à son tour le précurseur des leucocytes (CFUc) et le système de macrophages mononucléés. Les précurseurs des lymphocytes T sous l'influence du thymus se transforment en lymphocytes T et leurs sous-classes. Les voies de différenciation des lymphocytes B sont décrites ci-dessus.
En général, le système lymphocytaire B assure la synthèse des anticorps, est responsable de l'immunité contre la plupart des infections bactériennes et virales, de l'anaphylaxie et d'autres réactions d'hypersensibilité immédiate, de certaines maladies auto-immunes, de la formation de cellules immunitaires à mémoire et de la tolérance immunologique.
Le système lymphocytaire T joue un rôle régulateur vis-à-vis des lymphocytes B, est responsable de toutes les réactions d'hypersensibilité de type retardé, de l'immunité contre les infections virales et certaines infections bactériennes (tuberculose, brucellose, tularémie, etc.), assure la surveillance immunologique, est responsable de l'immunité antitumorale, de la tolérance immunologique, de certains types d'immunopathologie.
Cependant, les lymphocytes T et B constituent deux parties du système immunitaire unifié du corps. Par conséquent, la division de l'immunité en humorale et cellulaire est très conditionnelle, puisque les anticorps sont synthétisés par les lymphocytes B, et que les lymphocytes T et autres cellules exercent leur immunocompétence à travers les facteurs humoraux qu'ils synthétisent (cytokines, lymphokines, interleukines, etc.).
L'interaction coordonnée des macrophages, des lymphocytes T et B lors de la rencontre avec un antigène assure la délivrance d'une réponse immunitaire adéquate.
49. Hypersensibilité : un aperçu
Certaines formes d'antigènes, lors d'un contact répété avec le corps, peuvent provoquer une réaction spécifique dans sa base, mais incluant des facteurs cellulaires et moléculaires non spécifiques d'une réponse inflammatoire aiguë. Ce phénomène de manifestation excessive ou inadéquate des réponses immunitaires acquises est appelé hypersensibilité.
Les réactions d'hypersensibilité peuvent être déclenchées par de nombreux antigènes et leurs causes varient d'une personne à l'autre.
Deux formes d'hypersensibilité sont connues : l'hypersensibilité de type immédiat, qui comprend trois types d'hypersensibilité (types I, II et III) et l'hypersensibilité de type retardé (IV). En pratique, les types d’hypersensibilité n’apparaissent pas nécessairement séparément.
Si l'hypersensibilité de type immédiat est provoquée par des mécanismes immunitaires humoraux, alors l'hypersensibilité de type retardé est provoquée par des mécanismes cellulaires. Cependant, pour certaines réactions d'hypersensibilité, cette classification n'est pas adaptée, car leur mécanisme est complexe. Dans le même temps, tant pour l'hypersensibilité provoquée par les IgE (type I) que pour le développement de diverses formes de maladies associées aux IgG (types II et III), la dose et la méthode de pénétration de l'antigène dans l'organisme sont critiques.
L'hypersensibilité de type immédiat (types I, II et III) se manifeste avec la participation d'anticorps cytophiles envers les mastocytes et les basophiles, producteurs de médiateurs inflammatoires. L'hypersensibilité de type retardé (type quatre) est réalisée à l'aide des lymphocytes T inflammatoires (TH1) comme principaux effecteurs de la réaction, assurant l'accumulation de macrophages dans la zone inflammatoire.
L'hypersensibilité de type retardé a été observée pour la première fois par le bactériologiste allemand R. Koch à la fin du XIXe siècle : l'introduction de bacilles tuberculeux dans la peau d'un animal infecté par la tuberculose a provoqué une inflammation locale sévère avec formation de granulomes au bout de 1 à 2 jours. , alors que chez les animaux intacts, une telle injection n'entraînait qu'une très faible réaction à court terme .
En 1902, Charles Richet et Paul Portier, alors qu'ils étudiaient l'immunité antitoxique au venin d'anémone de mer, décrivaient le phénomène de choc anaphylactique. L'administration intraveineuse répétée de poison à des chiens pré-immunisés en une quantité nettement inférieure à la dose mortelle a conduit au développement d'une réaction systémique aiguë, se manifestant par un vasospasme, un collapsus et la mort des animaux. L'introduction de poison dans la peau d'animaux immunisés n'a provoqué qu'une réaction inflammatoire locale.
Parallèlement, Maurice Arthus, travaillant sur des formes non toxiques de l'antigène, décrit une des formes de réaction allergique locale. La première injection d'un tel antigène dans la peau n'a provoqué aucune réaction ou a été très faible. L'administration répétée du même antigène a conduit dans certains cas à une infiltration intense du site d'injection par des leucocytes polymorphonucléaires, une réaction hémorragique et une nécrose vasculaire.
Un autre phénomène associé à une réaction allergique a été découvert avec l'utilisation généralisée de sérums équins anti-diphtérie et anti-tétanos pour le traitement de maladies apparentées. L'introduction de quantités importantes de ces sérums aux stades ultérieurs du traitement entraînait parfois une réaction systémique, accompagnée de fièvre, d'éruptions cutanées, d'urticaire et, dans certains cas, de lésions des articulations et des reins. Ce phénomène est appelé maladie sérique, car il est associé à la formation d'anticorps dirigés contre les protéines du sérum administré.
La capacité de développer ces réactions allergiques dans un organisme intact peut être initiée par le transfert de sérum provenant de donneurs malades. De plus, un receveur ainsi sensibilisé, lors de l'administration d'une dose résolutive de l'allergène, développera la même réponse d'hypersensibilité rapide que le donneur de sérum.
Si l'hypersensibilité de type immédiat est transmise par le sérum, alors l'hypersensibilité de type retardé dans un organisme intact ne peut être provoquée que par le transfert adoptif de cellules lymphoïdes viables provenant d'un donneur sensibilisé ; dans ce cas, le délai de développement d'une réaction de type retardé chez un receveur passivement sensibilisé est, comme chez un donneur, de 1 à 2 jours.
Ces premiers résultats indiquent clairement que des mécanismes différents sont à l'origine des deux formes d'hypersensibilité.
La mémoire immunologique est la capacité du système immunitaire à répondre plus rapidement et plus efficacement à un antigène (pathogène) avec lequel l’organisme a déjà été en contact.
Une telle mémoire est assurée par des clones préexistants spécifiques de l'antigène des cellules B et des cellules T, qui sont fonctionnellement plus actifs en raison d'une adaptation primaire passée à un antigène spécifique.
Il n'est pas encore clair si la mémoire est établie à la suite de la formation de cellules mémoire spécialisées à longue durée de vie ou si la mémoire reflète le processus de restimulation des lymphocytes par un antigène constamment présent qui est entré dans l'organisme lors de la primo-immunisation.
Troubles immunologiques chez l'homme
Immunodéficiences
Les immunodéficiences (IDS) sont des troubles de la réactivité immunologique provoqués par la perte d'un ou plusieurs composants de l'appareil immunitaire ou de facteurs non spécifiques interagissant étroitement avec lui.
Processus auto-immuns
Les processus auto-immuns sont des phénomènes en grande partie chroniques qui entraînent des lésions tissulaires à long terme. Cela est principalement dû au fait que la réaction auto-immune est constamment soutenue par des antigènes tissulaires.
Hypersensibilité
L'hypersensibilité est un terme utilisé pour décrire une réponse immunitaire aggravée et inappropriée, entraînant des lésions tissulaires.
Autres mécanismes de protection du macroorganisme
Immunologie tumorale
Les aspects de l’immunologie tumorale comprennent trois domaines de recherche principaux :
- Utiliser des méthodes immunologiques pour diagnostiquer les tumeurs, déterminer le pronostic et développer des tactiques de traitement pour la maladie ;
- Mise en œuvre de l'immunothérapie en complément d'autres types de traitement et pour l'immunocorrection - restauration du système immunitaire ;
- Déterminer le rôle de la surveillance immunologique des tumeurs humaines.
Gestion du système immunitaireMécanismes physiologiquesMéthodes d'influence utilisées en médecine Il existe différentes méthodes pour influencer le système immunitaire, conçues pour ramener son activité à la normale. Ceux-ci comprennent l'immunoréhabilitation, l'immunostimulation, l'immunosuppression et l'immunocorrection.
Immunoréhabilitation- Il s'agit d'une approche globale pour influencer le système immunitaire. Le but de l'immunoréhabilitation est de restaurer les valeurs fonctionnelles et quantitatives du système immunitaire à des niveaux normaux.
Immunostimulation est un processus consistant à influencer le système immunitaire pour améliorer les processus immunologiques qui se produisent dans le corps, ainsi qu’à augmenter l’efficacité de la réponse du système immunitaire aux stimuli internes.
Immunosuppression (immunosuppression)- Il s'agit d'une suppression du système immunitaire pour une raison ou une autre.
L'immunosuppression peut être physiologique, pathologique ou artificielle. L'immunosuppression artificielle est provoquée par la prise d'un certain nombre de médicaments immunosuppresseurs et/ou de rayonnements ionisants et est utilisée dans le traitement de maladies auto-immunes, dans les transplantations d'organes et de tissus, etc.
Immunocorrection- C'est la restauration du système immunitaire. L'immunocorrection est réalisée à des fins préventives pour augmenter la résistance de l'organisme lors des périodes d'épidémies d'infections respiratoires, pour améliorer la récupération de l'organisme après des opérations et des maladies.
Complexes immunitaires, complexes antigène-anticorps - complexes résultant de l'interaction d'un antigène avec un anticorps ; composants d'une réponse immunitaire normale qui ont la capacité de fixer le complément, d'influencer les processus d'activation des lymphocytes T et B et d'influencer la structure des antigènes situés à la surface des macrophages.
Des complexes immuns peuvent se former dans les cas où : 1) des antigènes et des anticorps se forment dans le sang puis se déposent dans la paroi des vaisseaux sanguins ; 2) l'antigène est localisé dans les tissus et réagit avec les anticorps présents dans le sang ; 3) l'antigène et l'anticorps se forment localement. Les complexes immuns se forment avec la participation d'anticorps appartenant aux immunoglobulines, le plus souvent aux classes IgG et IgM. En raison de leur capacité à fixer le complément et à réagir avec les récepteurs Fc des plaquettes et des neutrophiles, les complexes immuns peuvent provoquer une réponse inflammatoire aiguë.
Dans de nombreux cas complexes immuns peut soit ne pas pénétrer du tout dans la circulation sanguine, soit en être éliminé très rapidement. Pour le diagnostic et le développement de mesures thérapeutiques pour les maladies à complexes immuns, il est important de déterminer non seulement les niveaux de complexes immuns, mais également leur composition antigénique. Dans certains cas, la détermination des complexes immuns circulants permet de diagnostiquer des maladies qui ne reposent pas sur une pathologie des complexes immuns.
Mémoire immunologique. Lorsqu’il rencontre à nouveau un antigène, le corps forme une réponse immunitaire plus active et plus rapide – une réponse immunitaire secondaire. Ce phénomène est appelé mémoire immunologique.
La mémoire immunologique a une spécificité élevée pour un antigène spécifique, s'étend à la fois à l'immunité humorale et cellulaire et est provoquée par les lymphocytes B et T. Il se forme presque toujours et persiste pendant des années, voire des décennies. Grâce à cela, notre corps est protégé de manière fiable contre les interventions antigéniques répétées.
Actuellement, deux mécanismes les plus probables sont envisagés formation de la mémoire immunologique. Un des ils impliquent la préservation à long terme de l’antigène dans l’organisme. Il existe de nombreux exemples : l'agent pathogène encapsulé de la tuberculose, les virus persistants de la rougeole, de la polio, de la varicelle et certains autres agents pathogènes restent longtemps, parfois tout au long de la vie, dans l'organisme, maintenant le système immunitaire sous tension. Il est également probable qu’il existe des APC dendritiques à longue durée de vie, capables de stocker et de présenter l’antigène pendant une longue période.
Un autre mécanisme prévoit que lors du développement d'une réponse immunitaire productive dans l'organisme, une partie des lymphocytes T ou B réactifs à l'antigène se différencie en petites cellules au repos, ou cellules immunologiques mémoire. Ces cellules sont hautement spécifiques d'un déterminant antigénique spécifique et ont une grande espérance de vie (jusqu'à 10 ans ou plus). Ils sont activement recyclés dans le corps, distribués dans les tissus et les organes, mais retournent constamment à leur lieu d'origine grâce aux récepteurs à tête chercheuse. Cela garantit la disponibilité constante du système immunitaire à répondre de manière secondaire à un contact répété avec l’antigène.
Le phénomène de mémoire immunologique est largement utilisé dans la pratique de la vaccination des personnes pour créer une immunité intense et la maintenir longtemps à un niveau protecteur. Ceci est accompli par 2 à 3 vaccinations lors de la primo-vaccination et des injections répétées périodiques de la préparation vaccinale - revaccinations.
Cependant, le phénomène de mémoire immunologique a aussi des côtés négatifs. Par exemple, une tentative répétée de greffe de tissu qui a déjà été rejeté une fois provoque une réaction rapide et violente : crise de rejet.
Tolérance immunologique- un phénomène opposé à la réponse immunitaire et à la mémoire immunologique.Il se manifeste par l'absence de réponse immunitaire productive spécifique de l'organisme face à un antigène en raison de l'incapacité à le reconnaître.
Contrairement à l’immunosuppression, la tolérance immunologique implique l’insensibilité initiale des cellules immunocompétentes à un antigène spécifique.
La tolérance immunologique est causée par des antigènes appelés tolérogènes. Il peut s'agir de presque toutes les substances, mais les polysaccharides sont les plus tolérogènes.
La tolérance immunologique peut être congénitale ou acquise. Exemple tolérance innée est le manque de réponse du système immunitaire à ses propres antigènes. Tolérance acquise peut être créé en entrant
l'organisme avec des substances qui suppriment le système immunitaire (immunosuppresseurs), ou en introduisant un antigène dans la période embryonnaire ou dans les premiers jours après la naissance de l'individu. La tolérance acquise peut être active ou passive. Actif tolérance créé en introduisant un tolérogène dans le corps, qui forme une tolérance spécifique. Tolérance passive peut être causé par des substances inhiber l'activité biosynthétique ou proliférative cellules immunocompétentes (sérum antilymphocytaire, cytostatiques, etc.).
La tolérance immunologique est spécifique : elle s'adresse à des antigènes strictement définis. Selon le degré de prévalence, on distingue la tolérance polyvalente et fractionnée. Tolérance polyvalente se produit simultanément en réponse à tous les déterminants antigéniques qui composent un antigène particulier. Pour diviser, ou monovalent, tolérance caractérisé par une immunité sélective contre certains déterminants antigéniques individuels.
Le degré de manifestation de la tolérance immunologique dépend de manière significative d'un certain nombre de propriétés du macroorganisme et du tolérogène. La dose de l'antigène et la durée de son exposition sont importantes dans l'induction de la tolérance immunologique. Il existe une tolérance aux doses élevées et faibles. Tolérance à haute dose causée par l’introduction de grandes quantités d’antigènes hautement concentrés. Tolérance à faible dose, au contraire, elle est provoquée par une très petite quantité d’antigène moléculaire hautement homogène.
Mécanismes de tolérance sont diverses et pas entièrement déchiffrées. On sait qu'elles reposent sur les processus normaux de régulation du système immunitaire. Il existe trois raisons les plus probables au développement d’une tolérance immunologique :
Élimination des clones de lymphocytes spécifiques de l'antigène du corps.
Blocus de l'activité biologique des cellules immunocompétentes.
Neutralisation rapide de l'antigène par les anticorps.
Le phénomène de tolérance immunologique a une grande signification pratique. Il est utilisé pour résoudre
de nombreux problèmes médicaux importants, tels que la transplantation d'organes et de tissus, la suppression des réactions auto-immunes, le traitement des allergies et d'autres conditions pathologiques associées au comportement agressif du système immunitaire.
№ 64 Classification de l'hypersensibilité selon Jail et Coombs.
L'étude des mécanismes moléculaires de l'allergie a conduit à la création d'une nouvelle classification par Jell et Coombs en 1968. Conformément à celui-ci, on distingue quatre principaux types d'allergies : anaphylactiques (type I), cytotoxiques (type II), à complexes immuns (type III) et à médiation cellulaire (type IV). Les trois premiers types appartiennent à HNT, le quatrième à HRT. Les anticorps (IgE, G et M) jouent un rôle de premier plan dans l'initiation du HNT, et le THS est une réaction lymphoïde-macrophage.
Réaction allergique de type I associé aux effets biologiques des IgE et du G4, appelés réagit, qui ont une cytophilie - une affinité pour les mastocytes et les basophiles. Ces cellules portent à leur surface un FcR de haute affinité qui lie les IgE et le G4 et les utilise comme facteur co-récepteur pour une interaction spécifique avec l'épitope de l'allergène. La liaison de l'allergène au complexe récepteur provoque la dégranulation du basophile et du mastocyte - une volée de composés biologiquement actifs (histamine, héparine, etc.) contenus dans les granules dans l'espace intercellulaire. DANS
En conséquence, un bronchospasme, une vasodilatation, un œdème et d'autres symptômes caractéristiques de l'anaphylaxie se développent. Les cytokines produites stimulent la composante cellulaire de l’immunité : la formation de cellules auxiliaires T2 et l’éosinophilogenèse.
Les anticorps cytotoxiques (IgG, IgM), dirigés contre les structures de surface (antigènes) des cellules somatiques du macroorganisme, se lient aux membranes cellulaires des cellules cibles et déclenchent divers mécanismes de cytotoxicité dépendant des anticorps ( réaction allergique II taper). Une cytolyse massive s'accompagne de manifestations cliniques correspondantes. Un exemple classique est la maladie hémolytique résultant d’un conflit Rh ou d’une transfusion d’un groupe sanguin différent.
Les complexes antigène-anticorps, qui se forment en grande quantité dans le corps du patient après l'administration d'une dose massive d'antigène, ont également un effet cytotoxique ( réaction allergique III taper). En raison de l'effet cumulatif, les symptômes cliniques d'une réaction allergique de type III ont une manifestation retardée, parfois pendant plus de 7 jours. Néanmoins, ce type de réaction est classé comme HNT. La réaction peut se manifester comme l'une des complications liées à l'utilisation de sérums immuns hétérologues à des fins thérapeutiques et prophylactiques. (« maladie sérique »), et aussi lors de l'inhalation de poussières de protéines (« poumon du fermier »).
|
Type de réaction |
vecteur de pathogenèse |
anisme pathogenèse |
Exemple clinique |
||||||
|
anaphylactique (GNT) |
IgE, IgG4 |
e récepteur |
moi, choc anaphylactique, Polly |
||||||
|
gE (G4)-ASA des obèses | |||||||||
|
filov → | |||||||||
|
vie épitope allergène | |||||||||
|
m complexe → | |||||||||
|
cellules scientifiques et | |||||||||
|
→ Libération | |||||||||
|
inflammation et autres | |||||||||
|
et substances actives | |||||||||
|
. cytotoxique (GNT) |
cytotoxique et |
lupus, |
automatisation automatique |
||||||
|
dépendant des anticorps | |||||||||
|
complexe immunologique (GNT) |
maladies systémiques |
||||||||
|
nouveau tissu, phénomène Arthus, "l |
|||||||||
|
complexes par basal | |||||||||
|
endothélium | |||||||||
|
non-tissé | |||||||||
|
dépendant des anticorps | |||||||||
|
médiatisé | |||||||||
|
inflammation | |||||||||
|
à médiation cellulaire (THS) |
-lymphocytes |
ation T-lymphocytergique | |||||||
|
macrophages |
→ Allergie retardée aux céréales |
||||||||
|
inflammation | |||||||||