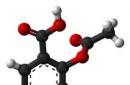Un chien en bonne santé est un animal joyeux et actif avec un pelage brillant, des yeux propres et clairs et une truffe légèrement humide et fraîche. Parfois, la truffe peut être sèche et chaude chez un chien en bonne santé lorsqu'il dort ou vient de se réveiller, ou encore après un travail intense par temps très sec. Un chien en bonne santé a bon appétit, les selles sont régulières, la miction est normale et la respiration est douce. Les muqueuses sont propres, rose pâle.
Un chien malade est très différent d’un chien en bonne santé. Elle est déprimée, essaie de se cacher dans un endroit sombre, répond à contrecœur à l'appel. Le chien ne mange pas bien, mais il a constamment soif. De plus, les signes de la maladie peuvent inclure des troubles des selles (diarrhée, constipation, sang dans les selles), des vomissements, des mictions fréquentes, des écoulements purulents des yeux et du nez. Les muqueuses sont pâles, bleutées ou ictériques.
Vous devez contacter votre vétérinaire au plus vite si votre chien présente un ou plusieurs symptômes persistants de la maladie.
Prendre soin de la santé du chien est l’une des principales responsabilités du propriétaire.
Le pelage devient terne, échevelé, avec une possible calvitie sur certaines zones du corps et des grattages.
La température corporelle, le pouls et la respiration peuvent également être anormaux. Les signes répertoriés n'apparaissent généralement pas simultanément, mais à mesure que la maladie progresse, leur nombre augmente.
Avant d'aborder la question des premiers secours à un animal de compagnie, il serait utile de considérer les caractéristiques anatomiques et physiologiques du chien.
Structure du corps du chien
Quiconque acquiert un chien doit comprendre la structure de son corps et son fonctionnement afin d'identifier à temps les problèmes de santé et de contacter un vétérinaire.
La connaissance de la structure et des fonctions du corps d'un chien permet de comprendre de nombreuses caractéristiques de son comportement, de constater à temps les écarts par rapport à l'état normal et de prendre des mesures opportunes pour prévenir les maladies.
Cela est particulièrement vrai pour les chiots, dont le corps est en train de se former.
Tous les organes sont étroitement interconnectés et le travail de chacun d'eux dépend directement de l'autre.
Le corps du chien se compose de 2 systèmes organiques principaux : externe et interne.
Tout organe est constitué de tissus qui assurent son fonctionnement et sont constitués d'un ensemble de cellules de formes, de fibres et de substances intercellulaires les plus diverses. Les cellules sont les plus petites unités structurelles du corps dont la forme et la structure dépendent de leur fonction.
La taille des cellules est de quelques millièmes de millimètre (10 à 100 microns).
Il existe 4 groupes principaux de tissus dans le corps du chien.
Tissus épithéliaux ou tégumentaires. Ces tissus forment la surface de la peau, tapissant la surface interne des cavités buccales et nasales, de l'œsophage, de l'estomac, des intestins, de la vessie, des uretères, etc.
Les tissus épithéliaux remplissent une fonction protectrice et assurent l'échange de substances entre l'environnement externe et interne de l'organisme. De plus, certaines cellules du tissu épithélial produisent des substances particulières : suc gastrique, suc intestinal, salive, larmes, etc.
Tissus de soutien-trophique. Ce groupe comprend le sang, la lymphe, la graisse, les tissus conjonctifs, le cartilage et les os. Les tissus trophiques de soutien sont très divers dans leur structure et leurs fonctions.
Ils créent la partie de support (charpente) de nombreux organes et du corps dans son ensemble (squelette), relient certains organes à d'autres, forment des coques protectrices d'organes qui leur donnent une certaine forme et agissent comme un lit pour les vaisseaux sanguins et les nerfs.
Muscle. Ce tissu remplit des fonctions motrices, permettant au chien de bouger et d'effectuer des mouvements contractiles de divers organes.
De plus, les tissus trophiques de soutien remplissent des fonctions vitales : trophique (nutritive), hématopoïétique, protectrice.
Tissu nerveux. Il forme le système nerveux, qui coordonne les fonctions de tous les tissus et organes, perçoit les signaux de l'environnement extérieur et détermine les réponses.
Tous les tissus sont des matériaux de construction pour les organes. Habituellement, la prédominance de tout type de tissu dans un organe détermine ses fonctions. Par exemple, dans le cerveau, qui est un organe du système nerveux, le tissu nerveux prédomine.
Classiquement, dans le corps d'un chien, comme chez les autres animaux domestiques, un certain nombre d'appareils et de systèmes organiques sont distingués en fonction de la fonction principale remplie par ce système. Cependant, il ne faut pas oublier que chaque organe peut remplir, en plus des fonctions principales, d'autres fonctions non moins importantes pour l'organisme.
Par exemple, la fonction principale des os squelettiques est musculo-squelettique, mais en plus de cela, les os squelettiques remplissent également des fonctions nutritionnelles, hématopoïétiques et électrolytiques.
Les os sont impliqués dans le métabolisme des protéines, de l’eau, des glucides, des graisses, des minéraux et en général.
Le corps du chien est constitué des organes et systèmes suivants :
1. Appareil de mouvement composé d'os, de ligaments et de muscles.
2. Systèmes internes des organes digestifs, respiratoires, excréteurs et reproducteurs.
3. Systèmes d'intégration, notamment les systèmes de circulation sanguine et lymphatique, le système immunitaire, le système des glandes endocrines, la peau, les organes sensoriels et le système nerveux.
Principaux organes internes d'un chien
Les chiens sont des mammifères, leur squelette est donc typique des mammifères et se compose des mêmes sections.
Les mammifères ont un crâne plus grand que celui des reptiles, par exemple.
Les mammifères se caractérisent par la présence 7 vertèbres cervicales. Les girafes, qui ont un très long cou, et les baleines, qui n'ont pas de cou du tout, ont le même nombre de vertèbres cervicales. Les vertèbres thoraciques (généralement 12 à 15 d'entre elles), ainsi que les côtes et le sternum, forment la poitrine.
La colonne lombaire est formée de vertèbres massives et articulées de manière mobile qui assurent la flexion et l'extension dans cette section de la colonne vertébrale. De cette façon, le torse peut se plier et se déplier. Le nombre de vertèbres lombaires chez différentes espèces de mammifères peut varier de 2 à 9, chez un chien il y en a 6. La colonne vertébrale sacrée est composée de 3 à 4 vertèbres reliées aux os pelviens.
Le nombre de vertèbres dans la région caudale chez le chien peut varier de 3 à plusieurs dizaines, ce qui détermine la longueur de la queue.
La ceinture des membres antérieurs des mammifères se compose de deux omoplates, d'os de corbeau fusionnés avec elles et d'une paire de clavicules sous-développées.
La ceinture des membres postérieurs - le bassin - chez un chien est formée de 3 paires d'os pelviens. La plupart des mammifères, y compris les chiens, ont des muscles particulièrement développés dans le dos et les membres.
La bouche du chien, comme celle des autres mammifères, contient sa langue et ses dents. La langue est utilisée pour déterminer le goût des aliments : sa surface est recouverte de nombreuses papilles, qui contiennent les terminaisons des nerfs gustatifs. La langue mobile déplace la nourriture autour de la bouche, ce qui aide à la mouiller avec la salive sécrétée par les glandes salivaires. Les dents des mammifères ont des racines avec lesquelles elles sont renforcées dans les alvéoles des mâchoires. Chaque dent est constituée de dentine et est recouverte à l’extérieur d’un émail durable. Chez les mammifères, les dents ont différentes structures associées à un objectif spécifique. Devant les mâchoires du chien se trouvent des incisives, des deux côtés desquelles se trouvent des crocs. Au fond de la bouche se trouvent les molaires.
Les muscles de la mâchoire inférieure sont également très développés, grâce auxquels le chien est capable de maintenir fermement ses proies.

Squelette d'un chien : 1 – mâchoire supérieure ; 2 – mâchoire inférieure ; 3 – crâne ; 4 – os pariétal ; 5 – protubérance occipitale ; 6 – vertèbres cervicales ; 7 – vertèbre thoracique; 8 – vertèbres lombaires ; 9 – vertèbres caudales ; 10 – omoplates ; 11 – humérus ; 12 – os de l'avant-bras ; 13 – os du carpe ; 14 – métacarpe ; 15 – phalanges des doigts ; 16 – côtes ; 17 – cartilages costaux ; 18 – sternum ; 19 – os pelvien ; 20 – articulation de la hanche ; 21 – fémur ; 22 – articulation du genou ; 23 – tibia ; 24 – péroné ; 25 – calcanéum ; 26 – articulation du jarret ; 27 – tarse ; 28 – métatarse ; 29 – doigts
Les chiots développent d’abord des dents de lait, qui tombent ensuite et sont remplacées par des dents permanentes.
Toutes les dents d'un chien ont un but. Il utilise ses molaires pour déchirer de gros morceaux de viande.
Les molaires externes ont des pointes émoussées qui aident à mâcher les matières végétales. Les incisives sont conçues pour séparer la viande des os.
L'estomac du chien, comme celui de la plupart des mammifères, est mono-chambre ; l'intestin est constitué du petit, du gros et du rectum. Dans les intestins, les aliments sont digérés sous l'influence des sécrétions des glandes digestives des intestins, ainsi que des sucs du foie et du pancréas.
Chez un chien, comme chez d'autres mammifères, la cavité thoracique est séparée de la cloison musculaire abdominale - le diaphragme, qui fait saillie dans la cavité thoracique et est adjacent aux poumons. Lorsque les muscles intercostaux et le diaphragme se contractent, le volume de la poitrine augmente, les côtes avancent et se déplacent sur les côtés et le diaphragme devient plat plutôt que convexe. À ce moment-là, la force de la pression atmosphérique force l’air à pénétrer dans les poumons – l’inhalation se produit. Lorsque les côtes descendent, la poitrine se rétrécit et l'air est expulsé des poumons - l'expiration se produit.

Organes internes du chien : 1 – cavité nasale ; 2 – cavité buccale ; 3 – trachée ; 4 – œsophage ; 5 – poumons ; 6 – cœur ; 7 – foie; 8 – rate ; 9 – reins ; 10 – intestin grêle ; 11 – gros intestin ; 12 – anus ; 13 – glandes anales ; 14 – vessie ; 15, 16 – organes génitaux ; 16 – cerveau ; 17 – cervelet ; 18 – moelle épinière
Le cœur du chien a quatre chambres et se compose de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Le mouvement du sang s'effectue dans 2 cercles de circulation sanguine : grand et petit.
L'urine est excrétée par les reins, un organe apparié situé dans la cavité abdominale, sur les côtés des vertèbres lombaires. L'urine qui en résulte s'écoule à travers 2 uretères dans la vessie, et de là, elle est périodiquement évacuée par l'urètre.
Le métabolisme chez les mammifères, en raison du développement élevé des systèmes respiratoire et circulatoire, se produit à grande vitesse. La température corporelle des mammifères est constante.
Le cerveau du chien, comme celui des autres mammifères, est constitué de 2 hémisphères. Les hémisphères cérébraux possèdent une couche de cellules nerveuses qui forment le cortex cérébral.
Chez de nombreux mammifères, y compris les chiens, le cortex cérébral est tellement élargi qu'il forme des plis-gyri, et plus il y a de circonvolutions, plus le cortex cérébral est développé et plus il contient de cellules nerveuses. Le cervelet est bien développé et, comme les hémisphères cérébraux, comporte de nombreuses circonvolutions. Cette partie du cerveau coordonne les mouvements complexes des mammifères.
La température corporelle normale d'un chien est de 37 à 38 °C ; les chiots de moins de 6 mois ont une température moyenne de 0,5 °C supérieure à celle des chiens adultes.
Les chiens ont 5 sens : l'odorat, l'ouïe, la vision, le toucher et le goût, mais ils ne sont pas également développés.
Les chiens, comme la plupart des mammifères terrestres, ont un bon odorat, ce qui les aide à traquer leurs proies ou à détecter un autre chien par leur odeur, même à une distance considérable. L'audition de la plupart des chiens est également bien développée, ceci est facilité par les oreilles mobiles qui captent le son.
Les organes du toucher chez le chien sont des poils longs et raides, appelés vibrisses, dont la plupart sont situés près du nez et des yeux.
En rapprochant leur tête de n’importe quel objet, les mammifères le reniflent, l’examinent et le touchent simultanément. Le comportement des chiens, ainsi que leurs instincts complexes, sont largement déterminés par une activité nerveuse supérieure basée sur des réflexes conditionnés.
Immédiatement après la naissance, le cercle social du chiot se limite à sa mère et aux autres chiots, parmi lesquels il acquiert ses premières compétences de communication avec le monde extérieur. À mesure que les chiots grandissent, leur expérience personnelle avec leur environnement augmente continuellement.
Les changements dans l'environnement amènent les chiens à développer constamment de nouveaux réflexes conditionnés, et ceux qui ne sont pas renforcés par des stimuli disparaissent. Cette capacité permet aux chiens de s'adapter aux conditions environnementales changeantes.
Les jeux pour chiots (lutte, poursuite, saut, course) constituent un bon entraînement et contribuent au développement des techniques individuelles d'attaque et de défense.
Mesure de température
La température normale d'un chien varie de 37 à 39,2 °C (chez un chiot, elle peut être supérieure de 0,2 °C).
Avant de mesurer la température, secouez le thermomètre, puis lubrifiez l'embout avec de la vaseline ou de la crème, placez le chien avec la queue relevée et insérez soigneusement le thermomètre dans le rectum d'environ 1,5 à 2 cm. Vous devez tenir le thermomètre avec votre main et assurez-vous que le chien ne s'assoit pas dessus.
La température est mesurée dans les 3 à 5 minutes. Désinfectez le thermomètre après chaque utilisation.
Détermination de la fréquence respiratoire
La fréquence respiratoire peut être déterminée en comptant le nombre de fois où le chien inspire ou expire au cours d'une minute.
Le comptage peut se faire par les mouvements de la poitrine ou des ailes du nez du chien. La fréquence respiratoire normale d'un chien est de 10 à 20 fois par minute.
Le rythme respiratoire augmente fortement pendant l'entraînement ou le jeu, ainsi que lorsque le chien est excité ou effrayé. Le processus respiratoire est également affecté par l'heure de la journée et la saison : la nuit, au repos, le chien respire moins souvent ; En été, par temps chaud, sa respiration devient plus rapide.
Les chiots respirent plus fréquemment que les chiens adultes.
Compter les battements de coeur (pouls)
Vous pouvez facilement sentir les contractions cardiaques de votre chien en plaçant votre paume sur le côté gauche de sa poitrine, juste en dessous de l'omoplate.
La fréquence cardiaque d'un chien augmente fortement lors d'un effort physique ou en état d'excitation. Cela se produit également lorsque le chien souffre, a de la fièvre, a subi un choc électrique ou souffre d'un problème cardiaque.
Le cœur des chiens adultes bat plus lentement que celui des chiots.
Trousse de premiers secours vétérinaire
Afin de prodiguer les premiers soins à un chien malade, il est nécessaire de disposer d'une trousse de premiers soins dont le contenu doit être vérifié périodiquement, en remplaçant les médicaments périmés par des nouveaux. La trousse de premiers secours doit contenir :
Thermomètre;
Pipette;
Seringue 50-100 ml ;
Seringues jetables;
Élastique;
Ciseaux;
Forfait pansement individuel ;
Ouate stérile ;
Pansement;
Teinture d'iode;
Le permanganate de potassium;
Acide borique;
vaseline;
Analgine;
Charbon actif;
Antihistaminiques ;
Antipyrétique.
Méthodes d'administration de médicaments sur le corps d'un chien
Chaque propriétaire doit donner des médicaments à un chien malade au moins une fois dans sa vie. Certains éleveurs de chiens rencontrent des difficultés : leurs animaux refusent obstinément d'avaler les pilules et les mélanges.
Afin de faciliter l’introduction des médicaments dans l’organisme du chien, il existe des techniques particulières :
Pour stimuler la déglutition, vous pouvez utiliser une seringue ou une cuillère à café pour verser une petite quantité d’eau dans la bouche du chien, tout en continuant à fermer ses mâchoires.
Lorsque vous donnez au chien des comprimés et des gélules, ouvrez ses mâchoires, placez le médicament sur la racine de la langue, puis serrez fermement le museau de l'animal jusqu'à ce que le comprimé soit avalé. Les tentatives de mélange d'un comprimé écrasé avec une friandise n'ont généralement aucun effet : l'animal apprend rapidement à sélectionner les morceaux savoureux et à laisser le médicament ;


Donner à votre chien des comprimés et des médicaments liquides
Les poudres sont versées sur la langue et après quelques minutes, le chien peut les boire avec de l'eau ;
Pour donner un médicament au chien, soulevez la tête de l’animal, versez le médicament dans la joue et attendez le mouvement de déglutition.
L'usage externe de médicaments ne pose généralement pas de difficultés. Les zones affectées de la peau sont lubrifiées avec des pommades, puis un collier est mis sur le chien pour éviter qu'il ne soit léché.
L'administration rectale et vaginale des médicaments se fait à l'aide de suppositoires ou de microlavements. Les suppositoires sont appliqués sur l'anus ou l'ouverture vaginale, puis poussés à l'intérieur avec l'index. Pour l'administration rectale, la queue du chien est brièvement pressée contre l'anus pour empêcher le suppositoire de sortir. La procédure pour les microlavements et les injections vaginales est réalisée presque de la même manière.
L'administration du médicament dans le sac conjonctival est une procédure légèrement plus complexe. À cette fin, des pommades produites dans des tubes spéciaux sont utilisées. Lorsqu'il place le médicament derrière la paupière inférieure, le propriétaire tient la tête du chien, tire la paupière vers l'arrière et extrait ou instille (s'il s'agit de gouttes pour les yeux) le médicament dans son pli, en prenant soin de ne pas toucher le globe oculaire avec une pipette ou un tube. . Après cela, les paupières du chien sont fermées et légèrement massées.
Les injections sous-cutanées sont administrées à l'aide d'une seringue munie d'une fine aiguille. Au niveau du garrot, un pli est collecté avec les doigts, dans lequel une aiguille est insérée à 1 à 2 cm sous la couche cutanée, et le médicament est injecté en appuyant lentement sur le piston.


Injecter des médicaments dans le sac conjonctival et l'oreille du chien
L'injection intramusculaire est effectuée dans le groupe postérieur des muscles de la cuisse ou de l'épaule, une aiguille de taille moyenne est prélevée et immergée dans le tissu sur 3 à 4 cm. Si vous devez administrer plusieurs médicaments incompatibles, il n'est pas nécessaire d'en utiliser plusieurs. aiguilles ou percer la peau à plusieurs endroits. Il suffit de débrancher la seringue, de retirer légèrement l'aiguille sans la retirer de la peau et de percer la zone musculaire adjacente.


Injections sous-cutanées et intramusculaires
Les perfusions intraveineuses doivent aussi parfois être administrées par les propriétaires de chiens eux-mêmes. La petite veine saphène de la jambe convient à cet effet. Un garrot est appliqué au-dessus du site d'injection, la patte du chien est retirée et une aiguille est insérée sans seringue. Après l'apparition de gouttes de sang dans la lumière de l'aiguille, la seringue elle-même y est connectée et le médicament est injecté lentement pour éviter un choc. Il est extrêmement important de tenir fermement la patte de l'animal lors de l'injection intraveineuse.

Injection intraveineuse
Si le chien fait des secousses pendant la procédure, cela peut entraîner des blessures à la veine ou la rupture de l'aiguille, ce qui est encore pire. Pour éviter cela, tenez fermement la patte de votre animal lors de l'injection.
Tous les autres types d'administration de médicaments : intracavitaire, injection dans le sac conjonctival, dans le muscle cardiaque, pose IV et transfusion sanguine doivent être effectués par un vétérinaire.
10 - gommes
11 - pli sublingual-maxillaire
22 - langue
30 - émail des dents
31 - couronne dentaire
La dent est constituée de dentine, d'émail et de ciment.
Dentine- le tissu qui constitue la base de la dent.
La dentine est constituée d'une matrice calcifiée pénétrée par des tubules dentinaires contenant des processus de cellules odontoblastiques tapissant la cavité dentaire. La substance intercellulaire contient des composants organiques (fibres de collagène) et minéraux (cristaux d'hydroxyapatite). La dentine comporte différentes zones qui diffèrent par leur microstructure et leur couleur.
Émail- une substance recouvrant la dentine au niveau de la couronne. Il est constitué de cristaux de sels minéraux, orientés de manière particulière pour former des prismes d’émail. L'émail ne contient pas d'éléments cellulaires et n'est pas un tissu. La couleur normale de l'émail va du blanc au crème avec une teinte jaunâtre (distinguable de la plaque).
Ciment- tissu recouvrant la dentine au niveau des racines. La structure du ciment est proche du tissu osseux. Se compose de cellules cémentocytes et cémentoblastes et d'une matrice calcifiée. La nutrition du ciment se fait de manière diffuse à partir du parodonte.
A l'intérieur de la dent il y a cavité, qui est divisé en cavité coronale Et canal radiculaire, ouvrant avec ce qui précède à propos de ouverture de l'apex de la dent. Remplit la cavité dentaire pulpe dentaire, constitué de nerfs et de vaisseaux sanguins immergés dans du tissu conjonctif lâche et assurant le métabolisme de la dent. Distinguer coronaire Et pulpe de racine.
Gencive- membrane muqueuse qui recouvre les bords dentaires des os correspondants, étroitement fusionnés avec leur périoste.
La gencive recouvre la dent au niveau du cou. Il est abondamment irrigué en sang (tendance aux saignements), mais relativement peu innervé. La dépression rainurée située entre la dent et le bord libre de la gencive est appelée sillon gingival.
Le parodonte, la paroi alvéolaire et les gencives se forment appareil de soutien de la dent - parodonte.
Parodonte- assure la fixation de la dent à l'alvéole dentaire.
Il est constitué du parodonte, de la paroi des alvéoles dentaires et des gencives. Le parodonte remplit les fonctions suivantes : support et amortisseur, barrière, trophique et réflexe.
CHANGEMENT DE DENTS
Les dents d'un chien, comme celles de la plupart des mammifères, sont diphyodonte type, c'est-à-dire qu'au cours de la vie de l'animal, il y a un changement de dents : la première génération - temporaire, ou dents de lait remplacé par des dents de deuxième génération - permanent. Chez le chien, seules les dents P1 ne changent pas ; elles éclatent avec les dents de lait et restent permanentes.
Tableau Moment de la poussée dentaire chez le chien
(d'après J. Hozgood et al., 2000).
Changement de dents (radiographie générale)
 |
TYPES DE DENTS
Les chiens sont des animaux hétérodontes, c'est-à-dire ont des dents de structures différentes selon les fonctions qu'elles remplissent. On distingue les types de dents suivants : incisives, crocs Et dents permanentes: prémolaires (fausses, petites molaires), ou prémolaires Et vraiment indigène, ou molaires qui ne contiennent pas de précurseurs du lait.
Dents disposées dans l'ordre sous forme de rangée hautet arcades dentaires inférieures (arcades) . L'arcade supérieure est représentée par 20, et l'arcade inférieure par 22 dents (respectivement 10 et 11 de chaque côté).
Anatomie des incisives de l'arcade supérieure
 |
Incisives

|
Entre le bord et la canine de l'arcade supérieure, ainsi que la canine et la première prémolaire de l'arcade inférieure, il y a des espaces - diastèmes, qui assurent la fermeture des canines.
Les molaires de chaque arcade augmentent de taille distalement par rapport aux plus grandes dents sécantes, également appelées prédateur. Les molaires ont une structure différente sur les arcades supérieure et inférieure, et leur structure sera donc considérée séparément.
Prémolaires - 4 de chaque côté.
P I - a 1 (rarement 2) tubercules de la couronne et 1 racine.
P 2.3 - la couronne a 3 dents : une grande médiale et 2 plus petites distales ; la dent a 2 racines - médiale et distale ;
P 4 - la couronne comporte 3 tubercules : gros médial
à la fois distal et petit lingual ; Il y a 3 racines, elles correspondent aux tubercules en emplacement.
Molaires - 2 de chaque côté. Leurs axes longitudinaux sont parallèles entre eux et perpendiculaires au plan médian.
M 1 - la couronne a 6 tubercules : 2 grands buccaux, moyens - linguals et 3 petits entre eux. La dent a 3 racines : linguale puissante
et 2 plus petits buccaux – médial et distal.
M 2 - la couronne a 4-5 tubercules : 2 buccaux (médial et distal) et 2-3 lingual. Il y a 3 racines, leur localisation est similaire à celle de M 1.
 |
Les P 1-4 ont une structure similaire à celle de l'arcade supérieure, à l'exception de racines légèrement plus longues et plus étroites.
Le P 1 inférieur est parfois appelé dans la littérature une dent de loup.
Molaires- 3 de chaque côté.
M 1 est la plus grande des molaires. La couronne comporte 5 cuspides : médiale, 2 distales et 2 médianes entre elles : buccales puissantes.
et un lingual plus petit. 2 racines : médiale et distale.
M 2 - la couronne a 3-4 tubercules : 2 médiaux et 2 distaux. La dent a 2 racines, de taille identique : médiale et distale.
M 3 est la plus petite des molaires ; la couronne comporte généralement 1 ou 2 cuspides. Il y a une racine, rarement deux.
FORMULE DENTAIRE
L'enregistrement des dents sous la forme d'une série de chiffres, où chaque nombre indique le nombre de dents d'un certain type sur un côté de chaque arcade dans la direction du plan médian est appelé formule dentaire.
La formule dentaire est :
dents de lait D : ICP/ICP
molaires : P : IСРМ/IСРМ.
Formules dents de chien :
D : 3130/3130
R : 3142/3143.
Ainsi, 28 dents de lait (ici il ne faut pas prendre en compte les premières prémolaires, qui sont essentiellement des dents permanentes, bien qu'elles éclatent avec le passage du lait) et 42 dents permanentes.
Dans la pratique médicale dentaire, la formule dentaire est rédigée selon le schéma suivant : D : PCI|ICP/PCI|ICP ; R : МРCI|ICРМ/ МРCI|ICРМ le nombre de dents se reflète dans toute l’arcade, et pas seulement sur un côté. Dans ce cas, la formule dentaire du chien ressemblera à D : 313| 313/ 313|313 ; R : 2413|3142/3413|3143.
Cette forme d'enregistrement de la formule dentaire semble la plus rationnelle. En utilisant ce type de notation, vous pouvez désigner brièvement n'importe quelle dent d'arcade. Par exemple, la deuxième prémolaire permanente inférieure gauche est désignée par P|P2, la dent à feuilles caduques supérieure droite par DI1|-, ou OP en abrégé]. L'entrée D|Р1 est erronée,
puisqu'il n'y a pas de première prémolaire primaire chez le chien.
MORDRE
La fermeture des arcades dentaires est appelée occlusion, ou occlusion.
Lorsque les mâchoires du chien se ferment, les incisives supérieures se placent devant les inférieures de telle sorte que les surfaces linguales des premières soient en contact libre avec la surface vestibulaire (vestibulaire) des secondes, et les crocs pénètrent librement dans le diastème correspondant. , formant ce qu'on appelle un verrou. Cela se produit parce que l’arcade dentaire supérieure est légèrement plus large que l’arcade inférieure (arcades anisognathes). Le contact des dents est appelé antagonistes.
La morsure peut varier en fonction de la forme et de la taille des mâchoires et de l'os incisif, du sens de croissance des incisives et des canines, qui à son tour est déterminé par la race, le type de constitution de l'animal, l'âge et d'autres facteurs.
Les options d'occlusion physiologique sont :
Orthognathie ou l'articulé en ciseaux décrit ci-dessus. Caractéristique des chiens de constitution douce, forte et forte. C’est normal pour la plupart des races. Avec ce type de morsure, l'usure des incisives se produit le plus lentement.
Si les incisives inférieures sont situées derrière les supérieures, mais en sont séparées à une certaine distance, une telle morsure est appelée sous-dépassé.
Dans ce cas, la surface mésiale des canines supérieures et la surface distale des canines inférieures sont usées par frottement.
Une telle morsure peut être causée par des anomalies du développement osseux (mâchoire supérieure allongée et/ou mâchoire inférieure raccourcie - microgénie) ou par une croissance dentaire. Il est plus fréquent chez les chiens de races dolichocéphales au museau pointu. On le retrouve chez les chiots ayant une tête massive au niveau des pommettes et une large mâchoire inférieure au niveau des branches. En règle générale, une fois la formation du squelette terminée, la morsure chez ces chiots est restaurée en ciseaux ou en morsure droite.
Pour les chiens adultes de la plupart des races, cela est considéré comme un défaut, car cela complique considérablement l’alimentation et réduit les performances de l’animal. De plus, avec la sous-occlusion, les crocs de la mâchoire inférieure ne forment pas de verrou, mais blessent le palais.
Progénie ou collation- Les incisives inférieures sont situées devant les supérieures. Un raccourcissement important des os de la région du visage avec une mâchoire inférieure normale ou allongée provoque l'avancement non seulement des incisives inférieures, mais également des canines - une morsure de bouledogue. Il est standard pour les races telles que les bouledogues anglais et français, les carlins, les boxeurs et quelques autres, à condition que les incisives et les canines de la mâchoire inférieure ne dépassent pas de la lèvre supérieure.
Morsure droite (en forme de pince)- les incisives touchent les bords.
Cette morsure est typique des chiens de constitution lâche et grossière avec une mâchoire inférieure massive. Pour certaines races, la morsure directe est autorisée par le standard sans condition ou à partir d'un certain âge. Par exemple, la norme FCI-335 pour la race de berger d’Asie centrale (entrée en vigueur le 22 mars 2000) précise : « articulé en ciseaux, droit ou serré sous le dessous (sans déchet), quel que soit l’âge ». Avec une morsure droite, les incisives s'écrasent le plus rapidement.
L’érosion progressive de l’émail et de la dentine avec l’âge est un processus physiologique. Avec une occlusion correcte et un stress physiologique, des changements compensatoires adéquats se produisent dans l'organe dentaire, garantissant le plein fonctionnement des dents usées.
DATES POUR L’ABRASION DES DENTS
Le moment où la couronne est portée chez le chien, comme chez les autres animaux, dépend de nombreux facteurs. Il s'agit tout d'abord de la morsure. Comme indiqué ci-dessus, avec un articulé en ciseaux, le meulage des incisives et des canines se produit beaucoup plus lentement qu'avec un articulé droit (pince) et d'autres options d'occlusion.
Il ne faut pas oublier qu'en plus des types décrits, il existe une grande variété de formes pathologiques d'occlusion, dans lesquelles le grincement de dents individuelles se produit de manière inappropriée pour l'âge.
De plus, l'intensité de l'abrasion du collet est déterminée par les conditions d'alimentation, telles que : la consistance de la nourriture (nourriture sèche ou humide) ; la profondeur du plat dans lequel le chien prend la nourriture et le matériau dans lequel elle est fabriquée (le chien a-t-il la capacité de capturer physiologiquement la nourriture et de ne pas se blesser les dents). L'habitude de certains chiens de mâcher et de transporter des objets durs affecte grandement le temps nécessaire à l'usure des incisives et des autres dents.
Les caractéristiques individuelles de la microstructure et de la composition chimique de l'émail et de la dentine sont particulièrement importantes pour l'abrasion dentaire. De telles anomalies peuvent être soit congénitales (facteur héréditaire, utilisation de médicaments tératogènes chez les chiennes gestantes, troubles graves de l'alimentation et maladies pendant la grossesse), soit acquises (maladies et autres maladies infectieuses pendant la période de changement de dents, prise de médicaments à base de tétracycline chez les jeunes animaux, excès de fluorure). dans l'organisme (fluorose dentaire), l'utilisation de produits chimiques agressifs (acides minéraux) pour traiter la cavité buccale, etc.
Compte tenu des facteurs ci-dessus, il devient évident qu'il est impossible d'établir une relation stricte entre le degré d'abrasion des dents individuelles et l'âge de l'animal. L'exception concerne les animaux de moins de 10 à 12 mois, chez lesquels l'ordre d'éruption des dents permanentes est assez stable, et après son achèvement (6 à 7 mois) jusqu'à 10 à 12 mois, les couronnes des dents permanentes bougent enfin dans la cavité buccale.
Sur 1 an, la corrélation entre l'effacement et l'âge est très conditionnelle.
 |
Effacement des trèfles des incisives inférieures (2,5 ans)
Vous trouverez ci-dessous le calendrier approximatif des changements dans l'appareil dentaire chez le chien.
Les trèfles commencent à s'estomper vers l'âge de 2 ans. Tout d'abord, ils sont meulés sur les incisives inférieures, à 3 ans - sur les crochets supérieurs, à 4 ans - sur ceux du milieu, et à 5-6 ans, les trèfles, en règle générale, sont absents sur toutes les incisives, à l'exception de les bords supérieurs.
De 5-6 à 10-12 ans, les incisives inférieures avancent avec une intensité variable (les crochets inférieurs sont généralement les premiers à avancer), les canines et les gros tubercules des molaires s'usent.
Chez les chiens âgés de plus de 10 à 12 ans, la couronne des orteils inférieurs est généralement presque complètement usée. Les couronnes des autres dents sont meulées légèrement uniformément. Si l'animal ne souffre pas de maladie parodontale (ce qui est rare chez les chiens de compagnie), la perte naturelle des dents commence vers l'âge de 14-17 ans.
Notez qu'en cas de parodontite et de maladie parodontale, une perte complète des dents peut survenir vers l'âge de 8 à 10 ans.
Un critère plus fiable pour déterminer l’âge d’un chien est la taille relative de la cavité dentaire. Avec l’âge, on observe une diminution progressive de la cavité de la dent jusqu’à son oblitération complète chez les chiens âgés. Ce paramètre n'est pratiquement pas influencé par des facteurs externes et internes et peut servir de base au développement d'une méthode de détermination de l'âge.
Pour déterminer la taille de la cavité dentaire, il est nécessaire de prendre une radiographie. Grâce à cette technique, il sera possible de déterminer l'âge à partir d'une radiographie ou d'une coupe, en n'ayant qu'une seule dent à votre disposition.
DIGESTION MÉCANIQUE
La digestion dans la cavité buccale se produit principalement mécaniquement : lors de la mastication, de gros fragments de nourriture sont brisés en morceaux et mélangés à la salive. La mastication est particulièrement importante pour l’absorption des ingrédients d’origine végétale, car les nutriments sont souvent enfermés dans des membranes contenant de la cellulose qui résistent à la digestion. Ces membranes doivent être brisées avant que les nutriments qu’elles contiennent puissent être utilisés.
La digestion mécanique augmente également la zone exposée aux enzymes digestives.
PIED DE LA CAVITÉ ORALE
STRUCTURE
Le plancher de la cavité buccale est recouvert d'une membrane muqueuse située sous la surface libre de la langue et sur les côtés de son corps, il s'agit d'un espace en forme de fente sous la muqueuse sublinguale. Sagittalement, le plancher buccal est divisé par un pli du frein de la langue.
Sur les côtés du corps de la langue, la membrane muqueuse du bas avec une épaisse couche sous-muqueuse forme des plis dans lesquels s'ouvrent plusieurs conduits courts. glande salivaire sublinguale. Latéralement au frein de la langue se trouvent de petites verrues sublinguales (faim). Ce sont les ouvertures des canaux excréteurs mandibulaire
et long conduit sublingual glandes salivaires.
GLANDES SALIVAIRES
1 - glande parotide
2 - glande mandibulaire
3 - glande sublinguale
7 - glande zygomatique
Glande salivaire maxillaire (mandibulaire) situé derrière la branche de la mâchoire inférieure, ventrale par rapport à la glande salivaire parotide, atteint le cou, où il se situe entre les veines maxillaires.
Elle est grande, de forme ovale, de couleur cireuse jaunâtre et plus grande que la glande parotide. Ses canaux excréteurs suivent dans l'espace intermaxillaire le muscle prémaxillaire médialement depuis la glande salivaire sublinguale jusqu'aux verrues affamées. La glande sécrète une sécrétion muqueuse séreuse.
Glande salivaire parotide se trouve ventral par rapport à l'oreillette, et est de taille relativement petite. Le canal excréteur traverse le muscle masticateur et débouche dans le vestibule buccal avec une papille salivaire basse.
Glande salivaire sublinguale se trouve sous la membrane muqueuse sur les côtés du corps de la langue. Divisée en à canaux multiples, qui s'ouvre dans un grand nombre de canaux sur la surface latérale du pli sublingual, et monocanal- un conduit - dans une verrue affamée. Produit une sécrétion muqueuse.
DIGESTION ENZYMATIQUE
La salive est sécrétée dans la cavité buccale par quatre paires de glandes salivaires.
Généralement, une petite quantité de salive est présente dans la bouche, mais cette quantité peut être augmentée par la vue et l’odeur des aliments. Cet effet, appelé « réaction gustative », a été étudié pour la première fois par l'académicien I.P. Pavlov.
La salivation se poursuit à mesure que les aliments pénètrent dans la cavité buccale et son effet est renforcé par le processus de mastication.
La salive est composée à 99 % d’eau, tandis que les 1 % restants sont constitués de mucus, de sels inorganiques et d’enzymes.
Le mucus agit comme un lubrifiant efficace et favorise la déglutition, notamment les aliments secs. Contrairement aux humains, la salive des chats et des chiens est dépourvue de l'enzyme amylase qui digère l'amidon, ce qui empêche l'hydrolyse rapide de l'amidon dans la cavité buccale.
L’absence de cette enzyme est cohérente avec le comportement observé des chiens, qui ont tendance à avaler sans mâcher tous les aliments sauf les plus durs, et avec le comportement des chats, caractéristique des carnivores, qui ont tendance à consommer des aliments à faible teneur en amidon.
LANGUE
Langue- un organe musculaire et mobile situé au fond de la cavité buccale.
Structure de la langue
Les papilles de la membrane muqueuse de la langue remplissent la fonction d'analyseur de goût, sa surface assure la thermorégulation du corps du chien et remplit également la fonction du toucher.
Courbée comme une cuillère, la langue sert à recevoir l'eau.
En termes de forme externe, la langue des chiens est longue, large et fine. Le squelette de la langue constitue la surface interne de la mâchoire inférieure, ainsi que l'os hyoïde.
Structure de la langue
 |
2 - muscles de la langue
3 - corps de la langue
4 - racine de langue
Dans la langue il y a : racine, corps Et haut.
Racine La langue est située entre les molaires et est recouverte de la membrane muqueuse de l'arcade palatoglosse.
Corps La langue se situe entre les branches de la mâchoire inférieure et on y distingue les surfaces arrière et latérales. Il y a de nombreuses papilles sur le dos. Le dos de la langue est concave et divisé par un profond sillon sagittal s'étendant jusqu'au sommet de la langue. Sur les côtés du dos, les surfaces latérales du corps de la langue convergent vers son frein.
bout de langue- sa partie la plus mobile, élargie et aplatie, présente une face ventrale exempte de frein. La surface dorsale de l'apex est sensiblement plus large que son dos.
Dans l’épaisseur de l’apex de la langue se trouve un cartilage intralingual spécifique (reste de l’os intralingual), qui soutient la langue saillante du chien et facilite la prise de nourriture liquide.
PAPIPLES DE LA LANGUE
Les papilles de la langue sont divisées en mécanique Et goût.
Mécanique:
1. En forme de fil
Couvrir toute la surface dorsale de la langue, longue et fine
et doux.
2. Conique
Situé dans la zone de la racine de la langue au lieu des filaments.
Arôme(contiennent des récepteurs nerveux gustatifs - papilles gustatives) :
1. Champignon
Dispersés sur toute la surface de l'arrière de la langue parmi les filiformes.
2. En forme de rouleau (rainuré).
Ils se trouvent sur le bord du corps et à la racine de la langue en 2-3 paires. Ils sont grands, de forme ronde, avec une rainure autour de chacun. Dans ce dernier cas, les glandes muqueuses s'ouvrent.
3. En forme de feuille
Ils se trouvent sur les côtés de la racine de la langue, devant les arcs palatoglosses. De forme ovale, de 0,5 à 1,5 cm de long, divisée en segments - « feuilles ». Contient des glandes séreuses-muqueuses.
GLANDES DE LA LANGUE
Les glandes de la langue sont pariétales, elles sont dispersées sur toute la surface et les bords de la langue, se trouvent profondément dans la membrane muqueuse et sécrètent une sécrétion muqueuse.
MUSCLES DE LA LANGUE
La langue repose sur du tissu musculaire strié. Ses fibres musculaires sont orientées dans trois directions mutuellement perpendiculaires : longitudinale (d'avant en arrière), transversale (de droite à gauche) et oblique (de haut en bas) et forment des muscles différenciés, divisés en muscles de la langue et de l'os hyoïde.
La base du langage est muscle lingual. Il est constitué de fibres musculaires verticales, obliques et longitudinales allant de l’os hyoïde jusqu’à la pointe de la langue.
Fonction : modifie la forme (épaisseur, longueur, largeur) de la langue dans différentes directions.
Muscle lingual latéral. Il part de la surface latérale du segment médian de l'os hyoïde et suit la surface latérale de la langue jusqu'à son sommet.
Fonction: avec une action bilatérale, tire la langue vers l'arrière, avec unilatéral - le tourne dans la direction correspondante.
Sublingual - muscle lingual. Il commence sur le corps et les cornes laryngées de l'os hyoïde, se termine dans l'épaisseur de la langue en dedans du muscle lingual latéral, latéralement du génioglosse.
Fonction : tire la langue vers l'arrière, aplatit la racine de la langue lors de la déglutition.
Muscle génioglosse. Il commence sur l'angle mental de la mâchoire inférieure et se ramifie en forme d'éventail dans le plan médio-sagittal depuis l'apex jusqu'au milieu du corps de la langue.
Fonction : aplatit la langue, la fait avancer.
MUSCLES DES HYPOGLOUS
Le muscle génio-hyoïdien est fusiforme et s'étend du menton de la mâchoire inférieure jusqu'à l'os hyoïde.
Fonction : tire l’os hyoïde et avec lui la langue vers l’avant. Fournit une extension maximale de la langue lors du rodage ou du léchage.
Muscle prémaxillaire transversal (hyoïde). Il s'étend depuis l'angle mental de la mâchoire inférieure, le long du bord dentaire le long de la ligne de son attachement musculaire jusqu'à la suture tendineuse de l'espace sous-maxillaire et se termine sur le corps et les grandes cornes de l'os hyoïde.
Fonction : soulève la langue lors de la mastication. Repousse au palais dur.
Muscle stylo-hyoïdien - des grandes et petites cornes de l'os hyoïde.
Fonction : rapproche les branches lors de la déglutition.
Muscle hornohyoïdien - découle des cornes laryngées de l'os hyoïde jusqu'à ses petites cornes.
Fonction : extrait les branches nommées.
Muscles rétracteurs hyoïdes - les muscles sterno-hyoïdien et sternothyroïdien rétractent l'os hyoïde lors de la déglutition.
2. Pharynx (Pharynx)
Gorge - pharynx - un organe mobile en forme de tube dans lequel traverse le tube digestif, passant par le pharynx de la cavité buccale au pharynx et plus loin vers l'œsophage et les voies respiratoires - à travers les choanes jusqu'au pharynx et plus loin jusqu'au larynx.
1 - œsophage
2 - la gorge
4 - trachée
5 - larynx
6 – épiglotte
STRUCTURE
La cavité pharyngée est divisée en deux parties différentes : la partie supérieure – respiratoire – nasopharynx et la partie inférieure – digestive – (larynx), qui sont limitées l'une de l'autre par l'arc vélopharyngé. Les arcs vélopharyngés convergent avant le début de l’œsophage, formant la bordure œsophagopharyngée.
La partie respiratoire du pharynx, située sous la base du crâne, sert de prolongement à la cavité nasale derrière les choanes. Elle est tapissée d'un épithélium cilié colonnaire monocouche, tandis que la partie digestive est tapissée d'un épithélium pavimenteux stratifié. Les ouvertures pharyngées des trompes auditives (Eustache) s'ouvrent dans les parties latérales du nasopharynx, qui relient le nasopharynx à la cavité tympanique de l'oreille moyenne (la pharyngite peut provoquer une otite moyenne).
La partie antérieure de la partie digestive du pharynx borde le pharynx, dont elle est séparée par le voile palatin et sert ainsi de prolongement à la cavité buccale, et est donc appelée la cavité buccale. A l'arrière, elle vient en butée contre la face antérieure de l'épiglotte. Puis, situé au sommet du larynx, le pharynx continue jusqu'à l'entrée.
dans l'œsophage. Cette partie de la section digestive du pharynx est appelée partie laryngée, puisque l'entrée du larynx s'y ouvre par le bas. Ainsi le pharynx comporte 7 trous.
Sur la paroi dorsale du pharynx, au niveau du fornix, se trouve l'amygdale pharyngée.
Le pharynx est situé entre les segments médians de l'os hyoïde, ils recouvrent l'organe sur les côtés et les segments supérieurs (proximaux) de l'os hyoïde le suspendent à la partie mastoïde de l'os pétreux.
La contraction des muscles pharyngés est à la base de l’acte complexe de déglutition, qui implique également le palais mou, la langue, le larynx et l’œsophage.
Radiographie : contrôle des rayons X
effectuer une endoscopie de la région du pharynx

Dans le même temps, les releveurs pharyngés le tirent vers le haut et les compresseurs rétrécissent systématiquement sa cavité vers l'arrière, poussant le bol alimentaire dans l'œsophage. Dans le même temps, le larynx s'élève également, son entrée est étroitement recouverte par l'épiglotte, en raison de la pression exercée sur lui par la racine de la langue. Dans ce cas, les muscles du palais mou le tirent vers le haut et caudalement de telle sorte que le voile palatin repose sur les arcs vélopharyngés, séparant le nasopharynx.
Pendant la respiration, le voile palatin raccourci pend obliquement vers le bas, recouvrant le pharynx, tandis que l'épiglotte, constituée de cartilage élastique, dirigée vers le haut et vers l'avant, permet d'accéder à un courant d'air dans le larynx.
L’extérieur du pharynx est recouvert d’adventice de tissu conjonctif.
Il est attaché à la base du crâne par le fascia basilaire pharyngé.
La base du pharynx est constituée de trois paires de constricteurs (rétroducteurs) et d'un dilatateur (dilatateur). Ces paires de muscles forment une suture tendineuse sagittale moyenne sur la paroi supérieure de l'organe, s'étendant de l'arc vélopharyngé à l'œsophage.
1. Constricteur crânien (rostral) du pharynx - se compose de muscles appariés : vélopharyngé et ptérygopharyngé.
Le muscle vélopharyngé constitue les parois latérales de la partie crânienne du pharynx, ainsi que l'arc vélopharyngé, part des os palatin et ptérygoïdien et se termine à la suture tendineuse pharyngée.
Fonction : rapproche la bouche de l’œsophage de la racine de la langue.
Le muscle ptérygopharyngé commence tendineux sur l'os ptérygoïdien et se termine dans la partie caudale du pharynx. Fusionne avec le muscle vélopharyngé.
Fonction : tire la paroi pharyngée vers l’avant.
La fonction principale du constricteur pharyngé antérieur est de bloquer l’entréedans le nasopharynx et l'expansion de l'œsophage.
2. Le constricteur moyen du pharynx (muscle hypoglosse) est formé par : les muscles cartilagineux et oropharyngés (appartiennent au groupe des muscles de l'os hyoïde) - il découle des cornes laryngées de l'os hyoïde jusqu'à la suture tendineuse du pharynx.
Fonction : pousse le bolus alimentaire vers l’œsophage.
3. Le constricteur caudal du pharynx est formé par : le muscle thyropharyngé, allant du cartilage thyroïde du larynx à la suture tendineuse, et le muscle annulaire pharyngé, allant du cartilage annulaire à la suture pharyngée.
Fonction : pousse le bolus alimentaire vers l’œsophage.
Dilatateur pharyngé - découle de la surface médiale du segment médian de l'os hyoïde sous les constricteurs moyen et caudal jusqu'à la surface latérale du pharynx.
Fonction : élargit la partie postérieure du pharynx après ingestion, rétrécit le nasopharynx.
3. Œsophage (Œsophage)
Œsophage- est la partie initiale de l'intestin antérieur
et dans sa structure, c'est un organe typique en forme de tube. C'est une continuation directe de la partie laryngée du pharynx.
La membrane muqueuse de l'œsophage sur toute sa longueur est collectée
en plis longitudinaux, qui se redressent au fur et à mesure du passage du bol alimentaire. La couche sous-muqueuse contient de nombreuses glandes muqueuses qui améliorent le glissement des aliments. La muqueuse musculaire de l’œsophage est une couche striée complexe à plusieurs niveaux.
STRUCTURE
La membrane externe des parties cervicale et thoracique de l'œsophage est constituée d'adventice du tissu conjonctif et la partie abdominale est recouverte de péritoine viscéral. Les points d'attache des couches musculaires sont : latéralement - les cartilages aryténoïdes du larynx, ventralement - son cartilage annulaire, et dorsalement - la suture tendineuse du larynx.
Représentation schématique de l'œsophage

En cours de route, le diamètre de l'œsophage est inégal : il présente 2 expansions et 2 rétrécissements. Chez les chiens de taille moyenne, le diamètre à l'entrée peut atteindre 4 cm et à la sortie jusqu'à 6 cm. Il existe des parties cervicales, thoraciques et abdominales de l'œsophage.
La longueur totale de l'œsophage est en moyenne de 60 cm et le diamètre moyen de l'œsophage affaissé est d'environ 2 cm. Topographiquement, l'œsophage est divisé en parties cervicale, thoracique et abdominale. La partie cervicale est longue et représente environ la moitié de la longueur de l’œsophage. Directement derrière le pharynx, il est situé au-dessus des demi-anneaux de la trachée
et sous la couche prévertébrale du fascia du cou (plaque de surface).
Ensuite, au niveau de 4 à 6 vertèbres cervicales, l'œsophage fait une courbure descendant vers le côté gauche de la trachée et suit l'entrée de la cavité thoracique. Cette caractéristique de la topographie permet d'éviter les tensions sur l'organe dans la partie thoracique lors des mouvements de la tête et du cou, en même temps, elle doit être prise en compte lors des manipulations médicales sur l'organe.
Dans la cavité thoracique du médiastin, l'œsophage accompagne la trachée à gauche, puis dans la région de sa bifurcation (bifurcation) repose à nouveau sur la trachée. La partie thoracique de l'œsophage passe d'abord par la base du cœur à droite de la crosse aortique, puis par l'orifice œsophagien du diaphragme, situé au niveau du troisième espace intercostal, légèrement à gauche. Derrière le diaphragme, dans la cavité abdominale, la courte partie abdominale de l'œsophage constitue l'entrée de l'estomac ou ouverture cardiaque (cardia).
LES FONCTIONS
Il n'y a pas de sécrétion d'enzymes digestives dans l'œsophage, cependant, les cellules épithéliales de la muqueuse œsophagienne sécrètent du mucus, qui sert à lubrifier le coma alimentaire pendant le processus de péristaltisme, contractions musculaires ondulatoires automatiques stimulées par la présence d'aliments. dans l'œsophage et assurer son déplacement dans le canal digestif. Le processus de déplacement des aliments de la bouche vers l’estomac ne prend que quelques secondes.
4. Estomac (ventricule)
L'estomac du chien est de type intestinal à chambre unique. C'est une extension du tube digestif derrière le diaphragme.
Apparition d'un estomac isolé

1 - partie pylorique de l'estomac
2 - partie cardiaque de l'estomac
3 - partie fundique de l'estomac
4 - sortie du duodénum
5 - ouverture cardiaque (entrée de l'œsophage)
La flexion ventrale externe de l'estomac est communément appelée grande courbure, et le petit pli dorsal entre l'entrée et la sortie de l'estomac est petite courbure. La surface antérieure de l'estomac entre la petite et la grande courbure fait face au diaphragme et est appelée diaphragmatique, et la surface postérieure opposée est appelée viscérale. Il fait face aux anses intestinales.
Du côté de la plus grande courbure, le grand omentum est attaché à l'estomac - mésentère gastrique. Il est très étendu, couvrant tout l'intestin jusqu'à l'hypogastre comme un tablier et formant un sac omental. Sur la surface gauche de la grande courbure, dans le pli du sac omental, la rate est adjacente à l'estomac.
Ceci est lié à la grande courbure de l’estomac ligament gastrosplénique, dans lequel se trouvent de nombreux navires. Ce ligament est une continuation du mésentère de l'estomac - le grand omentum.
L'entrée du sac omental est située entre la veine cave caudale et la veine porte du foie, en dedans du rein droit. Petit sceau situé sur la petite courbure, il est court et constitué de ligament gastro-hépatique. Dans la direction crânienne, il fusionne avec ligament oesophago-hépatique, et dans la caudale - avec ligament hépatoduodénal. Les ligaments ci-dessus, en plus du ligament gastrosplénique, remplissent uniquement une fonction mécanique.
Endoscopie : l'aspect de l'estomac est normal

Endoscopie : aspect de l'estomac.
Gastrite ulcéreuse

(diverses projections)

TOPOGRAPHIE DE L'ESTOMAC
L'estomac est situé dans l'hypocondre gauche dans la région du 9e au 12e espace intercostal et du cartilage xiphoïde (épigastre) ; une fois rempli, il peut s'étendre au-delà de l'arc costal et descendre sur la paroi abdominale ventrale.
Chez les grands chiens, cette caractéristique anatomique est à l'origine de la pathogenèse de maladies non contagieuses de l'estomac - sa dilatation aiguë ou volvulus.
PARTIES DE L'ESTOMAC
Il est d'usage de distinguer trois parties d'un estomac à chambre unique : cardiaque, fond d'œil (fundique), pylorique, qui diffèrent non seulement par la structure, mais aussi par la spécialisation des glandes. La partie cardiale de l'estomac est plus épaisse et moins approvisionnée en sang que les autres parties ; ce fait doit être pris en compte lors de la réalisation d'interventions chirurgicales.
La partie cardiaque est une extension derrière l'entrée
dans l'estomac et représente 1/10 de la surface de sa plus grande courbure. La membrane muqueuse de la partie cardiaque de type intestinal est de couleur rosâtre, riche en glandes cardiaques pariétales, qui sécrètent une sécrétion séreuse-muqueuse d'une réaction alcaline.
La partie médiane de l’estomac située derrière la pars cardia, du côté de la grande courbure, est appelée fond de l’estomac. C'est la partie principale de l'estomac où la nourriture est déposée en couches. Il y a situé zone inférieure du presse-étoupe(alias fonctionnel ou inférieur). Chez le chien, il occupe la moitié gauche de la grande courbure de l'estomac.
La zone des glandes fundiques se distingue par une coloration sombre de la muqueuse et est également équipée de fosses gastriques - l'embouchure des glandes pariétales. La moitié droite de l'estomac est occupée zone des glandes pyloriques. La muqueuse gastrique, lorsqu’elle n’est pas remplie, est rassemblée en plis. Ce n'est que dans la zone de moindre courbure qu'ils sont orientés depuis l'entrée de l'estomac jusqu'au pylore.
La partie pylorique de l'estomac du chien possède un constricteur puissamment développé (plus étroit), qui la recouvre circonférentiellement sur 5 à 7 cm de l'entrée du duodénum et assure l'évacuation des aliments de l'estomac vers l'intestin.
MINES DE L'ESTOMAC

La membrane muqueuse est blanche, tapissée d'un épithélium pavimenteux stratifié, rassemblé en de nombreux plis longitudinaux. La couche sous-muqueuse bien développée contient des glandes muqueuses.
La muqueuse musculaire de l'estomac est constituée de tissu musculaire lisse et comporte trois couches de fibres : longitudinale, circulaire et oblique.
Couche de fibres longitudinale mince suit de l'œsophage au pylore. Couche circulaire situé principalement en bas
et les parties pyloriques de l'estomac. Il forme le constricteur du pylore.
Couche oblique prédomine dans la moitié gauche de l'estomac; dans la zone de la couche circulaire, elle se double (en interne et externe).
La membrane séreuse de l'estomac passe de la petite courbure au petit omentum, et de la grande courbure au ligament splénique et au grand omentum.
EMBRYOLOGIE
Au cours du développement embryonnaire, l’estomac, faisant partie d’un tube digestif droit, subit deux rotations de 180 degrés. L’un dans le plan frontal dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et l’autre dans le plan segmentaire.
LES FONCTIONS
L'estomac remplit plusieurs fonctions :
Il sert à stocker temporairement les aliments et contrôle la vitesse à laquelle les aliments pénètrent dans l'intestin grêle.
L'estomac sécrète également des enzymes nécessaires à la digestion des macromolécules
Les muscles de l'estomac régulent la motilité, permettant aux aliments de se déplacer caudalement (loin de la bouche) et facilitent la digestion en mélangeant et en broyant les aliments.
L'estomac du chien est de grande taille, son volume maximum peut approcher le volume de l'ensemble du gros et du petit intestin. Cela est dû à l’alimentation irrégulière du chien et à sa consommation de nourriture « pour une utilisation future ».
On sait qu'un chien peut également utiliser son estomac comme réservoir temporaire pour stocker de la nourriture : par exemple, lorsqu'elle nourrit des chiots plus âgés, la chienne régurgite la nourriture qu'elle a obtenue pour eux.
PHASES DE SÉCRÉTION DE L'ESTOMAC
La sécrétion gastrique est régulée par des processus complexes d'interaction nerveuse et hormonale, grâce auxquels elle s'effectue au bon moment et dans le volume requis. Le processus de sécrétion est divisé en trois phases : cérébrale, gastrique et intestinale.
Phase cérébrale
La phase médullaire de sécrétion est initiée par l'anticipation de la prise alimentaire et la vue, l'odeur et le goût des aliments, qui stimulent la sécrétion de pepsinogène, bien que la gastrine et l'acide chlorhydrique soient également libérés en petites quantités.
Phase gastrique
La phase gastrique est initiée par un étirement mécanique de la muqueuse gastrique, une diminution de l'acidité, ainsi que des produits de digestion des protéines. Dans la phase gastrique, le principal produit de sécrétion est la gastrine, qui stimule également la sécrétion d'acide chlorhydrique, de pepsinogène et de mucus. La sécrétion de gastrine ralentit fortement si le pH descend en dessous de 3,0 et peut également être contrôlée par des hormones peptiques telles que la sécrétine.
ou entéroglucagon.
Phase intestinale
La phase intestinale est initiée à la fois par une distension mécanique du tractus intestinal et par une stimulation chimique avec des acides aminés et des peptides.
5. Intestin grêle (Intestinum tenue)
STRUCTURE
L'intestin grêle est une section rétrécie du tube intestinal.
L'intestin grêle est très long, représentant la partie principale de l'intestin et varie de 2,1 à 7,3 mètres chez le chien. Suspendu sur un long mésentère, l’intestin grêle forme des anses qui remplissent la majeure partie de la cavité abdominale.
L'intestin grêle émerge de l'extrémité de l'estomac et est divisé en trois sections différentes : le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Le duodénum représente 10 % de la longueur totale de l’intestin grêle, tandis que les 90 % restants de la longueur de l’intestin grêle sont constitués du jéjunum et de l’iléon.

APPROVISIONNEMENT EN SANG
La paroi de la coupe mince est richement vascularisée.
Le sang artériel circule à travers les branches de l'aorte abdominale - l'artère mésentérique crânienne, et vers le duodénum également par l'artère hépatique.
Le drainage veineux se produit dans la veine mésentérique crânienne, qui est l'une des racines de la veine porte du foie.
Le drainage lymphatique de la paroi intestinale se produit à partir des sinus lymphatiques des villosités et des vaisseaux intra-organiques à travers les ganglions lymphatiques mésentériques (intestinaux) jusqu'au tronc intestinal, qui se jette dans la citerne lombaire, puis dans le canal lymphatique thoracique et la veine cave crânienne.
INNERVATION
L'apport nerveux de la petite section est représenté par des branches du nerf vague et des fibres postganglionnaires du plexus solaire issues du ganglion semi-lunaire, qui forment deux plexus dans la paroi intestinale : intermusculaire (Auerbach) entre les couches de la couche musculaire et sous-muqueuse ( Meissner) dans la couche sous-muqueuse.
Le contrôle de l'activité intestinale par le système nerveux s'effectue à la fois par des réflexes locaux et par des réflexes vagaux impliquant le plexus nerveux sous-muqueux et le plexus nerveux intermusculaire. La fonction intestinale est régulée par le système nerveux parasympathique, dont le centre est sa moelle oblongate, à partir de laquelle le nerf vague (10e paire de nerfs crâniens, nerf respiratoire-intestinal) s'étend jusqu'à l'intestin grêle. L'innervation vasculaire sympathique régule les processus trophiques dans l'intestin grêle.
TOPOGRAPHIE
La section mince part du pylore de l'estomac au niveau de la 12e côte, est recouverte ventralement par les feuilles du grand omentum et est limitée dorsolatéralement par la section épaisse. Il n'y a pas de limites claires entre les sections de l'intestin grêle et l'identification des sections individuelles est principalement de nature topographique.
Seul le duodénum se distingue le plus clairement, qui se distingue par son grand diamètre et sa proximité topographique avec le pancréas.
Radiographie barytée de contraste de l'intestin grêle

EXTRAITS MINIERS DE L'INTESTINAL
DÉFINITION
Les caractéristiques fonctionnelles de l’intestin grêle laissent une empreinte sur sa structure anatomique. Il y a la membrane muqueuse et la couche sous-muqueuse, les muscles (muscles longitudinaux externes et transversaux internes) et la membrane séreuse de l'intestin.

LA MUQUEUSE INTESTINALE
La membrane muqueuse forme de nombreux dispositifs qui augmentent considérablement la surface d'absorption.
Ces dispositifs comprennent des plis circulaires, ou plis de Kirkring, dans la formation desquels non seulement la muqueuse est impliquée, mais également la couche sous-muqueuse et les villosités, qui donnent à la muqueuse un aspect velouté. Les plis couvrent 1/3 ou 1/2 de la circonférence de l'intestin. Les villosités sont recouvertes d'un épithélium bordé spécial, qui effectue la digestion et l'absorption pariétale. Les villosités, se contractant et se relaxant, effectuent des mouvements rythmiques à une fréquence de 6 fois par minute, grâce auxquels elles agissent comme une sorte de pompe lors de l'aspiration.
Au centre de la villosité se trouve un sinus lymphatique qui reçoit les produits de transformation des graisses. Chaque villosité du plexus sous-muqueux contient 1 à 2 artérioles qui se divisent en capillaires. Les artérioles s'anastomosent les unes avec les autres et pendant l'absorption, tous les capillaires fonctionnent, tandis que pendant une pause, il y a de courtes anastomoses. Les villosités sont des excroissances filiformes de la membrane muqueuse, formées de tissu conjonctif lâche riche en myocytes lisses, en fibres de réticuline et en éléments cellulaires immunocompétents, et recouvertes d'épithélium.
La longueur des villosités est de 0,95 à 1,0 mm, leur longueur et leur densité diminuent dans la direction caudale, c'est-à-dire que dans l'iléon, la taille et le nombre de villosités sont beaucoup plus petits que dans le duodénum et le jéjunum.
HISTOLOGIE
La membrane muqueuse de la section mince et des villosités est recouverte d'un épithélium cylindrique monocouche, qui contient trois types de cellules : des cellules épithéliales colonnaires à bordure striée, des exocrinocytes en forme de gobelet (mucus sécrété) et des endocrinocytes gastro-intestinaux.

La membrane muqueuse de la section mince regorge de nombreuses glandes pariétales - l'intestin commun, ou glandes de Lieberkühn (cryptes de Lieberkühn), qui s'ouvrent dans la lumière entre les villosités. Le nombre de glandes est en moyenne d'environ 150 millions (dans le duodénum et le jéjunum, il y a 10 000 glandes par centimètre carré de surface et 8 000 dans l'iléon).
Les cryptes sont tapissées de cinq types de cellules : les cellules épithéliales à bordure striée, les glandulocytes caliciformes, les endocrinocytes gastro-intestinaux, les petites cellules sans bordure du fond de la crypte (cellules souches de l'épithélium intestinal) et les entérocytes à granules acidophiles (cellules de Paneth). Ces derniers sécrètent une enzyme impliquée dans la dégradation des peptides et du lysozyme.
FORMATIONS LYMPHOÏDES
Le duodénum est caractérisé par des glandes duodénales tubulaires-alvéolaires, ou glandes de Bruner, qui s'ouvrent en cryptes. Ces glandes sont une continuation des glandes pyloriques de l'estomac et sont situées uniquement sur les 1,5 à 2 premiers cm du duodénum.
Le segment final de la section mince (iléon) est riche en éléments lymphoïdes, qui se trouvent dans la membrane muqueuse à différentes profondeurs du côté opposé à l'attache du mésentère, et sont représentés à la fois par des follicules simples (solitaires) et par leurs amas dans la forme des taches de Peyer.
Les plaques commencent dans la partie finale du duodénum.
Le nombre total de plaques est de 11 à 25, elles sont de forme ronde ou ovale, d'une longueur de 7 à 85 mm et d'une largeur de 4 à 15 mm.
L'appareil lymphoïde participe aux processus digestifs.
À la suite de la migration constante des lymphocytes dans la lumière intestinale et de leur destruction, des interleukines sont libérées, qui ont un effet sélectif sur la microflore intestinale, régulant sa composition et sa répartition entre les sections fines et épaisses. Chez les jeunes organismes, l'appareil lymphoïde est bien développé et les plaques sont grandes.
Avec l'âge, il se produit une réduction progressive des éléments lymphoïdes, qui se traduit par une diminution du nombre et de la taille des structures lymphatiques.
TRANSCRIPTION MUSCULAIRE
La tunique musculaire est composée de deux couches de tissu musculaire lisse : longitudinal Et circulaire, et la couche circulaire est mieux développée que la couche longitudinale.
La musculeuse propria assure des mouvements péristaltiques, des mouvements pendulaires et une segmentation rythmique qui propulsent et mélangent le contenu intestinal.
SÉROSA
La membrane séreuse - le péritoine viscéral - forme le mésentère, sur lequel est suspendue toute la fine section. Dans le même temps, le mésentère du jéjunum et de l'iléon est mieux exprimé et sont donc regroupés sous le nom de côlon mésentérique.
FONCTIONS DE L'INTESTIN GRÉ
Dans l'intestin grêle, la digestion des aliments s'effectue sous l'action d'enzymes produites par la paroi (foie et pancréas) et les glandes pariétales (Lieberkühn et Brunner), l'absorption des produits digérés dans le sang et la lymphe et la désinfection biologique des substances entrantes.
Cette dernière est due à la présence de nombreux éléments lymphoïdes enfermés dans la paroi du tube intestinal.
La fonction endocrinienne de la section mince est également importante et consiste en la production de certaines substances biologiquement actives par les endocrinocytes intestinaux (sécrétine, sérotonine, motiline, gastrine, pancréozymine-cholécystokinine, etc.).
PARTIES DE L'INTESTIN GRÉ
Il est d'usage de distinguer trois sections de la coupe mince : le segment initial, ou duodénum, le segment médian, ou jéjunum, et le segment final, ou iléon.
DUODÉNUM
Structure
Le duodénum est la section initiale de la section mince, qui est reliée au pancréas et au canal biliaire principal et a la forme d'une boucle orientée caudalement et située sous la colonne lombaire.
La longueur de l'intestin est en moyenne de 30 cm soit 7,5 % de la longueur de la section mince. Cette section de la section mince est caractérisée par la présence de glandes duodénales (de Bruner) et d'un mésentère court, de sorte que l'intestin ne forme pas de boucles, mais forme quatre circonvolutions prononcées.
Radiographie de contraste baryté
duodénum:

Topographie
La partie crânienne de l'intestin se forme en forme de S, ou gyrus sigmoïde, situé dans la région du pylore, reçoit les canaux du foie et du pancréas et s'élève dorsalement le long de la surface viscérale du foie.
Sous le rein droit, l'intestin fait un tour caudal - ceci gyrus crânien du duodénum, et va à partie descendante, qui est situé dans l’iliaque droite. Cette partie passe à droite de la racine du mésentère et sous les 5-6 vertèbres lombaires passe du côté gauche partie transversale, divisant le mésentère en deux racines à cet endroit, et forme gyrus caudal du duodénum.
L'intestin est alors dirigé crâniennement vers la gauche de la racine mésentérique comme partie ascendante. Avant d'atteindre le foie, il se forme gyrus duodéjéjunal et passe dans le jéjunum. Ainsi, sous la colonne vertébrale, une boucle étroite de la racine antérieure du mésentère se forme, contenant le lobe droit du pancréas.
JÉJUNUM
Structure
Le jéjunum est la partie la plus longue de la petite section et mesure environ 3 mètres, soit 75 % de la longueur de la petite section.
L'intestin tire son nom du fait qu'il a un aspect à moitié dormant, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de contenu volumineux. Le diamètre dépasse l'iléon situé derrière lui et se distingue par un grand nombre de vaisseaux traversant un mésentère bien développé.
En raison de sa longueur considérable, de ses plis développés, de ses nombreuses villosités et cryptes, le jéjunum possède la plus grande surface d'absorption, qui est 4 à 5 fois supérieure à la surface du canal intestinal lui-même.
Topographie
L'intestin forme 6 à 8 écheveaux situés dans la région du cartilage xiphoïde, la région ombilicale, la partie ventrale des iliaques et des aines.
ILÉUM
Structure
L'iléon est la partie finale de la coupe mince, atteignant une longueur d'environ 70 cm, soit 17,5 % de la longueur de la coupe mince. Extérieurement, l'intestin n'est pas différent du jéjunum. Cette section se caractérise par la présence d'un grand nombre d'éléments lymphoïdes dans la paroi. La dernière section de l'intestin a des parois plus épaisses et la plus forte concentration de plaques de Peyer. Cette section passe directement sous la 1ère-2ème vertèbre lombaire de gauche à droite et dans la zone de l'ilion droit se jette dans le caecum, se connectant à lui par un ligament. Au point où l'iléon pénètre dans le caecum, la partie rétrécie et épaissie de l'iléon se forme valvule iléo-cæcale, ou papille iléale, qui présente l'apparence d'un amortisseur en forme d'anneau en relief.
Topographie
Cette section de l'intestin grêle doit son nom à sa proximité topographique avec les os iliaques auxquels elle est adjacente.
GLANDES MURALES. FOIE.
Foie- la plus grosse glande du corps, c'est un organe parenchymateux de couleur rouge foncé, pesant 400 à 500 g, soit 2,8 à 3,4 % du poids corporel.
Cinq systèmes tubulaires se forment dans le foie :
1) voies biliaires ;
2) artères ;
3) branches de la veine porte (système porte) ;
4) veines hépatiques (système cave) ;
5) vaisseaux lymphatiques.


STRUCTURE DU FOIE D'UN CHIEN
La forme du foie est irrégulièrement arrondie avec une marge dorsale épaissie et des marges ventrales et latérales pointues. Les bords pointus sont disséqués ventralement par de profondes rainures en lobes. La surface du foie est lisse et brillante grâce au péritoine qui la recouvre, seul le bord dorsal du foie n'est pas recouvert de péritoine, qui à cet endroit passe sur le diaphragme, et se forme ainsi champ extrapéritonéal foie.
Sous le péritoine se trouve une membrane fibreuse. Il pénètre dans l'organe, le divise en lobes et forme capsule fibreuse périvasculaire(capsule de Glisson), qui entoure les voies biliaires, les branches de l'artère hépatique et la veine porte.
La surface antérieure du foie - la surface diaphragmatique - pénètre dans la niche formée par le dôme du diaphragme, et la surface postérieure - la surface viscérale est en contact avec les organes situés à proximité du foie.
La marge dorsale présente deux échancrures : à gauche - dépression œsophagienne, et à droite - gouttière de la veine cave. Situé sur le bord ventral coupe du ligament rond. Dans le centre surface viscérale situé entouré de tissu conjonctif porte du foie- c'est l'endroit où pénètrent les vaisseaux et les nerfs, où sortent le canal biliaire principal et où se trouvent les ganglions lymphatiques hépatiques.
Le ligament falciforme, qui est une copie du péritoine passant du diaphragme au foie, est une continuation ligament rond- vestige de la veine ombilicale, divise le foie en deux lobes : droite- grand et gauche- plus petit. Ainsi, toute la partie du foie située à droite du ligament rond est le lobe droit.
Du côté droit du foie se trouve la vésicule biliaire. La zone du foie située entre la vésicule biliaire et le ligament rond est part intermédiaire. Le lobe moyen de la porte du foie est divisé en deux sections : la plus inférieure est appelée fraction carrée, et celui du haut est lobe caudé. Cette dernière consiste en processus caudé, qui a dépression rénale, Et processus mastoïde, qui occupe la petite courbure de l'estomac. Enfin, les lobes gauche et droit sont divisés
en deux parties chacune : latérale et médiale.
Ainsi, le foie a six lobes : latéral droit, médial droit, latéral gauche, médial gauche, carré et caudé.
Le foie est un organe polymère dans lequel on distingue plusieurs éléments structurels et fonctionnels : lobule hépatique, secteur (une section du foie alimentée par une branche de la veine porte de 2ème ordre), segment (section du foie alimentée par une branche de la veine porte du 3ème ordre), l'acinus hépatique (sections adjacentes de deux lobules adjacents) et le lobule hépatique porte (zones de trois lobules adjacents).
L'unité morphofonctionnelle classique est le lobule hépatique, de forme hexagonale, situé autour de la veine centrale du lobule hépatique.
L'artère hépatique et la veine porte, pénétrant dans le foie, sont divisées à plusieurs reprises en lobaire, segmentaire, etc. branches jusqu'au bout
avant artères et veines interlobulaires, qui sont situés le long des surfaces latérales des lobules avec canal biliaire interlobulaire, formant des triades hépatiques. De ces artères et veines naissent des branches qui donnent naissance à des capillaires sinusoïdaux qui se jettent dans les veines centrales du lobule.
Les lobules sont constitués d'hépatocytes, qui forment des trabécules sous la forme de deux cordons cellulaires. L’une des caractéristiques anatomiques les plus importantes du foie est que, contrairement à d’autres organes, le foie reçoit du sang de deux sources : le sang artériel par l’artère hépatique et le sang veineux par la veine porte.
VOIES BILIAIRES ET FORMATION DE LA BILE
L’une des fonctions les plus importantes du foie est le processus de formation de la bile, qui conduit à la formation des voies biliaires. Entre les hépatocytes qui forment les lobules, se trouvent les voies biliaires qui se jettent dans les canaux interlobulaires, qui, à leur tour, forment deux canal hépatique, sortant de chaque lobe : droite et gauche. En fusionnant, ces conduits forment le canal hépatique commun.
La vésicule biliaire est un réservoir de bile, dans laquelle la bile s'épaissit 3 à 5 fois, car elle est produite plus que ce qui est nécessaire au processus de digestion. La couleur de la bile de la vésicule biliaire chez le chien est rouge-jaune.
La vessie se trouve sur le lobe carré du foie, en hauteur depuis son bord ventral et est visible depuis les surfaces viscérales et diaphragmatiques. La bulle a bas, corps Et cou. La paroi de la vessie est formée par la membrane muqueuse, une couche de tissu musculaire lisse et est recouverte à l'extérieur par le péritoine, et la partie de la vessie adjacente au foie est constituée de tissu conjonctif lâche. Le canal cystique provient de la vessie et contient pli en spirale.
À la suite de la fusion du canal cystique et du canal hépatique commun, le canal biliaire principal se forme, qui s'ouvre
dans le gyrus en forme de S du duodénum à côté du canal pancréatique au sommet papille duodénale majeure. Au point où il pénètre dans l'intestin, le canal a sphincter des voies biliaires(sphincter d'Oddi).
Grâce à la présence du sphincter, la bile peut s'écouler directement dans les intestins (si le sphincter est ouvert) ou dans la vésicule biliaire (si le sphincter est fermé).
TOPOGRAPHIE DU FOIE
Le foie est situé devant l'estomac et est en contact avec diaphragme. Se trouve presque symétriquement dans les deux hypocondres. Bord caudal Le foie correspond à l'arc costal ; ce n'est que chez les animaux âgés que le foie peut dépasser de l'arc costal.
Lors de l'examen radiographique et échographique, la distance entre le bord caudal du foie et le diaphragme doit être cinq fois supérieure à la longueur de la deuxième vertèbre lombaire.

Le foie est maintenu dans sa position par l'appareil ligamentaire, qui comprend ligament rond foie - relie le bord ventral du foie à l'anneau ombilical, le ligament continue dans Ligament falciforme, attachant le foie au diaphragme ; le foie est également relié au diaphragme par le ligament coronaire, le ligament triangulaire gauche ; Le foie est relié au rein droit par le ligament hépato-rénal, à l'estomac par le ligament hépato-gastrique et au duodénum par le ligament hépatoduodénal.
3 - cavité de la vésicule biliaire.

Balayage longitudinal de la vésicule biliaire : 1 - cavité vésiculaire,
2 - paroi de la vésicule biliaire,

Balayage transversal de la vésicule biliaire, 1 - cavité vésiculaire,
2 - paroi de la vésicule biliaire,
Le foie reçoit un apport sanguin par les artères hépatiques et la veine porte, et l'écoulement veineux se produit par les veines hépatiques vers la veine cave caudale.
L'innervation du foie est assurée par le nerf vague à travers les ganglions extra- et intra-muros et le plexus hépatique sympathique, représenté par les fibres postganglionnaires du ganglion semi-lunaire. Le nerf phrénique participe à l'innervation du péritoine recouvrant le foie, ses ligaments et la vésicule biliaire.
FONCTIONS HÉPATIQUES
Le foie est un organe multifonctionnel qui participe à presque tous les types de métabolisme, joue un rôle de barrière et de désinfection, est un dépôt de glycogène et de sang (jusqu'à 20 % du sang est déposé dans le foie) et remplit une fonction hématopoïétique dans la période embryonnaire.
La fonction digestive du foie est réduite au processus de formation de bile, qui favorise l'émulsification des graisses et la dissolution des acides gras et de leurs sels. Les chiens sécrètent 250 à 300 ml de bile par jour.
La bile est un mélange d'ions bicarbonate, de cholestérol, de métabolites organiques et de sels biliaires. La base sur laquelle agissent les sels biliaires est la graisse. Les sels biliaires décomposent les grosses particules de graisse en petites gouttelettes qui interagissent avec diverses lipases.
La bile sert également à excréter des résidus organiques, tels que le cholestérol et la bilirubine, lors de la dégradation de l'hémoglobine. Les cellules hépatiques produisent de la bilirubine à partir du sang et la sécrètent activement dans la bile. C'est grâce à ce pigment que la bile acquiert sa couleur jaune.
Structure tridimensionnelle d'un sel biliaire
indiquant les côtés polaires et non polaires

GLANDES MURALES. PANCRÉAS
Le pancréas est un grand organe parenchymateux lâche, constitué de lobules individuels unis par du tissu conjonctif lâche. En poids, le fer représente 30 à 40 g, soit 0,20 à 0,25 % du poids corporel, et sa couleur est rose pâle.
Selon la structure du fer, il appartient aux glandes complexes tubulo-alvéolaires à sécrétion mixte. La glande n'a pas de contours clairs, car elle n'a pas de capsule, est étirée le long de la section initiale du duodénum et de la petite courbure de l'estomac, recouverte de péritoine ventro-caudalement, la partie dorsale n'est pas recouverte de péritoine.

Le pancréas est constitué de lobules exocrines et de parties endocrines.
Anatomiquement, la glande est divisée en corps, qui est situé dans le gyrus en forme de S du duodénum, gauche le lobe ou lobe gastrique, qui est adjacent à la petite courbure de l'estomac, se trouve dans le double de l'omentum et atteint la rate et le rein gauche, et lobe droit, ou lame duodénale, qui se trouve dans le double du mésentère du duodénum et atteint le rein droit.
Chez le chien, le lobe droit est très développé, de sorte que la glande a une forme allongée (en forme de ruban) courbée en angle. La glande a un principal (virzung) canal pancréatique, qui quitte le corps de la glande et s'ouvre à côté du canal biliaire au sommet de la papille duodénale (parfois le canal peut être absent),
et 1-2 conduits accessoires (Santorin), qui s'ouvrent à une distance de 3 à 5 cm du principal.
L'apport sanguin à la glande est assuré par les branches des artères splénique, hépatique, gastrique gauche et mésentérique crânienne, et l'écoulement veineux se produit dans la veine porte du foie.
L'innervation est réalisée par les branches du nerf vague et le plexus sympathique du pancréas (fibres postganglionnaires du ganglion semi-lunaire).
FONCTIONS DU PANCRÉAS
Le pancréas est responsable à la fois des fonctions exocrines et endocriniennes, mais dans le contexte de cette section, seules les fonctions digestives exocrines sont prises en compte.
Le pancréas exocrine est responsable de la sécrétion de sécrétions digestives et de grands volumes d'ions bicarbonate de sodium, qui neutralisent l'acidité du chyme provenant de l'estomac.
Produits de sécrétion :
Trypsine : décompose les protéines entières et partiellement digérées en peptides de différentes tailles, mais ne provoque pas la libération d'acides aminés individuels.
- la chymotrypsine : décompose les protéines entières et partiellement digérées en peptides de différentes tailles, mais ne provoque pas la libération d'acides aminés individuels.
- carboxypeptidase : clive les acides aminés individuels de l'extrémité amino des gros peptides.
- aminopeptidases : clive les acides aminés individuels de l'extrémité carboxyle des gros peptides.
- lipase pancréatique : hydrolyse les graisses neutres en monoglycérides et acides gras.
- amylase pancréatique : hydrolyse les glucides et les convertit en di- et trisaccharides plus petits.
6. Gros intestin (Intestinum crassum)
Le gros intestin est la dernière section du tube intestinal, mesure en moyenne 45 cm de long et est divisé en caecum, côlon et rectum. Il présente un certain nombre de caractéristiques, notamment une relative brièveté, un volume, une faible mobilité (mésentère court) et la présence d'une excroissance aveugle - le caecum - à la limite de la section mince.


1 - estomac
2, 3, 4, 5 - duodénum
6 - jéjunum
7 - iléon
8 - caecum
9, 10, 11 - côlon
12 - rectum

L'apport sanguin au côlon est assuré par les branches des artères mésentériques crâniennes et caudales, et le rectum est assuré par trois artères rectales : crânien(branche de l'artère mésentérique caudale), moyenne et caudal(branches de l'artère iliaque interne).
Le drainage veineux du caecum, du côlon et de la partie crânienne du rectum se produit dans la veine porte du foie. Depuis les parties moyenne et caudale du chat droit jusqu'à la veine cave caudale, en contournant le foie.
L'innervation de la section épaisse est assurée par les branches vague(position transversale du côlon) et nerfs pelviens(aveugle, la majeure partie du côlon et du rectum). La partie caudale du rectum est également innervée par le système nerveux somatique à travers les nerfs rectaux pudendal et caudal du plexus spinal sacré. L'innervation sympathique s'effectue à travers les plexus mésentériques et rectaux, qui sont formés par les fibres postganglionnaires des ganglions mésentériques semi-lunaires et caudaux.
Le contrôle musculaire du système nerveux s'effectue à la fois par des réflexes locaux et par des réflexes vagaux impliquant le plexus nerveux sous-muqueux et le plexus nerveux intermusculaire, situé entre les couches musculaires circulaires et longitudinales. La fonction intestinale normale est régulée par le système nerveux parasympathique. Le contrôle est dirigé de la partie médullaire du nerf vague vers la partie antérieure et depuis les noyaux de la colonne sacrée.
à travers le nerf pelvien jusqu'à la partie périphérique du gros intestin.
Le système nerveux sympathique (contrôle dirigé depuis les ganglions du tronc sympathique paravertébral) joue un rôle moins important. Les processus de contrôle local et de coordination de la motilité et de la sécrétion de l'intestin et des glandes associées sont de nature complexe, impliquant les nerfs, les produits chimiques paracrines et endocriniens. L'apport nerveux de la petite section est représenté par des branches du nerf vague et des fibres postganglionnaires du plexus solaire issues du ganglion semi-lunaire, qui forment deux plexus dans la paroi intestinale : intermusculaire (Auerbach) entre les couches de la couche musculaire et sous-muqueuse ( Meissner) dans la couche sous-muqueuse.
Le contrôle de l'activité intestinale par le système nerveux s'effectue à la fois par des réflexes locaux et par des réflexes vagaux impliquant le plexus nerveux sous-muqueux et le plexus nerveux intermusculaire.
La fonction intestinale est régulée par le système nerveux parasympathique. Le contrôle est dirigé de la partie médullaire du nerf vague vers l’intestin grêle. Le système nerveux sympathique (contrôle dirigé depuis les ganglions du tronc sympathique paravertébral) joue un rôle moins important.
Les processus de contrôle local et de coordination de la motilité et de la sécrétion de l'intestin et des glandes associées sont de nature plus complexe : les nerfs, les produits chimiques paracrines et endocriniens y participent.
Les anses du gros intestin sont situées dans les cavités abdominale et pelvienne.
MEMBRANES DU GROS INTESTIN
La structure du côlon se compose de plusieurs couches : la membrane muqueuse, la couche sous-muqueuse, la couche musculaire (2 couches - couche longitudinale externe et couche circulaire interne) et la séreuse.
L'épithélium du caecum ne contient pas de villosités, mais possède à la surface de nombreuses cellules caliciformes qui sécrètent du mucus.
La membrane muqueuse ne présente pas de villosités ni de plis circulaires, c'est pourquoi elle est lisse. Les villosités ne sont présentes qu’à l’état embryonnaire et disparaissent peu après la naissance. Ceci est parfois observé chez certains chiens dans les premiers jours de la vie, et chez la plupart des individus dès la fin de la deuxième semaine.
On distingue les types de cellules suivants dans la membrane muqueuse : les cellules épithéliales intestinales à bordure striée, les entérocytes caliciformes, les entérocytes sans bordure - source de restauration de la membrane muqueuse et les endocrinocytes intestinaux uniques. Les cellules de Paneth, présentes dans l’intestin grêle, sont absentes dans le gros intestin.
Les glandes intestinales (Lieberkühn) sont bien développées, profondes et proches les unes des autres, et il y a jusqu'à 1 000 glandes pour 1 cm2.
Les ouvertures des glandes de Liberkühn donnent à la muqueuse un aspect inégal. Dans la partie initiale de la section épaisse, il y a une accumulation d'éléments lymphoïdes qui forment des plaques et des champs lymphatiques. Un champ étendu est situé dans le caecum au confluent de l'iléon, et des plaques sont situées sur le corps du caecum et à son extrémité aveugle.
La couche musculaire de la section épaisse est bien développée, ce qui donne à l'ensemble de la section épaisse un aspect épais.
FONCTIONS DE LA SECTION ÉPAISSE
Les débris alimentaires non digérés pénètrent dans le gros intestin et sont exposés à la microflore qui l'habite. La capacité digestive du gros intestin du chien est négligeable.
Certains excréments (urée, acide urique) et sels de métaux lourds sont libérés par la membrane muqueuse du gros intestin ; l'eau est intensément absorbée, principalement dans la partie initiale du côlon. La section épaisse est fonctionnellement plus un organe d'absorption et d'excrétion que de digestion, ce qui laisse une empreinte sur sa structure.
PARTIES DU GROS INTESTIN
Le gros intestin est constitué de trois parties principales : caecum, côlon Et rectum.


CAECUM
Structure
Le caecum est une excroissance aveugle située à la limite des sections fines et épaisses. Le foramen iliaque est bien marqué et représente un mécanisme obturateur.
L’ouverture coecumcolique de sortie n’est pas clairement définie et ne dispose pas de mécanisme de verrouillage. Le caecum chez le chien est considérablement réduit. Il a l'apparence d'un appendice alambiqué, faisant de 1 à 3 boucles, ses parois sont enrichies en éléments lymphoïdes, mais l'intestin ne possède pas d'appendice vermiforme, caractéristique des primates supérieurs. Selon la taille et le nombre de boucles, on distingue 5 types de caecum du chien.
Topographie
L'intestin pend au mésentère droit dans la région lombaire sous les 2 à 4 vertèbres lombaires, sa longueur varie de 2 à 16 cm, soit 11 % de la longueur de la section épaisse.
Le caecum forme une poche fermée à une extrémité située sous la jonction du gros et du petit intestin. Chez le chat, le caecum est un organe vestigial, tandis que chez le chien, la taille du caecum est importante.
CÔLON
Structure
Le côlon constitue le volume principal de la section épaisse.
Il atteint environ 30 cm de longueur, soit 66,7 % de la longueur totale de la section épaisse. L'intestin est très étroit (plus étroit que le duodénum), mais à parois épaisses. La forme forme un rebord situé dans le plan frontal, sous la colonne vertébrale, qui ressemble en apparence à un fer à cheval.
Le côlon est constitué de trois sections relativement droites : le côlon ascendant, le côlon transverse
et le côlon descendant, qui continue dans le rectum.
Topographie
Le côlon commence à droite dans la région lombaire et s'étend dans la partie dorsale de l'ilion droit en ligne droite jusqu'au diaphragme en tant que côlon ascendant.
Derrière le diaphragme (dans l'hypocondre), il forme une courbure transversale - le côlon transverse et, se déplaçant vers la gauche, s'étend caudalement dans la partie dorsale de l'iliaque gauche comme le côlon descendant. Ayant atteint l'aine gauche, le côlon sigmoïde forme un coude sigmoïde et passe dans le rectum.
RECTUM
Structure
Le rectum est le dernier segment du gros intestin. La longueur du rectum est d'environ 10 cm, soit 22,2 % de la longueur du côlon. L'intestin est suspendu au mésentère et, dans la cavité pelvienne, il est entouré de tissu conjonctif lâche (tissu pararectal).
Dans la cavité pelvienne, l'intestin forme une ampoule peu développée.
Le rectum a des parois lisses, élastiques et épaisses, avec une couche musculaire uniformément développée. La membrane muqueuse est rassemblée en plis longitudinaux et contient des glandes de Lieberkühn modifiées et de nombreuses glandes muqueuses qui sécrètent de grandes quantités de mucus.
Il existe de nombreux plexus veineux dans la couche sous-muqueuse, grâce auxquels l'eau et les solutions aqueuses du rectum sont bien et rapidement absorbées.
Topographie
Se trouve sous le sacrum et la première vertèbre caudale, se terminant par l'anus.
Anus
La partie périnéale du rectum s’appelle le canal anal. La membrane muqueuse du rectum 2-3 cm avant l'anus se termine par la ligne ano-rectale, caudale à partir de laquelle commence l'épithélium pavimenteux stratifié. Dans cette zone, deux zones en forme d'anneau se forment. La zone interne est appelée zone colonnaire de l'anus, dont les plis longitudinaux sont appelés colonnes anales. Entre eux se forment des dépressions - des sinus anaux, dans lesquels s'accumule le mucus sécrété par les glandes anales.
La zone externe est appelée zone intermédiaire, qui est séparée de la zone cutanée de l'anus par la ligne cutanée anale.
Dans ce dernier cas, les glandes circonférentielles et les sinus paranaux s'ouvrent. Le rectum et l'anus ont leur propre appareil musculaire, qui dans la région anale est représenté par deux sphincters : externe et interne. Le premier est une accumulation de tissu musculaire lisse autour de l’anus, formé à partir de la couche musculaire du rectum, et le second est un muscle strié. Les deux sphincters fonctionnent de manière synchrone.
Un certain nombre de muscles s'étendent de l'anus vers les côtés :
Le muscle rectal-queue est représenté par une couche longitudinale de la musculature rectale, qui passe des parois du rectum à la première vertèbre caudale ;
- releveur de l'anus - provient de la colonne ischiatique et va du côté du rectum aux muscles de l'anus ;
- ligament suspenseur de l'anus - provient de la 2ème vertèbre caudale et recouvre en forme d'anse le rectum par le bas ; construit de tissu musculaire lisse; chez les hommes, il devient un écarteur du pénis ; et chez les femelles, il se termine dans les lèvres.
Dans cet article, j’examinerai les caractéristiques structurelles du squelette interne du chien et en quoi il diffère de l’anatomie des autres animaux. Je vais vous parler en détail de chaque section du squelette. J'indiquerai le nombre total d'os que possède l'animal.
La structure anatomique est nécessaire à l'étude de tous les propriétaires de chiens, car ce sont des animaux assez mobiles. Et la structure du squelette joue un rôle important et revêt une grande importance.
Le squelette est la base à laquelle sont attachés tous les tissus mous. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de muscles et d'articulations, ici tout est pensé par la nature si subtilement que c'est le squelette qui est responsable de la variété des mouvements.
Structure squelettique d'un chienComment fonctionne le squelette interne d'un chien ?
Colonne supérieure (cou). Il se compose de sept os vertébraux. Le tout premier s’appelle « Atlas » (traduit du latin « Atlas »). Il se distingue des autres par sa forme annulaire et assure la mobilité verticale de la tête. La deuxième vertèbre est appelée « épistrophie » et est responsable des mouvements horizontaux de la tête de l’animal.
La tête du chien peut pivoter à 350 degrés.
Département thoracique.
Il se compose principalement de 13 vertèbres, mais il existe des individus dotés de douze vertèbres.
Les côtes sont attachées aux apophyses transverses des vertèbres de cette section. Les apophyses épineuses des vertèbres 1 à 10 sont dirigées vers la queue, mais la onzième est appelée diaphragmatique. Son apophyse épineuse est dirigée vers le haut. Ces mêmes processus de la 12e à la 13e vertèbre sont dirigés vers la tête de l'animal.
 Comparaison des squelettes humains et canins
Comparaison des squelettes humains et canins Région lombaire ou lombaire. Ces vertèbres sont ovales. Leurs processus sont longs, plats, en forme de ruban, transversaux - les articulations costales sont superbement développées.
Cette section compte principalement sept vertèbres, mais il existe également des représentants avec six.
Les apophyses épineuses des vertèbres lombaires sont dirigées vers la tête. La longueur de chacun (jusqu'au cinquième) augmente progressivement, puis se raccourcit immédiatement.
Le sacrum est la fusion de trois ou quatre vertèbres sacrées en un seul os. La fonction principale de cette partie de la colonne vertébrale est de relier fermement la colonne vertébrale aux membres postérieurs.
Les os du sacrum fusionnent enfin entre 2 et 2,5 ans.
Chez les femmes, le sacrum est plus long et plus large que chez les hommes. Ces tailles sont dues à la fonction reproductrice des femelles. Dans cette partie de la colonne vertébrale, les apophyses vertébrales se fondent dans la crête du même nom.
Dans la plupart des cas chez le chien, l'apophyse vertébrale de la première vertèbre sacrée reste séparée.
 Les os de la queue soutiennent les muscles qui font remuer la queue du chien.
Les os de la queue soutiennent les muscles qui font remuer la queue du chien. Queue. Les quatre premières vertèbres sont bien développées. Ils sont dotés de toutes les caractéristiques correspondantes, comme les vertèbres ordinaires. De plus, les vertèbres de la région caudale servent uniquement à attacher les muscles qui permettent le mouvement de la queue.
Différentes races ont un nombre différent d'os vertébraux dans la queue. Leur nombre est généralement de 20 à 23, dans des cas plus rares de 15 à 25.
En cas de lésions de la colonne vertébrale ou de pathologies congénitales, un traitement est prescrit.
La ceinture scapulaire comprend les os de l'omoplate et les rudiments de la clavicule. L'os de l'omoplate est attaché au corps du chien, près de la première paire de côtes. Grâce à cette ceinture, les membres antérieurs sont attachés au squelette.
 Comparaison des os de membres d'animaux
Comparaison des os de membres d'animaux Membres. Les chiens n'ont que quatre pattes.
Ces animaux ont des membres thoraciques et pelviens.
La ceinture pectorale des membres est constituée de :
- L'épaule, qui est constituée de l'humérus.
- L'avant-bras comprend les os du cubitus et du radius.
- Brosse. Il se compose de sept os carpiens, de cinq os métacarpiens et de phalanges. Le chien a cinq orteils, constitués de trois phalanges.
Le doigt arrière est le premier doigt et n'a que deux phalanges. Certaines races de chiens peuvent ne pas en avoir du tout.
La ceinture pelvienne comprend :
- Os pelviens (iliaques, pubiens, ischiatiques).
- Les hanches sont constituées du fémur et de la rotule.
- Le tibia comprend le tibia et le péroné.
- Arrêt. Il se compose de sept os tarsiens et de cinq os métatarsiens. Les phalanges des doigts et leur structure sont les mêmes que celles de la région thoracique.
 Os pelvien de chien
Os pelvien de chien Anatomie du crâne d'un chien
Crâne et dents. La connexion des os du crâne est mobile. C'est ce qui donne à l'animal la capacité de mâcher, de ronger, etc.
Les chiens adultes ont quarante-deux dents, les chiots vingt-huit dents de lait.
La formule dentaire comprend : les canines, les incisives, les molaires et les prémolaires.
La morsure est influencée par la race et les standards de la race.
 Formes de morsure chez le chien
Formes de morsure chez le chien - En forme de ciseaux. Ici, les incisives inférieures semblent se trouver sous les incisives supérieures et sont également étroitement liées les unes aux autres.
- Morsure en pince – Cette forme de morsure se produit lorsque les incisives se rapprochent.
Les chiens diffèrent les uns des autres par leur morsure.
- Droit. Les incisives sont superposées.
- Collation. La mâchoire inférieure dépasse vers l’avant et les dents ne s’alignent pas.
 Structure du crâne
Structure du crâne La structure du crâne est directement liée à la race du chien et à son âge. Aujourd’hui, beaucoup sont capables de distinguer par la forme du crâne à quelle race appartient un individu particulier.
Il existe deux types dans lesquels tous les chiens de garde sont divisés :

La structure du crâne contient des os appariés et non appariés.
Les os non appariés comprennent les os « ptérygoïdiens », « occipitaux », hyoïdes, ainsi que le « vomer ». De plus, le squelette comprend et n'a pas de paire d'os ethmoïde et de sphénoïde avec l'interpariétal.
Les paires comprennent deux os de la mâchoire supérieure, les os de la pommette, lacrymal, nasal, palatin et deux autres os incisifs, les os de la mâchoire inférieure, le frontal, la couronne et les tempes.
Caractéristiques structurelles
 Moment de la croissance osseuse
Moment de la croissance osseuse Le squelette de n’importe quelle race remplit la fonction la plus importante. Ce n'est pas seulement la base de tout l'organisme, c'est un levier qui assure le mouvement et il remplit également une fonction de soutien pour tous les organes, muscles et systèmes de l'animal.
Le squelette est impliqué dans presque tous les processus biologiques du corps de l'animal.
Le tissu osseux est solide et léger par rapport aux autres systèmes du corps de l’animal.
Combien y a-t-il d’os ?
Au total, le squelette du chien est constitué de 247 os et 262 articulations.
Chez l’humain, il n’y a que 205 à 207 os et environ deux cents articulations. le même nombre d'os est d'environ 244 pièces.
Le squelette du chien est unique par sa composition et ses fonctions. Grâce à lui, ces animaux sont mobiles et actifs. Ils ont une bonne coordination et peuvent être très résilients.
Si vous n'êtes pas vétérinaire, vous ne savez peut-être pas certaines choses sur les organes internes de votre animal ou, par exemple, sur la structure du squelette. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins intéressant. Au contraire, je suis curieux, quelle est l'anatomie d'un chien ? L'article devant vous vous aidera à trouver des réponses complètes à toutes vos questions.
Structure squelettique
Pour comprendre en quoi « consiste » un chien, nous analyserons progressivement la structure de son squelette. Le squelette ou la colonne vertébrale - qu'il s'agisse d'un chien ou d'un humain - constitue la base du corps, car les os, le cartilage et les ligaments jouent des rôles biologiques, moteurs et mécaniques importants.
Le squelette protège les organes du chien de diverses blessures et grâce à lui, l’animal peut bouger. Nous examinerons plus en détail la structure du squelette d'un chien ci-dessous.
Godille
L'anatomie prévoit la division du crâne en deux lobes : le facial et le cerveau, constitués de 27 os, chacun étant équipé de tissu conjonctif - cartilage et ligaments. Un chien naît avec un tissu élastique qui devient dur et ossifié à mesure qu'il grandit.
En raison de la mobilité de la connexion osseuse, la mâchoire inférieure est adjacente au crâne. Ce mécanisme permet à votre animal de mâcher facilement de la nourriture, de ronger des os, etc. Les chiens adultes ont 42 dents, les chiots 28. La formule dentaire comprend des canines, des incisives, des molaires et des prémolaires. Les chiens ont aussi des morsures différentes. Cela dépend de la race et du standard fixé par la race.
Il existe ces types de morsures :
- En forme de ciseaux. Dans le cas de cette morsure, les incisives supérieures, recouvrant les inférieures, sont étroitement liées les unes aux autres.
- En forme de pince - les incisives convergent.
- Droit. Il existe également une morsure directe, lorsque les incisives des mâchoires supérieure et inférieure se chevauchent.
- Sous-morsure. La mâchoire supérieure est plus éloignée que la mâchoire inférieure, il y a donc un grand espace entre les dents.
- Collation. Cette morsure est déterminée par la mâchoire inférieure. Il avance, donc les incisives ne coïncident pas et un espace se forme entre elles. Les collations sont également divisées en collations denses et inutiles. Les brachycevuls ont une morsure principalement sous-occlusion. Le bouledogue et le dépassement sont quelque peu différents : le dessous se produit lorsque la mâchoire inférieure s'étend au-delà de la mâchoire supérieure, et le bouledogue se produit lorsque la mâchoire inférieure ne sort pas simplement, mais est légèrement pliée vers le haut.
La race et l'âge affectent le crâne d'un chien. Au fil du temps, les gens ont appris à reconnaître certaines races de chiens grâce à la structure unique du crâne.
Par exemple, selon la forme du crâne, qui est significative en particulier dans la partie faciale, les chiens sont répartis dans les types suivants :

Les animaux avec une partie réduite du crâne sont appelés brachycéphales. Leurs représentants sont les carlins, les Sharpeis, les Pékinois et d'autres chiens avec des parties faciales similaires du crâne.
Le crâne brachycéphale possède un os pariétal large, un museau aplati et une mâchoire saillante. Cette structure du crâne a été délibérément obtenue grâce à un élevage sélectif. La conséquence de ces expériences est de nombreux problèmes liés à la santé des chiens, par exemple une perturbation de la structure des voies respiratoires.
En raison du museau trop court de l'animal, cela a entraîné des problèmes respiratoires. Les brachycéphales souffrent souvent d'un collapsus trachéal, d'une hypertension pulmonaire et d'une hyperactivité des glandes lacrymales. Le syndrome brachycéphale est un concept introduit spécifiquement pour désigner la race de ces chiens.
Torse
Le crâne est attaché au squelette du corps à l’aide de vertèbres. Le corps du chien est également constitué de vertèbres et de côtes reliées entre elles. Le reste du squelette est attaché à cette structure osseuse.
La crête se compose de sections :

La queue de l'animal est constituée de vertèbres mobiles, qui comprennent 20 à 25 parties. La partie thoracique est constituée de 13 paires de côtes. Ce sont les côtes qui protègent les organes internes de l'animal comme un bouclier, les maintenant dans une certaine position qui n'affecte pas la santé.
Il est à noter que 4 paires de côtes forment l'arc costal, tandis que les 9 autres sont directement attachées au sternum. Les côtes des chiens ont différents degrés de courbure, et tout dépend directement de la race.
Dans le bas du dos se trouvent de grandes vertèbres sur lesquelles des processus peuvent être notés. Grâce à ces processus, les muscles, les tendons et les ligaments sont attachés aux vertèbres. Ils maintiennent les organes internes de l'animal dans la bonne position. L'anatomie du squelette d'un chien est présentée en détail sur l'image.
Image de squelette de chien
Membres
Les membres des chiens ont une anatomie très complexe, car ils contiennent de nombreux os, muscles, ligaments élastiques et autres éléments différents. Les membres antérieurs assurent le soutien du corps, car ce sont les pattes avant qui supportent le poids de l'animal. Ils constituent une continuation de l'omoplate qui, à travers l'articulation, se jette dans l'humérus.
Vient ensuite l’avant-bras, constitué du radius et de l’humérus. Ils sont reliés par l'articulation du coude. Vient ensuite l’articulation du carpe, composée de 7 os. Il est relié aux 5 os de la main. La main a l'apparence suivante : cinq doigts, dont 4 ont trois phalanges et 1 n'en a que deux.
Chaque doigt a une griffe qui n'est pas tirée vers l'intérieur et est constituée de tissus solides. Les pattes avant, à l'aide des muscles des épaules, sont attachées à la vertèbre du chien. Grâce aux omoplates qui dépassent des vertèbres du sternum, l'animal crée un garrot - c'est un indicateur de taille. Les membres postérieurs comprennent le fémur et le tibia.
Ces éléments sont maintenus ensemble par les articulations de la hanche et du genou. Le tibia lui-même est constitué du tibia et du péroné et, avec l'aide de l'articulation du jarret, de structure complexe, est attaché au tarse. Cette partie du pied va dans une autre - le métatarse, et se termine par 4 orteils avec trois phalanges. Il existe également des griffes qui n'ont pas de propriétés rétractables. Dans la vidéo d'Alisa Gagarinova, vous pouvez voir l'anatomie des muscles d'un chien.
Les organes internes
Le prochain point après l'étude du squelette sera le « monde intérieur » du chien.
Système digestif
L’anatomie du système digestif est similaire à celle des autres mammifères, dont les humains. Cela part de la cavité buccale, qui est équipée de dents solides et pointues. Ils sont conçus pour déchirer des aliments, couper des os et bien plus encore.
Dès qu’un chien sent une nourriture attrayante, il produit immédiatement de la salive. L'animal avale parfois de la nourriture entière, sans même la mâcher. Il suit l'œsophage jusqu'à l'estomac, où le suc gastrique et les enzymes transforment les aliments en chyme, une masse homogène.
Le système digestif d’un animal sans problème de santé détermine clairement le moment où la nourriture doit pénétrer dans les intestins. Les valves gastriques empêchent les aliments de retourner dans l’œsophage ou les intestins jusqu’à ce qu’ils soient digérés. Les intestins s’en mêlent et collaborent avec le foie et le duodénum.
Les enzymes pancréatiques, continuant à influencer les aliments, en isolent des substances utiles, qui sont absorbées par les parois intestinales. Après cela, les nutriments pénètrent dans le sang.
Les aliments transformés se déplacent en toute confiance vers le gros intestin. À ce stade, il ne reste plus rien d’utile. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir une image du système digestif d'un animal.
Anatomie du système digestif du chien
Système respiratoire
La respiration joue un rôle important chez tous les êtres vivants, car grâce au système respiratoire, le corps reçoit de l'oxygène et produit du dioxyde de carbone. Le système respiratoire est divisé en deux sections : supérieure et inférieure. L'air commence à circuler dans les narines, dont les caractéristiques sont influencées par la race du chien.
Ensuite, dans le nasopharynx, l’air est réchauffé et filtré, le débarrassant ainsi des germes. Le mouvement de l'air se poursuit ensuite à travers le larynx puis la trachée. La partie inférieure du système respiratoire est constituée des poumons et des bronches. Les poumons enrichissent le corps en oxygène. Ils sont constitués de 7 lobes élastiques qui, grâce à la contraction du diaphragme et des muscles, sont capables de changer de volume au cours de la respiration.
L'air circule constamment dans les alvéoles et est ainsi remplacé par de l'air frais. La fréquence respiratoire dépend de la race du chien, de son état de santé et d'autres facteurs (l'auteur de la vidéo sur l'anatomie des poumons d'un chien est Alexander Lyakh).
Système circulatoire
Le centre de la vie dans le corps est le cœur. Il s’agit d’un organe puissant constitué de muscles et situé entre la 3e et la 6e côte, juste devant le diaphragme. Le cœur se compose de deux parties et de quatre chambres. Les deux parties du cœur possèdent leurs propres oreillettes et ventricules. Le sang artériel circule dans le lobe gauche du cœur et le sang veineux dans le lobe droit.
Le flux sanguin passe par différentes veines : le côté gauche du cœur est enrichi en sang grâce aux veines pulmonaires, le côté droit - la veine cave. Le lit artériel est saturé d'oxygène et se jette dans l'aorte. Le flux sanguin ne ralentit ni ne s’arrête. Le chemin du sang va des oreillettes aux ventricules, puis aux vaisseaux artériels.
Le système circulatoire du chien
Les parois du cœur sont constituées de l'endocarde, de l'épicarde et du myocarde - respectivement les parois interne et externe du cœur et le muscle cardiaque. Entre autres choses, cet organe possède un appareil valvulaire qui contrôle la direction du flux sanguin et garantit que le sang artériel ne se mélange pas avec le sang veineux.
Comme d’autres organes, la taille et le fonctionnement du cœur dépendent de l’âge, de la race et du sexe du chien. L'environnement et les autres créatures avec lesquelles l'animal entre en contact jouent également ici un rôle important.
Le travail du cœur est déterminé par le pouls. Son indicateur doit être compris entre 70 et 120 battements par minute, ce qui indique un cœur sain et fort. Les chiens jeunes et en bonne santé ont généralement un rythme cardiaque plus rapide car le muscle cardiaque se contracte plus fréquemment.
Anatomie du système circulatoire
Le système circulatoire est constitué de nombreux capillaires et vaisseaux sanguins. Ils entrelacent étroitement tout le corps de l'animal et chaque organe. Grâce à cela, le sang communique avec le cœur. Ce qui est intéressant c'est que pour 1 m². mm. Le tissu comporte plus de 2 500 capillaires et le volume sanguin total dans le corps de l'animal représente environ 6 à 13 % du poids corporel.
Système excréteur
La base du système excréteur d'un chien (comme de nombreux autres êtres vivants) sont les reins. Il s'agit d'un schéma assez complexe où, à l'aide des uretères, les reins sont en contact avec la vessie et l'urètre.
Grâce à ce système, l'urine se forme et s'accumule, qui finit par être excrétée par le corps. Cela se produit afin de nettoyer le corps des produits métaboliques. S’il y a des irrégularités dans le système, cela peut entraîner des problèmes de santé.
Les néphrons des reins nettoient et filtrent le sang. En vieillissant, le tissu néphron se dégrade et est remplacé par des cicatrices. Pour cette raison, les maladies rénales sont fréquentes chez les chiens âgés.
Anatomie du système excréteur du chien
Système reproducteur
Les systèmes reproducteur et excréteur sont étroitement liés. Chez l’homme, le canal urinaire est également le canal séminal. Pour se reproduire, les hommes ont besoin de testicules, d’un organe génital externe et d’une prostate qui maintiennent la viabilité des spermatozoïdes à un niveau approprié.
L'organe reproducteur mâle se compose d'une tête, d'un corps et d'une racine. Il est recouvert par le sac préputial, mais au moment de l'excitation, l'organe est libéré du sac, ce qu'on appelle une érection. Chez la femme, l’organe reproducteur s’appelle l’utérus. Il s'agit de processus auxquels sont attachés les ovaires, où mûrissent l'ovule, les trompes de Fallope et le vagin.
Système nerveux
Le système nerveux existe en deux types : central et périphérique. Le central comprend le cerveau et la moelle épinière, le périphérique comprend les fibres qui enchevêtrent tout le corps.
Les faisceaux de telles terminaisons sont appelés troncs nerveux ou nerfs. Ils sont divisés en afférents, qui envoient des impulsions sur l'état des organes au cerveau, et en efférents, qui agissent dans l'autre sens.
Les nerfs efférents envoient des impulsions cérébrales au corps. La cellule nerveuse constitue la base du système nerveux. Il dispose de processus grâce auxquels il est capable d’envoyer des impulsions. Cela se produit lorsqu'un tel processus d'une cellule nerveuse entre en contact avec un émetteur d'impulsions (médiateur). Grâce aux cellules nerveuses, les informations parviennent au cerveau à une vitesse d'environ 60 m/s.
Système nerveux périphérique du chien
Organes sensoriels
Après une analyse approfondie du squelette du chien, de ses systèmes et organes internes, nous avons abordé les sens, qui sont très développés. Un chien entend mieux qu’un humain et n’importe qui peut envier son odorat. Examinons de plus près les sens du chien.
Structure de l'oeil
L'anatomie de l'œil d'un chien est très similaire à celle de l'œil humain : c'est le même organe sensoriel. Il y a beaucoup de similitudes. L'œil d'un ami à quatre pattes est constitué de la cornée, du cristallin et de la rétine, c'est-à-dire de trois membranes : fibreuse, vasculaire et rétinienne.
Il est à noter que le chien n'a pas de tache jaune. Pour cette raison, la vision de l'animal est bien pire que celle des humains. Mais le chien peut voir dans le noir. Le principe de la vision chez un chien est le suivant : un rayon de lumière traverse la cornée de l'œil. Il tombe sur la rétine et est perçu par les bâtonnets et les cônes.
Structure anatomique de l'œil d'un animal
Structure de l'oreille
Le prochain avantage des chiens par rapport aux humains est une excellente audition. Le chien analyse le son à travers son oreille externe. Le son voyage ensuite jusqu’à l’oreille moyenne et termine son voyage dans l’oreille interne. L'oreille externe est constituée du pavillon, un organe cartilagineux à travers lequel l'animal absorbe les sons. Après l'oreillette se trouve le conduit auditif, qui se compose de deux parties : horizontale et verticale.
Le conduit auditif est comme un tunnel à travers lequel le son se propage vers le tympan. La peau de ce canal est constituée de glandes qui, entre autres, provoquent également la croissance des poils dans l'oreille.
Le tympan joue également un rôle important : il divise l'oreille et capte les ondes acoustiques. L'oreille moyenne contient les os auditifs, qui sont attachés à la membrane du tympan, et l'oreille interne.
L’oreille interne contient des récepteurs auditifs et l’appareil vestibulaire, qui contribuent au maintien de l’équilibre. Grâce au travail de l'oreille interne, se forment des informations qui pénètrent dans le cerveau.
Structure anatomique de l'oreille d'un animal
Structure du nez
Tout comme l’oreille, qui capte les sons avec une grande précision, le nez du chien fonctionne à pleine capacité. Cela permet à l’animal de se créer un certain portrait de son environnement, car l’animal est également guidé par l’odorat.
Grâce à l'odeur, l'animal reconnaît son propriétaire ou un animal ennemi.
Et grâce à cette propriété de capter l'odeur à grande distance, certains chiens sont dressés pour attraper les criminels et simplement aider une personne dans la vie de tous les jours.
Le nez d'un chien est équipé de nombreux récepteurs sensibles. Il existe 125 millions de ces récepteurs olfactifs, alors que le nez humain n’en compte que 5 millions. Les humains et les chiens ont du mucus dans le nez qui recouvre l’intérieur des parois nasales. Chez le chien, il s’étend, entre autres, jusqu’à l’extérieur du nez, ce qui rend le nez de l’animal si humide.
L’odeur pénètre dans le corps du chien par les narines, et c’est grâce à elles que l’animal capte tel ou tel arôme. La majeure partie de l’air que le chien inhale passe par les découpes latérales du nez.
Le nez de l'animal se compose d'un nez externe et d'une cavité nasale divisée en trois sections : supérieure, moyenne et inférieure. La partie supérieure du nez du chien est l'endroit où se trouvent les récepteurs olfactifs. La partie inférieure conduit l'air inhalé vers le nasopharynx, où il commence à se réchauffer.
La partie externe du nez, qui est souvent humide de mucus, est appelée le plan nasal. Chaque chien possède un tel "miroir" avec un motif unique, grâce auquel vous pouvez distinguer un chien d'un autre.
Comparé au monde canin, le monde humain n’est pas si diversifié en termes d’odeurs.
galerie de photos
 Photo 1. Anatomie d'un chien
Photo 1. Anatomie d'un chien  Photo 2. Anatomie musculaire d'un chien
Photo 2. Anatomie musculaire d'un chien  Photo 3. Système reproducteur féminin
Photo 3. Système reproducteur féminin
Vidéo «Muscles de la ceinture scapulaire»
Dans la vidéo fournie par Alexander Lyakh, vous pouvez étudier l’anatomie des muscles d’un chien.
Squelette axial et périphérique du chien. Objectif, composants.
Le squelette joue un rôle important dans la vie du corps. Il sert de levier de mouvement, de support pour les parties molles du corps, de protection, de lieu de développement des organes hématopoïétiques, et participe également aux processus métaboliques et biochimiques de l'organisme. Le squelette est unique dans sa structure. Le squelette est une structure rigide constituée d'os individuels reliés les uns aux autres par des articulations ou immobiles. Des muscles sont attachés au squelette, provoquant le mouvement de certaines parties de celui-ci, ce qui permet à l'animal de se déplacer dans l'espace. Les caractéristiques distinctives du système squelettique sont la résistance et la légèreté par rapport aux autres tissus. Les jeunes animaux ont des os plus élastiques que les plus âgés. En vieillissant, les os deviennent plus fragiles.
Le système musculo-squelettique est constitué des os du squelette, des articulations avec des ligaments et des muscles avec des tendons. Le mouvement se manifeste sous la forme d'un changement de position des articulations sous l'influence de la contraction des muscles squelettiques, qui servent de moteurs à chaque articulation, ou s'effectuent sans la participation de l'appareil ostéoarticulaire par les muscles seuls (fermeture et ouverture les paupières, le travail des muscles du visage, etc.). Dans les os, les muscles et les tendons se trouvent des terminaisons nerveuses spéciales, des récepteurs qui envoient des impulsions aux cellules situées à différents niveaux du système nerveux central. Ils sont abondamment alimentés en vaisseaux sanguins et lymphatiques. À cet égard, le manque d'activité physique suffisante réduit la quantité d'énergie mécanique et, par conséquent, l'innervation et la circulation sanguine dans le corps sont perturbées, l'envoi d'impulsions au cerveau se détériore, l'écoulement des produits métaboliques de tous les organes du corps ralentit. vers le bas et leur métabolisme est perturbé.
Les recherches de ces dernières années ont montré que l’état du squelette peut être utilisé pour juger de la santé des animaux : le squelette est appelé miroir, reflétant l’état du corps.
- Le degré de développement du squelette est d'une grande importance dans la vie de l'animal. Ce n'est pas seulement une structure de support rigide, elle produit également du sang ; une partie de celle-ci, la moelle osseuse rouge, produit les éléments formés du sang, notamment les globules rouges qui effectuent les échanges gazeux, et les cellules souches qui, à mesure qu'elles se développent, forment en outre des cellules immunitaires protectrices qui assurent la vitalité de l'organisme.
- La moelle osseuse, en plus de la formation d'éléments sanguins (érythrocytes et leucocytes), produit des cellules immunitaires protectrices qui assurent la vitalité de l'organisme.
- Ils agissent comme un dépôt de substances minérales, maintiennent l'alcalinité de réserve du sang et l'équilibre électrolytique de l'organisme.
- Sous l'influence d'une forte diminution de l'activité motrice, une atrophie musculaire se produit, la structure osseuse change, la quantité de tissu adipeux augmente, les processus métaboliques sont perturbés et la structure et l'état du système nerveux central changent. Le squelette, qui est le premier à subir les effets du stress physique qui se produit lors du mouvement, souffre grandement de l'inactivité physique.
- Le squelette fournit un certain rapport de Ca et P dans le sang et, enfin, il assure l'équilibre électrolytique du corps. Tout au long de la vie, le squelette est reconstruit, détruit et restauré et, comme il s'est avéré, toutes ces fonctions du squelette se sont développées en relation avec le mouvement de l'animal et en sont devenues dépendantes.
- Des études ont montré que le manque d'activité physique nécessaire entraîne une perturbation des processus d'hématopoïèse et de métabolisme dans les os, ce qui entraîne des maladies chez l'animal, un relâchement des os, leur ramollissement - déminéralisation et une diminution de la résistance des os. L'animal perd la capacité de se déplacer. Les déformations élastiques des os qui se produisent lors du mouvement entraînent des tensions dans les fibres de collagène, sans lesquelles la minéralisation osseuse ne se produit pas. Et il en résulte que si l'os ne subit pas la dose nécessaire, au moins minimale, d'énergie mécanique, les processus normaux de formation osseuse, d'hématopoïèse, de métabolisme et d'équilibre électrolytique ne pourront pas s'y produire.
- La nature des processus métaboliques minéraux dans le corps d'un chien est jugée par le degré de développement des os dans la région du métacarpe, du métatarse, la gravité des articulations du carpe et du jarret et l'état des dents.
- La courbure des os de l'avant-bras, la nodularité des articulations du poignet sont un signe de rachitisme.
- Des disproportions dans le développement des os et d’autres organes ou parties du corps indiquent un dysfonctionnement du système hormonal.
- Le sous-développement des os du visage du crâne, la faible expression des tubercules sur les os indiquent des troubles plus profonds du métabolisme minéral et général du corps. Ceci est également mis en évidence par l'absence de dents individuelles, la destruction de l'émail, les incisives petites ou non situées sur la même ligne, ainsi que tous les écarts par rapport à l'occlusion normale.
- Les défauts et défauts énumérés peuvent être héréditaires.
Le squelette d'un chien se compose de 289 à 292 os (les fluctuations de leur nombre sont associées aux vertèbres caudales et à 262 articulations. Des os de formes diverses, reliés entre eux par des ligaments, du cartilage ou du tissu osseux dans des sections aussi grandes que la colonne vertébrale, le crâne et squelette des membres.
Le squelette est divisé en :
Riz. 1. Squelette d'un chien : 1 - mâchoire supérieure ; 2 - mâchoire inférieure ; 3 - crâne; 4 - os pariétal; 5 - protubérance occipitale ; 6 - vertèbres cervicales ; 7 - vertèbres thoraciques ; 8 - vertèbres lombaires ; 9 - vertèbres caudales ; 10 - lame; 11 - humérus ; 12 - os de l'avant-bras; 13 - os du carpe; 14 - os du métacarpe; 15 - phalanges des doigts ; 16 - côtes; 17 - cartilages costaux ; 18 - sternum ; 19 - os pelvien; 20 - articulation de la hanche; 21 - fémur ; 22 - articulation du genou; 23 - tibias ; 24 - péroné; 25 - calcanéum; 26 - jarret; 27 - tarse; 28 - métatarse; 29 - doigts
Le squelette axial comprend :
1 . Squelette de la tête (crâne), constitué des os du cerveau et du crâne facial. Le crâne est formé dans la majeure partie du plan par des os, reliés immobiles chez les jeunes animaux à l'aide de cartilage ou de tissu conjonctif (chez les chiots faibles, les connexions entre les os ne s'ossifient pas longtemps, elles peuvent être ressenties sous la forme de sutures souples). Chez les chiens plus âgés, tous les os du crâne sont fusionnés. Seule la mâchoire inférieure est reliée à l'os temporal par une articulation très mobile, grâce à laquelle le chien saisit et « coupe » la nourriture. Le travail de cette articulation de la mâchoire est assuré par les muscles les plus forts - les muscles masticateurs. Sur le bord postérieur du crâne, la crête occipitale triangulaire est clairement palpable, d'autant plus prononcée que les muscles du cou y sont attachés plus puissants. Sous la crête occipitale, à la frontière avec la première vertèbre cervicale, se trouve un grand foramen magnum du crâne, à travers lequel la moelle épinière sort du cerveau et pénètre dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. La cavité crânienne se forme à l’arrière du crâne, là où se trouve le cerveau. Devant la cavité crânienne se trouve la cavité nasale, très complexe chez le chien. Vous pouvez y pénétrer par les narines, situées sur la peau toujours humide et glabre de l'apex (lobe) du nez. La cavité nasale est divisée au milieu par une cloison nasale cartilagineuse et dans chacune de ses 2 moitiés se trouvent de fines plaques osseuses qui s'enroulent dans des tubes, fixés à sa paroi latérale. Ces plaques sont appelées coquilles. Les coquilles remplissent les deux moitiés de la cavité nasale, ne laissant entre elles que des espaces étroits (passages), à travers lesquels l'air traverse la cavité nasale et se dirige vers les poumons. Au-dessous de la cavité nasale, les os du crâne forment la cavité buccale, encadrée en dessous par une mâchoire inférieure mobile. Les dents sont situées sur l'os incisif, les mâchoires supérieure et inférieure.
Os du crâne appariés et non appariés :
Apparié : os temporal, os pariétal, frontal, mâchoire inférieure, os incisif, os palatin, lacrymal, nasal, zygomatique et mâchoire supérieure ;
Non appariés : os sphénoïde, interpariétal, ethmoïde, vomer, os hyoïde, occipital et sphénoïde.

Riz. 2. Crâne de chien : 1 - os incisif ; 2 - os nasal; 3 - os maxillaire ; 4 - os lacrymal; 5 - os zygomatique ; 6 - os frontal;7 - l'os pariétal; 8 - os temporal; 9 - os occipital; 10 - mâchoire inférieure
2 . Os de la colonne vertébrale, y compris les vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires, sacrées et caudales. La colonne vertébrale est une série de vertèbres reliées par du cartilage intervertébral et des articulations. Au-dessus de la partie de soutien de la colonne vertébrale, dans son canal, se trouve la moelle épinière, à partir de laquelle les nerfs se dirigent vers toutes les parties du corps par les foramens intervertébraux.
7 vertèbres cervicales. La colonne cervicale d'un chien est la plus mobile, quelle que soit la taille de l'animal.
13 vertèbres thoraciques inactives (mais souvent il peut y en avoir 12 et dans des cas isolés 14).
7 vertèbres lombaires étroitement connectées (dans des cas isolés 6). Les reins sont situés sous les vertèbres ; chez la femme, les ovaires se trouvent derrière elles.
3 vertèbres sacrées fusionnées, auxquelles l'ilion du bassin est attaché par une articulation serrée.
jusqu'à 20 à 23 vertèbres caudales (le nombre de vertèbres est déterminé par la norme)
Tableau 1. Sections de la colonne vertébrale et nombre de vertèbres chez un chien.

L'os sacré, la première vertèbre caudale et les os pelviens - l'ilion (en haut), le pubis et l'ischion (en bas du bassin) - forment la cavité pelvienne. Extérieurement, avec les muscles, cette zone est appelée croupe. Les os du bassin sont fermement reliés au sacrum et aux premières vertèbres caudales par des ligaments solides, et le long du bas du bassin, les os droit et gauche sont reliés chez les jeunes animaux par du cartilage, formant ce qu'on appelle la suture pelvienne. Avant la mise bas, la connexion entre les os se détend, ce qui facilite un meilleur passage du fœtus à travers la cavité pelvienne. Après l'accouchement, la connexion entre les os redevient rigide.
3 . Treize paires de côtes - 26
9 paires sont vraies, car reliés au sternum à l'aide de leurs propres cartilages costaux
4 paires sont fausses, car Les cartilages costaux de ces côtes s'unissent d'abord les uns aux autres, puis se connectent ensuite au sternum. La dernière paire de côtes, avec son extrémité cartilagineuse libre, peut se terminer par des muscles, c'est pourquoi cette paire de côtes est appelée côtes pendantes.
4 . Sternum.
Les vertèbres thoraciques, les côtes et le sternum forment ensemble la cage thoracique. Le mouvement de sa paroi assure la respiration - l'expansion de la paroi thoracique, associée à la contraction des muscles du diaphragme, permet l'inspiration ; le rétrécissement de la paroi thoracique, le relâchement du diaphragme et la pression exercée sur celui-ci par les organes internes, tout en contractant simultanément les muscles de la paroi abdominale, assurent l'expiration. Le bord postérieur de la poitrine, formé par les bords des dernières côtes et des cartilages costaux, est appelé arc costal.
Squelette périphérique.
Le membre thoracique commence par l'omoplate, puis l'humérus, l'avant-bras, le poignet (7 os du carpe), le métacarpe (5 os métacarpiens).
Les doigts sont équipés de griffes solides et non rétractables à leur extrémité. Le membre thoracique est relié à la colonne vertébrale par des muscles. Il est attaché par l'omoplate et les muscles à la poitrine et à la nuque. Le garrot est formé au-dessus de l'omoplate. Le membre pelvien (postérieur) commence par le fémur, qui, à son tour, passe dans le tibia (tibia et péroné), puis dans le tarse (constitué de 7 os).
Viennent ensuite le métatarse (de 4 à 5 os métatarsiens), puis 4 orteils phalangiens terminés par des griffes.
Parfois, un doigt rudimentaire (ergot) pousse de l'intérieur. Il est généralement amputé à un jeune âge. Le membre pelvien a une connexion articulaire avec le bassin et est fixé par les muscles du groupe de la hanche. Les membres thoraciques et pelviens appariés ont un plan structurel similaire - ils sont constitués de 3 maillons :
- Le 1er maillon est l'épaule (au niveau thoracique) ou la cuisse (au niveau du bassin), qui reposent sur de longs os tubulaires - l'humérus et le fémur.
- 2ème lien - avant-bras ou bas de jambe. La base de ce lien est constituée de 2 os : le radius et le cubitus avec le grand olécrane sur l'avant-bras, et le tibia et le péroné sur le bas de la jambe, et le cubitus et le péroné sont beaucoup plus fins et moins prononcés que le radius et le tibia. - les principaux os sur lesquels repose le poids du corps.
- Le 3ème maillon des membres est la main ou le pied. Ce sont les parties les plus difficiles. La main et le pied comportent chacun 3 maillons d'os : 1er maillon - 2 ou 3 rangées d'os courts du poignet (sur la main) et du tarse (sur le pied). 2ème - 4 ou 5 os longs et fins du métacarpe (sur la main) ou du métatarse (sur le pied), reliés par des ligaments courts. Les doigts sont attachés à chacun des os du métacarpe ou du métatarse ; chaque doigt est constitué de 3 phalanges.
Le chien est un animal qui marche avec les doigts ; il ne repose que sur son doigt. Les majeurs les plus longs (3e et 4e), les 2e et 5e sont plus courts et le 1er doigt est pendant et peut être complètement absent. Chez les chiens, l'os du talon du tarse est élevé par rapport au sol, tandis que chez les plantigrades, le talon repose sur le sol.
Toutes les parties des membres sont reliées entre elles par des articulations mobiles - capsules hermétiquement fermées et ligaments renforcés. Il y a un liquide synovial clair et visqueux à l'intérieur de l'articulation, donc le premier signe d'une perforation de l'articulation sera l'écoulement d'une synoviale transparente jaunâtre à travers la ponction. Chaque articulation est affectée par des groupes de muscles reliés par des nerfs à certains centres de la moelle épinière. L'appareil musculo-ligamentaire des membres est un puissant appareil d'absorption des chocs qui adoucit la charge de choc sur le squelette. Pour permettre des mouvements plus rapides, les parties inférieures du membre sont allégées : seuls les tendons musculaires courent le long de la main et du pied. La majeure partie de la masse musculaire est concentrée au niveau de l'omoplate ou du bassin, de l'épaule et de la cuisse. Tous les muscles squelettiques, en se contractant, provoquent non seulement le mouvement de l'animal, mais contribuent également à la formation d'énergie thermique. Il ne faut pas oublier cela et lorsque l'on travaille avec un chien, tenir compte de la température ambiante afin de ne pas provoquer de coup de chaleur.
L’une des zones du corps les plus difficiles est la zone de la tête. Il contient : les cavités nasales et buccales, le pharynx et le larynx, le cerveau, les organes de la vision et de l'audition.
Dans la cavité nasale, il existe un passage supérieur étroit entre les conques et l'os nasal, qui pénètre directement dans le labyrinthe de l'os ethmoïde - l'organe de l'odorat, c'est pourquoi il est appelé olfactif. Pour que l'air y pénètre, le chien « retient » sa respiration et aspire l'air plus fortement en reniflant. Les coquilles, entre lesquelles se forment des passages étroits dans la cavité nasale, forment une sorte de filtre, à travers lequel l'air inhalé est nettoyé, chauffé et vérifié pour son odeur.
Les cavités des os frontaux et maxillaires du crâne, appelées sinus, communiquent avec la cavité nasale. Pour cette raison, l’inflammation de la muqueuse de la cavité nasale peut provoquer non seulement une inflammation de la muqueuse des sinus, mais, pire encore, de la zone olfactive, ce qui peut entraîner une altération de l’odorat du chien.
À l'avant de la cavité nasale du chien se trouvent de petits trous par lesquels vous pouvez entrer dans la cavité oculaire, où mène le canal lacrymo-nasal.
De la cavité nasale, la sortie mène à la cavité pharyngée, où se croisent les voies respiratoires et digestives. Il est situé sous la base du crâne. Sur ses parois latérales se trouvent des trous menant aux trompes auditives, ce qui crée un risque d'infection du pharynx pénétrant dans l'oreille moyenne.
L'entrée de la cavité buccale est formée par les dents. L'espace entre les dents et les gencives d'un côté et les joues de l'autre s'appelle le vestibule de la cavité buccale. Sur la partie médiane de la muqueuse de la joue, au niveau entre les arcades des dents fermées, s'ouvrent les canaux des très petites glandes salivaires parotides, situées à la base des oreillettes. En ouvrant les mâchoires, vous pouvez entrer dans la cavité buccale. Au bas de celle-ci, sous la langue, deux autres glandes salivaires s'ouvrent : la glande sous-maxillaire, qui se trouve derrière et sous la mâchoire inférieure, à côté de la glande parotide, et la glande sublinguale, qui se trouve sur le côté de la base de la langue. . Les deux glandes s'ouvrent au fond de la bouche.
Le long des bords de l'incisive, de l'os maxillaire et de la mâchoire inférieure se trouvent les dents du chien. Devant, ils sont recouverts de plis cutanés - les lèvres et sur les côtés - les joues. La gueule du chien est très grande. Il atteint presque l'angle entre les mâchoires supérieure et inférieure ; le chien ne mâche pas, mais « hache » la nourriture. Ses dents et ses mâchoires ne sont pas adaptées à la mastication des aliments ; elle peut saisir et avaler de gros morceaux de nourriture. Devant le chien, il y a 6 incisives supérieures et 6 inférieures, de chaque côté il y a 2 canines, derrière lesquelles se trouvent des molaires : de chaque côté, 6 sur la mâchoire supérieure et 7 sur la mâchoire inférieure. Il faut cependant garder à l’esprit que le chien change toutes les incisives, canines et les 4 molaires antérieures (prémolaires) de chaque côté de chaque mâchoire. Les molaires postérieures, les molaires, poussent plus tard et ne changent pas (il y a 2 molaires de chaque côté de la mâchoire supérieure, 3 sur la mâchoire inférieure).
Les chiots naissent sans dents à la surface des gencives, qui n'éclatent que entre 18 et 25 jours après la naissance. Une poussée dentaire retardée indique un retard dans le développement du chiot.
La langue est située au fond de la cavité buccale. Chez un chien, il est fin et très mobile, recouvert sur le dessus (le long du dos) de délicates papilles filiformes, parmi lesquelles sont dispersées les papilles gustatives.
Au sommet de la cavité buccale, les crêtes du palais dur sont visibles, se transformant en voile palatin à l'entrée du pharynx. Les gencives et le palais dur peuvent être inégalement pigmentés, c'est-à-dire avoir une couleur marbrée. À la sortie de la cavité buccale dans le pharynx, sur les côtés du pharynx, se trouvent des amygdales, des formations lymphoïdes qui remplissent une fonction protectrice - neutralisant la microflore qui pénètre dans la cavité buccale depuis l'environnement extérieur.
Les organes visuels du chien sont situés dans des recoins spéciaux du crâne - les orbites. Chez le chien, l’orbite forme un anneau osseux incomplet. Ici, les globes oculaires se trouvent dans des coussinets adipeux spéciaux, recouverts devant les paupières supérieures et inférieures. Les cils poussent le long des bords des paupières. À l’intérieur, les paupières sont recouvertes d’une muqueuse rose pâle qui s’étend jusqu’à la surface du globe oculaire et s’appelle la conjonctive ; son inflammation est appelée conjonctivite. Les canaux de la glande lacrymale, située au-dessus du globe oculaire, s'ouvrent à l'arrière de la surface interne de la paupière supérieure. La larme lave constamment la membrane muqueuse des paupières et des yeux et s'écoule dans la zone du coin interne de l'œil, où, sur les bords des paupières supérieures et inférieures, de petites ouvertures ponctuelles des canalicules lacrymaux sont visibles, à travers lesquelles le la déchirure pénètre dans le canal lacrymo-nasal et se jette dans la partie antérieure de la cavité nasale. Si les ouvertures des canalicules lacrymaux sont enflammées ou « obstruées », les yeux commencent à « pleurer », car les larmes ne coulent plus dans la cavité nasale, mais sur la surface du visage (cela s'observe parfois chez les chiens âgés).
Le globe oculaire lui-même, qui perçoit la stimulation lumineuse, est une bulle à trois couches. La couche externe a une partie transparente - la cornée et une coque blanche et dense - la sclère. Sous la cornée, une deuxième membrane est visible : la choroïde. Au niveau de la cornée, il a de la couleur et est donc appelé iris. En son centre, vous pouvez voir un trou - la pupille, à travers lequel un rayon de lumière pénètre dans le globe oculaire. L'élève peut se contracter ou se dilater à l'aide de muscles. Derrière la pupille se trouve une lentille transparente - la lentille, maintenue en place par des ligaments spéciaux dotés de muscles. Les muscles, en se contractant, agissent sur la courbure de la surface du cristallin. Derrière le cristallin, le globe oculaire est rempli d'une masse gélatineuse et transparente : le corps vitré. La troisième couche du globe oculaire est la rétine, sur laquelle se trouvent les cellules nerveuses, leurs processus sont reliés aux cellules nerveuses du cerveau par un nerf optique spécial.
L'organe auditif du chien est divisé en oreille externe, moyenne et interne. L'oreille externe est le pavillon des oreilles qui, chez le chien, présente les formes les plus variées, caractéristiques de chaque race. Sous la peau de l'oreillette se trouve une plaque cartilagineuse qui assure la position de l'oreillette - un cartilage dense se trouve à la base de l'oreille dressée, un cartilage mince constitue la base de l'oreille pendante. De l'oreillette vient le conduit auditif externe qui, à l'entrée de l'oreille moyenne, est recouvert par le tympan. Les oreilles moyennes et internes sont situées dans un os spécial du crâne - l'os pétreux.
L'oreille moyenne est une cavité osseuse dans laquelle se trouvent les osselets auditifs interconnectés - le marteau, l'enclume, l'os lentiforme et l'étrier -. Ils transmettent les ondes sonores de l’oreille externe vers l’oreille interne. Deux ouvertures mènent de l'oreille moyenne à l'oreille interne, qui sont également recouvertes par les tympans. Les osselets de l'oreille moyenne sont reliés au tympan externe par le marteau et par l'étrier au tympan interne. Il y a une ouverture dans l’oreille moyenne qui traverse le tube auditif jusqu’à la cavité pharyngée. L'organe de l'audition et de l'équilibre est situé dans l'oreille interne, à partir des cellules sensibles dont les processus se dirigent vers les centres du cerveau situés dans la cavité crânienne.
Ainsi, la tête d'un chien est une zone très complexe et importante du corps.
La région du cou se caractérise par le fait que sous ses vertèbres se trouvent : l'œsophage qui longe la trachée, de très gros vaisseaux et des troncs nerveux. Chez les jeunes chiots, le long de la trachée se trouve l'organe central du système lymphoïde - le thymus.
La région de la poitrine abrite des organes très importants : les poumons et le cœur. Ils se trouvent dans des cavités séparées hermétiquement fermées, formées par une membrane séreuse transparente spéciale, qui sécrète un liquide séreux qui « hydrate » la surface des organes. Ainsi, la cavité du poumon droit ne communique pas avec la cavité du poumon gauche, et aucune d’elles ne communique avec la cavité dans laquelle se trouve le cœur. L'œsophage, les gros troncs de deux nerfs innervant le diaphragme, et tous les organes internes de la cavité thoracique et abdominale traversent la poitrine entre les poumons. Sous la colonne vertébrale se trouve l'aorte, qui provient du cœur et passe par l'ouverture du diaphragme jusqu'à la cavité abdominale. À l'arrière, la poitrine est séparée de la cavité abdominale par le diaphragme ou, comme on l'appelle, la barrière thoraco-abdominale. Le nerf qui alimente le diaphragme (sans lui, le diaphragme est paralysé) provient du bas du cou, de sorte que des blessures au bas du cou peuvent affecter ce nerf et causer des problèmes au niveau du diaphragme, ce qui peut entraîner de graves problèmes respiratoires.
Sous la région lombaire, derrière la cage thoracique et le diaphragme, se trouve la cavité abdominale. Son toit est le bas du dos, à l'arrière il passe librement dans la cavité pelvienne et ses parois latérales sont formées de muscles répartis en 4 couches. En dessous, le long de la ligne médiane de l'abdomen, ces muscles des côtés gauche et droit sont « cousus ensemble », formant ce qu'on appelle la ligne de suture physiologique, ou linea alba. Chez les chiens mâles, à l'arrière de la paroi abdominale, légèrement en retrait de la ligne blanche, on peut palper des fentes étroites, appelées anneaux inguinaux, à travers lesquelles on peut pénétrer dans les canaux inguinaux (droit et gauche), où se trouvent les cordons spermatiques. mensonge - cordons droit et gauche constitués de vaisseaux, de nerfs et de canaux déférents. Chez la femme, le canal inguinal n'est pas exprimé.
La cavité abdominale contient la plupart des organes digestifs. Immédiatement derrière le diaphragme, légèrement à gauche de la ligne médiane, se trouve l'estomac, dans lequel s'écoule l'œsophage et où est attachée la rate. Le duodénum émerge de l'estomac, dans lequel s'ouvrent les conduits des grosses glandes - le foie et le pancréas. Le foie est attaché à droite du diaphragme et bouge avec lui lors de l’inspiration et de l’expiration.
Dans la cavité abdominale, sous le bas du dos, se trouvent les reins, à partir desquels l'urine est évacuée par les uretères vers la vessie - un réservoir où l'urine s'accumule et est périodiquement excrétée du corps du chien par l'urètre.
Dans la cavité pelvienne, située sous le sacrum et les premières vertèbres caudales de la colonne vertébrale, se trouve le rectum. Chez la femme, se trouvent en dessous les organes génitaux internes : l'utérus, le vagin, le vestibule urogénital, qui se termine sous l'anus par les lèvres externes. Dans le coin inférieur de la fente génitale se trouve le clitoris (un rudiment du pénis masculin). Au bas du bassin, sous l'utérus et le vagin, se trouvent la vessie et l'urètre, qui s'ouvrent dans la paroi inférieure entre le vagin et son vestibule. Chez les hommes, dans la cavité pelvienne sous le rectum se trouvent la vessie et la partie pelvienne du canal génito-urinaire. Le canal urogénital provient du col de la vessie et ici, chez un chien mâle, se trouve une grande et unique glande sexuelle accessoire - la prostate, qui sécrète un liquide dans lequel se trouvent les cellules reproductrices mâles - le sperme. Le canal urogénital émerge de la cavité pelvienne et longe la face inférieure du pénis, s'ouvrant à sa tête avec le processus urogénital.
Tous les organes situés dans la cavité pelvienne, comme l'anus, sont reliés par des nerfs aux centres sacrés de la moelle épinière. Les dommages aux centres de la moelle épinière sacrée peuvent entraîner une perturbation non seulement de la défécation, mais également de la miction et des fonctions sexuelles.
Appareil de respiration. Structure, fonctions.
L'appareil respiratoire assure l'entrée de l'oxygène dans le corps et l'élimination du dioxyde de carbone, c'est-à-dire l'échange de gaz entre l'air atmosphérique et le sang. Chez les animaux de compagnie, les échanges gazeux se produisent dans les poumons, situés dans la poitrine. La contraction alternée des muscles des inhalateurs et des expirateurs entraîne une expansion et une contraction de la poitrine, et avec elle des poumons. Cela garantit que l’air est aspiré par les voies respiratoires dans les poumons et expulsé vers l’extérieur. Les contractions des muscles respiratoires sont contrôlées par le système nerveux.
En passant par les voies respiratoires, l'air inhalé est humidifié, réchauffé, débarrassé de la poussière et également examiné pour détecter les odeurs à l'aide de l'organe olfactif. Avec l'air expiré, un peu d'eau (sous forme de vapeur), l'excès de chaleur et certains gaz sont évacués du corps. Les sons sont produits dans les voies respiratoires (larynx).
Les organes respiratoires sont représentés par le nez et la cavité nasale, le larynx, la trachée et les poumons.
NEZ ET CAVITÉ NASALE
Le nez et la bouche constituent la partie avant de la tête chez les animaux - le museau. Le nez contient une cavité nasale appariée, qui constitue la section initiale des voies respiratoires. Dans la cavité nasale, l'air inhalé est examiné pour détecter les odeurs, chauffé, humidifié et nettoyé des contaminants. La cavité nasale communique avec le milieu extérieur par les narines, avec le pharynx par les choanes, avec le sac conjonctival par le canal lacrymo-nasal et également avec les sinus paranasaux. Sur le nez, il y a l'apex, le dos, les côtés et la racine. Au sommet, il y a deux trous - les narines. La cavité nasale est divisée par la cloison nasale en parties droite et gauche. La base de ce septum est le cartilage hyalin.
Les sinus paranasaux communiquent avec la cavité nasale. Les sinus paranasaux sont des cavités remplies d'air et tapissées de mucus situées entre les plaques externe et interne de certains os plats du crâne (par exemple, l'os frontal). En raison de ce message, les processus inflammatoires de la membrane muqueuse de la cavité nasale peuvent facilement se propager aux sinus, ce qui complique l'évolution de la maladie.
LARYNX
Le larynx est une section du tube respiratoire située entre le pharynx et la trachée. Chez un chien, il est court et large. La structure unique du larynx lui permet de remplir, en plus de conduire l'air, d'autres fonctions. Il isole les voies respiratoires lors de la déglutition des aliments, sert de support à la trachée, au pharynx et au début de l'œsophage, et sert d'organe vocal. Le squelette du larynx est formé de cinq cartilages interconnectés de manière mobile, sur lesquels sont attachés les muscles du larynx et du pharynx. Il s'agit d'un cartilage annulaire, devant et en dessous se trouve le cartilage thyroïde, devant et au-dessus se trouvent deux cartilages aryténoïdes et en dessous se trouve le cartilage épiglottique. La cavité laryngée est tapissée de muqueuse. Entre le processus vocal du cartilage aryténoïde et le corps du cartilage thyroïde à droite et à gauche se trouve un pli transversal - ce qu'on appelle la lèvre vocale, qui divise la cavité laryngée en deux parties. Il contient la corde vocale et le muscle vocal. L’espace entre les lèvres vocales droite et gauche s’appelle la glotte. La tension des lèvres vocales lors de l'expiration crée et régule les sons. Les chiens ont de grandes lèvres vocales, ce qui permet à votre animal à quatre pattes d'émettre une variété de sons.
TRACHÉE
La trachée sert à conduire l'air vers et depuis les poumons. Il s'agit d'un tube doté d'une lumière constamment béante, qui est assurée par des anneaux de cartilage hyalin non fermés au sommet dans sa paroi. L'intérieur de la trachée est tapissé de muqueuse. Il s'étend du larynx jusqu'à la base du cœur, où il se divise en deux bronches, qui constituent la base des racines des poumons. Cette localisation, qui se situe au niveau de la 4ème côte, est appelée bifurcation trachéale. La longueur de la trachée dépend de la longueur du cou et le nombre de cartilages chez le chien varie donc de 42 à 46.
POUMONS
Ce sont les principaux organes respiratoires, directement dans lesquels se produisent les échanges gazeux entre l'air inhalé et le sang à travers la fine paroi qui les sépare. Pour assurer les échanges gazeux, une grande zone de contact est nécessaire entre les voies respiratoires et la circulation sanguine. Conformément à cela, les voies respiratoires des poumons - les bronches - comme un arbre, se ramifient à plusieurs reprises vers les bronchioles (petites bronches) et se terminent par de nombreuses petites vésicules pulmonaires - les alvéoles, qui forment le parenchyme pulmonaire (le parenchyme est une partie spécifique du organe qui remplit sa fonction principale). Les vaisseaux sanguins se ramifient parallèlement aux bronches et enlacent les alvéoles avec un réseau capillaire dense, où s'effectuent les échanges gazeux. Ainsi, les principales composantes des poumons sont les voies respiratoires et les vaisseaux sanguins.
Le tissu conjonctif les unit en un organe compact apparié - les poumons droit et gauche. Le poumon droit est légèrement plus gros que le gauche, puisque le cœur, situé entre les poumons, est décalé vers la gauche. Le poids relatif des poumons est de 1,7 % par rapport au poids corporel.
Les poumons sont situés dans la cavité thoracique, à côté de ses parois. En conséquence, ils ont la forme d’un cône tronqué, quelque peu comprimé sur les côtés. Chaque poumon est divisé en lobes par de profondes fissures interlobaires : le gauche en trois et le droit en quatre.
La fréquence des mouvements respiratoires chez le chien dépend de la charge sur le corps, de l'âge, de l'état de santé, de la température et de l'humidité de l'environnement.
Normalement, le nombre d'inspirations et d'expirations (respirations) chez un chien en bonne santé varie dans des limites significatives : de 14 à 25-30 par minute. Cette largeur de plage dépend d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, les chiots respirent plus souvent que les chiens adultes car leur métabolisme est plus actif. Les chiennes respirent plus fréquemment que les mâles. Les chiennes enceintes ou allaitantes respirent plus fréquemment que les chiennes non enceintes. Le rythme respiratoire peut également être affecté par la race du chien, son état émotionnel et la taille du chien l'affecte également. Les chiens de petite race respirent plus souvent que les grands : le pinscher nain et le menton japonais respirent 20 à 25 fois par minute, et l'Airedale terrier - 10 à 14 fois. Cela est dû à des taux différents du processus métabolique et, par conséquent, à une perte de chaleur plus importante.
La respiration dépend en grande partie de la position du corps du chien. Les animaux respirent mieux lorsqu'ils sont debout. En cas de maladies accompagnées de lésions du cœur et des organes respiratoires, les animaux prennent une position assise, ce qui contribue à faciliter la respiration.

Topographie des poumons du chien, vue de droite : 1 - trachée ; 2,3,4 - lobe moyen crânien du poumon ; 5 - cœur ; 6 - diaphragme; 7 - bord dorsal du poumon ; 8 - bord basal du poumon ; 9 - estomac; 10 - bord ventral du poumon
Le processus respiratoire est également affecté par l’heure de la journée et la saison. La nuit, au repos, le chien respire moins fréquemment. En été, lorsqu'il fait chaud, ainsi que dans les pièces étouffantes et très humides, la respiration devient plus fréquente. En hiver, la respiration des chiens au repos est régulière et imperceptible.
Le travail musculaire augmente fortement la respiration du chien. Le facteur de l'excitabilité de l'animal revêt également une certaine importance. L’apparition d’un étranger ou d’un nouvel environnement peut provoquer une respiration rapide.
Physiologie de la reproduction.
ORGANES GÉNITAUX DE LA FÉMININE
La femelle possède des organes génitaux internes et externes.
Les organes génitaux internes comprennent les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin.
Les ovaires (Ovaria, Oophoron) sont les principales glandes sexuelles appariées qui remplissent des fonctions reproductives et hormonales. Les ovaires sont de forme ovoïde, légèrement aplatis latéralement. Pendant les chaleurs, la phase lutéale du cycle sexuel et pendant la grossesse, leur forme peut être en forme de raisin. La taille des ovaires chez le chien varie considérablement en fonction de l'état morphofonctionnel de l'organe et de la taille de l'animal. Par exemple, chez les chiens de grande race, pendant la phase lutéale du cycle reproductif et pendant la grossesse, les ovaires peuvent atteindre 2 à 2,5 cm de longueur et 1 à 1,5 cm de largeur.
Les ovaires sont situés dans la cavité abdominale, derrière et sous les reins, dans la bourse ovarienne ouverte. Les parois de la bourse ovarienne sont formées par les mésentères des ovaires et des trompes de Fallope. L'ouverture abdominale de la bourse ovarienne est petite - ne dépasse pas 1 à 1,5 cm de longueur. À l'aide de son propre ligament, l'ovaire est relié au sommet de la corne utérine correspondante et est attaché aux vertèbres lombaires au moyen d'un accessoire. ligament. Les ligaments ovariens accessoires chez le chien sont courts et contiennent beaucoup de graisse et de vaisseaux sanguins. Ces caractéristiques anatomiques limitent l'accès aux ovaires et compliquent leur ablation chirurgicale.
Extérieurement, l'ovaire est recouvert d'un épithélium cubique monocouche, sous lequel se trouve une membrane fibreuse (albuginine). Le parenchyme ovarien est représenté par la moelle et le cortex. La moelle est constituée de tissu conjonctif, de vaisseaux sanguins et de nerfs. La base du tissu conjonctif du cortex contient l'appareil folliculaire (follicules primaires, secondaires et tertiaires) et le corps jaune.
Les follicules au repos primaires ou primordiaux, qui sont des ovocytes de premier ordre entourés d'une seule couche de cellules folliculaires, se forment dans les ovaires fœtaux des chiens. A la naissance, il y en a 700 000 dans les ovaires, au début de la puberté - 250 000, à l'âge de 5 ans - 33 000, à l'âge de 10 ans - 500 follicules primaires.
Les follicules secondaires ou en croissance sont des ovocytes de premier ordre entourés de deux ou plusieurs couches de cellules folliculaires. A ce stade de la folliculogenèse, l'ovule est en croissance active et recouvert d'une membrane transparente
Riz. 2. Bourse ovarienne :
A - vue latérale, surface médiale ; B - vue de dessus. la paroi dorsale de la bourse est ouverte ; 1 - ouverture abdominale de la bourse ovarienne ; 2 - ovaire ; 3 - trompe de Fallope; 4 - entonnoir de la trompe de Fallope

Les follicules tertiaires, ou vésiculaires, cavitaires, de Graaf (dernière étape de la folliculogenèse) contiennent une cavité micro ou macroscopique remplie de liquide folliculaire. Leur paroi est tapissée de l'intérieur par un épithélium folliculaire multicouche et de l'extérieur par les couches interne et externe de la membrane du tissu conjonctif. Les cellules épithéliales folliculaires forment un tubercule ovoïde, au centre duquel se trouve un ovocyte de premier ordre. Les follicules tertiaires produisent des hormones œstrogéniques. L'activité hormonale des follicules de Graaf dépend de leur degré de maturité. Les plus actifs endocriniens sont les follicules préovulatoires qui sont entrés dans la phase finale de leur développement. Peu de temps avant l'ovulation, ils atteignent 6 à 8 mm de diamètre, leur nombre peut varier de 1 à 14. L'ovulation chez le chien se produit spontanément.
Le corps jaune, qui se forme à l'emplacement du follicule ovulé, est une glande endocrine à sécrétion temporaire. Les cellules du corps jaune (lutéocytes) produisent de la progestérone, une hormone nécessaire au maintien de la grossesse. Il existe des corps jaunes du cycle reproductif et de la grossesse. Chez le chien, le corps jaune du cycle reproducteur fonctionne pendant la même période que le corps jaune de la grossesse.
Les trompes de Fallope (Tuba uterina, salpinx), ou oviductes, trompes de Fallope, sont un organe apparié sous la forme d'un tube alambiqué s'étendant de chaque corne de l'utérus. Les trompes de Fallope sont situées dans leur propre mésentère, formé par la couche interne du ligament large utérin. Leur extrémité opposée débouche dans la cavité de la bourse ovarienne ; la paroi est constituée de membranes muqueuses, musculaires et séreuses. La membrane muqueuse est repliée, son épithélium cylindrique monocouche est représenté par des cellules sécrétoires et ciliées. Les spermatozoïdes mûrissent dans les trompes de Fallope, l'ovule est fécondé et l'embryon se développe jusqu'au stade d'un blastomère à 16 cellules. Les cellules germinales et l'embryon sont transportés vers l'utérus en raison des vibrations des cils des cellules épithéliales et de la contraction des fibres musculaires lisses de la paroi de l'organe. L'activité contractile de la paroi musculaire des trompes de Fallope est stimulée par les œstrogènes et supprimée par la progestérone.
L'utérus (Uterus, histera, metra) chez le chien est à deux cornes, composé d'un cou, d'un corps et de cornes. Le col et le corps de l'utérus sont courts, les cornes sont longues et servent de réceptacle au fruit. Les cornes divergent selon un angle aigu, donnant à l'utérus une forme de fronde. La taille des cornes utérines chez le chien varie considérablement et dépend de la taille de l'animal et de l'état physiologique du corps - le stade du cycle de reproduction et le moment de la grossesse. La paroi de l'utérus est constituée de trois membranes : la externe - séreuse (périmétrie), la moyenne - musculaire (myomètre) et la interne - muqueuse (endomètre). La couche musculaire est représentée par des couches longitudinales et circulaires, entre lesquelles se trouve une couche riche en vaisseaux sanguins et en nerfs. L'activité contractile du myomètre corporel et des cornes utérines est stimulée par les œstrogènes et supprimée par la progestérone. La structure de la membrane muqueuse du corps et des cornes de l'utérus est assez complexe : elle est recouverte d'un épithélium cylindrique monocouche, dans son épaisseur se trouvent de nombreuses glandes tubulaires dont les conduits s'ouvrent dans la cavité utérine. Les glandes produisent ce qu'on appelle la gelée royale, nécessaire à la nutrition de l'embryon. L’endomètre, comme le myomètre, sert de tissu cible aux hormones sexuelles. Les œstrogènes améliorent la vascularisation de l'endomètre et stimulent la croissance des glandes endométriales. Une vascularisation excessive de l'endomètre entraîne une fuite (diapédèse) de cellules sanguines dans la lumière de l'utérus et l'apparition d'écoulements hémorragiques de la fente génitale pendant la phase proestrus. La progestérone provoque la ramification des glandes tubulaires et stimule la production de gelée royale.
Pendant la grossesse chez le chien, ainsi que chez d'autres animaux placentaires, un placenta se forme à partir de la membrane muqueuse de l'utérus et de la choroïde du fœtus, qui dans sa structure microscopique appartient au type endothéliochorionique et dans sa structure macroscopique - au type type zonal. Lors de l’accouchement, seule la partie bébé du placenta tombe.
Le col de l'utérus (Cervix uteri) a un canal étroit, une paroi épaisse avec une couche musculaire bien développée. Chez le chien, le col atteint une longueur de 1 à 1,5 cm et se caractérise par l'absence de limites claires avec le corps de l'utérus et du vagin. L'entrée du canal cervical depuis le vagin est recouverte par le pli vaginal postcervical et est inaccessible pour un examen vaginal. Le col de l'utérus remplit la fonction de sphincter utérin. L'ouverture complète de son canal et du pli vaginal postcervical (faux col) est notée lors de l'accouchement, une ouverture partielle - pendant l'oestrus, les chaleurs sexuelles et pendant la période post-partum. L'ouverture du col de l'utérus pendant l'accouchement est stimulée par les œstrogènes et la relaxine ; pendant l'oestrus et les chaleurs sexuelles - uniquement par les hormones œstrogènes. L'épithélium de la membrane muqueuse du col de l'utérus est monocouche, cylindrique et est représenté principalement par des cellules sécrétoires qui produisent une sécrétion muqueuse aux propriétés bactéricides et bactériostatiques.
L'utérus est situé dans la cavité abdominale, il est soutenu par des ligaments utérins larges et ronds. Les ligaments larges de l'utérus sont des doubles feuillets de péritoine s'étendant de la petite courbure des cornes, de la surface latérale du corps, du col et de la partie crânienne du vagin jusqu'aux parois latérales du bassin. Les ligaments ronds de l'utérus en forme de cordons commencent au sommet des cornes utérines et se terminent à l'ouverture interne du canal inguinal.
Fig 3. Représentation schématique de l'ovaire, coupe sagittale :
1 - épithélium tégumentaire ; 2 - follicules primaires ; 3 - follicule secondaire ; 4 - follicule tertiaire ; 5- atrésie folliculaire ; 6 - follicule ovulé; 7 corps jaune

Le vagin (Vagina), ou vagin, est situé dans la cavité pelvienne entre le col de l'utérus et l'ouverture de l'urètre. (urinaire canal). Il s'agit d'un tube élastique à paroi mince qui sert d'organe de copulation et de canal génital. L'intérieur de la paroi vaginale est tapissé d'une membrane muqueuse, dépourvue de glandes et recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié. Sous l'influence des hormones œstrogéniques pendant la période de proestrus et surtout d'oestrus (chaleurs sexuelles), le nombre de couches de cellules épithéliales augmente, les cellules superficielles se kératinisent, perdent leur noyau et la kératine s'accumule dans leur cytoplasme. Sous la membrane muqueuse se trouvent deux couches de muscles : longitudinale et circulaire (transversale). La partie crânienne du tube vaginal est recouverte extérieurement d'une membrane séreuse (péritonéale), tandis que le reste est recouvert de tissu conjonctif lâche qui, avec le tissu conjonctif pararectal, assure la fixation du vagin et du rectum dans la cavité pelvienne.
Les organes génitaux externes comprennent le vestibule vaginal, les lèvres et le clitoris.
Le vestibule du vagin (Vestibulum vaginae) sert de canal urogénital. Sa membrane muqueuse ne contient pas de glandes vestibulaires, est recouverte d'un épithélium pavimenteux stratifié et ne remplit qu'une fonction protectrice. La membrane musculaire est bien développée et forme le sphincter du vestibule du vagin, qui assure l'adhésion des organes génitaux de la femme et de l'homme lors des rapports sexuels. La frontière entre le vagin et son vestibule est l'ouverture de l'urètre. L'hymen (Hymen) chez le chien est peu développé ou absent. Le vestibule du vagin passe caudalement dans la fissure génitale (Rima pudendi), délimitée par les lèvres vulvaires, ou vulve, anse génitale. Le coin supérieur de la vulve est arrondi, le coin inférieur est pointu. Dans le coin inférieur de la fente génitale se trouve le clitoris (Clitoris) - un homologue du pénis qui ne contient pas d'os génital. Le clitoris est composé de tissus fibreux, adipeux et érectiles et est riche en terminaisons nerveuses sensorielles.
Les organes génitaux féminins sont alimentés en sang par des vaisseaux provenant de l'artère ovarienne ou ovarienne (Arteria ovaricd) et des branches de l'artère pudendale interne (A. pudenda inlerna).
L'artère ovarienne part directement de l'aorte derrière l'artère rénale et se divise en deux branches - tubaire (Ramus tubarius) et utérine (R. uterinus), qui vascularisent les ovaires, les trompes de Fallope et la partie crânienne des cornes utérines.
L'artère pudendale interne provient de l'artère iliaque interne (A. iliaca intema) et est divisée en plusieurs branches. Dans l'apport sanguin aux organes génitaux des femmes, deux d'entre elles sont d'une importance primordiale : les artères vaginales (A. vaginalis) et ventrale périnéale (A. perinealis ventralis). L'artère vaginale irrigue la paroi vaginale et au niveau du col passe dans l'artère utérine (A. uterina), qui vascularise les parois du col, le corps et les ⅔ des cornes utérines. Les branches de l’artère périnéale ventrale alimentent les organes génitaux externes et le tissu périnéal.
Les veines ovariennes (Venae ovaricae) constituent le tronc principal par lequel le sang veineux est évacué des organes génitaux. Dans ce cas, la veine ovarienne droite (Vena ovarica dextra) se jette dans la veine cave postérieure (V. cava caudalis), la gauche (V. ovarica sinistra) dans la veine rénale (V. renalis).
Le système lymphatique des organes génitaux féminins est très bien développé. La lymphe est collectée dans les ganglions lymphatiques régionaux - pelviens, sacrés et inguinaux, qui remplissent des fonctions de barrière de filtration et immunitaires.
Les fonctions les plus importantes des organes génitaux féminins :
|
Organe |
Fonction |
|
Ovaires |
1. Reproductif - formation et libération d'ovocytes 2. Hormonal - production d'œstrogènes, de progestérone et d'inhibine |
|
Les trompes de Fallope |
1. Transport des cellules germinales 2. Lieu de maturation des spermatozoïdes 3. Lieu de fécondation de l'ovule et développement de l'embryon jusqu'au stade morula |
|
Utérus |
1. Lieu de stockage du sperme 2. Organe réceptacle des fruits 3. Chaleur |
|
Col de l'utérus |
1. Sphincter de l'utérus 2. Canal de naissance 3. Production de sécrétion muqueuse |
|
Vagin |
1. Organe de copulation 2. Canal de naissance |
|
Vestibule vaginal |
1. Canal urogénital 2. Couplage des organes génitaux masculins et féminins lors du coït |
|
Clitoris |
Organe sexuel |
|
Lèvres |
Fermer la fissure génitale |
Les systèmes sympathique et parasympathique sont impliqués dans l'innervation des organes reproducteurs des femelles. Les fibres sympathiques proviennent du plexus pelvien (Plexus pelvinus), les fibres parasympathiques des nerfs sacrés (Nervi sacrales). Les organes génitaux externes et le vagin sont également bien pourvus en fibres nerveuses sensorielles.
ORGANES GÉNITAUX DU MÂLE.
Les organes reproducteurs masculins sont constitués des testicules, de leurs canaux excréteurs (épididyme, canaux spermatiques et canal urogénital), de la prostate, du pénis, du prépuce et du scrotum (Fig. 4).
Riz. 4. Organes génitaux masculins, vue latérale :
1 - scrotum; 2 - testicule ; 3 - appendice du testicule ; 4 - pénis; 5 - canal urogénital ; 6 - prostate; 7 - ampoule du tube à spermatozoïdes ; 8 - tube à sperme; 9 - vessie; 10 - os génital; 11 - prépuce ; 12 - bulbe de la tête génitale

Les testicules (Testis, orchis, didymis), ou testicules, sont les principaux organes reproducteurs appariés qui remplissent des fonctions reproductives et hormonales : ils produisent des spermatozoïdes mâles et de la testostérone, une hormone sexuelle mâle. Les testicules sont de forme ovale, ont une consistance élastique dense et atteignent une longueur de 2 à 4 cm. Sur le testicule, il y a des extrémités capitées et caudées, des bords libres et annexiels, des surfaces latérales et médiales.
Extérieurement, le testicule est recouvert de sa propre tunique vaginale (séreuse), sous laquelle se trouve la tunique albuginée. Ses cordons radiaux divisent le parenchyme de l'organe en de nombreux lobules pyramidaux et forment le médiastin du tissu conjonctif du testicule. Le sommet des lobules pyramidaux fait face au médiastin du testicule, la base fait face à la tunique albuginée.
Chaque lobule contient plusieurs tubules contournés entourés de tissu conjonctif lâche avec un grand nombre de vaisseaux sanguins. Dans la base du tissu conjonctif des lobules pyramidaux se trouvent des cellules de Leydig qui produisent l'hormone androgène testostérone. Les tubules contournés commencent comme un sac aveugle et, fusionnant au sommet du lobule pyramidal, se jettent dans les tubules droits des testicules dont les conduits débouchent dans le réseau testiculaire. Les spermatozoïdes se forment dans les tubules contournés des testicules ; les tubules droits et le réseau testiculaire ont pour fonction de transporter les cellules germinales. La paroi des tubules contournés est constituée de deux couches : le tissu conjonctif et l'épithélial, séparées l'une de l'autre par une membrane basale, qui sert de barrière hémato-testiculaire.
Riz. 5. Représentation schématique du testicule et de son appendice, coupe sagittale :
1 - tubules contournés ; 2 - tubules droits ; 3 - réseau testiculaire ; 4 - canaux spermatiques; 5 - canal de l'épididyme ; 6 - tube à sperme

Riz. 6. Microstructure de la paroi du tube contourné du testicule :
1 - spermatogonies; 2 - spermatocyte de premier ordre ; 3 - spermatocyte de second ordre ; 4 - spermatides ; 5 - sperme; 6 - Cellule de Sertoli ; 7 - fibrocytes

Le processus de formation des spermatozoïdes est caractérisé par un cycle temporel clair et se poursuit tout au long de la vie reproductive du mâle. L'épithélium spermatogène des chiens adultes est multicouche et se compose de spermatogonies, de spermatocytes de premier et de deuxième ordre, de spermatides et de spermatozoïdes. Toutes ces cellules sont interconnectées par les processus syncytiaux des cellules de Sertoli, qui remplissent des fonctions nutritionnelles et sécrétoires : elles produisent du liquide testiculaire, produisent une protéine qui lie la testostérone et l'hormone inhibine, qui inhibe la sécrétion de l'hormone folliculo-stimulante (FSH).
Le scrotum (Scrotum) est une formation particulière de la paroi abdominale dans laquelle se trouvent les testicules. Remplit des fonctions de protection et de thermorégulation. Chez le chien, le scrotum est situé entre les cuisses et constitue un sac cutanéo-musculaire, divisé par un septum en chambres droite et gauche, qui communiquent avec la cavité abdominale par les canaux inguinaux correspondants. La peau du scrotum chez le chien est peu poilue et contient un grand nombre de glandes sébacées et sudoripares. Grâce aux glandes sudoripares, le scrotum est capable de maintenir activement la température optimale pour la spermatogenèse dans les testicules, plusieurs degrés Celsius en dessous de la température corporelle de l'animal. La sécrétion des glandes sébacées réduit le transfert de chaleur et protège la peau du scrotum des facteurs environnementaux défavorables. La peau est étroitement fusionnée avec la membrane musculo-élastique, formant la cloison scrotale. Derrière la membrane musculo-élastique se trouve la membrane vaginale commune du testicule, qui est une couche pariétale du péritoine. Les membranes musculo-élastiques et vaginales communes sont faiblement reliées les unes aux autres, elles sont faciles à séparer les unes des autres. La membrane vaginale commune, à travers le ligament vaginal (testiculaire), qui passe jusqu'à l'extrémité caudée du testicule, est reliée à la propre membrane vaginale du testicule. Le releveur des testicules (M. cremaster) est attaché à la surface externe de la membrane vaginale commune sur le côté et à l'arrière, qui, avec la membrane musculo-élastique, participe à la régulation de la température dans les testicules et ses appendices, en modifiant le volume du scrotum et la distance entre les testicules et les canaux inguinaux.
Les testicules chez le chien sont situés dans la cavité scrotale dans une position presque horizontale. Ils sont suspendus devant au cordon spermatique, à l'arrière - sur leur propre ligament du testicule.
Le cordon spermatique (Funiculus spermaticus) est un cordon s'étendant de l'extrémité capitatée du testicule jusqu'à l'anneau inguinal interne. Se compose du releveur des testicules, des vaisseaux testiculaires très alambiqués, des nerfs et du canal spermatique. Un réseau dense de vaisseaux veineux qui abaissent la température du sang artériel dans les testicules forme le plexus veineux.
Les appendices des testicules (épididyme) sont un organe apparié étroitement adjacent à la surface des testicules. L'épididyme est divisé en une tête, un corps et une queue. La tête est constituée de 12 à 18 canaux spermatiques reliant le réseau testiculaire au canal très contourné de l'épididyme, à partir duquel commence le canal spermatique. Dans l'épididyme, les spermatozoïdes mûrissent et se concentrent. Les fonctions de l'organe comprennent également le stockage et le transport des spermatozoïdes. En se déplaçant le long du canal de l'épididyme, les spermatozoïdes sont libérés de la goutte cytoplasmique (restes du cytoplasme de la spermatide), recouverts d'une coque protectrice, acquérant une charge électrique négative, la capacité de mouvement de translation rectiligne et de fécondation. Dans un environnement acide et sans oxygène, à une température inférieure de plusieurs degrés Celsius à la température corporelle de l’animal, ils conservent leur capacité fertilisante pendant plusieurs mois.
Les canaux spermatiques (Ductus deferens) sont un organe tubulaire apparié constitué de membranes muqueuses, musculaires et séreuses ; assure le transport des spermatozoïdes du canal caudal de l'épididyme vers le canal génito-urinaire. Il y a quatre parties dans le canal spermatique : testiculaire, correspondant à la longueur du testicule ; funiculaire, passant dans le cadre du cordon spermatique jusqu'à l'anneau inguinal superficiel ; inguinal - dans le canal inguinal; partie pelvienne - la zone allant de l'anneau inguinal profond jusqu'à l'endroit où il pénètre dans le canal urinaire. Près du col de la vessie, les parties terminales des canaux spermatiques se dilatent, prennent la forme d'un fuseau et forment des ampoules. La paroi des ampoules contient des glandes tubulaires sécrétoires actives.
Le canal urogénital (Canalis urogenitalis), qui assure le transport de l'urine et des spermatozoïdes, commence à l'endroit où les canaux spermatiques pénètrent dans le canal urinaire. Il fait la distinction entre les parties pelviennes (jusqu'à l'échancrure sciatique) et les parties du pénis. La membrane muqueuse du canal génito-urinaire chez le chien ne contient pas de glandes urétrales et est représentée par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisant. Derrière la membrane muqueuse se trouve une couche de fibres musculaires lisses. La partie pénienne du canal génito-urinaire est entourée de tissu spongieux et est située dans un sillon spécial de l'os génital. Le canal urogénital se termine à la tête du pénis par l'ouverture urogénitale.
La prostate ( Prostata) chez le chien est de structure bilobée, tubulaire-alvéolaire. Situés dans la cavité pelvienne, au-dessus du col de la vessie, les conduits débouchent dans la partie pelvienne du canal génito-urinaire. La prostate produit une sécrétion qui fait partie du sperme. Les glandes vésiculaires et bulbeuses sont absentes chez le chien.
Le pénis (Penis), ou pénis, est un organe de copulation et de miction. Chez le chien, il est de type vasculaire avec un os génital (Os pénis), qui lui confère de l'élasticité. Le pénis est divisé en racine, corps et tête. La racine est constituée de deux pattes provenant des tubérosités ischiatiques. Les jambes, entourées d'un muscle bulbocaverneux développé (M. bulbospongiosus), se connectent au-dessus du canal urogénital et forment avec lui le corps du pénis, se terminant par la tête. L'osselet génital, situé dans la tête du pénis, remplit le canal urogénital aux ⅔, rétrécissant ainsi son ouverture. Chez les chiens de grande race, l'os génital atteint 8 à 10 cm de longueur. La base du pénis est constituée de deux corps caverneux et d'un corps spongieux, entourant le canal urogénital et formant le bulbe du pénis chez le chien. Ces corps sont recouverts d'une tunique albuginée et contiennent de nombreuses cavités interconnectées (cavités) qui, lorsque le muscle bulbocaverneux (érecteur) se contracte lors de l'excitation sexuelle, accumulent du sang et provoquent une érection du pénis.
Les spermatozoïdes sont libérés du pénis en raison des contractions péristaltiques de la paroi du canal urogénital et des contractions rythmiques du muscle bulbocaverneux situé à la base du pénis.
La partie coanale du pénis est située dans le sac préputial sur la surface ventrale de l'abdomen. L'extérieur du prépuce est recouvert de peau, l'intérieur est tapissé d'un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisant (couche pariétale), qui recouvre également la tête du pénis (couche viscérale). La feuille pariétale du poepucium chez le chien ne contient pas de glandes préputiales. Dans le sac préputial, le pénis est maintenu par un muscle rétracteur spécial (M. retractor pénis), constitué de fibres musculaires lisses. Le muscle prend naissance à la première vertèbre caudale et se termine à la base de la tête du pénis. Lors d’une érection, le pénis grossit et s’étend au-delà du sac préputial. Le bulbe du pénis gonfle fortement, ce qui favorise l’adhésion des organes génitaux de l’homme et de la femme lors des rapports sexuels.
Les organes génitaux masculins sont alimentés en sang par l'artère spermatique (A. testicularis) et les branches de l'artère pudendale interne. L'artère spermatique naît de l'aorte et irrigue le testicule et ses appendices. L'artère pudendale interne provient de l'artère iliaque interne et dégage trois branches principales impliquées dans l'apport sanguin aux organes génitaux masculins : l'artère prostatique (A. prostatica), l'artère périnéale ventrale et l'artère pénienne (A. pénis). L'artère prostatique vascularise la prostate et la vessie. Périnéal ventral - tissus du périnée et du scrotum. L'artère pénienne est divisée en trois branches : l'artère dorsale du pénis (A. dorsalis pénis), l'artère du bulbe pénien (A. buibi pénis) et l'artère profonde du pénis (A. profunda pénis).
L'écoulement du sang des organes génitaux est assuré par les veines du même nom. La lymphe des organes génitaux est collectée dans les ganglions lymphatiques régionaux.
Les systèmes nerveux autonome et somatique participent également à l’innervation des organes génitaux masculins. Les organes génitaux externes - le scrotum, le prépuce et surtout la partie crânienne du pénis - sont bien pourvus en terminaisons nerveuses sensorielles. L'irritation pendant les rapports sexuels des thermo- et baro-récepteurs du gland déclenche l'éjaculation (libération de spermatozoïdes). Les barorécepteurs jouent un rôle de premier plan dans la manifestation du réflexe d'éjaculation.
Les fonctions les plus importantes des organes reproducteurs mâles sont résumées ci-dessous.
|
Organe |
Fonction |
|
Testicules |
1. Reproducteur - formation et transport des spermatozoïdes testiculaires 2. Hormonal - sécrétion de testostérone et d'inhibine |
|
Appendices testiculaires |
1. Transport de sperme 2. Lieu de maturation des spermatozoïdes 3. Concentration et stockage du sperme |
|
Cordon spermatique |
1. Appareil de soutien des testicules et de leurs appendices 2. Thermorégulation |
|
Canaux spermatiques |
Transport de sperme |
|
Ampoules pour tubes de sperme |
1. Production de sécrétions 2. Stockage à court terme du sperme |
|
Canal urogénital |
Excrétion d'urine et de sperme |
|
Prostate |
1. Sécrétion de plasma spermatique 2. Nettoyer le canal génito-urinaire |
|
Pénis |
Organe de copulation |
|
Prépuce |
1. Réceptacle pénien 2. Protecteur |
|
Scrotum |
1. Réceptacle pour les testicules et leurs appendices 2. Protecteur 3. Thermorégulation |
DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX ET CARACTÉRISTIQUES DE L'OVO- ET DE LA SPERMATOGENÈSE
Au cours du processus de développement embryonnaire, un individu développe simultanément des organes génitaux masculins et féminins. Le système reproducteur indifférent comprend les gonades primaires, les canaux mésonéphriques (Wolffien) et paramésonéphriques (Müllérien), le sinus urogénital, le tubercule génital et les plis génitaux. Les caractéristiques de différenciation des organes génitaux des fœtus chez le chien sont présentées dans le tableau 1 et la figure 7.
Caractéristiques du développement intra-utérin des organes génitaux chez le chien
|
Des organes génitaux indifférents |
Différenciation des organes génitaux indifférents |
|
|
mâles |
les femelles |
|
|
Gonades primaires : cortex moelle |
Régressions Testicules |
Ovaires Régressions |
|
de Müllerconduits |
Rudiments |
Trompes de Fallope, utérus, partie crânienne du vagin |
|
du loupconduits |
Épididyme, canaux spermatiques |
Rudiments |
|
Sinus urogénital |
Urètre, prostate |
Urètre, partie caudale du vagin, vestibule du vagin |
|
Tubercule génital |
Pénis |
Clitoris |
|
Plis sexuels |
Scrotum |
Lèvres |
Les gonades se forment sur la surface interne du rein primaire. La gonade primaire est constituée de cellules épithéliales coelomiques (cortex externe), de mésenchyme (médulla interne) et de cellules germinales primaires d'origine extragonale - les gonocytes, qui migrent vers la gonade indifférente depuis l'endoderme du sac vitellin.
La différenciation sexuelle des gonades est induite par un ensemble de chromosomes sexuels formés chez le zygote lors de la fusion d'un spermatozoïde avec un ovule. Les cellules germinales, contrairement aux cellules somatiques, contiennent un ensemble haploïde de chromosomes. Un spermatozoïde peut porter un chromosome X ou un chromosome Y ; un ovule ne porte qu'un chromosome X. L'ensemble XY de chromosomes sexuels induit la différenciation des gonades selon le type masculin, et l'ensemble XX - selon le type femelle.
Lors du développement des gonades selon le type mâle, les gonocytes sont localisés dans la moelle interne de la gonade. Ils pénètrent dans les cordons séminifères formés par les cellules épithéliales coelomiques. Les cordons séminifères se différencient en réseau testiculaire, tubules testiculaires droits et alambiqués. Dans les tubules contournés, les gonocytes se transforment en spermatogonies, les cellules épithéliales coelomiques en cellules de Sertoli. Dans le même temps, les cellules de Leydig sont formées à partir de cellules mésenchymateuses. Les testicules fœtaux sont hormonalement actifs. Les cellules de Sertoli produisent le facteur anti-Müllérien, qui provoque la régression des canaux paramésonéphriques, les cellules de Leydig produisent de la testostérone, qui assure le développement des organes reproducteurs secondaires masculins à partir de l'ébauche embryonnaire : appendices testiculaires, canaux spermatiques, prostate, pénis, prépuce et scrotum. .
Riz. 7. Différenciation des organes génitaux :
A - stade indifférent : 1 - gonade ; 2 - rein primaire (mésonéphros); 3 - mésonéphrique ( Wolffien) conduits ; 4 -paramésonéphrique ( Müllérien) conduits ; 5 - cordon inguinal ; 6 - vessie; 7 - sinus urogénital ; 8 - tubercule génital;
B- formation des organes génitaux masculins : 1 - testicules ; 2 - appendice du testicule ; 3 - tube à sperme ; 4 - ligament testiculaire (corde inguinale) ; 5 - vessie; 6 - prostate; 7 - pénis;
B - formation des organes génitaux féminins : 1 - ovaire ; 2 - restes du bourgeon primaire (para - et épophoron) ; 3 - trompes de Fallope ; 4 - ligament utérin rond (corde inguinale); 5 - vessie; 6 - clitoris

À la fin de la période de développement fœtal, les testicules se retrouvent dans le canal inguinal et le 10ème...14ème jour après la naissance du chiot, ils descendent dans le scrotum en raison de la croissance différenciée des ligaments de soutien du testicule. et surtout la moelle inguinale du ligament testiculaire. L'absence de testicules dans le scrotum peut être due à des malformations des gonades - cryptorchidie, anorchidie et ectopie.
Au cours de la période postnatale, les systèmes reproducteur et hypothalamo-hypophysaire mûrissent, l'interaction de leurs hormones s'établit et des caractères sexuels secondaires se développent (puberté).
La spermatogenèse est le processus de formation et de maturation des cellules reproductrices mâles, précède le début de la puberté et se poursuit tout au long de la vie reproductive du mâle.
La durée moyenne de la spermatogenèse chez le chien est de 56,4 jours. Les spermatozoïdes sont produits dans les tubules contournés des testicules. Au cours de la spermatogenèse, les spermatogonies diploïdes se transforment en cellules mâles haploïdes différenciées - les spermatozoïdes. Les cellules germinales progénitrices sont divisées selon le type de mitose et de méiose. Les spermatogonies se reproduisent par mitose. Au cours de chaque division mitotique, les spermatogonies se différencient en variantes actives, intermédiaires et inactives. Les spermatocytes de premier ordre, formés de spermatogonies actives, se développent et entrent dans la première division méiotique, dans laquelle deux spermatocytes de second ordre sont formés à partir d'un spermatocyte de premier ordre. Au cours de la première division méiotique, un croisement se produit - l'échange de blocs génétiques au sein d'un chromosome et entre chromosomes homologues, ce qui crée la possibilité d'une variation héréditaire chez la progéniture. Après une courte période de repos, les spermatocytes de second ordre entrent dans la deuxième division méiotique, qui aboutit à la formation de quatre spermatides avec un ensemble haploïde de chromosomes. Les spermatides ne se divisent plus, mais se modifient, aboutissant à la formation de spermatozoïdes.
L'ovogenèse est le processus de formation des cellules germinales femelles. Le développement intra-utérin du système reproducteur chez les fœtus féminins commence plus tard que chez les fœtus mâles. Les gonocytes, localisés dans la couche corticale externe des gonades, se transforment en oogonies qui, comme les spermatogonies, contiennent un ensemble diploïde de chromosomes. Les oogonies se reproduisent intensément par division mitotique. Après avoir terminé la dernière division mitotique, les ovogonies entrent dans la première étape de la méiose et se transforment en ovocyte de premier ordre. La maturation de l'ovocyte de premier ordre est suspendue au stade dictyotène de la prophase de la première méiose. Le blocage de la méiose coïncide avec le processus de formation du follicule primaire - la formation d'une couche de cellules folliculaires autour de l'ovocyte de premier ordre. Au moment de la naissance du fœtus, les ovaires sont morphologiquement formés. Le cortex contient plusieurs follicules primaires. La moelle (restes de la couche mésenchymateuse de la gonade indifférente) est constituée de tissu conjonctif, de vaisseaux sanguins et de nerfs.
Contrairement aux testicules fœtaux, l’activité hormonale des ovaires fœtaux est insignifiante. Les hormones ovariennes n'ont pas d'influence décisive sur la différenciation sexuelle du système reproducteur des femelles pendant la période de développement prénatal. En l'absence congénitale de gonades ou à la suite de leur ablation au stade gonadique indifférent, seuls les organes génitaux féminins se développent. Avec l'hermaphrodisme (anomalies du développement sexuel, lorsque les gonades se différencient dans deux directions à la fois - ovarienne et testiculaire), le développement des organes génitaux internes et externes dépend de la présence et de l'activité de cellules sécrétant de la testostérone dans la gonade de type mixte.
Dans la période postnatale, pendant la puberté, une cyclicité quotidienne se forme et la libération de gonadotrophines augmente, sous l'influence de laquelle la sécrétion d'hormones œstrogéniques des ovaires augmente et une interaction s'établit entre les ovaires et le système hypothalamo-hypophysaire. La folliculogenèse est incomplète. Les follicules dégénèrent à différents stades de leur développement. Le processus de dégénérescence des follicules tertiaires est appelé atrésie.
Les ovaires commencent à montrer une activité générative au début de la puberté. La maturation des cellules germinales est cyclique : au cours de chaque cycle sexuel, plusieurs follicules tertiaires entrent dans la phase finale de leur développement, mûrissent et ovulent. L'ovule ovule au stade ovocytaire de premier ordre (ne contient pas de globules polaires). Il est de forme sphérique régulière, son diamètre est de 1,2. 10 -5 mm, et avec la coque transparente 1,56. 10 -5 mm (Hoist P.A. et al., 1971). L'ovocyte mûrit dans le tiers supérieur de l'oviducte et subit deux divisions méiotiques. La première division méiotique est initiée par la libération préovulatoire de l'hormone lutéinisante (LH) et conduit à la formation d'un ovocyte de second ordre et à la séparation du premier globule polaire, contenant une petite quantité de cytoplasme et de chromosomes supplémentaires, dans l'espace périvitellin. . Lorsqu'un spermatozoïde pénètre dans l'ovule, l'ovocyte de second ordre subit une seconde division méiotique, qui aboutit à la formation d'un ovule mature doté d'un ensemble haploïde de chromosomes, capable de fécondation, et d'un deuxième corpus polaire.
RÉGULATION NEUROENDOCRINE DES PROCESSUS SEXUELS
La fonction la plus importante du système nerveux est de contrôler les activités de tout l'organisme à l'aide de signaux nerveux et humoraux basés sur la collecte, l'analyse et l'intégration d'informations émanant de différentes parties du corps et de l'environnement.
Sur la base des caractéristiques topographiques, le système nerveux est divisé en système central et périphérique. Le système nerveux central (SNC) comprend la moelle épinière et le cerveau, les nerfs périphériques spinaux et crâniens, leurs branches et plexus.

Riz. 8. Schéma de régulation neuroendocrinienne des processus sexuels chez la femme
[Les lignes pleines montrent un retour direct et positif (stimulation), les lignes pointillées montrent un retour négatif (blocage)] :l'hormone hypothalamique G-RH stimule la libération de FSH et de LH par l'adénohypophyse ; La FSH active la croissance et le développement des follicules ainsi que leur production d'œstrogènes et d'inhibine - l'inhibine bloque sélectivement la sécrétion de FSH ; les œstrogènes, agissant sur les organes cibles (système nerveux central, organes génitaux secondaires), induisent la manifestation de l'œstrus, de l'excitation sexuelle et de la chasse ; en fin de proestrus et en début d'oestrus, lorsque les concentrations de progestérone sont faibles, le pic préovulatoire de Prestradiol initie une libération cyclique de G-RH, FSH et LH ; le pic préovulatoire de LH induit la maturation des follicules préovulatoires, leur ovulation, la sécrétion basale de LH - la formation du corps jaune et leur production de progestérone ; la progestérone, par des mécanismes de rétroaction négative, contrôle la sécrétion de G-RH, FSH et LH : ses concentrations élevées bloquent et ses faibles concentrations stimulent la libération de ces hormones
Sur la base de leurs caractéristiques fonctionnelles, on distingue les systèmes nerveux somatique et autonome.
Le système somatique innerve les organes du corps (soma) et relie le corps à l'environnement extérieur à travers les sens, la sensibilité cutanée et le mouvement. Les centres du système somatique sont situés dans le système nerveux central, dont la partie la plus élevée, le cortex cérébral, contrôle l'activité nerveuse supérieure.
Le système végétatif ou autonome, qui assure l'innervation des organes et systèmes du corps, qui comprennent les fibres musculaires lisses et l'épithélium glandulaire (organes de digestion, de respiration, d'approvisionnement en sang, d'excrétion, de reproduction et de sécrétion interne), comprend le système sympathique et parasympathique. les pièces. Les centres du système nerveux sympathique sont situés dans la moelle épinière thoraco-lombaire, le parasympathique - dans le tronc cérébral et la moelle épinière sacrée. L'influx nerveux dans les synapses périphériques du système sympathique est transmis par la noradrénaline et le système parasympathique par l'acétylcholine. Les parties sympathiques et parasympathiques coordonnent le travail des organes internes, exerçant sur eux des effets opposés, par exemple chez la femme, la stimulation des récepteurs b-adrénergiques du système sympathique favorise la relaxation de l'utérus, leur blocage ou la stimulation des récepteurs cholinergiques du système parasympathique , au contraire, stimule la contraction de l'organe. Chez l'homme, la partie sympathique stimule le réflexe d'éjaculation, la partie parasympathique stimule les érections.
La manifestation du cycle sexuel et des réflexes sexuels dépend de l'interaction des systèmes nerveux et endocrinien.
L'hypothalamus, la région supratubéreuse du diencéphale, est à la fois une formation nerveuse et une glande endocrine. Il produit de l'ocytocine, de la vasopressine et 10 autres neurohormones hypophysiotropes, dont sept ont un effet stimulant sur l'hypophyse antérieure (libérines), trois ont un effet inhibiteur (statines). L'ocytocine, la prolactostatine, la gonadolibérine et la corticolibérine participent à la régulation de la fonction reproductive.
Riz. 9. Schéma de régulation neuroendocrinienne des processus sexuels chez les hommes
[Les lignes pleines montrent une connexion directe (stimulation), les lignes intermittentes montrent une rétroaction négative (blocage)] : l'hormone hypothalamique G-RH stimule la libération de FSH et de LH par l'adénohypophyse ; La LH stimule la production de l'hormone testostérone par les cellules de Leydig ; la testostérone soutient la spermatogenèse, le désir sexuel et, par des mécanismes de rétroaction négative, contrôle la sécrétion de G-RH, FSH et LH : des concentrations élevées la bloquent et de faibles concentrations stimulent la libération de ces hormones ; La FSH stimule la production de l'hormone inhibine par les cellules de Sertoli ; l'inhibine supprime la sécrétion de FSH grâce à des mécanismes de rétroaction

L'ocytocine est un nanopeptide ; produit par l'hypothalamus et accumulé dans le lobe postérieur de l'hypophyse (neurohypophyse). L'ocytocine stimule l'activité contractile de l'utérus, participe à l'acte d'accouchement et favorise la libération des sécrétions des glandes mammaires lors de l'acte de succion. Chez les hommes, l’ocytocine semble induire des contractions péristaltiques dans les canaux spermatiques. La sécrétion de l'hormone dans le corps est régulée par la voie neuroréflexe.
La prolactostatine, ou facteur inhibiteur de la prolactine (PIF), bloque la sécrétion de prolactine par l'hypophyse antérieure (adénohypophyse). La sécrétion de prolactostatine est stimulée par la dopamine. L'utilisation d'agonistes dopaminergiques est utilisée pour supprimer la lactation dans la pratique vétérinaire et médicale.
L'hormone de libération des gonadotrophines, ou luliberine, facteur de libération des gonadotrophines, hormone de libération des gonadotrophines G-RH, LH-RH, FSH/LH-RH, est un décapeptide qui régule la synthèse et la sécrétion des hormones gonadotropes de l'hypophyse - la follitropine. (stimulation folliculaire hormone, ou FSH) et lutropine (lutéinisant hormone, ou LH). La FSH et la LH sont des glucoprotéines de composition chimique. La FSH stimule la croissance et le développement des follicules chez les femelles et la spermatogenèse chez les mâles ; LH - maturation des follicules préovulatoires, leur ovulation, formation du corps jaune et production de progestérone. Avec la FSH, la lutropine initie également la sécrétion d'œstrogènes par les follicules tertiaires. Chez les hommes, la LH stimule la production de testostérone, une hormone sexuelle masculine, par les cellules de Leydig.

Riz. 10. Voies neuroréflexes pour la libération d'ocytocine par le système hypothalamo-hypophysaire
La prolactine (PRL), hormone lactogène ou lutéotropique est un polypeptide produit par l'adénohypophyse ; chez les femelles, il stimule le processus de formation du lait, soutient la lactation et présente des propriétés lutéotropes dans la seconde moitié de la grossesse. Son effet chez les mâles est inconnu. Une caractéristique du PRL est que les organes cibles de la prolactine (glande mammaire, corps jaune) ne synthétisent pas d'hormones qui inhibent sa sécrétion (absence de rétroaction).
Il existe deux types de sécrétion de gonadotrophines : tonique et cyclique. La sécrétion tonique est continue et est enregistrée chez les mâles et les femelles tout au long de la vie. La sécrétion cyclique de FSH et de LH précède l'ovulation et est enregistrée chez les femelles sexuellement matures. La poussée préovulatoire de LH chez les animaux à ovulation spontanée est initiée par un pic préovulatoire d'estradiol, chez les animaux à ovulation réflexive (chats, lapins, chameaux) - par des rapports sexuels.
La glande pinéale, ou glande pinéale, est l'appendice cérébral supérieur lié aux structures du diencéphale. Il produit la mélatonine neurosécrétée, qui se caractérise (selon le type d'animal) par une activité anti- et progonadique : capacité à inhiber ou, au contraire, stimuler la sécrétion de gonadolibérine. Une caractéristique distinctive de la glande pinéale est la dépendance de son activité sécrétoire à l'égard de l'éclairage (photopériodisme). L'activité de la glande augmente dans l'obscurité. La neurohormone de la glande pinéale contrôle le rythme hormonal quotidien du corps. Chez de nombreux animaux mono- (loups, coyotes, chacals, lycaons Dingo, etc.) et polycycliques (représentants de la famille des chats, moutons, chevaux, etc.), le facteur lumière sert de principal régulateur climatique de la saisonnalité de la reproduction. . Le rôle de la mélatonine chez les chiens reste flou, puisque les chiens sont sexuellement actifs quelle que soit la saison.
Le rôle physiologique des hormones sexuelles dans le corps des femmes et des hommes est extrêmement diversifié. Les parties endocriniennes des ovaires produisent des œstrogènes, de la progestérone et de l'inhibine, et les testicules produisent de la testostérone et de l'inhibine.
Les œstrogènes sont des hormones sexuelles de nature stéroïdienne, constituées de 18 atomes de carbone (C 18). Produit par la croissance et la maturation des follicules tertiaires et du placenta. Il existe trois fractions d'œstrogènes : l'estradiol, l'estrone et l'estriol. L'estradiol, le plus actif d'entre eux, est un œstrogène primaire qui peut être converti en estrone et en estriol. Dans le corps des femelles, les œstrogènes sont responsables du développement des caractères sexuels secondaires et des canaux excréteurs des glandes mammaires. Les œstrogènes induisent l'oestrus, l'excitation sexuelle et la chasse, provoquent la prolifération de l'endomètre, du myomètre, de l'épithélium de la muqueuse vaginale et de son vestibule, augmentent l'apport sanguin aux organes génitaux, favorisent l'ouverture du canal cervical, stimulent l'activité contractile de l'utérus, les trompes de Fallope et participent activement au travail grâce à des mécanismes de rétroaction positive induit une poussée préovulatoire de LH chez les animaux à ovulation spontanée.
La progestérone est une hormone stéroïde (C 21). Produit par le corps jaune du cycle reproductif et de la grossesse, ainsi que par le placenta. Chez le chien, le corps jaune est le principal producteur de progestérone tout au long de la grossesse. L'ovariectomie entraîne une interruption de grossesse à tout moment. La progestérone transfère l'endomètre à un état sécrétoire actif, le prépare à la fixation de l'embryon, maintient dans l'utérus les conditions nécessaires au développement de l'embryon et du fœtus, bloque l'activité contractile de l'utérus, provoque la fermeture du canal cervical, supprime la maturation des follicules, la manifestation de l'oestrus, l'excitation sexuelle et la chasse, stimule le développement des alvéoles de la glande mammaire et inhibe la sécrétion de LH.
Implication des hormones dans la régulation de la fonction reproductive chez le chien
|
Hormone |
Fonction hormonale |
||
|
Nom |
lieu de production |
Chimique nature |
|
|
Hormone de libération des gonadotrophines(G-RG) |
Hypothalamus |
Peptide |
Stimulation de la sécrétion de FSH et de LH |
|
Inhibiteur de la prolactinefacteur (UIF) |
Hypothalamus |
Peptide |
Inhibition de la sécrétion de l'hormone prolactine |
|
Hormone de libération des corticotropines(K-RG) |
Hypothalamus |
Peptide |
Stimulation de la sécrétion d'ACTH |
|
Hormone folliculostimulante (FSH) |
Adhéiohypophyse |
Glucoprotéine |
1. Croissance folliculaire 2. Sécrétion d'hormones œstrogènes 3. Spermatogenèse |
|
Lutéinisanthormone (LH) |
Adhéiohypophyse |
Glucoprotéine |
1. Ovuler 2. Formation du corps jaune et sécrétion de l'hormone progestérone 3. Sécrétion de l'hormone testostérone |
|
Prolactine |
Adhéiohypophyse |
Protéine |
1. Allaitement 2. Facteur lutéotropique |
|
Hormone adrénocorticotrope (ACTH) |
Adhéiohypophyse |
Polypeptide |
Sécrétion d'hormones glucocorticoïdes |
|
L'ocytocine |
Hypothalamus |
Peptide |
1.Accouchement 2. Libération du lait |
|
Œstrogènes |
Ovaires Placenta |
Stéroïde |
1. Œstrus, excitation sexuelle et désir sexuel 2. Formation du sol 3.Accouchement 4. Croissance mammaire |
|
Progestérone |
Ovaires Placenta |
Stéroïde |
1. Préservation de la grossesse 2. Croissance mammaire |
|
Relaxine |
Ovaires |
Polypeptide |
1. Relaxation des ligaments pelviens 2. Dilatation cervicale |
|
Testostérone |
Testicules |
Stéroïde |
1. Désir sexuel 2. Spermatogenèse 3. Stimulation de la croissance et du développement des canaux excréteurs des testicules, des glandes sexuelles accessoires et du pénis |
|
Inhibine |
Ovaires Testicules |
Protéine |
Inhibition de la sécrétion de FSH |
|
Cortisol |
Glandes surrénales |
Stéroïde |
1.Accouchement 2. Allaitement |
L'inhibine est une hormone peptidique produite par l'épithélium folliculaire des follicules tertiaires et des cellules de Sertoli. Inhibe la sécrétion de FSH dans le corps des femmes et des hommes.
La relaxine est une hormone peptidique produite par le corps jaune en fin de grossesse. Prépare le corps de la mère à l'accouchement, provoquant un relâchement des ligaments pelviens, des muscles du col de l'utérus, du vagin et de son vestibule.
La testostérone est une hormone sexuelle masculine de nature stéroïdienne (C 19), produite dans les testicules, les ovaires et le cortex surrénalien. Dans les testicules, la testostérone est synthétisée dans les cellules de Leydig, dans les ovaires - dans les follicules tertiaires, n'étant qu'une étape intermédiaire de la biosynthèse. Le rôle physiologique de la testostérone pendant la période embryonnaire est sa participation à la différenciation sexuelle de l'organisme. La testostérone est nécessaire au développement des caractères sexuels secondaires, au maintien de la spermatogenèse, à la stimulation du désir sexuel et à la régulation de la sécrétion de LH chez l'homme.
Les glucocorticoïdes maternels et fœtaux et la prostaglandine Fzc participent également à la régulation des processus sexuels.
Les glucocorticoïdes sont des hormones stéroïdes produites par les glandes surrénales de la mère et du fœtus. Le cortisol (hormone du stress) est l'hormone glucocorticoïde la plus active et la plus importante qui participe à la régulation du processus d'accouchement et de la lactogenèse. Le cortisol fœtal semble jouer un rôle de premier plan dans le déclenchement du travail.
La sécrétion de glucocorticoïdes est contrôlée par la corticolibérine et l'hormone adrénocorticotrope, ou ACTH. La corticolibérine est une hormone peptidique de l'hypothalamus qui stimule la sécrétion de l'hormone polypeptidique ACTH, caractérisée par une activité corticotrope.
La prostaglandine F 2 a (PgF 2 a) est un composé biologiquement actif doté de propriétés hormonales, un dérivé d'acides gras polyinsaturés. Il est produit par de nombreuses cellules et tissus et participe à divers processus et réactions du corps. Chez de nombreux animaux domestiques, la PgF 2 a sert de facteur lutéolytique utérin (provoque la régression du corps jaune du cycle reproductif et de la grossesse) et participe activement au déclenchement et au maintien du processus de naissance. Le corps jaune du cycle reproductif et de la grossesse chez la chienne et la chatte y est peu sensible. L'avortement chez les animaux de ces espèces ne peut généralement être provoqué qu'après une utilisation répétée de PgP 2 a, à partir du 5ème jour du diestrus.
La régulation neuroendocrinienne de la fonction sexuelle des chiens est considérablement influencée par la communication avec le sexe opposé (ceci est particulièrement important pour les animaux à ovulation réflexive - lapins, chameaux, lamas et représentants de la famille féline). La coordination du comportement sexuel des femmes et des hommes est assurée par les organes sensoriels, la sensibilité cutanée et le mouvement.
La nourriture est un facteur externe important qui affecte toutes les fonctions du corps d’un chien. Une alimentation insuffisante, excessive et (ou) défectueuse réduit non seulement la capacité de reproduction des animaux, mais provoque souvent leur infertilité.
Les fonctions reproductives les plus importantes des hormones de l'hypothalamus, de l'hypophyse, des gonades, du placenta et des glandes surrénales sont répertoriées dans le tableau 2.
MATURITÉ SEXUELLE ET PHYSIOLOGIQUE
La puberté est l'âge auquel les mâles et les femelles sont capables de participer au processus de reproduction sexuée : produire les cellules germinales correspondantes (sperme, ovocytes) et s'accoupler. L'activité sexuelle chez les femmes est cyclique. Ils démontrent leur volonté de s'accoupler uniquement pendant une période strictement fixée du cycle sexuel - pendant les chaleurs sexuelles. L'ovulation chez la chienne est spontanée et est liée à l'apparition des chaleurs. La libération de spermatozoïdes (spermatozoïdes et plasma de spermatozoïdes) par les organes génitaux des hommes et leur introduction dans les organes génitaux des femmes se produisent lors des rapports sexuels.
Le moment de la maturité chez les femelles est déterminé par la date du premier cycle sexuel. Habituellement, le premier cycle sexuel est enregistré entre 6 et 12 mois. Chez les hommes, la puberté survient environ 1 à 1,5 mois plus tard que chez les femmes. Les chiens de races moyennes et miniatures deviennent sexuellement matures plus tôt que les chiens de grandes races. Le moment du début de la puberté est fortement influencé par l’état de santé de l’animal, ses conditions d’alimentation et de logement, ainsi que par la communication avec le sexe opposé.
La puberté survient généralement avant la fin de la croissance principale, du développement structurel et physiologique de l'animal, garantissant sa fertilité élevée, le fonctionnement normal du corps pendant la grossesse, l'accouchement et la lactation, ainsi que la naissance d'une progéniture en bonne santé.
La maturité physiologique est l'âge à partir duquel il est conseillé d'utiliser des mâles et des femelles pour produire une progéniture. La maturité physiologique chez le chien coïncide généralement avec l'atteinte des tailles corporelles caractéristiques d'un animal adulte et avec l'apparition de 2 à 3 cycles sexuels chez les femelles. Les femelles de la plupart des races atteignent généralement leur maturité physiologique à l'âge de 1,5 an, les mâles à 2 ans.
SEXUEL RÉEL
Les rapports sexuels, ou copulation, coït, copulation, sont un ensemble de réflexes sexuels qui assurent l'élimination des spermatozoïdes de l'appareil génital masculin et leur introduction dans l'appareil reproducteur féminin. Lors des rapports sexuels, on distingue les réflexes suivants : approche, érection, étreinte, copulatoire et éjaculation.
Le réflexe d'approche est un ensemble de réactions comportementales qui coordonnent le comportement sexuel des individus de sexe opposé lors de l'accouplement.
Le réflexe érectile est un fort remplissage de sang et une augmentation de la taille du pénis, assurant son retrait du prépuce et la possibilité de son insertion dans le tractus génital féminin. Cet acte réflexe-vasculaire se manifeste chez la femme par un gonflement du clitoris et une hyperémie de la muqueuse du vagin et de son vestibule.
Le réflexe d’étreinte est l’adoption d’une position d’accouplement par la femelle et le mâle. Simultanément au réflexe d'étreinte, le réflexe copulatoire apparaît également.
Le réflexe copulatoire est l'insertion et la friction du pénis de l'homme dans le vagin de la femme, entraînant une irritation des zones érogènes de leurs organes génitaux et l'apparition de l'éjaculation.
Le réflexe d'éjaculation est l'élimination des spermatozoïdes (éjaculat) du système reproducteur masculin. L'éjaculation, comme l'érection, est un acte neuroréflexe.
Tous les réflexes sexuels sont de nature innée (inconditionnés). Dans le processus de leur formation et de l'acquisition de l'expérience sexuelle par les animaux, les réflexes conditionnés se superposent aux réflexes inconditionnés. Certains d'entre eux contribuent au développement de réflexes sexuels à part entière, tandis que d'autres, au contraire, renforçant ou affaiblissant leur manifestation, conduisent à l'apparition de comportements sexuels anormaux.
Le comportement sexuel des animaux est coordonné par les organes sensoriels : sensibilité cutanée et mouvement.
Pendant la période de proestrus et d'oestrus, les femelles sécrètent des phéromones sexuelles et notamment du p-hydroxybenzoate de méthyle, qui stimulent les réflexes sexuels des mâles. Au début du proestrus, les femelles se comportent passivement ou manifestent un comportement agressif envers les mâles ; à la fin du proestrus, elles commencent à manifester un intérêt sexuel à leur égard. Les mâles suivent une femelle présentant des signes d'oestrus et d'excitation sexuelle, disposés selon un rang hiérarchique. Si la femelle le permet, le mâle préféré commence à la renifler activement, à lécher les organes génitaux externes et d'autres parties de son corps, à mettre sa tête et une ou deux pattes avant sur son dos et à tenter d'avoir des rapports sexuels. Au début des chaleurs sexuelles, la femelle démontre qu’elle est prête à s’accoupler. Renifle les organes génitaux du mâle, prend une position d'accouplement : reste immobile, déplace la queue sur le côté, tire l'anse génitale vers le haut. Le mâle saute sur la femelle, lui serre les côtés avec ses pattes avant et effectue des mouvements de poussée avec son bassin, assurant l'insertion du pénis dans le vagin.

Riz. 11. Positions du chien pendant l'accouplement :
A - au début des rapports sexuels ; B - pendant la période d'accouplement des organes génitaux
Lorsque le pénis est complètement inséré, le sphincter du vestibule du vagin se contracte par réflexe, ce qui entraîne un gonflement sévère du bulbe pénien et une adhésion (collage) des organes génitaux des animaux. Le mâle saute de la femelle et les animaux se mettent queue contre queue. L'accouplement des organes génitaux (serrure génitale, accouplement) dure 5 à 45 minutes. La libération des spermatozoïdes s'accompagne de mouvements rythmiques de la racine de la queue et de contractions ondulatoires de la paroi du canal urogénital. Le sperme est sécrété dans le vagin sous la forme de trois fractions : la première fraction agit comme un lubrifiant, la seconde contient les spermatozoïdes et la troisième assure la poussée des spermatozoïdes dans la cavité utérine.
Muscles de la tête.
Les muscles de la tête sont divisés en expressions faciales Et à croquer. Les premiers se distinguent par le fait qu’ils débutent au niveau des os ou des fascias et se terminent au niveau de la peau. Certains muscles regroupés autour des ouvertures naturelles forment des sphincters (aident à rétrécir l’ouverture) ou des dilatateurs (aident à élargir l’ouverture). Fonction muscles du visage tête - assurant la mobilité des lèvres, des commissures de la bouche, des narines, des paupières, de la peau du museau, du menton, des joues, du front, etc. En plus de la valeur utilitaire de ces mouvements, importants pour la nutrition, la respiration, la vision, etc. , les muscles du visage fournissent liens de communication entre animaux, puisque l'expression des yeux, de la bouche, la position des lèvres, des oreilles, le relief de l'arrière du nez jouent une valeur de signalisation dans la communication des animaux entre eux. Les expressions faciales d'un chien sont extrêmement diverses et traduisent les différents états mentaux de l'animal d'une manière compréhensible pour la plupart des animaux. Certaines expressions faciales (dans ce contexte, vous ne pouvez pas l'appeler autrement) chez un chien sont similaires aux expressions faciales humaines, d'autres ne sont compréhensibles que par un éleveur de chiens observateur et expérimenté en interaction avec un chien particulier. Perturbations opérationnelles Les muscles du visage peuvent introduire des difficultés très importantes dans les actions collectives des animaux, parfois dans la nature, cela peut coûter la vie à l'animal. Grand rôle muscles du visage et dans l'évaluation extérieure d'un chien de race pure. Ce n’est pas pour rien que dans les standards de nombreuses races, la description commence souvent par l’expression caractéristique des yeux et du museau du chien. Déviations dans le sens d’un renforcement ou d’un affaiblissement des caractéristiques de la race à l’extérieur du chien peut être associé à caractéristiques du travail des muscles du visage. Donc, ton insuffisant sous-cutané les muscles de la bouche, les muscles incisifs et canins contribuent à l'apparition de lèvres tombantes et crues chez le Kuvac slovaque. Faiblesse les mêmes muscles et muscle zygomatique conduit à des lèvres tombantes avec des bajoues tombantes, des oreilles tombantes, ce qui est un défaut grave de l’extérieur du Rottweiler. Laxité des muscles buccinateurs et orbiculaires externes La bouche contribue à l'affaissement de la lèvre supérieure, simulant la profondeur du museau - cela profite à l'extérieur du bouledogue anglais et du Saint-Bernard, mais peut être une raison pour abattre le Dogue Allemand. Faiblesse du muscle zygomatique Pour un berger allemand ou un spitz, cela peut entraîner une perte de chances de carrière en exposition, car cela entraîne la formation d’oreilles tombantes. Les oreilles tombantes, également associées à une faiblesse du muscle zygomatique, sont un signe vicieux pour les chiens de plusieurs races - husky, écossais, doberman. Les narines étroites, associées à la faiblesse du labrum élévateur et du muscle transverse du nez, sont un vice du bouledogue anglais, mais une vertu du lévrier. Muscles à mâcher en raison de leur travail plus important que celui des imitateurs, ils sont beaucoup plus puissants. Ils partent de divers os du crâne et sont attachés principalement à la mâchoire inférieure. Leur réduction fournit une variété de mouvements de mâchoire pour saisir, mordre et broyer des aliments solides. Si l'acte de mâcher est perturbé (par exemple en raison d'une zone douloureuse au niveau de la gencive), d'un entraînement insuffisant des muscles masticateurs (par exemple lors de l'alimentation d'aliments pâteux) ou en raison d'un caractère traumatique, de phénomènes d'atrophie asymétrique ou générale et une faiblesse de ces muscles peut survenir. Faiblesse, les contractions spastiques de certains muscles peuvent déformer l’apparence du chien.
Muscles fonctionnellement importants de la tête du chien.

A - muscles du visage : 1 - muscle sous-cutané du visage, 2 - muscle orbiculaire oris, 3 - muscle zygomatique, 4 - élévateur nasogénien, 5 - muscle orbiculaire oculi.
B - muscles masticateurs : 1 - gros muscle masticateur (couches superficielles et profondes), 2 - muscle temporal, 3 - muscle digastrique.
La musculature de la tête du chien et son emplacement.
MUSCLE ROND DE LA BOUCHE - forme des touffes légèrement visibles dans la lèvre inférieure ; dans la lèvre supérieure, ils sont un peu plus développés, mais ne forment pas un anneau continu. Une partie d'entre eux, au niveau de la ligne médio-sagittale, se courbe vers le haut et est fixée sur la structure cartilagineuse du nez.
MUSCLES INCISEURS - peu développés.
MUSCLE DU MENTON - peu développé.
MUSCLE zygomatique - naît du cartilage auriculaire thyroïdien, s'étend sous la forme d'un mince ruban sous la peau le long du côté de la tête jusqu'au coin des lèvres et se termine sous le muscle labial cutané de la lèvre supérieure. L'original, en comparaison avec d'autres animaux, doit être considéré comme primitif. Chez d'autres animaux, il se différencie apparemment en deux parties - l'oreille et le zygomatique, et la première va du cartilage thyroïde à la zone de l'arc zygomatique, étant incluse dans les muscles généraux de l'oreille.
NASO - LEVATOR LIVIOUS - large, séparé par une bordure faible du dépresseur de la paupière inférieure et prend naissance comme un tendon lamellaire dans le coin médial des yeux à partir du fascia frontal et sur la mâchoire supérieure. Elle se divise en une partie profonde et superficielle et se termine à la lèvre supérieure. La partie superficielle s'étend jusqu'au muscle buccal et la partie profonde dégage des faisceaux vers la paroi latérale du tube cartilagineux nasal.
MUSCLE FANAN - commence sur la surface latérale de la mâchoire supérieure près du foramen sous-orbitaire et, en s'étendant progressivement, se termine dans la lèvre supérieure ; seule une très légère touffe s'étend au niveau de l'aile externe du nez.
LIVATEUR SPÉCIAL DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE - commence avec le précédent, est dirigé sous le releveur nasogénien, s'élargit progressivement et parfois même bifurque, et est fixé par de fines branches tendineuses autour de l'ouverture du nez. A son extrémité, une partie des branches se connecte au muscle du même nom de l'autre côté.
DÉGRATEUR DE LA LÈVRE INFÉRIEURE - des touffes très faibles partent de la mâchoire inférieure entre la canine et le foramen mentonnier et se terminent dans la lèvre inférieure au coin de la bouche. Sa présence est souvent difficile à établir.
MUSCLE SOUS-CUTANÉ DES LÈVRES - vient du cou le long de la surface externe du muscle masticateur et se termine au coin des lèvres.
MUSCLE buccal - peu développé.
GRAND MUSCLE MASTIQUE - provient du bord inférieur et de la surface médiale de l'arc zygomatique et est étroitement relié dans les parties initiales profondes au muscle temporal. Au cours de son parcours ultérieur, le muscle forme deux couches vaguement délimitées : a) la couche superficielle est dirigé vers le processus angulaire faisant saillie sur la mâchoire inférieure et est attaché dans sa zone, et certains des faisceaux dépassent des limites de ce processus et fusionnent avec le muscle de l'aile ; b) couche profonde en croisant avec le superficiel, il se dirige vers la fosse du muscle masticateur sur la branche de la mâchoire inférieure (certains auteurs distinguent trois couches dans le muscle).
MUSCLE DE L'AILE - a son origine sur l'os ptérygoïdien, l'apophyse ptérygoïdienne de l'os sphénoïde et en partie sur l'os palatin. Son abdomen n'est pas aussi nettement divisé que celui des chevaux, mais est divisé en deux couches. Le muscle se termine sur la surface correspondante de la branche de la mâchoire inférieure et sur son apophyse angulaire, et une partie des faisceaux, passant au-delà du bord de la branche, se connecte au gros muscle masticateur.
MUSCLE TEMPORAL - très fortement développé, commence sur la fosse temporale et le ligament orbitaire - se confond avec le grand muscle masséter et se termine sur l'apophyse coronoïde.
MUSCLE DIGASTIQUE - fortement exprimé ; Il n'y a pas de division en abdomens. L'action des muscles masticateurs est similaire à celle du porc, mais diffère par la possibilité d'une très large ouverture des mâchoires et de leur forte fermeture. Il n'y a pas de mouvements sur les côtés et un mouvement vers l'avant de la mâchoire ventrale se produit, mais pas dans une mesure significative.
LEUR FONCTION :
MUSCLE ORAL CIRCULAIRE - comprime les lèvres et ferme l'ouverture de la bouche.
LES MUSCLES INCISEURS SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS - antagonistes du muscle orbiculaire de l'oris - ouvrent l'ouverture buccale.
MUSCLE DU MENTON - abaisse le menton jusqu'à la lèvre inférieure.
MUSCLE Zygomaticus - tire le coin de la bouche vers l'arrière et vers le haut.
Ascenseur naso-génien - soulève la lèvre supérieure et élargit l'entrée du vestibule du nez.
FANUS MUSCLE - dilate les narines, soulève la lèvre supérieure.
LIFTER SPÉCIAL POUR LÈVRES SUPÉRIEURES - soulève la lèvre supérieure.
DEMOWER DE LÈVRE INFÉRIEURE - abaisse la lèvre inférieure.
MUSCLE DES LÈVRES SOUS-CUTANÉES - abaisse la lèvre inférieure.
Arc réflexe.
Un réflexe est la réponse du corps à une stimulation effectuée par le système nerveux. Chaque réflexe contient des liens afférents (sensoriels) et efférents (exécutifs) qui constituent l'arc réflexe. La partie afférente de l'arc réflexe est constituée de récepteurs et de neurones sensoriels, la partie efférente est constituée de motoneurones et de l'organe exécutif (muscle, glande, tissu). Pour réaliser un réflexe, au moins deux neurones sont nécessaires : sensoriel et moteur. Ce circuit neuronal est appelé arc réflexe simple. La plupart des arcs réflexes impliquent de nombreux interneurones et ces arcs sont appelés multineuronaux.
Schéma d'un arc réflexe simple
1 - récepteur;
2 - chemin sensible ;
3 - centre sensible ;
4 - transmission synaptique de l'excitation ;
5 - centre moteur ;
6 - voie motrice ;
7 - effecteur.

Les neurones sont connectés les uns aux autres par les branches des processus nerveux à l'aide de synapses, qui assurent le contact et le transfert de l'excitation d'un neurone à un autre ou à un organe de travail via une substance chimique appelée transmetteur.
Schéma d'arcs réflexes complexes avec feedback.

Transmission synaptique de l'excitation dans les circuits neuronaux

Les synapses sont capables de transmettre l'excitation dans une seule direction : de l'axone à la dendrite. Sur la base de leurs caractéristiques fonctionnelles, on distingue les synapses excitatrices et inhibitrices. Dans les synapses excitatrices, le médiateur est l'acétylcholine, dans les synapses inhibitrices, la glycine, etc. Le mécanisme de transmission de l'excitation est illustré dans le diagramme de la fonction synapse. Les synapses des interneurones du cortex cérébral sont le lieu de fermeture des connexions réflexes conditionnées. Les synapses forment et stockent des informations appelées mémoire.
L'afférentation de rétroaction (feedback) est une information provenant de l'organe exécutif vers le système nerveux central, où se produit une analyse de ce qui devrait se produire et de ce qui s'est passé en réponse à l'action du stimulus. Sur la base de cette analyse, des impulsions correctives sont envoyées du centre vers l'organe exécutant et vers les récepteurs. Ces signaux peuvent augmenter ou diminuer leur activité fonctionnelle. Le feedback dans le réflexe assure une autorégulation automatique et forme un système fonctionnel indépendant appelé anneau réflexe, et garantit également une évaluation automatique et un contrôle parfait de tout acte réflexe. Ces systèmes fonctionnels qui régulent les réactions comportementales sont appelés centres nerveux.
Articulations, connexions osseuses.
Une articulation est un type de connexion osseuse discontinue caractérisé par une liberté de mouvement accrue, c'est-à-dire déplacement des os les uns par rapport aux autres. Les os de l'articulation sont séparés par une fissure interosseuse. La structure des articulations est caractérisée par la présence de surfaces articulaires, d'une capsule articulaire et d'une cavité articulaire remplie de liquide articulaire.

Articulation 1 - capsule articulaire ; 2 - surfaces articulaires ; 3 - cavité articulaire
Les surfaces articulaires sont recouvertes d'une couche de cartilage articulaire très lisse.
La capsule articulaire est fixée le long du bord des os conjonctifs, fermement fusionnée avec eux. En conséquence, une cavité fermée se forme - une cavité articulaire. Dans les articulations individuelles, dans les endroits de forte friction, la capsule articulaire forme des saillies - des bourses séreuses, dont l'inflammation - la bursite - est caractéristique des chiens de grande taille et lourds, particulièrement fréquente au niveau des articulations du coude. La résistance des articulations est augmentée en attachant les ligaments articulaires à l'extérieur de la capsule articulaire. Chaque articulation a sa propre forme optimale et sa profondeur de connexion, qui assurent la congruence (coïncidence) des surfaces articulaires. Ceci est particulièrement important pour les articulations qui supportent de lourdes charges.
Il existe plusieurs types de connexions osseuses.
Continu . Ce type de connexion présente une grande élasticité, une grande résistance et une mobilité très limitée. Selon la structure du tissu reliant les os, on distingue les types de connexion suivants :
Avec l'aide du tissu conjonctif - syndesmose, et si les fibres élastiques y prédominent - synélastose. Un exemple de ce type de connexion est celui des fibres courtes qui relient fermement un os à un autre, comme les os de l'avant-bras et du tibia chez le chien ;
Avec l'aide du tissu cartilagineux - synchondrose. Ce type de connexion a une faible mobilité, mais assure la résistance et l'élasticité de la connexion (par exemple, la connexion entre les corps vertébraux) ;
Avec l'aide du tissu osseux - synostose, qui se produit, par exemple, entre les os du poignet et du tarse. À mesure que les animaux vieillissent, la synostose se propage à tout le squelette. Elle survient au site de syndesmose ou de synchondrose.
En pathologie, cette connexion peut se produire là où elle n'existe normalement pas, par exemple entre les os de l'articulation sacro-iliaque en raison de l'inactivité physique, notamment chez les animaux âgés ;

Schéma de développement et structure de l'articulation : a - fusion ; b - formation d'une cavité articulaire ; c - assemblage simple ; g - cavité articulaire; 1 - signets en os cartilagineux ; 2 - accumulation de mésenchyme ; 3 - cavité articulaire ; 4 - couche fibreuse de la capsule ; 5 - couche synoviale de la capsule ; 6 - cartilage hyalin articulaire ; Ménisque à 7 cartilages
Avec l'aide du tissu musculaire - synsarcose, dont un exemple est la connexion de l'omoplate au torse.
Type d'articulation(s) discontinu(s) (synovial(s)) . Il offre une plus grande amplitude de mouvement et est construit de manière plus complexe. Selon la structure, les articulations peuvent être simples et complexes, et selon la direction des axes de rotation - multiaxiales, biaxiales, uniaxiales, combinées et coulissantes.
La plupart des os du crâne sont reliés par un type de connexion continu, mais il existe également des articulations - temporo-mandibulaire, atlanto-occipitale. Les corps vertébraux, à l'exception des deux premiers, sont reliés entre eux par des disques intervertébraux (cartilage), c'est-à-dire une synchondrose, ainsi que par des ligaments longs. Les côtes sont reliées par un fascia intrathoracique, constitué de tissu conjonctif élastique, ainsi que de muscles intercostaux et de ligaments transversaux. L'omoplate est reliée au corps à l'aide des muscles de la ceinture scapulaire, et les os du bassin sont reliés à l'articulation avec l'os sacré et à la première vertèbre caudale - avec les ligaments. Les parties des membres sont attachées les unes aux autres à l'aide d'articulations de différents types, par exemple, la connexion de l'os pelvien avec le fémur s'effectue à l'aide d'une articulation de hanche multi-axiale.
Bibliographie:
M. V. Dorosh, Ouvrage de référence vétérinaire pour les propriétaires de chiens, 2008.
G.P. Dulger, Physiologie de la reproduction et pathologie reproductive du chien.
F.S. Araslanov, A.A. Alekseev, V.I. FORMATION DE CHIENS DE TRAVAIL Shigorin
Extérieur du chien et son évaluation par E.E. Yerusalimsky, Moscou 2002
Ressources Internet :
Portail pour les amoureux et propriétaires de chiens
www.amiog.ru