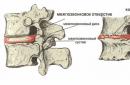Le problème du développement psychosocial d'une personne handicapée dans la famille et la société reste l'un des problèmes les plus difficiles de la psychologie sociale. La personne handicapée et sa famille souffrent d'un traumatisme psychologique.
Si un enfant naît avec une paralysie cérébrale, il existe un risque élevé de rejet, de retrait et d'agressivité parentale (y compris maternelle). L'apparition d'un tel enfant dans la famille menace les relations conjugales et peut affecter négativement l'état psychologique des autres enfants de la famille.
Les bébés aveugles ne peuvent pas suivre l’expression du visage de la personne qui s’occupe d’eux et leur sourire en retour.
Le comportement des enfants sourds peut être confondu avec de la désobéissance.
Les enfants atteints d’autres handicaps graves sont incapables de répondre aux signaux du monde extérieur de la même manière que les enfants en bonne santé.
Des anomalies évidentes chez les enfants, perceptibles dès la naissance, comme le syndrome de Down et la paralysie cérébrale, créent des difficultés d'adaptation et psychologiques considérables pour tous les membres de la famille, en particulier pour les jeunes parents. Enseigner à ces parents et aux autres membres de la famille la patience et les compétences de communication avec un enfant malade facilite le dialogue parent-enfant, la formation de l'attachement et toute socialisation ultérieure.
Le petit homme est né handicapé... Valide- traduit de l'anglais - "avoir de la force". Le handicap est un « manque de force », si on le traduit littéralement. Cela ressemble à un verdict... Cependant, ce verdict ne peut être considéré comme définitif !
Durant la période néonatale et la petite enfance, un enfant handicapé ressent de la douleur et de l'inconfort (désagrément). La mauvaise santé d'un enfant pousse souvent ses parents à l'abandonner...
Mais l’homme est un être rationnel ! Les parents sont obligés de faire face à leurs sentiments face à la naissance d'un bébé « imparfait », de prendre le contrôle de la situation avec leur conscience et de commencer à prendre soin du bébé. C'est très difficile.
Dans une telle situation, le soutien d’un groupe de parents élevant des enfants handicapés peut être d’une grande aide. Les précieux conseils des parents qui se retrouvent seuls avec le même deuil sont très importants.
À quels problèmes une famille avec un enfant handicapé est-elle confrontée ?
Il est important de considérer plusieurs aspects du problème :
- Premièrement, il s’agit de la relation mère-enfant malade ;
- Deuxièmement, mère - enfant malade - père ;
- Troisièmement, un enfant malade signifie des enfants en bonne santé ;
- Quatrièmement, mère - enfants en bonne santé ;
- Cinquièmement, une famille avec un enfant handicapé et d'autres proches ;
- Sixièmement, la famille avec un enfant handicapé et la société ;
- Septièmement, une décision constructive de créer une association de familles avec enfants handicapés.
La vie, bien sûr, pose bien d’autres questions à ces familles, mais considérons le problème spécifiquement dans aspect socio-psychologique.
La famille était confrontée à un fait : il y avait dans la famille une personne handicapée ou gravement malade.
Les proches sont opprimés par des sentiments de peur, de culpabilité et de dépression ; la déception, ainsi que la rage causée par le caractère insoluble du problème de la maladie lui-même. Ces réactions familiales ne sont pas des aberrations, mais des réactions humaines normales face à une situation extrêmement complexe, frustrante, incompréhensible et clairement hors de leur contrôle.
La famille dans ce cas est confrontée à des difficultés objectives et subjectives.
1) Objectif : coût élevé des médicaments et des traitements, c'est-à-dire augmentation des dépenses familiales, perturbation du rythme et de l'ordre de la vie familiale, stress supplémentaire pour les membres de la famille en bonne santé.
2) Subjectif : diverses expériences liées à la maladie d'un membre de la famille (chagrin, culpabilité, désespoir, peur), c'est-à-dire réactions émotionnelles (stress).
La charge entre les membres d’une famille qui comprend une personne gravement malade ou handicapée est répartie comme un « gâteau en couches ».
Première couche intérieure- il s'agit généralement d'une seule personne (mère, grand-mère, etc.) - le membre de la famille qui assume le rôle de « tuteur » principal et qui supporte l'essentiel des soins, de l'entretien et de l'éducation quotidiens. La vie de ce membre de la famille est entièrement centrée sur le patient : jour et nuit, il pense aux besoins et aux désirs du patient, veille à sa satisfaction et à son confort.
Ce membre de la famille lit des articles médicaux, rend visite au médecin et communique avec des familles similaires pour apprendre quelque chose d'utile pour son patient. Plus que les autres membres de la famille, ce pécun souffre de toutes les fluctuations et changements de la maladie, de toute aggravation. C'est lui qui « ennuie » le médecin traitant et les travailleurs sociaux - il entre dans les détails du traitement, dans les petites choses, et accuse les autres d'inaction.
Sa vie est un flux continu d'affaires et de pensées liées au patient. Et plus les choses vont mal pour le patient, plus l’activité du soignant est requise. Il existe des cas fréquents où la mère d'un enfant handicapé est tellement « occupée » par ses soins que cela devient une menace pour l'existence de la famille dans son ensemble. Le mari et les autres enfants (en bonne santé) ressentent un manque aigu d'attention, de participation et parfois même une agressivité évidente de la part de la mère : la femme accuse sa famille de ne pas prêter suffisamment d'attention au patient, et il règne une atmosphère constamment douloureuse. dans la maison. Il existe un fossé entre le principal dispensateur de soins et les autres membres de la famille. Il n’y a pas de cohésion, la famille s’effondre.
La détérioration de l'état de santé du patient aggrave la situation de la famille. Ici, il est très important que le reste de la famille comprenne que pour la mère, cet enfant malade est d'une importance primordiale, il « domine » dans son cerveau comme la chose la plus importante.
Le reste des membres de la famille "deuxième couche de gâteau en couches", ils parviennent à « s'écarter » de l'atmosphère douloureuse de la maison au travail, aux études, en communiquant avec des amis, etc. Ils semblent créer une « barrière protectrice » contre cette situation traumatisante, ils fuient cette atmosphère douloureuse. Dans de telles familles, la joie de vivre disparaît souvent et le chagrin prend le dessus.
Comment pouvons-nous résoudre positivement cette situation ?
Donnons un exemple tiré de la pratique d'un des Centres d'Adaptation Sociale des Personnes Handicapées.
Une jeune femme, mère de deux enfants : une fille a 7 ans, l'autre fille a 1 an. Le plus jeune souffre de paralysie cérébrale. Avant cela, la famille amicale et aimante était dans un état de chagrin désespéré depuis la naissance de la plus jeune fille. La mère se consacre entièrement à son enfant malade, l’aînée des élèves de première année et le père de famille subissent l’aliénation et l’agressivité de la mère. Le père essaie d'être à la maison moins souvent et le moins possible ; sous n'importe quel prétexte, il essaie de sortir de la situation traumatisante. Il manque de soins et de « chaleur domestique ». De plus, un collègue qui « sympathise » avec son chagrin apparaît à « l'horizon » et n'hésite pas à « caresser et plaindre » le père de famille. La situation, à vrai dire, est critique... Heureusement, la jeune maman a trouvé la force en elle-même et est venue consulter un psychologue. En tant que conseillère, elle avait besoin de parler de ses problèmes, d'une analyse de la situation et de conseils précis qui pourraient sauver la famille. Il n'est pas facile de convaincre une personne adulte, offensée et fatiguée - la mère d'un enfant malade.
L'analyse de la situation comme « de l'extérieur », appuyée par des exemples figuratifs tirés des Saintes Écritures, a permis à la femme de comprendre différemment sa famille et d'évaluer la réalité de manière plus positive. Après tout, dans cette famille, l'atmosphère de joie de vivre a disparu et le péché de découragement s'est installé.
Après plusieurs conversations, la mère de l'enfant malade dit avec gratitude :
«Dès que ma vision du monde a changé, l'attitude du reste des membres de la famille à mon égard a également changé : ma fille et mon mari. J'ai choisi de traiter les autres avec gentillesse. L’essentiel désormais, c’est la vie de ceux qui vivent à côté de vous. Ce n'est que grâce à leur bien que vous recevrez votre bonheur. Restez proche de votre famille, elle vous aidera dans les moments difficiles. Et ensemble, nous sommes forts ! Il ne faut pas avoir peur de demander l’aide de spécialistes dans des situations de vie aussi difficiles.»
Comment se sentent les enfants en bonne santé dans une famille avec un enfant handicapé ?
Les enfants en bonne santé se caractérisent par des manifestations d’anxiété. Leur lien émotionnel avec le patient et ses problèmes n'est pas aussi fort que celui du principal « soignant ». Les enfants en bonne santé continuent d'étudier et lorsqu'ils quittent la maison pour vaquer à leurs activités professionnelles ou éducatives, tout ce qui est associé à la maladie s'éloigne psychologiquement d'eux. Mais ils craignent que le degré de mauvaise santé du patient ne l'oblige à interrompre ses nombreuses activités professionnelles, éducatives, personnelles et autres. La peur de cela peut se transformer en peur du principal soignant. Il y a une envie de « partir, de se cacher sur une île déserte », c'est-à-dire une aliénation en conséquence. Ici, le rôle du gardien principal dans une solution positive au problème est important.
L’exemple suivant est tiré de la pratique du Centre d’Adaptation.
Le plus jeune enfant de cette famille souffrait d'une grave maladie du sang oncologique, sa vie se calculait en mois. La mère et le père de cet enfant, ayant pris connaissance du diagnostic auprès d'oncologues et après avoir consulté un psychologue, ont décidé de créer une atmosphère de joie pour le patient et les autres enfants de la famille. Ils ont collé des décorations pour arbres de Noël, ont fait de courts voyages avec toute la famille et ont montré un théâtre de marionnettes à la maison. Partout nous essayions d’être ensemble, de saturer la vie des enfants de petites joies. Psychologiquement, cela a été très difficile pour les parents, car ils ont réalisé que l'issue était inévitable. Ils ont trouvé la force de préserver jusqu’au dernier jour le sentiment d’attention mutuelle et de gentillesse, sans trahir leur chagrin. Et cela demande beaucoup de courage et de volonté. L'unité de la famille leur a permis de supporter plus facilement l'amertume de la perte et au bébé malade de vivre une vie courte mais heureuse.
Il ne faut pas oublier que les enfants petits, même en bonne santé, peuvent développer un complexe de manque d'attention, une sorte de jalousie par rapport à l'attention portée à un enfant malade.
En raison des caractéristiques individuelles d'un enfant en bonne santé, ses maladies sont possibles, causées par le stress, le désir d'attention des autres membres de la famille : rhumes fréquents, immunité affaiblie, maladies pulmonaires et rénales.
Troisième couche (sous-groupe), qui se concentre autour du patient - ce sont des parents proches et éloignés. Leurs ragots se résument souvent au fait que la cause de la maladie était les mauvaises actions du principal soignant et d'autres membres de la famille. En conséquence, leurs opinions et leurs actions compliquent la situation du principal dispensateur de soins et des autres membres de la famille, augmentant ainsi leurs sentiments de culpabilité et d’impuissance.
L'insatisfaction des membres de la famille à l'égard de la vie de famille augmente et l'aliénation au sein de la famille augmente.
Qu’est-ce qui motive ce mécontentement familial mondial ? Premièrement, un sentiment de culpabilité face à la maladie : une famille vit la maladie particulièrement durement si ses membres se reprochent eux-mêmes ou reprochent au patient ce qui s'est passé. Kenneth Terkelsen a décrit en 1987 les deux opinions familiales les plus courantes sur les causes de la maladie :
a) Biologique : les familles qui adhèrent consciemment ou inconsciemment à cette théorie voient les causes de la maladie dans certaines mutations, changements dans le corps, indépendants de la volonté du patient. Dans ce cas, la famille surestime la possibilité d’un traitement médicamenteux et est souvent tourmentée par la peur de l’hérédité génétique ou par la crainte que, contrairement à toutes les assurances du médecin, la maladie soit contagieuse.
b) Psychologique : ses partisans se reprochent tout, eux-mêmes, tous les membres de la famille ou la personne handicapée. Il existe une agression cachée de tous les membres de la famille les uns envers les autres.
Il est important de comprendre tout cela et d'essayer de soulager l'irritation et l'agressivité au sein de la famille. L'accumulation de connaissances et d'expériences conduit au fait que la famille peut progressivement se libérer et cesser d'être émotionnellement dépendante des fluctuations temporaires de l'évolution de la maladie.
Une attention particulière doit être portée aux familles dont l'un des membres souffre d'un trouble neuropsychique grave. Considérons la dynamique d'une telle famille. Une pression interne et externe importante sur cette famille, un état de tension neuropsychique, de l'anxiété, des sentiments de culpabilité malsains - tout cela conduit au fait que la structure d'une telle famille est instable.
Cette situation est perçue comme difficile à supporter et les proches cherchent intensément une issue.
La famille peut dans ce cas soit s'effondrer, soit se mobiliser face à un malheur, comme la maladie mentale d'un de ses membres.
À quels problèmes une telle famille est-elle confrontée ? Tout d'abord, comprendre le patient et établir le niveau d'exigence à son égard.
Pour empêcher le patient de tout comportement inapproprié, la famille cherche des moyens de l'influencer.
Exemple. Patient N. - en mars 1999. Refus de nourriture pendant 3 jours, difficultés à avaler, état dépressif, combiné à la nécessité de « courir partout où l'on regarde », asthénie. Antécédents : syndrome asthénique-névrotique. Le traitement médicamenteux prescrit par le médecin (atarax, Coaxil, Relanium) n'a donné aucun effet. Perturbations mensuelles périodiques de la phase prémenstruelle. Réaction des membres de la famille : La famille s'est mobilisée pour résoudre ce problème. Massages, magnétothérapie pendant 20 jours, conversations avec le patient, obligeant à se distraire de la peur d'une « crise de maladie ». Chaque année, une famille aux revenus modestes part à la mer en tant que « sauvage », car cela lui donne une rémission d'environ 4 mois.
Cette solution constructive au problème, même si elle n’a pas permis un rétablissement complet, a permis à la famille d’apaiser les tensions et de s’unir.
Une version destructrice d’un tel cas est l’effondrement de la famille de L., où la mère de trois enfants a développé une maladie mentale après avoir souffert du stress.
Le climat émotionnel au sein de la famille est très important. Des études menées ces dernières années auprès de familles dans lesquelles se trouve un patient atteint de schizophrénie ont montré que la présence ou l'absence d'une rechute de la maladie dépend en grande partie de la capacité de la famille à comprendre et à prendre en compte la sensibilité accrue du patient. Ce phénomène a été abordé pour la première fois dans des études menées par l'Unité de psychiatrie sociale du Medical Research Council à Londres (1962), et le phénomène a reçu le nom d'EE-expressivité des émotions. Il a été prouvé que dans les familles « émotionnellement agitées », les rechutes de la maladie étaient plus fréquentes, et plus le climat familial était calme, moins les exacerbations de la maladie étaient fréquentes. Il est très important que les familles maîtrisent les déclarations émotionnellement douces.
Exemples de déclarations émotionnelles...
épargnant:
- Peut-être que tu peux le faire différemment
- Désolé, je ne t'ai pas bien compris
- C'est difficile pour moi de me concentrer
- Cela aurait dû être fait un peu différemment
dur:
- Tu as tout fait de travers
- Qu'est-ce que tu dis?
- Arrête de faire du bruit et de me déranger
- Tu as encore tout gâché
Lorsqu'une famille décide d'utiliser un langage doux, cela permet d'éviter les émotions négatives basées sur l'amertume, le ressentiment et le ressentiment.
Les émotions négatives dominantes peuvent se transformer en antipathie comportementale envers le patient et en désir de « se débarrasser » de lui. La concentration de l’attention familiale sur les aspects positifs et préservés de la personnalité d’un individu atteint d’un trouble neuropsychique sévère fait naître un motif de soin, le « Motif d’Exupéry » (« Nous sommes responsables de ceux que nous avons apprivoisés »).
Werner 1989 a prouvé que dans les familles prospères, les enfants présentant de graves complications post-partum présentaient un léger retard par rapport aux enfants en bonne santé, tandis que dans une famille dysfonctionnelle, l'enfant restait « sauvage ».
Depuis les années 70 du XXe siècle, des programmes d'assistance globale aux enfants handicapés et aux membres de leurs familles ont été expérimentés aux États-Unis (Broussard 1989, Sasserath 1983).Ces programmes ont permis aux parents d'enfants handicapés de développer des moyens efficaces de gérer leur situation. attention, augmenter leur capacité d'apprentissage avec les compétences les plus nécessaires, pour identifier même de petits changements positifs chez leur enfant ayant un retard de développement.
Malheureusement, dans les petites villes régionales de Russie et les agglomérations rurales, le travail auprès des enfants handicapés et de leurs familles est de nature purement formelle « divertissement » (excursions dans la nature, au théâtre), il existe peu de programmes de formation, il n'y a pas d'instructeurs de réadaptation psychosociale. pour travailler avec des enfants handicapés et leurs familles. Le plus souvent, le président de la société pour personnes handicapées ne parvient à s'occuper que des aspects organisationnels des événements destinés à ces enfants. Quand faut-il se soucier de leur développement physique ?
Au moment où les enfants en bonne santé commencent à aller à la maternelle, à l’école et à communiquer entre eux, les enfants handicapés restent insociables. Pourquoi? C'est juste très difficile pour eux de trouver des amis. Un tel enfant est clairement différent des autres : moins adroit, moins mobile et moins fort. C'est ce dernier aspect qui influence grandement l'attitude de ses pairs à son égard. Après tout, une société « d’enfants » s’apparente à une société primitive : ici, la loi du « qui est le meilleur », la loi du leader, opère. Lorsqu'il communique avec des pairs en bonne santé, un enfant handicapé peut ressentir de l'anxiété et de la peur, un stress excessif et un sentiment d'infériorité. Les petits enfants sont des gens très cruels. Beaucoup n’ont pas encore appris à faire preuve de compassion envers leur prochain. Par conséquent, un enfant malade devient souvent un paria parmi ses pairs en bonne santé.
Dans ces conditions, il est important que les parents, les éducateurs et les enseignants atteignent les objectifs suivants :
- Créer une atmosphère conviviale dans la communication entre les enfants en bonne santé et les enfants malades.
- Apprenez à reconnaître et à soulager les réactions de stress chez les enfants. Redonnez confiance à l'enfant par la chaleur et l'affection, encouragez-le à être franc.
- Ne vous arrêtez pas, mais essayez de comprendre pourquoi l’enfant suce son doigt, se ronge l’ongle ou cache sa tête sous la couverture. L'affection, les soins, un mot gentil venant du cœur calmeront et encourageront bébé.
Parmi les enfants handicapés, il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas apprendre en raison de la nature spécifique de leur maladie. Ce sont des enfants dyslexiques qui ont des difficultés à écrire. Les enfants hyperactifs sont ceux qui ne peuvent pas rester assis longtemps. À chaque échec, ces enfants croient de moins en moins en leur capacité à apprendre quelque chose. Certains deviennent renfermés, d’autres deviennent effrontés et agressifs. Cependant, il convient de noter que Thomas Edison, Nelson Rockefeller et Hans Christian Andersen ont souffert de dyslexie dans leur enfance. Ils ont réussi à se dépasser. Actuellement, de nombreux programmes de formation correctionnelle sont en cours d'élaboration, basés sur la nécessité de créer un sentiment de confiance en soi chez l'enfant.
Dans leur jeunesse, les enfants plus âgés commencent à comprendre qu’il existe différents types de corps humain et différents idéaux. Ils développent une idée assez précise de leur morphologie, de ses proportions et de sa dextérité. Les adolescents font beaucoup plus attention à leur corps. Durant cette période, les jeunes ressentent intensément le besoin d'attention du sexe opposé. Ici, un adolescent handicapé fait face à une amère déception. Un fauteuil roulant, des béquilles ou un bâton de hockey n'attirent l'attention des adolescents en bonne santé que comme objet de curiosité.
Le désespoir s’empare des jeunes handicapés. Dans cette situation, les relations de confiance avec les proches sont importantes.
Dans cette situation, une solution raisonnable est possible. Il est important de développer les talents d'un enfant handicapé dès la petite enfance. À un jeune âge, cela sera très utile, cela vous donnera un sentiment d'estime de soi, un sentiment de valeur, en tant qu'individu, en tant que personne. Il est important que les enfants handicapés se lient d'amitié.
Le développement et l'éducation d'un enfant handicapé sont sans aucun doute un processus complexe qui demande beaucoup d'efforts de la part des parents et des éducateurs. Cependant, il est très important d'inculquer à une personne la confiance que les personnes handicapées sont des personnes appelées à être mises à l'épreuve par la vie et non des parias de la société.
conclusions
L'expérience montre que le recours à des règles psychologiques permet à une famille avec une personne handicapée de survivre. De plus, l'esprit de réussite facilite considérablement l'adaptation sociale des personnes handicapées elles-mêmes et des membres de leur famille. Ce sont les règles.
- Ne perdez pas espoir et croyez en la victoire sur les difficultés. Réjouissez-vous de chaque petite victoire sur la maladie.
- Essayez de comprendre le patient mieux qu'il ne se comprend lui-même.
- Les alliés dans votre lutte contre la maladie sont la confiance et la franchise du patient. Essayez de les convaincre.
- Recherchez des approches auprès du patient, analysez les échecs et les erreurs lors de la communication avec un membre malade de la famille.
- Cherchez des alliés - organisez votre « habitat » social (clubs pour handicapés, sections sportives pour handicapés, cours en clubs, etc.). Développer les talents d'un enfant handicapé.
- "Combattre et chercher, trouver et ne pas abandonner" - telle est la devise de ceux qui ont suivi ce chemin.
La législation biélorusse prévoit certaines garanties juridiques dans le domaine du travail pour les travailleurs handicapés. Cela impose donc des responsabilités supplémentaires à l'employeur et rend l'embauche d'une personne handicapée moins attrayante que celle d'autres salariés. Parallèlement, pour stimuler l'emploi des personnes handicapées, l'État offre aux employeurs une compensation pour les coûts de création d'emplois spécialisés et finance des mesures d'adaptation au travail des travailleurs handicapés.
Bien que la procédure actuelle de financement par l'État des activités d'emploi et d'adaptation des personnes handicapées ait été introduite en 2009, les employeurs en sont peu conscients. Dans cette publication, nous examinerons le mécanisme d'adaptation au travail des personnes handicapées, qui s'applique à de nombreux employeurs, quels que soient la forme de propriété et le nombre de salariés handicapés, et permet de percevoir une compensation importante des coûts d'emploi des personnes. handicapés.
Qu'est-ce que l'adaptation d'une personne handicapée au travail et pourquoi un employeur devrait-il en être informé ?
L'adaptation d'une personne handicapée au travail est un concept général qui comprend diverses mesures pour acquérir ou développer les capacités de travail d'une personne handicapée et les consolider dans le processus de travail. Il peut s'agir essentiellement de toute mesure visant à accroître la compétitivité des travailleurs handicapés et à garantir leur emploi durable. Par exemple, employer une personne handicapée et lui assigner un mentor pendant les premiers mois de travail fait partie des mesures d'adaptation au travail.
Il est important que les employeurs sachent que pour financer les mesures d'adaptation au travail des personnes handicapées inscrites au chômage, des fonds du Fonds de protection sociale extrabudgétaire de l'État du ministère du Travail et de la Protection sociale peuvent être utilisés. Par exemple, les employeurs qui organisent l'adaptation des personnes handicapées au travail sont remboursés des frais de rémunération de ces travailleurs.
Pour ce faire, les employeurs de toute forme de propriété, y compris les entrepreneurs individuels, ont le droit de contacter les autorités du travail, de l'emploi et de la protection sociale (à Minsk - Département de l'emploi du Comité du travail, de l'emploi et de la protection sociale du Comité exécutif de la ville de Minsk , 113, avenue Nezavisimosti, tél. 8017 267 57 40) pour la conclusion d'un accord sur l'organisation de l'adaptation des personnes handicapées au travail.
Dans cet article, le terme «adaptation des personnes handicapées» est utilisé pour désigner les activités d'adaptation des personnes handicapées au travail, qui sont organisées et financées par le Fonds de protection sociale du ministère du Travail et de la Protection sociale (ci-après dénommé comme le Fonds) conformément au Règlement sur la procédure d'organisation et de financement des activités d'adaptation des personnes handicapées au travail, approuvé par la résolution du Conseil des ministres de la République de Biélorussie n° 128 du 02.02.2009 (ci-après dénommé le règlement sur l’adaptation).
Les personnes handicapées sont-elles adaptées à un travail qui ne nécessite pas de qualification ou de formation spécifique (par exemple, travailler comme femme de ménage) ?
Conformément à l'art. 32 de la loi « sur la prévention du handicap et la réadaptation des personnes handicapées », l'adaptation des personnes handicapées vise non seulement à améliorer les connaissances professionnelles, mais également à acquérir et à développer les capacités de travail et à les consolider dans le processus de travail.
L'adaptation des personnes handicapées au travail s'effectue si elles exercent une spécialité ou une profession, à l'exception des types d'activités ne nécessitant pas de formation professionnelle, conformément au programme individuel de réadaptation (article 4 du Règlement sur l'adaptation). Par conséquent, l’adaptation peut également être réalisée en relation avec des activités de travail qui ne nécessitent pas de formation professionnelle.
Quelles réglementations réglementent la procédure d'organisation et de financement des mesures d'adaptation au travail des personnes handicapées ?
Tout d'abord, il s'agit du règlement sur la procédure d'organisation et de financement des mesures d'adaptation des personnes handicapées au travail, approuvé par la résolution du Conseil des ministres de la République de Biélorussie du 02.02.2009 n° 128. Les principales dispositions relatives à la réinsertion professionnelle sont inscrites dans les lois « sur la prévention du handicap et la réadaptation des personnes handicapées » et « sur la protection sociale des personnes handicapées en République de Biélorussie ».
Quelles dépenses sont remboursées à l'employeur dans le cadre du financement d'activités d'adaptation des personnes handicapées ?
Lorsqu'ils mènent des activités d'adaptation des personnes handicapées, les employeurs peuvent se voir attribuer des fonds du Fonds pour compenser les coûts de rémunération des travailleurs handicapés ou pour l'achat d'équipements, de matériaux et de vêtements spéciaux.
Les frais de rémunération des salariés handicapés sont indemnisés mensuellement à hauteur des salaires accumulés, en tenant compte des indemnités incitatives et compensatoires. La rémunération est également soumise à :
- le montant du salaire moyen pendant le congé de travail ou la compensation monétaire pour le congé de travail non utilisé ;
— le montant des cotisations d'assurance obligatoires à la Caisse de sécurité sociale et des primes d'assurance pour l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pour recevoir une indemnisation pour ces frais liés aux mesures d'adaptation des personnes handicapées, l'employeur présente mensuellement à l'agence du travail, de l'emploi et de la protection sociale une attestation relative aux frais de rémunération des personnes handicapées.
Des fonds pour l'achat d'équipements destinés à créer des emplois pour les personnes handicapées peuvent être alloués aux employeurs qui organisent l'adaptation des personnes handicapées dans de tels lieux de travail pendant trois ans ou plus. Le financement de l'achat de matériaux est accordé aux employeurs à condition que les produits fabriqués à partir de ceux-ci soient transférés gratuitement à des organismes budgétaires ou soient utilisés pour leurs propres besoins par des organismes manufacturiers financés par le budget local ou républicain.
Comment sont formalisées les mesures d’adaptation des personnes handicapées soumises à un financement public ?
Les mesures d'adaptation au travail d'une personne handicapée sont formalisées dans le cadre d'une relation tripartite entre l'employeur, le salarié handicapé et l'organisme du travail, de l'emploi et de la protection sociale. Dans le même temps, le processus d'enregistrement nécessite la participation active à la fois de l'employeur et du salarié et peut être divisé en plusieurs étapes.
1. Le Département du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale du comité exécutif de la ville ou du district inscrit l'entreprise dans la Liste des employeurs prêts à organiser l'adaptation des personnes handicapées au travail dans des professions spécifiques.
Pour ce faire, l'employeur soumet au service (département) du travail, de l'emploi et de la protection sociale du comité exécutif de la ville ou du district :
— une déclaration de volonté d'organiser l'adaptation des personnes handicapées au travail, indiquant la liste des spécialités (professions), le nombre et la liste des emplois vacants, ainsi que la nécessité de créer de nouveaux emplois et des opportunités d'emploi supplémentaire pour les personnes handicapées ;
— calcul des coûts financiers d'organisation de l'adaptation (coûts de main d'œuvre, coût des équipements, matériaux).
Si un employeur souhaite embaucher un salarié spécifique handicapé pour adaptation, les informations et documents suivants sont également fournis :
— un programme individuel de réadaptation pour une personne handicapée indiquant la nécessité d'une adaptation dans un certain délai (de 6 à 12 mois), une copie du passeport ;
— des informations sur le spécialiste qui accompagnera le salarié handicapé pendant la période d'adaptation, y compris sa formation ;
— des informations sur les possibilités de poursuite d'emploi d'un salarié handicapé sur le marché libre ou de prolongation de l'adaptation dans un délai de 12 mois.
Le département (département) du travail, de l'emploi et de la protection sociale du comité exécutif de la ville ou du district dresse une conclusion sur la faisabilité d'organiser l'adaptation des personnes handicapées dans une entreprise donnée et la soumet avec une demande au Comité du travail, Emploi et protection sociale du comité exécutif régional (Comité exécutif de la ville de Ming), qui, sur la base des documents reçus, prend une décision sur l'opportunité d'organiser l'adaptation des personnes handicapées au travail chez cet employeur. Sur la base de cette décision, l'organisation est inscrite sur la liste des employeurs prêts à organiser l'adaptation des personnes handicapées au travail dans des spécialités ou professions spécifiques.
2. Réception par un salarié handicapé d'une saisine d'adaptation de l'agence du travail, de l'emploi et de la protection sociale
Seule une personne handicapée dûment inscrite au chômage peut bénéficier d'une orientation pour adaptation. Pôle emploi délivre une telle saisine sur la base d'un programme individuel de réadaptation d'une personne handicapée, tenant compte de la liste des employeurs prêts à organiser l'adaptation, et de la spécialité ou profession du salarié (ou sans). Si la saisine ne peut être délivrée, les motifs du refus sont communiqués par écrit.
Il est à noter que la saisine n'est délivrée que pour les professions et spécialités précisées dans le programme individuel de réadaptation d'une personne handicapée (ci-après dénommé l'IPR). Cependant, il est important que l'absence d'instructions appropriées dans l'IPR ne constitue pas un obstacle à l'emploi dans des professions ou des spécialités que le salarié peut maîtriser et exercer avec succès. Il est souvent impossible de fournir à l'avance dans l'IPR une liste complète des emplois susceptibles d'être accessibles à une personne handicapée. Par conséquent, s'il existe un poste vacant acceptable dans une spécialité non spécifiée dans l'IPR, une personne handicapée a le droit de s'adresser à la commission d'experts en médecine et en réadaptation (ci-après dénommée MREK) avec une demande de complément au programme de formation professionnelle et de travail. réhabilitation de l'IPR avec indication de la nécessité d'adaptation au travail dans une certaine profession ou spécialité. S'il existe un accord préalable avec l'employeur concernant l'emploi, vous pouvez fournir au MREC une lettre de l'employeur indiquant qu'il a l'intention d'embaucher une personne handicapée pour l'adapter à un poste particulier.
3. Conclusion d'un accord sur l'organisation de l'adaptation d'une personne handicapée au travail entre l'employeur et l'organisme du travail, de l'emploi et de la protection sociale.
Le contrat est conclu pour une durée de six mois à un an (selon la période d'adaptation préconisée dans l'IPR) indiquant le montant et l'objet du financement, ainsi que le calendrier de test de l'aptitude d'un salarié handicapé au travail indépendant. En outre, un tel accord prévoit l’obligation pour l’employeur d’utiliser les fonds aux fins prévues et de fournir des pièces justificatives aux autorités du travail, de l’emploi et de la protection sociale.
4. Conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée entre l'employeur et un salarié handicapé pour la période d'adaptation.
Les relations de travail entre l'employeur et le salarié envoyé par Pôle emploi en adaptation sont formalisées pour la durée précisée dans l'accord d'organisation de l'adaptation d'une personne handicapée au travail. Pour ce faire, l'employeur conclut un contrat de travail à durée déterminée avec les salariés et établit d'autres documents conformément à la législation du travail. L'employeur envoie une copie de l'ordre de travail à l'autorité du travail, de l'emploi et de la protection sociale dans un délai de cinq jours à compter de la date de publication.
Est-il possible de prolonger la période d'adaptation ?
Oui, mais seulement dans un délai d'un an. L'accord entre l'employeur et l'autorité du travail, de l'emploi et de la protection sociale prévoit la procédure permettant de tester le degré de préparation d'une personne handicapée au travail indépendant. Compte tenu des résultats de ces tests, une décision peut être prise de prolonger la période d'adaptation, mais uniquement à condition que la période d'adaptation totale ne dépasse pas un an. Dans ce cas, des modifications et compléments appropriés sont apportés à l'accord portant organisation de l'adaptation d'une personne handicapée au travail et au contrat de travail à durée déterminée.
L'employeur est-il obligé de conclure un contrat de travail avec le salarié après la fin de la période d'adaptation ?
Non, une telle obligation n'est pas prévue par la loi. Une fois la période d'adaptation expirée, l'employeur a le droit, mais non l'obligation, de proposer au salarié de poursuivre la relation de travail. Une fois l'adaptation terminée, l'employeur fournit à l'autorité du travail, de l'emploi et de la protection sociale soit une copie de l'arrêté de licenciement de la personne handicapée, soit un arrêté d'embauche à un emploi permanent. Un salarié handicapé qui n'a pas conclu de contrat de travail après avoir suivi une adaptation peut être réinscrit au chômage. Cependant, les références pour adaptation répétée auprès d'un autre employeur ne sont généralement pas émises.
Marina Kalinovskaïa
consultant juridique de l'ONG "BelAPDIiMI"
La pleine participation aux unités fondamentales de la société – famille, groupes sociaux et communauté – est un élément central de la vie humaine. Le droit à l’égalité des chances pour une telle participation est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et devrait être accordé à chacun, y compris aux personnes handicapées. Cependant, en réalité, les personnes handicapées sont souvent privées de la possibilité de participer pleinement aux activités du système socioculturel auquel elles appartiennent. L'absence d'une telle opportunité est une conséquence des barrières physiques et sociales qui surviennent pour un certain nombre des raisons suivantes :
· la peur (lorsque les gens font semblant de ne pas remarquer les personnes handicapées parce qu'ils ont peur des responsabilités, peur de souffrir (physiquement ou mentalement), de les bouleverser) ;
· point de vue agressif/indifférent (les personnes handicapées sont placées à un niveau inférieur par rapport aux personnes en bonne santé et, par conséquent, ne méritent pas leur attention, elles doivent vivre « dans un monde à part »).
De telles attitudes et comportements conduisent souvent à l’exclusion des personnes handicapées de la vie sociale et culturelle. Les gens ont tendance à éviter les contacts et les relations personnelles avec les personnes handicapées. La prévalence des préjugés et de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, ainsi que la mesure dans laquelle elles sont exclues des interactions sociales normales, créent des problèmes psychologiques et sociaux pour nombre d'entre elles.
Souvent, dans la sphère d'activité professionnelle et dans d'autres domaines de service, les personnes avec lesquelles les personnes handicapées entrent en contact sous-estiment les opportunités potentielles de participation des personnes handicapées à la vie publique normale et ne contribuent ainsi pas à l'inclusion des personnes handicapées et d'autres groupes sociaux. dedans.
En raison de ces obstacles, il peut être difficile, voire impossible, pour les personnes handicapées d'entretenir des relations étroites et intimes avec les autres. Les personnes classées comme « handicapées » se voient souvent empêcher de se marier et d’avoir des enfants, même s’il n’existe aucune limitation fonctionnelle à cet égard. On comprend désormais de mieux en mieux les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle en matière de communication personnelle et sociale, y compris les relations sexuelles.
De nombreuses personnes handicapées sont incapables de participer activement à la société en raison du manque d'équipements spécialisés (par exemple des rampes) dans les espaces publics : elles se heurtent à des obstacles physiques tels que des portes trop étroites pour les fauteuils roulants, des marches aux abords des bâtiments trop étroites pour les fauteuils roulants. impossible de grimper, bus, trains et avions, téléphones et interrupteurs mal situés, équipements sanitaires impossibles à utiliser. De même, ils sont incapables de participer à la société en raison d'autres obstacles, tels que les communications auditives qui ne répondent pas aux besoins des malentendants et les communications écrites qui ne répondent pas aux besoins des malvoyants. De tels obstacles sont le résultat de l’ignorance et du manque d’attention ; ils existent même si la plupart d’entre eux peuvent être éliminés à peu de frais grâce à une planification minutieuse. Bien que certains pays aient adopté des lois et mené des campagnes de sensibilisation pour éliminer ces obstacles, le problème reste aigu.
Il est bien évident que l'idée même d'adaptation sociale des personnes handicapées est majoritairement soutenue, cependant, des études approfondies ont révélé la complexité et l'ambiguïté de l'attitude des personnes en bonne santé envers les malades. Cette attitude peut être qualifiée d'ambivalente : d'un côté, les personnes handicapées sont perçues comme différentes et pour le pire, de l'autre, comme privées de nombreuses opportunités. Cela donne lieu à la fois au rejet des concitoyens en mauvaise santé par les autres membres de la société et à la sympathie à leur égard, mais en général, de nombreuses personnes en bonne santé ne sont pas préparées à un contact étroit avec des personnes handicapées et à des situations qui permettent aux personnes handicapées de réaliser leurs capacités de manière optimale. sur un pied d'égalité avec tous les autres. La relation entre les personnes handicapées et les personnes en bonne santé implique la responsabilité de ces relations de part et d'autre. Les personnes handicapées manquent de compétences sociales, de capacité à s'exprimer dans la communication avec des collègues, des connaissances, l'administration et les employeurs. Les personnes handicapées ne sont pas toujours capables de saisir les nuances des relations humaines, elles perçoivent les autres de manière assez générale, les évaluant uniquement sur la base de certaines qualités morales - gentillesse, réactivité, etc. Dans le même temps, il est important de se rappeler que toutes les personnes handicapées ont leurs propres maladies et que si une personne, en raison de sa maladie physique, ne peut pas communiquer pleinement avec les autres membres de la société, alors une autre ne peut être gênée que par les préjugés de autres.
Tout au long de son histoire, la société a constamment changé son attitude envers les personnes ayant une déficience intellectuelle. On est passé de la haine et de l’agression à la tolérance, au partenariat et à l’inclusion des personnes handicapées. À la suite de l'évolution de la conscience de la société, un modèle social du handicap est apparu, fondé sur la formation de la personnalité d'une personne handicapée à travers son environnement. Le processus de socialisation d'un individu est impensable sans la participation d'agents : primaires et secondaires. Ils jouent un rôle essentiel dans l’assimilation des normes, des valeurs, des attitudes du jeune handicapé et dans son intégration dans la société. Les agents sont le maillon principal du processus de socialisation et d'adaptation sociale des jeunes en situation de handicap. Seul le travail solidaire de tous les acteurs permettra à un jeune handicapé de réussir sa socialisation.
Il existe de nombreux mécanismes et technologies pour soutenir le processus de socialisation des jeunes handicapés. Seulement, la quasi-totalité d'entre eux sont peu destinés à la réalisation de soi, au perfectionnement personnel d'un jeune handicapé et à son adaptation.
Le concept d'« adaptation » vient du mot latin adaptatio - adaptation. Il existe différents processus dans les relations d'une personne avec le monde extérieur et il est donc essentiel de trouver des mécanismes et des moyens optimaux d'adapter le corps humain (son organisation physiologique) aux aspects individuels et personnels (organisation mentale) et aux besoins, exigences et normes de arrangement social (système de relations sociales) .
L'adaptation apparaît comme un phénomène diversifié et complexe dans la vie des sujets sociaux. Quatre aspects fondamentaux de la réflexion sur l’adaptation peuvent être distingués : en tant que type de relation sociale, processus social, activité sociale et forme institutionnelle. L’adaptation en tant que phénomène social est une formation spirituelle et pratique complexe, structurelle, fonctionnelle, qui se manifeste à tous les niveaux de la vie sociale des personnes. Grâce à cela, l'adaptation devient l'un des moyens universels les plus importants pour surmonter les phénomènes sociaux négatifs de la crise et préparer les personnes à l'inclusion dans des systèmes sociaux innovants. Ainsi, l'adaptation assure la cohérence et la régularité dans la transformation évolutive de la société, réduisant le risque de tendances destructrices et harmonisant les relations sociales émergentes.
Il existe quatre types d'adaptation humaine : biologique, physiologique, psychologique et sociale. Ces types sont étroitement liés, mais ils peuvent parfois avoir une relative indépendance ou acquérir une priorité temporaire. La principale caractéristique de l'adaptation sociale est qu'elle est associée au processus d'assimilation des normes sociales de comportement, avec « la croissance dans le monde social ». Essentiellement, l’adaptation sociale est le mécanisme de socialisation le plus important. Mais si la « socialisation » est un processus progressif de formation de la personnalité dans certaines conditions sociales, alors le concept d'« adaptation sociale » souligne que dans un laps de temps relativement court, un individu ou un groupe maîtrise activement un nouvel environnement social, qui apparaît soit comme un résultat d’un mouvement social ou territorial, ou lorsque les conditions sociales changent.
Le processus d’adaptation sociale doit être considéré à trois niveaux :
Société (macroenvironnement) - adaptation des couches individuelles et sociales aux caractéristiques du développement socio-économique, politique, spirituel et culturel de la société ;
Groupe social (microenvironnement) - adaptation d'une personne ou, à l'inverse, décalage entre les intérêts d'une personne et un groupe social (équipe de production, famille, équipe éducative, etc.) ;
L'individu lui-même (adaptation intrapersonnelle) est le désir d'atteindre l'harmonie, l'équilibre de sa position interne et son estime de soi par rapport à la position des autres individus.
L'adaptation sociale au niveau individuel comprend :
· Mise en œuvre du mécanisme d'interaction de l'individu avec le microenvironnement à travers une certaine adaptation à celui-ci à travers la communication, le comportement et l'activité ;
· Assimilation des normes et valeurs morales de l'environnement social positif immédiat à travers leur conscience rationnelle ou par internalisation ;
· Atteindre un état d'adaptabilité du sujet en établissant un équilibre dynamique entre ses attitudes personnelles et les attentes de l'environnement social en présence de contrôle de sa part.
Un indicateur essentiel de l'adaptation socio-psychologique des personnes handicapées est l'attitude des personnes handicapées envers leur propre vie après avoir souffert d'une maladie ou après être nées avec cette maladie. Plus de la moitié de ces personnes jugent leur qualité de vie insatisfaisante et considèrent leur situation comme désespérée et sans perspectives. De plus, la notion de satisfaction ou d'insatisfaction face à la vie se résume dans la plupart des cas à la situation financière instable ou insuffisante d'une personne handicapée, à l'incapacité de réaliser ses projets, ses capacités, qu'elle peut développer en elle-même, malgré sa maladie, mais, malheureusement, ne disposant pas de sécurité matérielle pour tout cela. Plus le revenu d'une personne handicapée est faible, plus son attitude envers sa vie est désespérée et plus son estime de soi est faible.
conclusions
Dans le premier sous-chapitre du premier chapitre de mon projet de cours, j'ai examiné le phénomène de l'humanisme. J'ai été confronté à la tâche de déduire une définition universelle, à mon avis, du terme « humanisme », basée sur l'expérience séculaire de nos prédécesseurs, mais répondant en même temps aux normes modernes. personnes à différentes époques, je suis arrivé à une conclusion commune : l'humanisme est un système de vision du monde historiquement changeant, dont la base est la protection de la dignité et de l'estime de soi de l'individu, de sa liberté et de son droit au bonheur ; considérer le bien de l'homme comme un critère d'évaluation des institutions sociales, et les principes d'égalité, de justice et d'humanité comme la norme souhaitée des relations entre les personnes.
Dans le deuxième sous-chapitre du premier chapitre, j'ai appris qu'à l'heure actuelle, environ 23 % des personnes dans le monde souffrent de handicaps de gravité variable, et que plus de la moitié d'entre elles évaluent la qualité de leur vie comme insatisfaisante, considèrent leur état comme désespéré, avec aucune perspective. J'ai également découvert que les principaux obstacles à une communication égale entre les personnes en bonne santé et les personnes handicapées sont :
· ignorance (comment se comporter dans une société de personnes handicapées, quelle est leur maladie et à quel point elle est dangereuse) ;
· la peur (quand les gens font semblant de ne pas remarquer les personnes handicapées parce qu'ils ont peur des responsabilités, peur de blesser (physiquement ou moralement), de les bouleverser) ;
· point de vue agressif/indifférent (les personnes handicapées sont placées à un niveau inférieur par rapport aux personnes en bonne santé et ne méritent donc pas leur attention, elles doivent vivre « dans un monde à part »).
L'essence de l'adaptation sociale des personnes handicapées
à l'environnement de production
L'activité professionnelle est l'une des catégories d'activités de la vie, la déficience de la capacité d'exercice qui, conformément aux exigences relatives au contenu, au volume et aux conditions de travail, est l'un des critères d'invalidité.
Il convient de noter que parmi les personnes handicapées en âge de travailler qui ont sollicité à plusieurs reprises les services de visite médico-sociale, seulement 20 % environ poursuivent leur activité professionnelle. Parmi eux, les travailleurs handicapés du groupe 1 – 0,15%, du groupe 2 – 5,15%, du groupe 3 – 14,7%.
En ce qui concerne l'adaptation professionnelle des personnes handicapées, il convient de noter que la maladie entraîne généralement une perturbation de l'adaptation existante de l'individu au travail, ce qui, avec une évaluation interprétative appropriée de la part de la personne handicapée elle-même, peut conduire à la émergence d'une situation adaptative et, par conséquent, nécessité de s'adapter à l'environnement de travail .
La classification suivante des types de situations d'adaptation parmi les personnes handicapées employées et travaillant peut être donnée :
1. Adaptation des personnes handicapées à leur ancien lieu de travail dans leur profession précédente (spécialité).
2. Adaptation des personnes handicapées à un nouveau lieu de travail, mais dans le même métier (spécialité).
3. Adaptation des personnes handicapées en cours de formation professionnelle dans une spécialité connexe (prise en compte des compétences professionnelles antérieures).
4. Adaptation des personnes handicapées lors de l'emploi dans une spécialité (profession) connexe, en tenant compte des compétences professionnelles antérieures.
5. Adaptation des personnes handicapées dans le processus et les conditions de formation professionnelle dans une nouvelle spécialité (profession).
6. Adaptation des personnes handicapées lors de la recherche d'un emploi dans une nouvelle spécialité (profession).
Les personnes handicapées, considérées comme des sujets d'activité professionnelle, présentent un certain nombre de caractéristiques :
1) restrictions sur la capacité d'acquérir et d'utiliser des compétences professionnelles ;
2) une période de travail plus longue que celle des personnes en bonne santé ;
3) effectuer un travail de puissance égale en raison d'une tension plus élevée des systèmes fonctionnels du corps ;
4) la nécessité d'adapter le lieu de travail, les équipements et le processus technologique aux caractéristiques de la pathologie d'une personne handicapée ;
5) niveau moyen de formation professionnelle ;
6) sphère de communication étroite ;
7) conflit intrapersonnel ;
8) faible résistance à la frustration ;
9) les difficultés des contacts sociaux et psychologiques avec des collègues et la direction en bonne santé.
Il convient de noter qu'il existe actuellement un manque d'unité dans la désignation terminologique du processus d'adaptation des personnes handicapées au milieu de travail. Ainsi, certains auteurs associent l'adaptation des personnes handicapées à la production au concept d'« adaptation sociale et professionnelle », tandis que d'autres l'associent au terme « adaptation professionnelle et industrielle », puisqu'ils considèrent l'adaptation des personnes handicapées à la production comme l'un des les mesures de réadaptation professionnelle.
Cependant, à notre avis, l'utilisation du terme « adaptation industrielle » en relation avec l'adaptation des personnes handicapées dans une entreprise est plus correcte, puisque la structure du travail elle-même nous semble être trois types d'activité de travail qualitativement uniques. Le premier type de travail comprend le travail socialement organisé, qui combine des types de travail inclus dans le système de division sociale du travail. Le travail des deuxième et troisième types comprend de nombreux types de travail domestique, c'est-à-dire le travail de libre-service domestique et le travail de loisir, « amateur ». Ainsi, le terme « adaptation du travail » est beaucoup plus large, tandis que le terme « adaptation industrielle » désigne immédiatement la spécificité de l'objet de l'adaptation sociale.
Nous considérons l’adaptation industrielle des personnes handicapées comme le processus et le résultat de l’adaptation d’une personne handicapée à l’assimilation et à l’exercice les plus adéquats et optimaux des fonctions sociales liées aux activités de production dans une entreprise particulière.
Il convient de noter qu'au cours des deux dernières décennies, assez peu de recherches ont été menées dans le domaine de l'adaptation industrielle des personnes handicapées. L'une des études sérieuses, dont le but était d'étudier la relation entre les composantes professionnelles et sociales de l'adaptation industrielle des personnes handicapées, a été réalisée en 1982-1983. à Moscou. La composante professionnelle de l'adaptation industrielle a été étudiée à l'aide d'indicateurs tels que la disponibilité de compétences et de connaissances professionnelles, le niveau de qualification, l'évaluation de l'attractivité de la profession et la satisfaction au travail. La composante sociale de l'adaptation industrielle des personnes handicapées comprenait un éventail plus large de facteurs liés à l'intégration du salarié dans la vie de l'équipe de travail, à l'activité sociale et à l'intensité des contacts interpersonnels.
Nous pouvons noter les conclusions suivantes comme les conclusions les plus importantes de cette étude :
1. Il n’y a aucun lien entre la réussite de l’adaptation professionnelle et l’adaptation sociale des personnes handicapées. Ainsi, si pour les personnes en bonne santé physique, une adaptation professionnelle réussie garantit pratiquement une adaptation sociale, alors pour les personnes handicapées cette relation est extrêmement compliquée : la majorité des personnes handicapées examinées ont des compétences professionnelles assez développées ; dans le même temps, près d'un tiers ont un faible niveau d'adaptation sociale et ne sont pas impliqués dans la vie sociale de l'équipe de production.
2. Les taux d'adaptation industrielle les plus faibles ont été enregistrés au cours de la première année d'invalidité. Pendant cette période, les mécanismes de protection de la personnalité ne « fonctionnent » pas encore ; il faut du temps pour s’habituer à l’idée dela nécessité de changer le modèle de vie antérieur. Au cours de la deuxième année d'invalidité, le niveau de la composante sociale de l'adaptation industrielle augmente : la proportion de personnes handicapées à forte adaptation double. À l'avenir, ce niveau reste stable. Quant à la composante professionnelle de l'adaptation, ce n'est qu'après 5 ans d'invalidité que la proportion de personnes ayant des scores élevés augmente fortement.
3. Lors de l'adaptation à la production secondaire, les hommes handicapés affichent de meilleures performances que les femmes, et lors de l'adaptation primaire, l'inverse est vrai.
4. Dans le groupe des personnes handicapées depuis l'enfance, 1/6 de la part présentait un faible niveau de composante professionnelle d'adaptation industrielle, parmi les personnes handicapées dues à une maladie générale - 1/55 de la part. Le niveau le plus bas de la composante professionnelle de l'adaptation industrielle a été enregistré parmi les personnes dont l'invalidité était causée par une maladie professionnelle.
De manière générale, on peut constater que le niveau d'adaptation industrielle des personnes handicapées est inférieur à celui des personnes non handicapées. Le niveau insuffisamment élevé de la composante professionnelle de l'adaptation industrielle s'explique en grande partie par le fait que l'emploi des personnes handicapées est souvent associé à une baisse de qualification et à des difficultés pour sélectionner un emploi correspondant à leurs capacités. Le faible niveau de composante sociale des personnes handicapées peut être dû aux difficultés des contacts socio-psychologiques avec des personnes en bonne santé - collègues, direction. Ceci est notamment démontré par le niveau plus élevé d'adaptation sociale des personnes handicapées travaillant dans des entreprises spécialisées, où leurs problèmes sont mieux compris par les autres.
Il est à noter que la structure de l'adaptation industrielle des personnes handicapées est insuffisamment développée, et la plupart des sources scientifiques mettent en avant comme éléments les composantes physiologiques, professionnelles et socio-psychologiques. Certains auteurs considèrent séparément les aspects psychologiques et sociaux de l’adaptation. Ainsi, nous proposons une structure d'adaptation industrielle des personnes handicapées, comprenant des éléments tels que : l'adaptation physiologique, l'adaptation professionnelle, l'adaptation sociale, qui, à son tour, comprend les aspects socio-psychologiques, socio-économiques et socio-organisationnels.
Caractérisons chacune des composantes de l'adaptation industrielle des personnes handicapées.
La composante physiologique de l'adaptation des personnes handicapées au travail est comprise comme le processus de formation d'un système stable de connexions fonctionnelles chez un travailleur, garantissant l'exécution efficace du travail avec le moins de dépenses énergétiques et spirituelles du corps.
Dans le processus de formation de l'adaptation physiologique au travail, on distingue trois étapes :
La phase initiale (travail), caractérisée par de faibles performances, un fonctionnement imparfait des systèmes corporels, des coûts énergétiques et mentaux élevés du corps qui sont inadaptés au travail effectué ;
Étape transitoire dont la durée est déterminée par la gravité, l'intensité et les conditions du travail effectué, ainsi que par son respect de l'état de santé du salarié ;
L'étape finale (étape d'adaptation physiologique), la formation de performances élevées et stables, de coûts énergétiques et mentaux adéquats pour le travail effectué. Chaque étape correspond à une courbe typique d'évolution des performances tout au long de la journée de travail, ainsi qu'à l'état des systèmes fonctionnels du corps qui assurent l'activité musculaire ou mentale.
La période de formation d'une adaptation physiologique stable au travail, selon la sévérité, l'intensité et les conditions de travail des différents auteurs, varie de plusieurs mois à 1 an. Les caractéristiques de l'adaptation physiologique au travail des personnes handicapées comprennent : un niveau d'adaptation émergent moins stable, effectuant un travail de même puissance en raison d'un stress plus élevé sur les systèmes fonctionnels du corps, etc. d'exercer leur ancien métier ou d'utiliser leurs compétences professionnelles plutôt que de passer à un autre emploi, encore plus facile.
La composante professionnelle de l'adaptation au travail est le processus par lequel une personne handicapée maîtrise les connaissances, les compétences et la maîtrise nécessaires, la capacité de s'orienter rapidement dans les situations de travail, de programmer et de contrôler ses actions de travail.
La durée et le succès de l'adaptation professionnelle sont déterminés par : la complexité et les caractéristiques du contenu du travail, la conformité des qualités et capacités psychophysiologiques du salarié avec les exigences de l'activité professionnelle (aptitude au travail) et les attitudes socio-psychologiques à l'égard du travail effectué. . Une importance importante dans la formation d’une adaptation professionnelle durable des personnes handicapées est accordée à l’adaptation du lieu de travail, de l’équipement et du processus technologique aux caractéristiques de la pathologie de la personne handicapée.
Dans la plupart des métiers ouvriers, la période d'adaptation professionnelle est généralement assimilée à la période d'affectation auprès d'un travailleur de la première catégorie de qualification, soit 3 à 6 mois de travail. Dans les métiers au contenu complexe, y compris créatifs, atteindre la maîtrise professionnelle demande plus de temps.
La composante socio-psychologique de l'adaptation au travail est considérée comme un processus de formation de l'attitude subjective d'une personne handicapée à l'égard du travail effectué, de sa conscience de la nature objective et du contenu du travail et de leur correspondance avec la structure interne de la personnalité, les intérêts , attitudes et orientations de valeurs du travailleur. Le côté subjectif du processus de travail comprend une prise de conscience plus ou moins complète par l'employé de la nature objective, des conditions et du contenu du travail et de leur correspondance avec la structure interne de l'individu, le système de ses intérêts, ses attitudes et ses orientations de valeurs. Le côté subjectif du travail, ainsi que le côté objectif, déterminent en grande partie l'attitude de l'employé envers le travail et sa satisfaction à l'égard du travail effectué. L'attitude d'une personne envers le travail est influencée par les caractéristiques de la structure interne de l'individu (intensité, force et type de manifestations émotionnelles, niveau d'activité, tempérament, adéquation de l'estime de soi de l'individu, attitude avant le travail, etc.), ainsi que les conditions objectives de travail qui se développent au cours du processus de travail (caractère, sévérité, horaire de travail et de repos, clarté de l'organisation du travail, état des relations au sein de l'équipe, niveau de rémunération matérielle, services culturels et communautaires, etc.). La satisfaction au travail explique en grande partie la persistance d'un salarié sur le lieu de travail ou, à l'inverse, son licenciement ou son envie d'arrêter.
L'adaptation socio-organisationnelle des personnes handicapées suppose que dans le processus de ce type d'adaptation, les exigences organisationnelles soient maîtrisées, qui incluent la mise en œuvre des horaires de travail, des routines quotidiennes, des descriptions de poste et des ordres des supérieurs. Ici, des liens et des relations se créent entre le travailleur handicapé et l'entreprise, qui rationalisent leur interaction conformément aux exigences de production. En règle générale, ces liens s'orientent de la production vers le travailleur handicapé, sont strictement standardisés, invariants par rapport à ses caractéristiques et sont dominés par les intérêts de la production. La discipline du travail est l'indicateur objectif le plus important de l'adaptation organisationnelle. Pour caractériser l'adaptation organisationnelle d'une personne handicapée, nous utilisons des indicateurs de sa satisfaction quant à l'organisation du travail, principalement directement sur le lieu de travail (travail posté, rythme de travail et sa conformité à la spécialité, état des équipements et outils).
Lorsqu'on étudie l'adaptation socio-économique des personnes handicapées, l'objet est le niveau des salaires et le mode de répartition, qui expriment de manière concentrée les relations économiques dans l'entreprise et dans la société.
A l'heure actuelle, le problème de l'évaluation du degré d'adaptation des personnes handicapées est tout à fait pertinent, que nous proposons de réaliser selon un ensemble de critères désignés en fonction des éléments qui composent la structure de l'adaptation industrielle.
Ainsi, nous proposons d'évaluer l'adaptation physiologique des personnes handicapées selon des critères tels qu'une sensation de fatigue en fin de journée de travail, le bien-être au travail, la présence de fatigue physique, la présence de fatigue nerveuse, une sensation de légèreté et lourdeur du travail effectué. Comme indicateurs d'adaptation physiologique spécifique aux personnes handicapées, nous mettons en avant les critères suivants : fréquence de morbidité avec perte temporaire d'aptitude au travail due à une pathologie invalidante et présence de conditions de travail contre-indiquées
Nous mettons en avant les critères suivants pour évaluer la réussite de l'adaptation professionnelle : l'attitude envers le métier, la facilité de sa maîtrise, l'envie de changer de métier, la qualité du travail effectué, la conformité du métier avec la formation générale existante, ainsi que l'influence de la pathologie existante. sur la qualité du travail effectué, la nécessité d'adapter le processus technologique à la pathologie d'une personne handicapée.
L’adaptation socio-psychologique peut être évaluée par la satisfaction de la personne handicapée dans ses relations avec l’administration, la présence de difficultés socio-psychologiques dans les relations avec des collègues sains et la présence de difficultés socio-psychologiques causées par le handicap.
Les critères d'adaptation économique sont la satisfaction à l'égard du salaire, la satisfaction à l'égard du système d'incitations matérielles pour les travailleurs, la satisfaction à l'égard de la ponctualité du paiement des salaires, ainsi que le rapport entre le niveau des salaires et le montant de la pension d'invalidité et les gains avant invalidité. .
L'adaptation sociale et organisationnelle, à notre avis, doit être évaluée selon les critères suivants : la possibilité de promotion ou d'éducation, la possibilité de perfectionnement, la satisfaction du travail posté, l'organisation du travail et du repos, l'état des équipements et outils de travail. , conditions de travail, rythme de travail
L'utilisation globale d'indicateurs à la fois spécifiques aux personnes handicapées et (généraux) adaptés à toute catégorie de travailleurs est due au fait que les personnes handicapées, malgré leurs caractéristiques spécifiques d'ordre physiologique, psychologique et social, sont néanmoins aussi des travailleurs ordinaires.
La complexité de l'évaluation de l'adaptation industrielle des personnes handicapées, tant pour chaque indicateur séparément que globalement, nécessite l'utilisation de formules mathématiques afin d'objectiver les conclusions sur le degré d'adaptation industrielle des personnes handicapées : élevé, moyen ou faible.
Ainsi, nous avons conclu que dans l’ensemble des recherches consacrées à l’adaptation industrielle, les problématiques d’adaptation au travail des personnes handicapées n’ont pas été suffisamment développées. Les études individuelles de nature théorique et appliquée en général n'apportent pas encore de réponse aux nombreuses questions qui se sont accumulées sur ce problème. Les questions suivantes restent en suspens ou nécessitent une justification scientifique plus approfondie :
Étudier les caractéristiques et les mécanismes d'adaptation à l'entreprise des personnes handicapées atteintes de diverses formes de maladies afin de déterminer des approches, méthodes et mesures spécifiques pour organiser leur adaptation professionnelle et industrielle, etc.
Étudier les facteurs et les conditions de travail qui contribuent à l'adaptation industrielle des personnes handicapées ;
Développement de critères et d'indicateurs pour évaluer le succès du processus d'adaptation industrielle des personnes handicapées, des moyens et méthodes pour influencer ce processus.
Bibliographie:
1. Le pic de rotation et l'adaptation de la production des travailleurs. Novossibirsk La science. 1986. p. 154.
2. , Shabalina : une minorité discriminée ? // Recherche sociologique. 1992. N° 5. P. 103-106.
3. , Shabalina adaptation industrielle des personnes handicapées // Études sociologiques. 1985. N° 3. P. 121 – 126.
4. Molevich comme objet et sujet de recherche en sociologie générale // Recherche sociologique. 2001. N° 4. P. 61-64.
5. Expérience nationale et étrangère dans l'adaptation professionnelle et industrielle des personnes handicapées. M. CBNTI Ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie. 2001. Numéro. 40. p. 24.
Expérience nationale et étrangère d'adaptation professionnelle et industrielle des personnes handicapées. M. CBNTI Ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie. 2001. Numéro. 40. p. 27 – 28.
Expérience nationale et étrangère d'adaptation professionnelle et industrielle des personnes handicapées. M. CBNTI Ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie. 2001. Numéro. 40. P. 4.
Le handicap est une caractéristique spécifique du développement et de l'état de l'individu, souvent accompagné de limitations dans les activités vitales dans une grande variété de domaines.
Mais aujourd'hui, le handicap n'est plus un problème pour un certain cercle soi-disant « personnes inférieures » C'est un problème pour la société dans son ensemble. Et ce problème est déterminé au niveau des caractéristiques juridiques, économiques, de production, de communication et psychologiques de l'interaction des personnes handicapées avec la réalité environnante.
Il y a environ 16 millions de personnes handicapées en Russie, soit plus de 10 pour cent des résidents du pays . Le handicap, hélas, n’est pas le problème d’une seule personne, mais le problème de l’ensemble de la société..
Malheureusement, en Russie, les gens autour d'eux traitent le plus souvent les personnes handicapées avec purement point de vue médical, du point de vue du « modèle médical », et pour eux, une personne handicapée est considérée comme la personne qui limité à un degré ou à un autre dans la capacité de bouger, d'entendre, de parler, de voir, d'écrire. Il se crée une certaine situation paradoxale et absurde, et très offensante pour les personnes handicapées, dans laquelle cette personne perçu comme une personne malade de manière persistante, comme ne répondant pas à une certaine norme, ce qui ne lui permet pas de travailler, d’étudier ou de mener une vie normale « saine ». Et en fait, dans notre société, l'opinion est cultivée et formée selon laquelle une personne handicapée est un fardeau pour la société, une personne à sa charge. Cela « sent », pour le moins, la « génétique préventive ».
Rappelons que du point de vue de « l'eugénisme préventif », après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne en 1933, le « Programme d'euthanasie T-4 » a commencé à être mis en œuvre, qui, entre autres, prévoyait extermination des personnes handicapées et des malades depuis plus de 5 ans comme incapables.
Les problèmes des personnes handicapées en Russie, et même en Occident, sont principalement associés à l'émergence de nombreuses barrières sociales qui ne permettent pas aux personnes handicapées de participer activement à la vie de la société. Hélas, cette situation n’est que la conséquence d’une politique sociale incorrecte, axée uniquement sur la population « en bonne santé » et exprimant, dans la plupart des cas, intérêts de cette catégorie particulière de la société. La structure elle-même production, la vie quotidienne, la culture et les loisirs, ainsi que les services sociaux, sont souvent inadaptés aux besoins des personnes handicapées.
Souvenons-nous des scandales des compagnies aériennes, non seulement en Russie, mais aussi en Occident, qui refusaient d'admettre sur les vols les personnes handicapées en fauteuil roulant ! Et en Russie, tant les transports publics que les entrées des maisons ne sont pas encore entièrement équipés d'ascenseurs spéciaux et d'autres moyens. Ou plutôt, ils ne sont quasiment pas équipés du tout. Cela se produit encore à Moscou, et même dans ce cas, ces ascenseurs sont fermés avec une certaine clé, tout comme dans le métro. Et dans les petites villes ? Qu’en est-il des immeubles sans ascenseur ? Une personne handicapée qui ne peut pas se déplacer de manière autonome est limitée dans ses mouvements et ne peut souvent pas quitter l'appartement du tout !
Il s'avère que les personnes handicapées deviennent spéciales groupe sociodémographique avec moins de possibilités de déplacement (ce qui est d'ailleurs contraire à la Constitution !), des revenus plus faibles, moins de possibilités de recevoir une éducation et surtout une adaptation aux activités de production, et seul un petit nombre de personnes handicapées ont la possibilité de travailler pleinement et perçoivent un salaire adapté à leur travail.
La condition la plus importante sociale et particulièrement adaptation du travail est d'introduire dans la conscience publique l'idée d'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. C'est la relation normale entre les personnes handicapées et les personnes en bonne santé qui constitue le facteur le plus puissant du processus d'adaptation.
Comme le montre l'expérience étrangère et nationale, souvent les personnes handicapées, même ayant certaines opportunités potentielles de participer activement à la vie de la société, et en particulier de travailler, ne sont pas en mesure de les réaliser.
La raison en est qu'une partie (et souvent une grande partie) de notre société ne veut pas communiquer avec eux et que les entrepreneurs ont peur d'embaucher une personne handicapée en raison de stéréotypes négatifs établis. Et, dans ce cas, même les mesures d'adaptation sociale d'une personne handicapée ne seront d'aucune utilité tant que les stéréotypes psychologiques ne seront pas brisés à la fois de la part des « en bonne santé » et, surtout, de la part des personnes « en bonne santé » et, surtout, employeurs.
Notons que l'idée même d'adaptation sociale des personnes handicapées est « verbalement » soutenue par la majorité, il existe de nombreuses lois, mais il reste encore de la complexité et de l'ambiguïté dans l'attitude des personnes « en bonne santé » envers les personnes handicapées, en particulier envers les personnes handicapées présentant des « caractéristiques handicapées » évidentes - celles qui sont incapables de se déplacer de manière autonome (appelées « utilisateurs de fauteuil roulant »), les aveugles et les malvoyants, les sourds et les malentendants, les patients atteints de paralysie cérébrale, les patients séropositifs. En Russie, les personnes handicapées sont perçues par la société comme étant prétendument différentes pour le pire, comme privées de nombreuses opportunités, ce qui génère, d'une part, leur rejet en tant que membres à part entière de la société, et d'autre part, de la sympathie à leur égard.
Et, surtout, il existe un « manque de préparation » de nombreuses personnes en bonne santé à un contact étroit avec des personnes handicapées sur le lieu de travail, ainsi que le développement de situations dans lesquelles une personne handicapée ne peut pas et n'a pas la possibilité de réaliser son potentiel sur un pied d'égalité. avec tout le monde.
Malheureusement, l'un des principaux indicateurs de l'adaptation socio-psychologique des personnes handicapées est leur attitude envers leur propre vie - près de la moitié d'entre elles jugent la qualité de leur vie insatisfaisante. De plus, le concept même de satisfaction ou d'insatisfaction à l'égard de la vie se résume le plus souvent à la situation financière pauvre ou instable d'une personne handicapée, et plus le revenu d'une personne handicapée est faible, plus son opinion sur son existence est pessimiste et plus son moi est bas. -estime.
Mais on remarque que Les personnes handicapées qui travaillent ont une estime d’elles-mêmes et une « vision de la vie » beaucoup plus élevées. que les chômeurs. D'une part, cela est dû à la meilleure situation financière des travailleurs handicapés, à leur plus grande adaptation sociale et industrielle et à leurs plus grandes possibilités de communication.
Mais, comme nous tous, les personnes handicapées éprouvent la peur de l'avenir, l'anxiété et l'incertitude quant à l'avenir, un sentiment de tension et d'inconfort, et pour elles, la perte d'un emploi est un facteur de stress plus important que pour une personne en bonne santé. Les moindres changements dans le désavantage matériel et les moindres difficultés au travail conduisent à la panique et à un stress intense.
En Russie, il existe une pratique consistant à employer des personnes handicapées ou, comme on dit, des « personnes ayant des capacités physiques limitées » dans des entreprises spécialisées (par exemple pour les aveugles et les malvoyants) et non spécialisées. Il existe également une législation obligeant les grandes organisations à employer des personnes handicapées selon un certain quota.
En 1995, la loi « Sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie » a été adoptée. Conformément à son article 21, les organisations de plus de 100 salariés se voient fixer un certain quota d'embauche de personnes handicapées et les employeurs sont obligés, Premièrement, attribuer des emplois pour l'emploi des personnes handicapées, et deuxièmement, créer des conditions de travail conformes au programme de réadaptation individuel. Le quota est considéré comme rempli si les personnes handicapées sont employées dans tous les emplois attribués en pleine conformité avec la législation du travail de la Fédération de Russie. Dans le même temps, le refus de l'employeur d'embaucher une personne handicapée dans le cadre du quota établi entraîne l'imposition aux fonctionnaires d'une amende administrative d'un montant de deux mille à trois mille roubles (article 5.42 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie) .
Les entreprises et les employeurs employant des personnes handicapées sont tenus de créer des emplois spéciaux pour leur emploi, c'est-à-dire les lieux de travail qui nécessitent des mesures supplémentaires pour organiser le travail, y compris l'adaptation des équipements principaux et auxiliaires, les équipements techniques et organisationnels, la fourniture de dispositifs techniques tenant compte des capacités individuelles des personnes handicapées.
Cependant, la plupart des employeurs ne font pas preuve d'enthousiasme lorsqu'ils embauchent des personnes handicapées, essayant de les accommoder pour diverses raisons, et même s'ils sont embauchés, ils essaieront de « se débarrasser » d'un tel employé dès que possible. La principale chose qui les arrête est le risque associé à la capacité d'une personne handicapée à effectuer un travail au niveau approprié. Et par conséquent : « ne vais-je pas subir de pertes ?
Une question liée au risque : « Une personne handicapée fera-t-elle ou non face au travail ou à la tâche qui lui est assigné ? En général, cela peut être fait pour n'importe quel salarié, d'autant plus qu'une personne handicapée est susceptible d'exercer ses fonctions avec plus de diligence.
Bien entendu, l'employeur aura des difficultés supplémentaires, voire des dépenses, liées à la réduction de la journée de travail, à la création de conditions de travail particulières, à la création d'un lieu de travail adapté à une personne handicapée, etc. Et l'adaptation même d'une personne handicapée dans un collectif de travail est plus difficile que pour une personne « normale », elle est soit « contournée avec dégoût » soit « prise en pitié », et vu ses efforts au travail, il est possible qu'une personne handicapée peut rapidement « gagner sa vie » avec des ennemis », et autour de lui des situations de conflit et de harcèlement direct seront pleinement créés et provoqués. Mais c'est déjà l'affaire de l'administration et des chefs d'équipe, ainsi que des psychothérapeutes « à plein temps » qui « s'essuient les pantalons et les jupes » dans de nombreuses grandes entreprises.
Notons que dans de nombreux pays, il existe des lois similaires à la loi « Sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie ». Par exemple, aux États-Unis, conformément à la loi, une entreprise qui refuse de fournir du travail à une personne handicapée est passible d'une amende importante, et les entreprises qui emploient des personnes handicapées bénéficient d'avantages fiscaux. Or, aux États-Unis il n'existe pas de législation sur les quotas d'emploi pour les personnes handicapées, et chaque entreprise a la possibilité de déterminer sa propre politique à cet égard.
Le gouvernement suédois encourage les employeurs à verser des subventions individuelles pour chaque personne handicapée employée, et les bourses du travail allemandes remplissent des fonctions de conseil professionnel et d'intermédiaire dans l'emploi des personnes handicapées.
Au Canada, il existe de nombreux programmes fédéraux, régionaux et locaux ciblés sur divers aspects de la réadaptation des personnes handicapées et des organismes spéciaux qui fournissent des services d'évaluation de l'aptitude au travail, de consultation, d'orientation professionnelle, de réadaptation, d'information, de formation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. personnes handicapées.
Notons que les « personnes handicapées » dans les pays développés ne travaillent pas seulement comme couturières, bibliothécaires, avocates, etc. Vous pouvez également trouver des mécaniciens et des réparateurs de véhicules lourds se déplaçant en fauteuil roulant, ce qui est tout simplement irréaliste pour la Russie à l'heure actuelle.
Considérons la question de lieu de travail spécial pour les invalides. Par exemple, la norme nationale de la Fédération de Russie GOST R 52874-2007 définit le lieu de travail comme suit : pour les malvoyants(article 3.3.1) :
Il s'agit d'un lieu de travail où des mesures supplémentaires ont été prises pour organiser le travail, notamment l'adaptation des équipements principaux et auxiliaires, les équipements techniques et organisationnels, les équipements supplémentaires et la mise à disposition de moyens techniques de réadaptation, en tenant compte des capacités individuelles des personnes handicapées.
En outre, la composition des moyens techniques et des mesures de réadaptation optimales ou suffisantes est déterminée pour la création et le maintien d'un lieu de travail spécial pour les personnes handicapées dans le contexte de l'expansion et de la modification de l'étendue de leur travail à l'aide de nouveaux moyens techniques de réadaptation et de mesures de réadaptation. (article 3.1.2).
La création d'un lieu de travail spécial pour les personnes handicapées comprend sélection, acquisition, installation et adaptation des équipements nécessaires (dispositifs supplémentaires, équipements et moyens techniques de rééducation), ainsi que mise en œuvre de mesures de réadaptation pour assurer un emploi efficace des personnes handicapées, en tenant compte de leurs capacités individuelles dans des conditions de travail qui correspondent à le programme individuel de réadaptation au travail d'une personne handicapée (clause 3.1 .3.).
Depuis que la loi fédérale n° 181-FZ du 24 novembre 1995 sur la protection sociale des personnes handicapées dans la Fédération de Russie prévoit la « réadaptation professionnelle des personnes handicapées », qui comprend l'orientation professionnelle, l'enseignement professionnel, l'adaptation professionnelle et l'emploi, il existe également un code de bonnes pratiques SP 35-104-2001 – « Bâtiments et locaux comportant des lieux de travail pour personnes handicapées » élaboré par arrêté du ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie. Les bâtiments et les structures doivent être conçus en tenant compte de l'accessibilité pour les personnes handicapées et les « groupes de population à faible mobilité » (SP35-101-2001 « Conception de bâtiments et de structures en tenant compte de l'accessibilité pour les groupes de population à faible mobilité ». Dispositions générales ; SP35-102-2001 « Milieu de vie avec éléments d'aménagement, accessible aux personnes handicapées » ; SP35-103-2001 « Bâtiments et structures publics accessibles aux visiteurs à mobilité réduite »).
Mais malgré les lois et les programmes de réinsertion sociale qui n'ont pas été adoptés, le nombre de personnes handicapées qui travaillent en Russie continue de diminuer et a diminué de près de 10 % au cours des trois dernières années ; moins d'un tiers des personnes handicapées en âge de travailler ont un emploi, bien que dans les entreprises de nombreux secteurs, dans diverses institutions et organisations, il existe des professions et des spécialités qui correspondent aux caractéristiques psychophysiologiques des personnes handicapées de diverses catégories.
L'un des principaux domaines de soutien aux personnes handicapées est réadaptation professionnelle et adaptation au travail, qui est la composante la plus importante de la politique de l'État dans le domaine de la protection sociale des personnes handicapées et comprend les activités suivantes : services et moyens techniques - orientation professionnelle (information professionnelle ; orientation professionnelle ; sélection professionnelle ; sélection professionnelle) ; soutien psychologique à l'autodétermination professionnelle; formation (recyclage) et perfectionnement ; aide à l'emploi (pour un travail temporaire, pour un travail permanent, pour un travail indépendant ou pour l'entrepreneuriat) ; quotas et création d’emplois spéciaux pour l’emploi des personnes handicapées.
Bien entendu, la réadaptation professionnelle des personnes handicapées avec leur emploi ultérieur est économiquement bénéfique pour l'État, puisque les fonds investis dans la réadaptation des personnes handicapées seront restitués à l'État sous forme de recettes fiscales résultant de l'emploi des personnes handicapées.
Mais si l'accès des personnes handicapées aux activités professionnelles est limité, les coûts de la réadaptation des personnes handicapées pèseront encore plus sur les épaules de la société.
Cependant, la « législation relative aux personnes handicapées » ne prend pas en compte un fait important : ce dont l’employeur a besoin, ce n’est pas d’une personne handicapée, mais d’un salarié.» Et la réadaptation et l'adaptation au travail à part entière consistent à faire d'une personne handicapée un travailleur, pour lequel il faut d'abord le former, s'adapter, puis seulement l'employer, et non l'inverse ! Près 60% handicapés sont prêts à participer au processus de travail après avoir reçu les spécialités et l'adaptation du travail appropriées et, par conséquent, avoir reçu un salaire décent.
L'adaptation d'une personne handicapée sur le lieu de travail lui-même est définie comme une adaptation logique à un emploi ou un lieu de travail spécifique qu'elle exerce, qui permet à une personne handicapée qualifiée d'exercer ses fonctions dans son poste. C'est adaptation d'une personne handicapée il s'agit de trouver un moyen par lequel il devient possible de surmonter les obstacles créés par un environnement inaccessible ; il s'agit de surmonter les obstacles sur le lieu de travail, ce qui est obtenu grâce à une approche ciblée pour résoudre un problème donné.
Malgré l'existence d'une législation appropriée dans la Fédération de Russie, d'un système de quotas et d'infrastructures de réadaptation, le faible nombre de personnes handicapées au travail indique qu'il existe certains facteurs qui interfèrent avec leur emploi et bien qu'il existe une politique visant à encourager l'emploi des personnes handicapées, néanmoins, des barrières psychologiques, physiques et sociales empêchent souvent sa mise en œuvre.
Jusqu'à présent, en Russie, il existe de nombreux obstacles à l'emploi des personnes handicapées : il n'y a pas d'accès physique au lieu de travail ni aux équipements appropriés, les personnes handicapées reçoivent le salaire minimum, sans attendre d'elles qu'elles travaillent dans la dignité, ce qui, en général, Ce n'est pas vrai, les transports accessibles sont pratiquement inexistants et de nombreux stéréotypes à l'égard des personnes handicapées persistent parmi les employeurs. Et les handicapés eux-mêmes, comme nous l'avons noté ci-dessus, souffrent toujours d'une faible estime d'eux-mêmes, ne sont pas prêts à entrer seuls sur le marché du travail et lorsqu'ils commencent à travailler, ils ne peuvent souvent pas faire face à leur travail en raison de manque de soutien et même harcèlement moral direct.
Aux États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple, les principaux types d'adaptation du travail sont : la flexibilité dans l'approche de la gestion du travail, l'amélioration de l'accessibilité des locaux, la restructuration des tâches (y compris les horaires de travail), la conclusion de contrats à durée déterminée avec des personnes handicapées et acheter ou modifier du matériel. Notons que dans les pays d'Europe occidentale, environ 40 à 45 % des personnes handicapées travaillent, et en Russie, au mieux, seulement 10 %, la plupart à domicile, pratiquement illégalement et pour des salaires extrêmement bas...
Bien que l'adaptation au travail puisse être unique dans chaque cas spécifique, pour la majorité des personnes handicapées russes, le principal besoin d'adaptation sur le lieu de travail et dans l'équipe de travail est la planification - par exemple, un horaire flexible et des pauses régulières, ainsi que, dans dans certains cas, une réduction du nombre de certaines activités.
Mais en Russie, l'obstacle le plus sérieux à la capacité d'une personne handicapée à travailler est la perte des prestations sociales (« allocations ») ou même de la pension d'invalidité elle-même. Notons que, selon la législation en vigueur, les personnes handicapées en Russie ont le droit de recevoir des médicaments gratuits, de voyager gratuitement dans les transports publics et les trains de banlieue, de bénéficier de soins en sanatorium et en villégiature, d'un paiement partiel pour le logement et les services communaux, etc. Et une personne handicapée peut perdre tout cela en trouvant officiellement un emploi ! Et c'est souvent la principale raison pour laquelle les gens refusent de travailler, surtout si le travail ne peut pas compenser la perte d'une pension et de toutes les prestations. De plus, une personne handicapée qui perçoit un complément de pension n'a le droit de gagner de l'argent supplémentaire nulle part, même temporairement, les « autorités de protection sociale » le supprimeront immédiatement, et même lui imposeront une amende ! Alors, est-il logique qu'une personne handicapée perde sa prime en triplant son travail ? Le plus souvent non, si le salaire est trop bas et ne compense pas, ou peu, cette prime.
Par exemple, une personne atteinte d'une maladie du système cardiovasculaire ou endocrinien, qui a le plus souvent reçu un handicap, possédant déjà une énorme expérience dans les activités scientifiques ou pédagogiques, peut bien exercer son travail habituel, mais... les « organismes de protection sociale » conçus spécifiquement pour « protéger » la personne handicapée, donc au contraire, ils la privent de la possibilité de travailler, voire de travailler à temps partiel ou temporairement, par exemple sous contrat, dans la même université, université , institut de recherche ou autre organisation.
Un autre obstacle à l'adaptation professionnelle d'une personne handicapée est l'environnement physique dans lequel elle vit, qui l'empêche d'aller travailler ; environ 30 % des personnes handicapées indiquent qu'il s'agit d'un problème grave. manque de transports adéquats.
Il existe le concept de « barrières physiques environnementales », qui englobe de nombreux facteurs : de l'inaccessibilité des transports au manque d'horaires flexibles et à la réduction du travail physique sur le lieu de travail. Il est clair que la nécessité d'un horaire flexible s'explique par le fait que pendant la journée, une personne handicapée est confrontée à de nombreux problèmes en dehors du travail ou de sa préparation, notamment pour se rendre au travail et en revenir, et qu'au travail, elle peut être moins mobile. - même aller aux toilettes prend plusieurs fois plus de temps à un utilisateur de fauteuil roulant.
Lors de l’embauche d’une personne handicapée, les employeurs doivent proposer certaines activités de base requises sur le lieu de travail et utiliser une technologie d’assistance créative. Par exemple, les personnes handicapées incapables de se déplacer de manière autonome sont moins capables d’effectuer des travaux liés aux ordinateurs.
Réfléchissons-y, mais c’est du gaspillage de confier à une personne en bonne santé un travail qu’une personne handicapée peut faire ! Et les personnes handicapées estiment que leur isolement au travail est totalement inutile pour la société. Pour eux, il est important non seulement d'exister, de toucher une maigre pension, mais de vivre et de travailler pleinement, il faut être recherché par la société, avoir la possibilité de se réaliser !
Dans les pays développés, un dollar investi dans la résolution des problèmes des personnes handicapées rapporte 35 dollars de profit !
Ce n’est pas le handicap lui-même qui constitue le malheur d’une personne, mais les épreuves qu’elle endure du fait que la société qui l’entoure limite la liberté de choix en matière d’emploi. Théoriquement, une personne handicapée jouit de tous les droits constitutionnels, mais dans la pratique, la grande majorité d’entre elles ne peuvent pas accéder à une éducation ou trouver un emploi, encore moins un emploi décemment rémunéré.
Et surtout, l'aide à la société elle-même dans l'adaptation et le travail normal d'une personne handicapée est encore plus importante que pour la personne handicapée elle-même. Une personne doit voir que si quelque chose lui arrive, elle ne sera pas mise à l'écart de la vie, et elle doit se rappeler que peu importe le déroulement de la vie (et, hélas, ce n'est pas prévisible), ce problème peut affecter tout le monde.