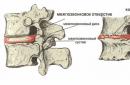UNE SITUATION EXTRÊME est une complication des conditions de vie et d'activité qui a acquis une signification particulière pour un individu ou un groupe. Toute situation présuppose l'inclusion d'un sujet. Par conséquent, une situation extrême incarne l’unité de l’objectif et du subjectif. Objectif - ce sont des conditions extérieures et un processus d'activité extrêmement compliqués ; subjectif - état psychologique, attitudes, méthodes d'action dans des circonstances radicalement modifiées. Une situation extrême peut avoir différentes formes de manifestation : a) une diminution de l'organisation des comportements ; b) inhibition des actions et des mouvements ; c) accroître l'efficacité opérationnelle. Une situation d’urgence peut être de courte ou de longue durée. Lors de la détermination de l’aptitude d’une personne à une profession particulière, il est nécessaire de déterminer et de prendre en compte, ainsi que les caractéristiques des processus mentaux et des traits de personnalité, sa capacité potentielle à développer et à maintenir sa préparation à des actions actives dans des situations extrêmes.
Il existe plusieurs types de situations extrêmes :
1) situations objectivement extrêmes (les difficultés et les dangers qu'elles contiennent proviennent de l'environnement extérieur et surviennent objectivement pour une personne) ;
2) situations potentiellement extrêmes (le danger est exprimé comme une menace cachée) ;
3) situations extrêmes personnellement provoquées (le danger est généré par la personne elle-même, son choix intentionnel ou erroné, son comportement) ;
4) situations extrêmes imaginaires (situations non dangereuses et menaçantes).
Les facteurs extrêmes sont des conditions environnementales extrêmement difficiles qui ne sont pas adaptées aux propriétés innées et acquises du corps humain. Leur influence entraîne des coûts neuropsychologiques et énergétiques élevés, l'émergence d'états fonctionnels négatifs (stress, conflit, crise, frustration, privation) et des perturbations dans l'adéquation des réactions physiologiques, psychologiques et comportementales.
Les facteurs qui déterminent les extrêmes sont généralement identifiés comme suit :
· diverses influences émotionnelles dues au danger, à la difficulté, à la nouveauté de la situation ;
· manque d'informations nécessaires ou excès évident d'informations contradictoires ;
· conditions de travail mettant la vie en danger
· « prix » élevé des décisions, des responsabilités, des situations à risque
situations de conflit
facteurs économiques
· organisation inconfortable du lieu de travail, mauvaise ergonomie
· stress mental, physique et émotionnel excessif ;
· exposition à des conditions climatiques défavorables : chaleur, froid, manque d'oxygène, etc. ;
· exposition à des conditions défavorables (influences chimiques, physiques, rayonnements, magnétiques)
· présence de faim, soif, divers types de privations, etc.
En psychologie extrême, il y a une distinction conditions de fonctionnement particulières, extrêmes et super-extrêmes.
Spécial – les activités des spécialistes sont associées à une action épisodique et incohérente de facteurs extrêmes ou à une forte probabilité perçue de leur apparition. Ils n’ont pas beaucoup de puissance ni d’intensité.
Extrême – caractérisé par une exposition constante à des facteurs extrêmes. Danger potentiel. Les états fonctionnels négatifs sont fortement exprimés.
Super extrême – exposition constante à des facteurs extrêmes. Haute intensité. Un réel danger. Les états fonctionnels négatifs sont d’un degré de gravité extrême. Une rééducation est nécessaire.
Le principal moyen d'augmenter l'efficacité et la fiabilité des activités dans des conditions extrêmes est la formation de capacités de réserve fonctionnelles de type compensatoire (connaissances, compétences et capacités supplémentaires incluses dans les activités lorsque des facteurs extrêmes apparaissent), ainsi que le développement de compétences générales et spéciales. invariants acméologiques du professionnalisme en matière de travail.
Facteurs psychologiques du professionnalisme en conditions extrêmes :
L'activité professionnelle subit des évolutions dans des conditions de travail particulières, défavorables et extrêmes.
Situation avec des conditions extrêmes. Il s'agit ici d'une exposition à long terme à des facteurs extrêmes (manque de temps, surcharge de tâches complexes, sursaturation d'informations, bruit, etc.). Il y a une tension mentale inappropriée, non contrôlée par la personne, mobilisation des ressources psychophysiologiques de réserve de la personne. Cela s'accompagne d'une détérioration des performances au travail. La surcharge ralentit l'activité de recherche, rend difficile la prise de décisions indépendantes et réduit la flexibilité des processus de pensée, ce qui est également dû à l'automatisation excessive des compétences et à la standardisation de la pensée, ce qui rend difficile l'évaluation intellectuelle des événements et la résolution de problèmes problématiques. .
Dans des situations extrêmes, les gens se comportent différemment. Certaines personnes affichent un style frugal. C'est, tout d'abord, style constructif– maîtriser la situation par une organisation active et rationnelle des circonstances et maintenir son propre statut, interagir avec les gens et organiser un soutien social durable. Ce style est efficace et à la fois doux, car il préserve la santé et le psychisme d'une personne. Les auteurs appellent un autre style économique style réfléchissant– gérer la situation par la revalorisation des valeurs, un niveau d'aspirations plus adéquat, la plasticité des stéréotypes de vie.
Moins économiques, notent les mêmes auteurs, sont : style volontaire comme la confiance uniquement dans ses propres capacités, les motivations du devoir, la discipline, une attitude intransigeante envers soi-même et les autres, le désir d'être aussi productif que possible, une réaction accrue aux échecs. Ce style de comportement peut conduire à un gaspillage et à une usure rapide du corps, à des pertes irréparables, à une disqualification professionnelle et à l'incapacité de « tenir le coup » pour un long marathon professionnel. Improductif, selon les auteurs, est également style capitulatif: si le but du travail n'a pas de signification personnelle pour une personne, alors un refus d'activité se produit. Ce style d'activité est moins souvent observé chez les individus ayant une formation psychologique professionnelle.
Lorsqu'elle travaille et agit dans une situation extrême, une personne développe souvent : une réaction active adéquate visant à éliminer ou à surmonter des facteurs extrêmes, un désir d'augmenter la productivité ; ambiance de mobilisation, augmentant la productivité de la réflexion, accélérant la vitesse d'action grâce à l'élargissement de ses unités ; expansion des apports sensoriels (vision périphérique, sensibilité extrasensorielle), limitation sélective des actions, économie ; l'expansion de la pensée et de la conscience, dépassant les limites d'une situation donnée, la capacité de voir la situation dans un contexte plus large ; transition vers des niveaux supérieurs de généralisation ou de « descente vers l'intuition » ; la capacité de trouver des solutions nouvelles et créatives et des erreurs productives sélectives ; des mécanismes de protection et d’adaptation pour assurer la mobilisation nécessaire ; pensée opérationnelle - la création soit d'un nouveau système d'actions, soit d'une nouvelle combinaison d'actions précédemment connues, à la suite de laquelle un signal incertain se transforme en un signal précis et la consolidation des unités opérationnelles en un seul plan de solution holistique se produit.
L'étude de l'influence des facteurs climatiques sur l'homme devient particulièrement pertinente dans les zones aux conditions naturelles extrêmes.
Le concept d’extrémité environnementale s’applique à différents types d’environnements, non seulement naturels, mais aussi sociaux. Un changement rapide des conditions habituelles vers de nouvelles – voire vers des conditions plus favorables à la vie – peut avoir un effet extrême sur une personne. L'extrême des différents impacts n'est pas la même pour les représentants de différents types adaptatifs de personnes, de groupes ethniques et de races, ainsi que pour différents groupes d'âge de la population.
Les idées sur l'extrême changent en fonction du niveau de développement économique et socio-politique de la société, puisque ce niveau détermine le degré de dépendance humaine aux forces de la nature. Ils évoluent également en fonction du degré de développement humain du territoire considéré auparavant comme extrême, c'est-à-dire sur l'activité avec laquelle une personne a influencé son environnement lors de la création de conditions favorables à la vie et au travail.
Sous zones extrêmes (régions) fait généralement référence à de vastes territoires aux conditions naturelles extrêmes. Il s'agit notamment de : la zone Arctique, couvrant les territoires septentrionaux de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, ainsi que le continent Antarctique, dans lequel les conditions sont extrêmes pour la vie humaine. Sous lieux extrêmes comprendre les petites zones.
Souligner zones absolument extrêmes, dans lequel la vie des personnes sans systèmes spéciaux de survie est pratiquement impossible, et relativementzones extrêmes, dans lequel la vie humaine est possible, mais largement difficile.
L’impact des conditions extrêmes sur les humains peut varier en durée au cours du cycle annuel. Par exemple, en Sibérie orientale, des conditions extrêmement froides surviennent en hiver, et dans les régions centrales de l’Antarctique, des conditions extrêmement froides surviennent tout au long de l’année. Les zones extrêmes comprennent les zones présentant des phénomènes naturels récurrents de nature spontanée, par exemple des inondations, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.
Il existe un lien écologique étroit entre les humains et les conditions géochimiques. Le principal lien entre les humains et les conditions géochimiques de l’environnement naturel passe par les chaînes alimentaires. En raison de la régulation homéostatique des processus métaboliques dans le corps humain, les concentrations requises de divers éléments chimiques sont maintenues, mais cette régulation ne peut être effectuée qu'à certaines concentrations d'éléments dans l'environnement extérieur, appelées concentrations seuils. Les conditions des zones qui, selon leurs paramètres, se situent entre les concentrations seuils inférieure et supérieure sont appelées confortable. Les zones restantes sont extrêmes. Le caractère extrême du territoire en termes de facteur géochimique est éliminé en introduisant les éléments chimiques manquants dans l'alimentation de la population.
Les conditions extrêmes sont considérées comme des conditions environnementales dangereuses auxquelles le corps ne s’adapte pas correctement. L'homme, comme tout autre organisme vivant, est adapté à la vie dans certaines conditions de température, de lumière, d'humidité, de gravité, de rayonnement, d'altitude, etc. Ces propriétés se sont développées chez lui au cours du processus de développement évolutif. Lorsqu'elle est exposée à des conditions extrêmes, une personne peut s'y adapter dans certaines limites. Par exemple, la plupart des habitants de la planète vivent à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer. Environ 15 millions de personnes vivent à des altitudes allant jusqu'à 4 800 m. Mais à des altitudes supérieures à 5 500 m, une personne ne peut pas vivre en permanence. Sa santé se détériore fortement, des maladies se développent rapidement, pouvant entraîner une mort inévitable s'il ne retrouve pas des conditions de vie normales. Cela est dû à la très faible pression partielle des gaz inhalés et expirés, à une grande différence entre les températures diurnes et nocturnes, à l'augmentation du rayonnement solaire ainsi qu'à une densité élevée de particules lourdes à haute énergie. Le principal problème du corps humain dans de telles conditions est le transfert de l’oxygène atmosphérique vers les cellules. Un exemple serait les grimpeurs --- les conquérants des hauts sommets des montagnes. Ils ne peuvent conquérir les 8 000 mètres d’altitude de l’Himalaya qu’avec des masques à oxygène, et ils ne peuvent rester à une telle altitude que quelques heures.
Un autre type de condition extrême est l’humidité. Une humidité élevée est caractéristique des forêts tropicales. Les fourrés forestiers ne laissent presque pas passer la lumière, bloquant ainsi le passage des rayons ultraviolets. Il fait chaud et humide ici, comme dans une serre. La température moyenne est de +28°C (fluctuations entre 3 et 9°C), l'humidité relative moyenne est de 95 % la nuit et de 60 à 70 % le jour. Les vents dans les forêts sont très faibles. L'air est saturé de dioxyde de carbone et plein d'odeurs, de fumées, de poils microscopiques, d'écailles et de fibres. Le niveau d'évaporation y est 3 fois supérieur à la moyenne de la planète dans son ensemble. Un exemple d’adaptation à des conditions aussi extrêmes est la taille des populations vivant dans les forêts tropicales. Ils sont plus petits et pèsent moins que ceux qui vivent dans des zones ouvertes. Leur poids moyen est de 39,8 kg pour une taille de 144 cm. Pour les habitants de la savane, ces chiffres sont de 62,5 kg et 169 cm. Par rapport aux représentants d'autres groupes de population, la consommation d'oxygène pendant l'activité physique, la capacité pulmonaire et la fréquence cardiaque sont supérieures à la moyenne. .
La température ambiante est le facteur environnemental le plus important et souvent limitant la vie, et un type de condition extrême que presque tout le monde peut rencontrer au cours de sa vie. Nous vivons et nous sentons à l’aise dans une plage de température plutôt étroite. Dans la nature, la température n'est pas constante et peut fluctuer dans une plage assez large (+60.... - 60C).
Les fortes fluctuations de température - fortes gelées ou chaleur - ont un effet néfaste sur la santé des personnes. Il existe cependant de nombreux dispositifs permettant de lutter contre le refroidissement ou la surchauffe.
Prenons, par exemple, les conditions extrêmes du Nord. L'acclimatation des Esquimaux (et ils vivent encore dans des conditions de période glaciaire) repose sur la régulation vasomotrice-nerveuse. Les animaux du Nord adaptent leur corps à une production d’énergie réduite. Pour certains, cela nécessite même une hibernation. Les personnes se trouvant dans les mêmes circonstances réagissent en augmentant leur production d’énergie. Cela nécessite de développer la capacité de se procurer suffisamment de nourriture pour soi-même et influence également le choix alimentaire. Cela devrait être aussi utile que possible à une personne. La nourriture esquimaude ne serait pas comestible pour nous, car elle doit contenir une grande quantité de graisse pure. Un dîner ordinaire, par exemple, se déroule ainsi : un Esquimau coupe une longue bande de graisse sous-cutanée crue, en enfonce le plus qu'il peut dans sa bouche, en arrache une portion avec un couteau près de ses lèvres et passe poliment le reste à la personne assise à côté de lui. Et dans d'autres cas, dans l'Arctique, on ne sert que de la viande, et la seule verdure chez les Esquimaux est le contenu fermenté des estomacs de rennes, qui sont des lichens digérés.
Comme le montre l'expérience des expéditions polaires des années passées et présentes, toutes n'ont pas été capables de résister aux conditions difficiles du Nord polaire (ou de l'Antarctique) et de s'y adapter.
Beaucoup sont morts à cause de la nourriture et du matériel mal sélectionnés.
Les gelées qui ont éclaté un hiver en Europe occidentale ont eu des conséquences catastrophiques et ont fait de nombreuses victimes. Ces mêmes jours-là, à Verkhoyansk (le pôle du froid), par une température de -57°C, des écoliers âgés de 8 à 9 ans allaient à l'école et des troupeaux de chevaux domestiques de race pure, accompagnés de bergers, paissaient comme d'habitude.
L’apesanteur est un type relativement nouveau de conditions extrêmes résultant de l’exploration humaine de l’espace. Avant le premier vol de l'homme dans l'espace, certains scientifiques affirmaient qu'il ne serait pas capable de travailler en apesanteur et pensaient en outre que le psychisme d'une personne normale ne serait pas capable de résister à l'apesanteur. Le vol du premier cosmonaute a réfuté ces prédictions. La manifestation de l'apesanteur commence à se manifester par une perturbation de l'appareil vestibulaire, de l'oreille interne, de la vision, de la sensibilité cutanée et musculaire. Une personne a l'impression de voler la tête en bas. La gravité et la durée de ces symptômes varient d’une personne à l’autre. À mesure que la période de séjour en apesanteur augmente, ils s'affaiblissent mais, en règle générale, réapparaissent dans les premières heures et jours après leur retour sur Terre dans des conditions de gravité terrestre. En apesanteur, il n'y a pas de pression hydrostatique du sang, et donc les réactions provoquées par l'apesanteur du sang lui-même commencent à prendre effet. Une redistribution du sang se produit : de la partie inférieure il se précipite vers la partie supérieure. Cela entraîne des modifications du métabolisme du muscle cardiaque et son affaiblissement progressif. De plus, des symptômes apparaissent associés à un manque de charge sur le système musculo-squelettique. Une atrophie des muscles responsables de l'organisation de la posture sous l'influence de la gravité se développe. En raison de la perte de sels de calcium et de phosphore, la résistance du squelette change, notamment lors de longs vols. Néanmoins, en apesanteur, une personne peut s'adapter à l'absence de gravité et de pression artérielle hydrostatique.
L'homme est un être social. Par conséquent, outre les situations naturelles extrêmes, des situations critiques liées à la vie humaine en société peuvent également survenir. Durant une période relativement courte de son histoire, l’humanité a connu des périodes d’esclavage, de servage et de guerres mondiales. Les conditions de vie – surpeuplement, peur, malnutrition, maladie – sont à l’origine de souffrances graves, parfois insupportables, pour de nombreuses personnes. Dans de telles conditions, un stress physique, mental et social aigu apparaît, créant une menace pour la vie. la santé et le bien-être des personnes.
Les effets du stress affectent les réactions physiologiques de base du système nerveux central, ainsi que l'activité des glandes endocrines. Les substances biologiquement actives produites par les glandes endocrines (hormones) ainsi que l'influx nerveux influencent presque toutes les cellules du corps.
Cependant, même dans des conditions stressantes, les humains développent des phénomènes d’adaptation.
L'homme a toujours eu la capacité de s'adapter à l'environnement naturel et artificiel. Il s'agit d'un processus à la suite duquel une personne acquiert progressivement une résistance auparavant absente à certains facteurs environnementaux et acquiert ainsi la possibilité de vivre dans des conditions auparavant incompatibles avec la vie. La pleine adaptation d'une personne dans des situations extrêmes préserve la possibilité d'une activité intellectuelle, d'un comportement adapté à la situation et de la procréation. Il faut cependant rappeler qu’un stress prolongé, intense et répétitif provoque des réactions qui conduisent à terme à la détérioration de la santé physique.
L'adaptation humaine est un processus à la suite duquel le corps acquiert progressivement une résistance auparavant absente à certains facteurs environnementaux et acquiert ainsi la possibilité de vivre dans des conditions auparavant incompatibles avec la vie et de résoudre des problèmes auparavant insolubles.
Les accidents de la route sont l’épidémie catastrophique de notre époque. En 10 ans, 22 millions de personnes sont mortes dans des accidents de la route dans le monde. Bien entendu, un accident de la route ne peut pas toujours être attribué à des conditions extrêmes. Mais il arrive parfois que lors d’un accident, les gens se retrouvent dans une situation extrême. Par exemple, le 22 juillet 1970, à Delhi, une vague de crue provenant d'une autoroute a emporté 25 bus, 5 taxis et un véhicule militaire dans un ravin voisin. Un grand nombre de personnes ont perdu la vie, la cause du décès n'étant pas seulement l'accident lui-même, mais aussi la panique qui a surgi parmi les gens.
En règle générale, le plus grand nombre de victimes sont des accidents ferroviaires et maritimes liés au transport de gros passagers.
Le 2 mars 1944, un train transportant des militaires en vacances s'arrête dans un tunnel près de Salerne en Italie : 526 personnes étouffent dans la fumée. Lorsque le train rapide Gdansk-Varsovie déraille le 22 octobre 1949 près de la ville de Nowy Dvor en Pologne, cela coûte la vie à deux cents personnes. La pire catastrophe ferroviaire a été l'accident d'un train express survenu sur un pont à l'est d'Hyderabad en Inde le 28 septembre 1954 : le train s'est écrasé dans une rivière, tuant 1 172 personnes. 238 personnes sont mortes sur le ferry Uskudar qui a coulé à Istanbul. Et d'autres faits.
Contrairement aux catastrophes naturelles, les accidents de transport sont avant tout un phénomène social. Avec le développement de nouveaux modes de transport modernes, de nouveaux problèmes surgissent.
Récemment, nous avons assisté à une baisse spectaculaire de la prudence des gens et à une prise de risque accrue. Il s’agit d’un phénomène général dans le système homme-machine. Nous sommes habitués à l’efficacité de la technologie et prenons peu en compte la possibilité de son échec. Certaines personnes oublient tout simplement les conséquences d’une telle négligence et qui devra en payer le prix.
Il en va de même pour les industries dangereuses où l'on travaille avec des micro-organismes hautement toxiques, des substances radioactives, etc.
Souviens-toi:
Quels systèmes corporels remplissent une fonction de régulation ?
Répondre. La fonction régulatrice est assurée par les systèmes nerveux, tégumentaire, circulatoire, digestif, urinaire, lymphatique, respiratoire et endocrinien.
Questions après le § 14
Qu’entend-on par stress ?
Répondre. Traduit de l’anglais, « stress » signifie « tension ». Le stress est une réaction neurohumorale générale non spécifique du corps à l'influence de divers facteurs - des facteurs de stress qui imposent des exigences accrues au corps. Les facteurs de stress peuvent être divisés en facteurs physiques : chaleur, froid ; mental – danger, conflits. Différents types de stress provoquent des changements biochimiques similaires dans le corps. Dans une situation de stress, le taux de certaines hormones dans le sang (adrénaline, noradrénaline, etc.) augmente, ce qui entraîne une augmentation de l'apport sanguin au cerveau, aux poumons, au cœur et aux muscles. La glycémie augmente, la respiration et la fréquence cardiaque augmentent - le corps se prépare à repousser les influences dangereuses. Et ces réactions peuvent être observées chez une personne non seulement en présence d'un véritable danger, mais aussi, par exemple, lors du souvenir de certaines situations.
Décrire les phases de stress
Répondre. Il y a trois étapes :
Anxiété – provoque la mobilisation de tout le corps, augmente la formation d'hormones surrénales. Les tensions commencent à monter rapidement. Dans certains cas, cette tension peut durer seulement quelques minutes, dans d’autres elle peut durer longtemps. A ce stade, la réaction d'un individu est spécifique. Chez certaines personnes, les processus de pensée s’accélèrent, les décisions optimales sont rapidement prises et le système musculaire est activé. D'autres personnes peuvent ressentir l'effet inverse.
Résistance – cette phase se produit dans les cas où l’impact des facteurs de stress externes ne s’arrête pas. L'organisme, mobilisé à l'étape précédente, commence à résister au stress. La personne semble en bonne santé et active, continue de réagir objectivement aux stimuli externes et essaie de résoudre tous les problèmes qui surviennent de manière constructive. Les capacités d'adaptation du corps sont équilibrées, la personne a « travaillé » et est prête à résister à des facteurs environnementaux défavorables et forts. Comme la première phase, la phase de résistance ne présente pas de danger pour l’homme.
Épuisement - la phase finale du développement du stress est caractérisée par l'épuisement des forces humaines et commence lorsque la deuxième phase dure trop longtemps et que la personne ne reçoit aucun repos. Les ressources du corps sont épuisées et la résilience d'une personne commence à décliner rapidement. Des problèmes physiologiques comme une perte d’appétit et des troubles du sommeil commencent à apparaître. La personne commence à perdre du poids, sa tension artérielle devient instable et augmente souvent. Il y a un sentiment constant de fatigue, de dépression et de faiblesse. Si une personne n'a pas la possibilité de se reposer à cette étape, cela peut provoquer de graves maladies mentales, psychologiques et. L’aide peut venir de l’extérieur sous forme de soutien ou d’élimination d’un facteur de stress. Sinon, les capacités d'adaptation seront surchargées, ce qui entraînera des traumatismes psychologiques et des maladies.
Dans quels cas le stress peut-il être bénéfique ?
Répondre. Les scientifiques estiment que dans certains cas, la première phase de stress peut être considérée comme bénéfique, car elle durcit le corps et l'entraîne à une mobilisation instantanée.
Comment résister à un facteur de stress ?
Répondre. Le stress émotionnel peut être soulagé par :
Activité réussie ;
Écouter de la musique mélodique ;
Communication avec la nature ;
Communication avec les proches ;
Communication avec les animaux de compagnie ;
Techniques de relaxation ;
Bonne alternance de travail et de repos ;
Sommeil complet.
Stresser font partie des dix principales causes de maladie.
Il est faux de penser que le stress est causé uniquement par des événements désagréables. Une joie excessive peut aussi conduire au stress. Par exemple, le stress lié à la réussite d'une séance peut provoquer les mêmes changements dans le corps que le stress provoqué par une forte frayeur.
Le plus douloureux et le plus dangereux est le stress traumatique, qui survient à la suite d'événements mettant la vie en danger tels que les guerres, les catastrophes naturelles, les accidents de voiture, la violence criminelle, etc.
Il existe plusieurs définitions du stress :
- 1. Comme stimulus : le stress peut être considéré comme une caractéristique de l’environnement (manque de temps, environnement de travail malsain, etc.).
- 2. En réaction : le stress est vu comme un état de tension mentale qui survient en réponse à des circonstances difficiles.
- 3. Déséquilibre dans la relation entre une personne et l'environnement (un modèle d'interaction pour une situation stressante). Une personne éprouve du stress lorsque les exigences perçues de l’environnement deviennent supérieures à la capacité perçue de répondre à ces exigences.
Le concept le plus général qui considère les mécanismes de réponse de l’organisme face au danger à tous les niveaux est le concept de stress, développé par G. Selye. . Selon ce concept, l'adaptation générale syndrome il y a une réaction universelle à tout demande présentée à l'organisme qui la détermine tension (stress) visant à surmonter difficultés et adaptation à des exigences accrues.
Selye identifie trois phases du syndrome général d'adaptation :
- - Réaction d'anxiété, traduisant la mobilisation de toutes les ressources de l'organisme.
- - La phase de résistance, au cours de laquelle, grâce à la mobilisation qui s'est produite, le corps résiste aux influences stressantes, maintenant efficacement l'homéostasie sans dommage notable pour la santé.
- - La phase d'épuisement, au cours de laquelle une lutte trop longue ou intense contre le facteur dommageable conduit à la détresse - à l'échec de l'adaptation et au développement de processus pathologiques et de maladies.
Sous le stress, il y a une consommation intense d’énergie et de réserves fonctionnelles de l’organisme.
Malgré l'unité des mécanismes du syndrome général d'adaptation, ses manifestations peuvent être différentes selon l'intensité, la durée et la nature de l'action du facteur dommageable.
La forme de stress qui joue le rôle le plus important dans l’adaptation humaine est le stress émotionnel (mental).
Il existe deux types de stress :
- 1. Stress systémique (physiologique).
- 2. Stress mental (émotionnel).
Émotionnel stresser agit comme la réponse du corps aux processus internes et externes, qui mettent à rude épreuve les capacités physiologiques et psychologiques à un degré proche de la limite, voire les dépasse.
Les différences entre les types de stress mentionnés s’expliquent par :
- - à stress physiologique- impact direct de facteurs défavorables sur l'organisme.
- - à mental stresser- inclusion d'une hiérarchie complexe de processus mentaux qui négocient l'influence d'une situation stressante, dans laquelle il ne peut y avoir d'effet dommageable direct sur le corps.
Une condition nécessaire à l'apparition d'un stress mental est la perception d'une menace (le stress émotionnel n'est pas aussi dangereux), et la perception d'une situation comme menaçante est associée à des processus cognitifs (cognitifs), à des caractéristiques de la personnalité (anxiété, stabilité émotionnelle , etc.).
Un attribut obligatoire du stress émotionnel, un signal indiquant l’insuffisance des réserves fonctionnelles d’une personne pour surmonter une menace, est anxiété. Liant les sentiments, l'anxiété à une menace spécifique est désignée comme peur.
Anxiété et peur sont des signes de tension dans les mécanismes d'adaptation mentale, des stimuli qui activent les mécanismes d'adaptation, les obligeant à chercher une issue à une situation stressante.
Selon le niveau d'anxiété et de peur, le comportement d'une personne peut varier. Les troubles de l'adaptation mentale peuvent se manifester par une diminution de l'efficacité, des relations interpersonnelles perturbées et un rétrécissement de l'éventail des intérêts ou de leur niveau.
S’ils sont graves, ces phénomènes peuvent être considérés comme des troubles de santé mentale.
Le stress et ses attributs (anxiété et peur) sont des composantes obligatoires de l'état fonctionnel des personnes situées en situation d'urgence et exposées à certains aléas.
Symptômes psychologiques possibles du stress :
sentir que quelque chose de grave va arriver
anxiété et nervosité déraisonnables et constantes
incapacité à se détendre
Dépression
sentiment d'impuissance ou d'impuissance
somnolence
affaiblissement de la mémoire et de l'attention
Souvent, les gens tentent de surmonter les effets du stress en recourant à l’alcool ou à des médicaments, mais même s’ils apportent un soulagement temporaire, ces médicaments ne font qu’aggraver leur état général. Si une personne éprouve constamment l'un des symptômes ci-dessus ou remarque une habitude de gérer le stress à l'aide de l'alcool, elle devra peut-être demander l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue. Il existe également diverses idées fausses liées au stress.
Le stress n’affecte que le psychisme, sans nuire à l’état physique. En influençant le psychisme, le stress affecte le corps dans son ensemble. Par exemple, l’hypertension et les ulcères gastriques et duodénaux sont souvent le résultat du stress. Il existe un concept de « maladies psychosomatiques », qui fait référence à des maladies « physiques » bien réelles.
Hystérique.
Tremblements nerveux.
Excitation motrice.
Agression.
» Stupeur,
Violences, etc
Pleurs
Les pleurs peuvent être attribués à des réactions qui permettent de laisser libre cours à des émotions négatives. La réaction des pleurs peut être considérée comme normale et même souhaitable dans des situations de perte d'un proche, de perte de logement, de foyer. La manifestation d’une réaction de pleurs est un symptôme du traitement des émotions négatives, il est donc extrêmement important de permettre à la réaction de pleurer de se produire.
Panneaux
La personne pleure déjà ou est prête à fondre en larmes ; les lèvres tremblent ; il y a un sentiment de dépression ; Contrairement à l’hystérie, il n’y a aucune excitation dans le comportement.
Aide "
Dans une situation où la victime commence à avoir une réaction de pleurs, il est extrêmement important de lui apporter un soutien sur les plans rationnel, verbal et physique. Il n'est pas souhaitable de laisser la victime seule, s'il est impossible de lui apporter une assistance professionnelle, il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un avec elle, de préférence une personne proche ou familière. Il est possible et conseillé d'avoir recours au contact physique avec la victime (prendre la main ; poser la main sur l'épaule ou le dos, caresser la tête) ; cela aidera une personne à sentir que quelqu'un est à proximité, qu'elle n'est pas seule.
L'utilisation de techniques ((écoute active) aide à rejoindre une personne au niveau verbal, ce qui donne la possibilité d'une réaction de pleurs, d'évacuer son chagrin. Dites périodiquement « uh-huh », « uh-huh » , "oui", hochez la tête, c'est-à-dire confirmez que vous écoutez et sympathisez. Répétez après la personne des extraits de phrases dans lesquelles elle exprime ses sentiments. Parlez de vos sentiments et de ceux de la victime. Ne posez pas de questions et ne donnez pas de conseils. .
Si une personne retient ses larmes, la libération émotionnelle et le soulagement ne se produisent pas. Si cela dure suffisamment longtemps, cela peut nuire à la santé physique et psychologique d’une personne.
Hystérique
Panneaux
La conscience demeure, mais le contact est presque impossible ; excitation excessive, beaucoup de mouvements, poses théâtrales ; la parole est émotionnellement riche, rapide ; des cris, des sanglots.
Aide
Éloignez les spectateurs, créez un environnement calme. Si ce n'est pas dangereux, restez seul avec la victime. Effectuez de manière inattendue une action qui peut arrêter l'hystérie (vous pouvez gifler le visage, verser de l'eau dessus, laisser tomber un objet avec un rugissement ou crier brusquement après la victime). Parlez à la victime par des phrases courtes, sur un ton confiant (« bois de l'eau », « lave-toi »),
Après l’hystérie vient la dépression. Endormez la victime. Avant l'arrivée du spécialiste, surveillez son état. Ne cédez pas aux souhaits de la victime.
Tremblements nerveux
On peut souvent observer l'image suivante : une personne qui vient de subir un accident, une agression ou qui a été témoin d'un incident tremble violemment. Il s'agit d'un tremblement nerveux incontrôlable - c'est ainsi que le corps « soulage » les tensions. Si cette réaction est stoppée, la tension restera dans le corps et pourra provoquer des douleurs musculaires et d’autres maladies.
Panneaux
Le tremblement commence soudainement immédiatement après l'incident ou après une courte période ; un fort tremblement de tout le corps ou de ses parties individuelles apparaît (une personne ne peut pas tenir de petits objets dans ses mains ni allumer une cigarette).
Aide
Il faut augmenter son tremblement ; Pour ce faire, prenez la victime par les épaules, secouez-la fortement et brusquement pendant 10 à 15 secondes. Durant cette technique, parlez-lui, sinon la personne pourrait percevoir vos actions comme une attaque.
Faux serrez ou câlinez la victime, couvrez-la, calmez-la, dites-lui de se ressaisir.
Peur
Un enfant se réveille la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Une personne qui a survécu à un tremblement de terre ne peut pas entrer dans son appartement survivant. Une fois que j’ai eu un accident, personne ne conduit plus. Tout cela n'est que peur.
Panneaux
Tensions musculaires (surtout faciales), palpitations, respiration rapide et superficielle, diminution du contrôle de son propre comportement ; la peur panique et l'horreur peuvent provoquer la fuite, provoquer un engourdissement et un comportement agressif ; en même temps, la personne a peu de contrôle sur ce qu'elle fait et ce qui se passe autour d'elle.
Aide
N'oubliez pas que la peur peut être utile lorsqu'elle vous aide à éviter le danger (c'est effrayant de marcher dans les rues sombres la nuit). Il est donc nécessaire de combattre la peur lorsqu'elle interfère avec la vie normale (un enfant a peur des monstres qui vivent sous le lit ; une personne qui a subi des violences a peur d'entrer dans son entrée).
Pour aider quelqu’un, placez sa main sur votre poignet. pour qu'il puisse sentir votre pouls calme ; c'est un signal - "Je suis là maintenant, vous n'êtes pas seul." Respirez profondément et uniformément. Encouragez la victime à respirer V le même rythme que toi. Donnez à la victime un léger massage des muscles les plus tendus du corps.
Si la victime parle, écoutez-la, montrez de l'intérêt, de la compréhension, de la sympathie. Utilisez des activités distrayantes qui ne nécessitent pas d’activités intellectuelles complexes.
Invitez la personne à retrouver une image de sa peur, obtenez-en une description détaillée, demandez-lui de la projeter sur un écran imaginaire (« A quoi ressemble votre peur ? De quelle couleur, forme, bouge-t-elle ou pas ? », etc.) . Demandez-moi d'agrandir (ou de zoomer) cette image, je la réduirai ensuite (ou la supprimerai) ; cela permettra à la victime de se sentir maître de sa propre peur. (« Essayez d'augmenter votre image de 1 % , maintenant réduire de 2%, etc.).
Demandez à la victime de trouver l'endroit dans le corps où se situe actuellement la peur. Aidez la personne à parler des sensations corporelles provoquées par la peur. Demandez à trouver et à décrire la sensation opposée dans le corps (« Quel est le contraire de la tension ? », « Où se ressent-on dans le corps ? »). Après une description détaillée, revenez à l'emplacement de la peur dans le corps et demandez ce qui a changé dans les sensations, « voyagez » des sensations corporelles de peur vers des expériences ingénieuses et positives jusqu'à ce que ces dernières deviennent insignifiantes.
Avec les enfants, utilisez la technique consistant à faire ressortir l'image de la peur (c'est-à-dire un dessin, une figure en pâte à modeler ou en argile). Demandez ce que l'enfant aimerait faire de sa peur (déchirer, se froisser, brûler, se cacher) ; après cela, faites ce que vous voulez avec votre enfant.
Ces techniques simples peuvent vous aider à faire face à l’expérience désagréable de la peur.
Excitation motrice
Parfois, le choc d'une situation critique est si fort qu'une personne cesse tout simplement de comprendre ce qui se passe autour d'elle. il ne comprend pas où sont les ennemis et où sont les secours, où est le danger et où est le salut. La seule chose qu'il peut faire, c'est bouger. Les mouvements peuvent être très simples (« J'ai couru, et quand j'ai repris mes esprits, il s'est avéré que je ne savais pas où j'étais ») ou assez complexes (« J'ai fait ça, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai couru quelque part, mais rien Je ne m'en souviens pas").
Panneaux
Mouvements brusques, actions souvent sans but et dénuées de sens, discours anormalement fort ; il n’y a souvent aucune réaction envers les autres ; danger de danger pour vous-même et pour autrui.
Aide
Il est nécessaire de maintenir la personne en utilisant la technique du « saisir » : étant par derrière, insérez vos mains sous les aisselles de la victime, appuyez-la contre vous et renversez-la légèrement ; isoler la victime des autres ; masser ses points positifs ; parlez d'une voix calme, ne discutez pas et évitez les phrases contenant la particule « non » dans votre conversation.
Agression
Chaque personne vit une situation critique à sa manière - certains se figent, certains courent et certains commencent à se mettre en colère. La manifestation de colère ou d'agressivité peut persister assez longtemps (elle va perturber la victime elle-même et son entourage/
Panneaux
Irritation, insatisfaction, colère (pour toute raison, même mineure) ; frapper les autres avec les mains ou avec tout autre objet ; violence verbale, jurons; tension musculaire; augmentation de la pression artérielle.
Aide
Minimisez le nombre de personnes autour de vous. -
Donnez à la victime l’occasion de « se défouler » (par exemple, d’en parler ou de « battre » un oreiller).
Attribuez des tâches qui impliquent un effort physique élevé. Faites preuve de gentillesse.
Essayez de désamorcer la situation avec des commentaires ou des actions amusantes.
L'agression peut être éteinte par la peur de la punition - s'il n'y a pas d'objectif de tirer profit d'un comportement agressif, si la punition est sévère et la probabilité de sa mise en œuvre est élevée. Si l'agression est causée par une personne - (patron, connaissance, collègue), vous pouvez utiliser plusieurs techniques simples :
- - proposer de le visualiser (« Imaginez cette personne, concentrez-vous sur ses vêtements, sa voix, son comportement),
- - proposez de faire les actions suivantes avec une image désagréable - réduisez-la en taille, habillez-la avec des vêtements amusants, dessinez une moustache, etc.
Une autre variante. Une fois que l'apparence de la personne agressante a été présentée dans les moindres détails, demandez à vous souvenir d'un endroit où il faisait très bon, calme, confortable, proposez de placer l'image désagréable sur une image lumineuse d'un tel endroit, demandez de réduire progressivement l'image image négative à un petit point.
Essayez différentes options. Demandez à nouveau de vous souvenir de l'image de la « mauvaise » personne et de la situation qui a provoqué l'agression. Faites cela jusqu'à ce que l'image évoque des émotions fortement négatives.
Stupeur
L’homme est immobile, assis dans une position et ne réagit à rien ; il semble « engourdi de chagrin ». C’est ainsi que se manifeste la stupeur, l’une des réactions défensives les plus puissantes du corps. Cela se produit lorsqu'une personne a dépensé tellement d'énergie pour survivre qu'elle n'a plus la force d'interagir avec le monde extérieur.
Panneaux
Une forte diminution ou absence de mouvements volontaires et de parole, manque de réactions aux stimuli externes (bruit, lumière, toucher, douleur), « gel » dans une certaine position, engourdissement, état d'immobilité totale ; tension possible de groupes musculaires individuels.
Aide
Pliez les doigts de la victime des deux mains et appuyez-les contre la base de la paume, les pouces doivent être pointés vers l'extérieur. À l'aide du bout du pouce et de l'index, massez les points de la victime situés sur le front au-dessus des yeux, exactement à mi-chemin entre la racine des cheveux et les sourcils. Placez la paume de votre main libre sur la poitrine de la victime. Adaptez votre respiration au rythme de sa respiration.
Une personne dans un tel état peut entendre et voir, alors parlez-lui doucement, lentement et clairement à l'oreille, ce qui peut provoquer des émotions fortes (de préférence négatives).
Il est important d'obtenir une réaction de la victime par tous les moyens, pour la sortir de sa stupeur.
Apathie
Une fatigue irrésistible. Tout mouvement ou tout mot s'accompagne de grandes difficultés. Il y a de l'indifférence et de l'indifférence dans l'âme - il n'y a pas de force même pour les émotions.
Panneaux
Attitude indifférente envers l'environnement, léthargie, léthargie, la parole est lente, avec de longues pauses.
Aide
Parlez à la victime. Posez-lui quelques questions simples (Comment vous appelez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Avez-vous faim ?).
Emmenez la victime dans un lieu de repos, aidez-la à s'installer confortablement (assurez-vous d'enlever ses chaussures), prenez-la par la main ou posez votre main sur son front. Donnez à la personne la possibilité de dormir ou de s'allonger.
S'il n'y a pas de possibilité de se reposer (incident dans la rue, dans les transports en commun, attente de la fin de l'opération à l'hôpital), discuter avec la victime, l'impliquer dans toute activité commune (se promener, boire du thé ou du café , aider les autres qui ont besoin d'aide).
Violence mettant la vie en danger (assistance aux adultes)
De telles situations incluent le détournement par des terroristes, le vol, le vol.
En peu de temps, on se confronte à la menace réelle de la Mort (dans la vie de tous les jours, le psychisme crée une protection sous forme d'illusions qui permettent de percevoir la mort comme un événement lointain et irréel.
Même si une personne n'a pas été soumise à des violences physiques, elle a néanmoins subi un grave traumatisme mental. L'image du monde change, la réalité semble remplie d'accidents mortels. Une personne commence à diviser sa vie en deux parties - avant et après l'événement. Il a le sentiment que les autres ne peuvent pas comprendre ses sentiments et ses expériences.
Aide
Donner à la personne la possibilité d'exprimer des sentiments liés aux événements vécus lors d'une conversation ; s'il refuse de parler, proposez-lui de décrire l'événement qui s'est produit et ses sentiments dans un journal ou sous forme d'histoire.
Montrez à la personne que même V A propos de l'événement le plus terrible, on peut tirer des conclusions utiles pour la vie ultérieure (laisser la personne elle-même réfléchir à l'expérience qu'elle a acquise au cours des épreuves de la vie).
Donner à la personne la possibilité de communiquer avec des personnes qui ont vécu avec elle une situation tragique (échanger les numéros de téléphone des participants à l'événement).
Ne laissez pas la victime jouer le rôle de « victime », c'est-à-dire utiliser l'événement tragique vécu pour en tirer un profit (« Je ne peux rien faire, parce que j'ai vécu des minutes si terribles »),
Violence associée à une menace pour la vie (aider un enfant)
L'enfant a subi des violences contre lui-même ou contre des membres de sa famille, ou a été témoin de blessures infligées à d'autres personnes.
L'enfant éprouve les mêmes sentiments forts que l'adulte (peur de répétition de l'événement, destruction de l'illusion d'un monde juste, impuissance). La violence directe contre un enfant peut être trop difficile et insupportable pour lui, ce qui se traduit par le silence et l'engourdissement.
L'enfant peut avoir une image de l'événement gravée dans sa mémoire. Il peut dessiner encore et encore les moments les plus terribles de ce qui s'est passé (personnes mutilées ou blessées).
Si un enfant associe les actions d'un criminel à la rage, il perd alors confiance dans la capacité des adultes à se débrouiller seuls ; commence à avoir peur de ses propres émotions incontrôlables, surtout s'il a des fantasmes liés à la vengeance.
L'enfant peut se sentir coupable, c'est-à-dire considérer son comportement antérieur comme la cause de l'existence
Un enfant qui a vécu un événement traumatisant ne voit pas de perspectives de vie supplémentaires - ne sait pas ce qui lui arrivera dans un jour, un mois, une année ; perd tout intérêt pour des activités auparavant passionnantes. Pour un enfant, un événement vécu peut provoquer un arrêt
développement personnel.
Aide
Faites savoir à votre enfant que ce qu'il a vécu est important pour nous ; que tu connaissais d'autres enfants qui avaient vécu ça aussi (« Vous pas seul. je Je connais un garçon très courageux et courageux à qui cela est également arrivé.
Créez une atmosphère de sécurité (embrassez votre enfant le plus souvent possible, parlez-lui, participez à ses jeux).
Regardez de bonnes photos avec votre enfant - cela vous permettra de faire appel À premières images et atténuer la mémoire traumatique récente.
Réduisez les conversations sur l’événement de la description des détails aux sentiments. Aidez votre enfant à construire une perspective de vie (objectifs spécifiques pour des dates précises). Répétez qu’il est tout à fait normal de se sentir impuissant. peur, colère.
Augmentez l'estime de soi de votre enfant (félicitez ses actions plus souvent).
Encouragez votre enfant à jouer avec du sable, de l'eau, de l'argile (aidez-le à extérioriser ses expériences sous forme d'images).
Ne permettez pas à votre enfant de devenir un tyran ; n'exaucez aucun de ses souhaits par pitié.
Catastrophes, accidents, catastrophes naturelles
En cas de catastrophes, catastrophes naturelles, explosions, accidents, vous pouvez rencontrer une situation où une personne est isolée dans les décombres (en cas d'explosions et de tremblements de terre) ; des toits des maisons, des arbres (lors d'inondations) ; dans une voiture (en cas d'accident). Cette personne est une victime directe du sinistre.
Imaginez la situation : vous êtes dans une pièce sombre jonchée de meubles ; vous n’avez aucune idée d’où et de ce qui se trouve, et vous ne savez pas comment sortir. La situation dans laquelle une personne est piégée est bien pire. On peut imaginer que dans ce cas, toute information constitue le seul lien avec le monde extérieur et vaut son pesant d’or. Ce qui est important, c'est quoi et comment dire.
Vous devez parler fort, lentement et clairement lorsque vous êtes dans un embouteillage. Informer les gens de l'arrivée des secours et des règles de comportement - économie d'effort maximale ; la respiration est lente, superficielle, à travers nez, cela permettra d'économiser de l'oxygène dans le corps et l'espace environnant ; interdiction des actions physiques pour l’auto-libération.
Les personnes libérées des décombres reçoivent d’abord une assistance médicale ; une assistance psychologique est nécessaire et possible dans le cas où une assistance médicale a déjà été apportée ou sa fourniture n'est pas encore possible (la personne est isolée)
Maladie mortelle
L'attitude d'une personne envers ce qui l'attend change comme suit :
déni - "Non, pas moi!"
colère - ((Pourquoi moi ?
« négociation » - le patient entame des négociations pour prolonger sa vie ; promet, par exemple, d'être obéissant, de devenir croyant ;
dépression - ne pose pas de questions, pleure, se replie sur lui-même ;
acceptation de la réalité.
Il est important de passer le plus rapidement possible du déni à la reconnaissance de ce qui est inévitable, pour ne plus avoir peur de la mort. Il existe un stéréotype enraciné : « combattre la mort jusqu'au bout » ; cependant, ce qu’il faut en réalité, c’est qu’une personne accepte la mort sur le plan spirituel.
Aide
Encouragez les pensées de départ plutôt que de mort. Parlez à la personne autant que possible. demandez-lui de parler de différents épisodes de sa vie.
Encouragez-vous à réfléchir (à vous souvenir) des réussites et des réalisations de la vie.
Ne laissez pas une personne seule si elle a besoin de soutien ou si elle veut parler.
Réaliser les désirs insatisfaits d'une personne (jouer une situation dans une bataille jusque dans les moindres détails qui ne se sont jamais matérialisés).
Si la personne est encore très active, n'essayez pas de la protéger des soucis quotidiens. Aidez à élaborer un plan des choses qu’une personne aimerait faire.
Trouvez une ressource (activité, pensées, souvenirs, affaires inachevées) pour une personne qui l'aidera à vivre le reste de sa vie sans angoisse mentale.