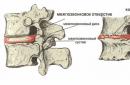Systèmes physiologiques du corps - squelettique (squelette humain), musculaire, circulatoire, respiratoire, digestif, nerveux, système sanguin, glandes endocrines, analyseurs, etc.
Le sang est un tissu liquide qui circule dans le système circulatoire et assure l'activité vitale des cellules et tissus de l'organisme en tant qu'organe et système physiologique. Il est constitué de plasma (55-60 %) et d'éléments formés en suspension : globules rouges, leucocytes, plaquettes et autres substances (40-45 %) et a une réaction légèrement alcaline (pH 7,36).
La quantité totale de sang représente 7 à 8 % du poids corporel d’une personne. Au repos, 40 à 50 % du sang est exclu de la circulation et se situe dans des « dépôts sanguins » : le foie, la rate, les vaisseaux cutanés, les muscles, les poumons. Si nécessaire (par exemple lors d'un travail musculaire), le volume de sang de réserve est inclus dans la circulation sanguine et dirigé par réflexe vers l'organe de travail. La libération du sang du « dépôt » et sa redistribution dans tout le corps sont régulées par le système nerveux central (SNC).
La perte de plus d'un tiers de la quantité de sang d'une personne met sa vie en danger. Dans le même temps, réduire la quantité de sang de 200 à 400 ml (don) est inoffensif pour les personnes en bonne santé et stimule même les processus hématopoïétiques. Il existe quatre groupes sanguins (I, II, III, IV). Pour sauver la vie de personnes ayant perdu beaucoup de sang ou pour certaines maladies, les transfusions sanguines sont pratiquées en tenant compte du groupe. Chaque personne devrait connaître son groupe sanguin.
Le système cardiovasculaire. Le cœur, organe principal du système circulatoire, est un organe musculaire creux qui effectue des contractions rythmiques, grâce auxquelles le processus de circulation sanguine se produit dans le corps. Le cœur est un appareil autonome et automatique. Cependant, son œuvre est corrigée par de nombreux directs et
feedback provenant de divers organes et systèmes du corps. Le cœur est relié au système nerveux central, ce qui a un effet régulateur sur son fonctionnement.
Le système cardiovasculaire comprend la circulation systémique et pulmonaire. La moitié gauche du cœur sert à la circulation systémique, la moitié droite sert à la circulation pulmonaire.
Le pouls est une onde d'oscillations propagée le long des parois élastiques des artères suite au choc hydrodynamique d'une partie du sang éjecté dans l'aorte sous pression lors de la contraction du ventricule gauche. La fréquence du pouls correspond à la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque au repos (le matin, couché, à jeun) est plus faible du fait de l'augmentation de la puissance de chaque contraction. Une diminution de la fréquence cardiaque augmente le temps de pause absolu nécessaire au repos du cœur et aux processus de récupération dans le muscle cardiaque. Au repos, la fréquence cardiaque d'une personne en bonne santé est de 60 à 70 battements/min.
La pression artérielle est créée par la force de contraction des ventricules du cœur et l’élasticité des parois des vaisseaux sanguins. Elle est mesurée dans l'artère brachiale. Il existe une pression maximale (systolique), qui est créée lors de la contraction du ventricule gauche (systole), et une pression minimale (diastolique), qui est observée lors de la relaxation du ventricule gauche (diastole). Normalement, une personne en bonne santé âgée de 18 à 40 ans au repos a une tension artérielle de 120/70 mmHg. (pression systolique de 120 mm, diastolique de 70 mm). La pression artérielle la plus élevée est observée dans l'aorte. À mesure que vous vous éloignez du cœur, votre tension artérielle diminue de plus en plus. La pression la plus basse est observée dans les veines lorsqu'elles se jettent dans l'oreillette droite. Une différence de pression constante assure un flux sanguin continu dans les vaisseaux sanguins (dans le sens de la basse pression).
Système respiratoire. Le système respiratoire comprend la cavité nasale, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. En respirant de l'air atmosphérique à travers les alvéoles des poumons, le corps reçoit constamment
l'oxygène et le dioxyde de carbone sont libérés du corps. Le processus respiratoire est un ensemble de processus physiologiques et biochimiques, dans la mise en œuvre desquels non seulement l'appareil respiratoire, mais également le système circulatoire. Le dioxyde de carbone pénètre dans le sang à partir des cellules des tissus, du sang vers les poumons et des poumons vers l'air atmosphérique.
Système digestif et excréteur. Le système digestif comprend la cavité buccale, les glandes salivaires, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, le foie et le pancréas. Dans ces organes, les aliments sont traités mécaniquement et chimiquement, les substances alimentaires entrant dans l'organisme sont digérées et les produits digestifs sont absorbés.
Le système excréteur est formé par les reins, les uretères et la vessie, qui assurent l'excrétion des produits métaboliques nocifs du corps avec l'urine (jusqu'à 75 %). De plus, certains produits métaboliques sont excrétés par la peau, les poumons (avec l'air expiré) et le tractus gastro-intestinal. Avec l'aide des reins, le corps maintient l'équilibre acido-basique (PH), le volume d'eau et de sels requis et une pression osmotique stable.
Système nerveux. Le système nerveux est constitué d'une section centrale (cerveau et moelle épinière) et périphérique (nerfs s'étendant du cerveau et de la moelle épinière et situés à la périphérie des ganglions nerveux). Le système nerveux central coordonne les activités de divers organes et systèmes du corps et régule cette activité dans un environnement externe changeant à l'aide du mécanisme réflexe. Les processus qui se produisent dans le système nerveux central sont à la base de toute activité mentale humaine.
Le cerveau est un ensemble d’un très grand nombre de cellules nerveuses. La structure du cerveau est incomparablement plus complexe que celle de n’importe quel organe du corps humain.
La moelle épinière se situe dans le canal rachidien formé par les arcs vertébraux. La première vertèbre cervicale est le bord supérieur de la moelle épinière et le bord inférieur est la deuxième vertèbre lombaire. La moelle épinière est divisée en cinq sections comportant un certain nombre de segments : cervical, thoracique, lombaire, sacré et coccygien. Au centre de la moelle épinière se trouve un canal rempli de liquide céphalo-rachidien.
Le système nerveux autonome est une partie spécialisée du système nerveux régulée par le cortex cérébral. Il est divisé en systèmes sympathique et parasympathique. L'activité du cœur, des vaisseaux sanguins, des organes digestifs, l'excrétion, la régulation du métabolisme, la formation de chaleur, la participation à la formation de réactions émotionnelles - tout cela est sous le contrôle du système nerveux sympathique et parasympathique et sous le contrôle de la partie supérieure. du système nerveux central.
Organes et quelles fonctions physiologiques existent.
Un organisme est une unité existant indépendamment du monde organique ; c'est un système ouvert, capable d'autorégulation, d'auto-récupération et d'auto-reproduction, et qui répond aux divers changements de l'environnement extérieur comme un tout.
Essayons d'analyser les composantes de cette définition.
Le corps vit de manière indépendante et la base de l’activité vitale est le métabolisme et l’énergie. On distingue le métabolisme externe (absorption et excrétion de substances) et le métabolisme interne (transformation chimique de substances dans les cellules). Un organisme ne peut fonctionner qu'en relation inextricable avec l'environnement extérieur auquel il est adapté. Le corps échange de la matière, de l'énergie et des informations avec l'environnement. Du point de vue de la thermodynamique, de tels systèmes sont dits ouverts.
Le métabolisme (métabolisme) est un ordre naturel de transformation des substances et de l'énergie dans les systèmes vivants, visant à leur préservation, leur auto-renouvellement et leur auto-reproduction. Le métabolisme comprend deux processus interdépendants et se produisant simultanément : l'assimilation (anabolisme) et la dissimilation (catabolisme).
Au cours des réactions cataboliques, les grosses molécules organiques sont décomposées en molécules simples, libérant de l'énergie qui s'accumule dans les liaisons phosphate à haute énergie. Lors des transformations anabolisantes, la biosynthèse de molécules complexes inhérentes à un organisme particulier se produit à partir de précurseurs plus simples. Ainsi, en décomposant les substances organiques de l'environnement extérieur au cours du métabolisme, les organismes animaux synthétisent de nouvelles substances dans lesquelles s'accumule de l'énergie libre (énergie pouvant être convertie en travail). Le processus d'accumulation d'énergie libre nous permet de protéger le corps des effets destructeurs de l'environnement et de maintenir son état de vie.
Pour préserver un système vivant, il est nécessaire qu'au cours du processus métabolique, aucune macromolécule ne soit synthétisée, mais uniquement celles caractéristiques d'un organisme particulier. Cela se produit en raison de la réplication, c'est-à-dire de l'auto-reproduction de macromolécules d'acide nucléique. Après cela, la copie exacte et la transmission du système génétique sont effectuées, ce qui signifie l'auto-reproduction du système vivant.
Le processus d'auto-guérison des structures cellulaires et de la substance intercellulaire est également associé au métabolisme - le remplacement continu des anciennes molécules par de nouvelles. Il a été établi que chez les animaux adultes, la moitié de toutes les protéines tissulaires se renouvellent en trois mois, les protéines hépatiques - en deux semaines, les protéines sanguines - en une semaine. À mesure que le corps vieillit, le taux d’auto-guérison des tissus ralentit.
Les organismes animaux sont unicellulaires et multicellulaires. Dans les organismes unicellulaires (et autres), il existe un niveau d’organisation cellulaire auquel il existe une division des fonctions entre les organites individuels. Par exemple, la fonction motrice est associée à des cils ou à un flagelle, la fonction digestive est associée à des vacuoles spécialisées, etc. Cependant, toutes les fonctions physiologiques se déroulent dans une seule cellule.
Dans les organismes multicellulaires, des différences de forme apparaissent entre les cellules. taille, structure et fonctions. Des cellules également différenciées donnent naissance à des tissus spécialisés pour remplir des fonctions individuelles : par exemple, des tissus musculaires pour remplir des fonctions motrices. Les cellules tissulaires spécialisées remplissent également des fonctions communes à toutes les cellules : métabolisme, nutrition, respiration. décharge. Des interactions se produisent entre les cellules qui forment le tissu.
À un certain stade de la phylogenèse et de l'ontogenèse, des organes constitués de divers tissus se forment. Les organes sont des structures anatomiques qui remplissent une fonction spécifique dans le corps et sont constitués de plusieurs tissus. L'ensemble des organes impliqués dans des activités complexes est appelé système d'organes physiologiques (système digestif, système respiratoire, système circulatoire, système excréteur, système endocrinien, etc.).
Ainsi, chez les animaux supérieurs et chez les humains, on peut distinguer les niveaux d'organisation moléculaires, cellulaires, tissulaires, organiques et systémiques. Pour comprendre les fonctions des organismes supérieurs, il est nécessaire d'étudier tous ces niveaux, car il fonctionne comme un système dans lequel les activités de toutes ses structures sont coordonnées dans l'espace et dans le temps.
Les organismes multicellulaires supérieurs ont une structure complexe et remplissent des fonctions complexes, il est donc conseillé de considérer les caractéristiques de leur organisation structurelle et fonctionnelle.
La base de l'organisation structurelle sont les cellules qui constituent les tissus, les tissus forment les organes et les organes forment le corps. Pour remplir des fonctions physiologiques, il est nécessaire de combiner un certain nombre de formations structurelles. Par conséquent, l'organisation fonctionnelle a la séquence suivante : unité fonctionnelle - système d'organes physiologiques - système fonctionnel.
Une unité fonctionnelle est un groupe de cellules combinées pour remplir des fonctions spécifiques. Les unités fonctionnelles de l'organe ne fonctionnent pas simultanément, mais alternativement. La combinaison d’organes pour remplir une fonction spécifique est un système organique physiologique. Ensemble, ils peuvent être organisés en un système fonctionnel - un ensemble de diverses structures et processus combinés pour atteindre les résultats de l'action conformément à l'objectif fixé (P.K. Anokhin, 1935). Par exemple, les muscles reçoivent la quantité d'oxygène requise lors d'un travail physique grâce à la mobilisation (avec la participation des systèmes nerveux et humoral) des systèmes physiologiques du sang, de la circulation et de la respiration, qui se transforment en un système fonctionnel de transport de gaz.
Les organismes unicellulaires et multicellulaires réagissent comme un tout à divers changements de l'environnement externe. Des réactions particulièrement complexes et variées se produisent dans tout l’organisme des animaux supérieurs. De telles réactions ne peuvent être réduites à la somme des réactions de cellules, tissus et organes individuels.
Les fonctions physiologiques sont des manifestations de l'activité vitale ; elles sont de nature opportuniste. Exerçant diverses fonctions, le corps s'adapte à l'environnement extérieur.
La principale manifestation de l'activité vitale est le métabolisme et l'énergie, auxquels sont associées toutes les autres fonctions physiologiques (croissance, développement, reproduction, nutrition, digestion, respiration, circulation sanguine, écoulement, sécrétion, éveil et sa conduction, contraction et mouvement musculaires, protection contre les infections, etc.). Les fonctions physiologiques peuvent être divisées en deux groupes : plastiques (construction) et réglementaires. Les premiers impliquent la synthèse d'acides nucléiques, de protéines et la formation de structures cellulaires, les seconds assurent la régulation des fonctions vitales des organes et des systèmes.
À la suite de transformations physico-chimiques, l'exercice de fonctions entraîne des changements structurels dans les cellules. Parfois, ils peuvent être identifiés à l’aide d’un microscope optique, et parfois uniquement au microscope électronique. Les changements structurels peuvent être réversibles. Les fonctions physiologiques, qui reposent sur des changements chimiques, physiques et mécaniques, ne peuvent être réduites à aucune d'entre elles, mais doivent être étudiées dans leur ensemble.
Le corps entier d'une personne saine ou malade, ses organes et systèmes individuels, en particulier les organes circulatoires, réagissent en permanence à diverses irritations provenant du monde environnant et interne. Dans ce cas, des réactions adaptatives se forment, qui à un certain moment sont utiles pour les organes individuels et pour l'organisme dans son ensemble, puis peuvent se transformer en réactions pathologiques et nécessiter une correction.
Systèmes fonctionnels du corps, selon P.K. Les Anokhin se forment au niveau moléculaire, homéostatique et comportemental, en tant qu'interaction d'éléments permettant d'obtenir des résultats bénéfiques communs pour les systèmes et les organes. Dans chaque élément individuel du système fonctionnel, les propriétés et les états du résultat adaptatif final, utile pour l'organisme, se manifestent.
De nombreux flux de signaux nerveux et de molécules d'information spéciales (oligopeptides, complexes immunitaires protéiques, acides gras, prostaglandines, etc.) informent en permanence le cerveau de l'état des différents tissus et des changements métaboliques qui s'y produisent. En se propageant depuis le cerveau, les signaux nerveux et les molécules d’information ont, à leur tour, des effets régulateurs sur les processus tissulaires. L'information circule ainsi à tout moment dans l'organisation dynamique des différents systèmes fonctionnels - du besoin à sa satisfaction.
En raison de l'interaction des systèmes fonctionnels du corps, toute maladie s'accompagne toujours de modifications d'autres organes et structures somatiques.
Les modifications pathologiques dans un organe contribuent à l'apparition de modifications dans les organes et tissus fonctionnellement liés, principalement innervés par les mêmes segments de la moelle épinière. Dans la zone d'innervation du segment, des zones d'hyperalgésie cutanée, de tension musculaire, de douleur du périoste et de troubles des mouvements dans le segment correspondant de la colonne vertébrale sont identifiées. Cependant, l’effet réflexe ne se limite pas à un seul segment. Des changements pathologiques peuvent apparaître dans les structures somatiques et viscérales innervées par d'autres segments de la moelle épinière.
Au niveau du segment médullaire, un traitement intrasegmentaire du signal nociceptif peut avoir lieu. Grâce à l'activation des cellules multimodales, les signaux de douleur peuvent affluer dans les neurones à des fins diverses - motrices, autonomes, etc. De ce fait, des connexions fonctionnelles sont établies : viscéro-motrices, dermatomotrices, dermato-viscérales, viscéro-motrices. -viscéral, moteur-viscéral - ayant souvent un caractère pathologique. De plus, les signaux afférents entrant dans le système nerveux central à partir de la lésion peuvent provoquer des réactions plus généralisées dues à une perturbation de la régulation neurohumorale.
Les relations viscéro-somatiques, prenant en compte les interrelations des divers systèmes fonctionnels du corps, peuvent être représentées par des mécanismes d'interaction non réflexe et réflexe.
Conséquence du non-réflexion interaction viscéro-somatique- déstabilisation des mécanismes de traitement des signaux sensoriels à l'entrée de l'appareil segmentaire, irritation des groupes neurogènes de la corne postérieure de la moelle épinière et excitation des canaux sensoriels de la peau, des ligaments, des muscles, des fascias. En conséquence, des zones d'hyperalgésie (zones Zakharyin-Ged) se forment dans le dermatome, le myotome et le sclérotome correspondants. La douleur n'est généralement pas intense, repose sur la correspondance métamérique de l'organe affecté et d'autres structures, est localisée dans la zone d'un métamère et ne s'accompagne pas d'une hypertonie locale des structures myofasciales. Elle existe pendant une courte période, après quoi elle disparaît ou se transforme en douleur, qui a un mécanisme réflexe, qui à son tour est à la base de la formation de trigger points myofasciaux.
Les mécanismes réflexes de l'interaction viscéro-somatique comprennent les interactions viscéro-motrices, viscéro-sclérotomiques, viscéro-dermatomiques et motrices-viscérales.
Les interactions viscéromotrices dans les maladies aiguës des organes internes s'accompagnent de la formation d'un flux afférent nociceptif intense et d'une défense musculaire.
La pathologie chronique des organes internes est caractérisée par un flux afférent nociceptif minime et la formation d'une hypertonie myofasciale, dans laquelle il existe une douleur localisée d'intensité variable, un resserrement musculaire local (en particulier dans les muscles paravertébraux toniques).
Dans l'interaction viscéro-sclérotomale, les mécanismes déclencheurs sclérotomiaux se forment à la suite d'un processus réflexe dans le fascia, les ligaments et le périoste. Ces changements se produisent plus lentement que dans les muscles.
L'interaction motrice-viscérale se produit en raison du flux d'informations du système musculo-squelettique vers l'organe interne. Dans ce cas, l'interaction proprioceptive se forme au sein du segment (à travers les systèmes humoral, endocrinien et nerveux), puis dans la formation réticulaire du tronc cérébral, dans le système limbique, dans l'hypothalamus, etc. Les entrées afférentes étant strictement segmentées , et la sortie est « dispersée » (animation des afférents ), alors le dysfonctionnement des centres végétatifs trophiques affecte une vaste zone.
Les relations anatomiques des segments de la moelle épinière, des dermatomes, des muscles et des organes internes donnent à penser que certaines zones de la surface du corps (peau, tissu sous-cutané, muscles, tissu conjonctif), via le système nerveux, sont reliées à certains organes internes. Par conséquent, dans tout processus pathologique à la surface du corps, l'organe interne correspondant est également inclus. Et vice versa : en cas de lésion d'un organe interne, les tissus tégumentaires correspondant à un certain segment participent également au processus, dont l'élimination des changements pathologiques est nécessaire pour augmenter l'efficacité du traitement.
Le système musculaire est très réactif et répond à tout stimuli externe et interne principalement par des tensions, suivies de changements dans le tonus de l'appareil ligamentaire, des fascias et de la peau. La correction de ces changements pathologiques est réalisée à l'aide d'exercices physiques et de massages. Le choix de la technique de massage, des types d’exercices physiques et de l’intensité de l’exercice dépend de l’état fonctionnel du patient, des changements pathologiques morphologiques et physiologiques caractéristiques d’une maladie donnée, ainsi que des processus biochimiques dans le corps qui se produisent lors de l’entraînement physique.
Il est d'usage de distinguer les systèmes physiologiques suivants de l'organisme : squelettique (squelette humain), musculaire, circulatoire, respiratoire, digestif, nerveux, système sanguin, glandes endocrines, analyseurs, etc.
Le sang comme physiologique Le sang est un tissu liquide qui circule dans le système, un tissu liquide dans le système circulatoire et assure l'activité vitale des cellules et des tissus du corps en tant qu'organe et système physiologique. Il est constitué de plasma (55 à 60 %) et d'éléments formés en suspension : globules rouges, leucocytes, plaquettes et autres substances (40 à 45 %) (Fig. 2.8) ; a une réaction légèrement alcaline (pH 7,36).
Les érythrocytes sont des globules rouges, ayant la forme d'une plaque concave ronde d'un diamètre de 8 et d'une épaisseur de 2-3 microns, remplie d'une protéine spéciale - l'hémoglobine, capable de former un composé avec l'oxygène (oxyhémoglobine) et de transporter des poumons aux tissus, et en le transférant des tissus au dioxyde de carbone vers les poumons, assurant ainsi la fonction respiratoire. La durée de vie d'un érythrocyte dans le corps est de 100 à 120 jours. La moelle osseuse rouge produit jusqu'à 300 milliards de jeunes globules rouges et les libère chaque jour dans le sang. 1 ml de sang humain contient normalement 4,5 à 5 millions de globules rouges. Pour les personnes activement impliquées dans une activité physique, ce nombre peut augmenter considérablement (6 millions ou plus). Les leucocytes sont des globules blancs qui remplissent une fonction protectrice en détruisant les corps étrangers et les agents pathogènes (phagocytose). 1 ml de sang contient 6 à 8 000 leucocytes. Les plaquettes (et il y en a de 100 à 300 000 dans 1 ml) jouent un rôle important dans le processus complexe de coagulation sanguine. Le plasma sanguin dissout les hormones, les sels minéraux, les nutriments et autres substances dont il alimente les tissus, et contient également des produits de dégradation éliminés des tissus.
Riz. 2.8.
Constantes de base du sang humain
Quantité de sang............................ 7% du poids corporel
Eau........................ 90-91%
Densité........................ 1,056-1,060 g/cm3
Viscosité............... 4--5 arb. unités (par rapport à l'eau)
pH....................................... 7,35-7,45
Protéines totales (albumine, globulines, fibrinogène). . . 65--85 g/l
Na* ...................... 1,8-2,2 g/l"
K* ...................... 1,5-2,2 g/l
Ca*........................ 0,04-0,08 g/l
Pression osmotique........ 7,6-8,1 atm (768,2-818,7 kPa)
Pression oncotique..... 25--30 mm Hg. Art. (3,325--3,99 kPa)
Indice de dépression........................ -0,56 "C
Le plasma sanguin contient également des anticorps qui créent une immunité (immunité) du corps contre les substances toxiques d'origine infectieuse ou autre, les micro-organismes et les virus. Le plasma sanguin participe au transport du dioxyde de carbone vers les poumons.
La constance de la composition sanguine est maintenue à la fois par les mécanismes chimiques du sang lui-même et par des mécanismes de régulation spéciaux du système nerveux.
Lorsque le sang circule dans les capillaires qui pénètrent dans tous les tissus, une partie du plasma sanguin s'écoule constamment à travers leurs parois dans l'espace interstitiel, qui forme le liquide interstitiel entourant toutes les cellules du corps. À partir de ce liquide, les cellules absorbent les nutriments et l'oxygène et y libèrent du dioxyde de carbone et d'autres produits de dégradation formés au cours du processus métabolique. Ainsi, le sang libère en permanence les nutriments utilisés par les cellules dans le liquide interstitiel et absorbe les substances sécrétées par celles-ci. Les plus petits vaisseaux lymphatiques se trouvent également ici. Certaines substances du liquide interstitiel s'y infiltrent et forment de la lymphe, qui remplit les fonctions suivantes : renvoie les protéines de l'espace interstitiel vers le sang, participe à la redistribution des liquides dans l'organisme, délivre les graisses aux cellules des tissus, maintient le cours normal de les processus métaboliques dans les tissus, détruit et élimine les micro-organismes pathogènes du corps. La lymphe retourne par les vaisseaux lymphatiques vers le sang, vers la partie veineuse du système vasculaire.
La quantité totale de sang représente 7 à 8 % du poids corporel d’une personne. Au repos, 40 à 50 % du sang est exclu de la circulation et se retrouve dans des « dépôts sanguins » : le foie, la rate, les vaisseaux sanguins de la peau, les muscles et les poumons. Si nécessaire (par exemple lors d'un travail musculaire), le volume de sang de réserve est inclus dans la circulation sanguine et dirigé par réflexe vers l'organe de travail. La libération du sang du « dépôt » et sa redistribution dans tout le corps sont régulées par le système nerveux central.
La perte de plus d'un tiers de la quantité de sang d'une personne met sa vie en danger. Dans le même temps, réduire la quantité de sang de 200 à 400 ml (don) est inoffensif pour les personnes en bonne santé et stimule même les processus d'hématopoïèse. Il existe quatre groupes sanguins (I, II, III, IV).Pour sauver la vie de personnes ayant perdu beaucoup de sang ou pour certaines maladies, des transfusions sanguines sont pratiquées en tenant compte du groupe. Chaque personne devrait connaître son groupe sanguin.
Le système cardiovasculaire. Le système circulatoire est constitué du cœur et des vaisseaux sanguins. Le cœur, organe principal du système circulatoire, est un organe musculaire creux qui effectue des contractions rythmiques, grâce auxquelles le processus de circulation sanguine se produit dans le corps. Le cœur est un appareil autonome et automatique. Cependant, son travail est ajusté par de nombreuses connexions directes et rétroactives provenant de divers organes et systèmes du corps. Le cœur est relié au système nerveux central, ce qui a un effet régulateur sur son fonctionnement.
Le système cardiovasculaire comprend la circulation systémique et pulmonaire (Fig. 2.9). La moitié gauche du cœur dessert un grand cercle

Riz. 2.9.
1 - aorte, 2 - artère hépatique, J ? - artère du tube digestif, 4 - capillaires intestinaux, 4" - capillaires des organes du corps ; 5 - veine porte du foie ; b - veine hépatique ; 7 - veine cave inférieure ; 8 - veine cave supérieure ; 9 - oreillette droite ; 10 - ventricule droit; 11 - artère pulmonaire commune; 12 - capillaires pulmonaires; 13 - veines pulmonaires; 14 - oreillette gauche; 15 - ventricule gauche; 16 - vaisseaux lymphatiques
circulation sanguine, à droite - petite. La circulation systémique part du ventricule gauche du cœur, traverse les tissus de tous les organes et retourne à l'oreillette droite. De l'oreillette droite, le sang passe dans le ventricule droit, d'où commence la circulation pulmonaire, qui traverse les poumons, où le sang veineux, dégageant du dioxyde de carbone et étant saturé d'oxygène, se transforme en sang artériel et est envoyé vers la gauche. atrium. De l'oreillette gauche, le sang circule dans le ventricule gauche et de là dans la circulation systémique.
L'activité du cœur consiste en un changement rythmique des cycles cardiaques, composé de trois phases : contraction des oreillettes, contraction des ventricules et relaxation générale du cœur.
Le pouls est une onde d'oscillations propagée le long des parois élastiques des artères suite au choc hydrodynamique d'une partie du sang éjecté dans l'aorte sous haute pression lors de la contraction du ventricule gauche. La fréquence du pouls correspond à la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque au repos (le matin, couché, à jeun) est plus faible du fait de l'augmentation de la puissance de chaque contraction. Une diminution de la fréquence cardiaque augmente le temps de pause absolu nécessaire au repos du cœur et aux processus de récupération dans le muscle cardiaque. Au repos, le pouls d'une personne en bonne santé est de 60 à 70 battements/min.

Figure 2.10.
1 - cavité nasale, 2 - cavité buccale, 3 - larynx, 4 - trachée, 5 - œsophage.
La pression artérielle est créée par la force de contraction des ventricules du cœur et l’élasticité des parois des vaisseaux sanguins. Elle est mesurée dans l'artère brachiale. On distingue la pression maximale (ou systolique), qui est créée lors de la contraction du ventricule gauche (systole), et la pression minimale (ou diastolique), qui est observée lors de la relaxation du ventricule gauche (diastole). La pression est maintenue grâce à l'élasticité des parois de l'aorte distendue et d'autres grosses artères. Normalement, une personne en bonne santé âgée de 18 à 40 ans au repos a une tension artérielle de 120/70 mmHg. Art. (pression systolique de 120 mm, diastolique de 70 mm). La pression artérielle la plus élevée est observée dans l'aorte.
À mesure que vous vous éloignez du cœur, votre tension artérielle diminue de plus en plus. La pression la plus basse est observée dans les veines lorsqu'elles se jettent dans l'oreillette droite. Une différence de pression constante assure un flux sanguin continu dans les vaisseaux sanguins (dans le sens de la basse pression).
Système respiratoire Le système respiratoire comprend la cavité nasale, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. Au cours du processus de respiration, l'oxygène provenant de l'air atmosphérique pénètre constamment dans le corps par les alvéoles des poumons et le dioxyde de carbone est libéré du corps (Fig. 2.10 et 2.11).
La trachée dans sa partie inférieure est divisée en deux bronches dont chacune, entrant dans les poumons, se ramifie comme un arbre. Les dernières plus petites branches des bronches (bronchioles) passent dans des années alvéolaires fermées, dans les parois desquelles se trouvent un grand nombre de formations sphériques - des vésicules pulmonaires (alvéoles). Chaque alvéole est entourée d'un réseau dense de capillaires. La surface totale de toutes les vésicules pulmonaires est très grande, elle est 50 fois supérieure à la surface de la peau humaine et s'élève à plus de 100 m2.

Riz. 2.11.
1 - larynx, 2 - trachée, 3 - bronches, 4 alvéoles, 5 - poumons
Les poumons sont situés dans une cavité thoracique hermétiquement fermée. Ils sont recouverts d’une membrane fine et lisse – la plèvre ; la même membrane tapisse l’intérieur de la cavité thoracique. L'espace formé entre ces feuilles de plèvre est appelé cavité pleurale. La pression dans la cavité pleurale est toujours inférieure de 3 à 4 mm Hg à la pression atmosphérique pendant l'expiration. Art., lors de l'inhalation - de 7 à 9.
Le processus respiratoire est un ensemble de processus physiologiques et biochimiques, dans la mise en œuvre desquels non seulement l'appareil respiratoire, mais également le système circulatoire.
Le mécanisme respiratoire est de nature réflexe (automatique). Au repos, l'échange d'air dans les poumons se produit à la suite de mouvements respiratoires rythmiques de la poitrine. Lorsque la pression dans la cavité thoracique diminue, une partie de l'air est aspirée passivement dans les poumons dans une mesure suffisante en raison de la différence de pression - l'inhalation se produit. Ensuite, la cavité thoracique diminue et l'air est expulsé des poumons - l'expiration se produit. L'expansion de la cavité thoracique résulte de l'activité des muscles respiratoires. Au repos, lors de l'inspiration, la cavité thoracique est dilatée par un muscle respiratoire spécial - le diaphragme, ainsi que les muscles intercostaux externes ; Lors d'un travail physique intense, d'autres muscles (squelettiques) sont également activés. L'expiration au repos se fait passivement ; lorsque les muscles qui inspirent sont détendus, la poitrine diminue sous l'influence de la gravité et de la pression atmosphérique. Lors d'un travail physique intense, l'expiration implique les muscles abdominaux, les muscles intercostaux internes et d'autres muscles squelettiques. L'exercice et le sport systématiques renforcent les muscles respiratoires et contribuent à augmenter le volume et la mobilité (excursion) de la poitrine.
L'étape de la respiration au cours de laquelle l'oxygène de l'air atmosphérique passe dans le sang et le dioxyde de carbone du sang dans l'air atmosphérique est appelée respiration externe ; le transfert de gaz par le sang est l'étape suivante et, enfin, la respiration tissulaire (ou interne) - la consommation d'oxygène par les cellules et la libération de dioxyde de carbone par celles-ci à la suite de réactions biochimiques associées à la formation d'énergie pour assurer le processus vitaux du corps.
La respiration externe (pulmonaire) se produit dans les alvéoles des poumons. Ici, à travers les parois semi-perméables des alvéoles et des capillaires, l'oxygène passe de l'air alvéolaire remplissant les cavités des alvéoles. Les molécules d'oxygène et de dioxyde de carbone effectuent cette transition en centièmes de seconde. Une fois l’oxygène transféré du sang aux tissus, la respiration tissulaire (intracellulaire) se produit. L'oxygène passe du sang au liquide interstitiel et de là aux cellules des tissus, où il est utilisé pour assurer les processus métaboliques. Le dioxyde de carbone, intensément produit dans les cellules, passe dans le liquide interstitiel puis dans le sang. Grâce au sang, il est transporté vers les poumons puis éliminé de l’organisme. Le passage de l'oxygène et du dioxyde de carbone à travers les parois semi-perméables des alvéoles, des capillaires et des membranes des globules rouges par diffusion (transition) est dû à la différence de pression partielle de chacun de ces gaz. Ainsi, par exemple, à une pression atmosphérique de 760 mm Hg. Art. la pression partielle d'oxygène (p0a) y est de 159 mm Hg. Art., et dans le sang alvéolaire - 102, dans le sang artériel - 100, dans le sang veineux - 40 mm Hg. Art. Dans le tissu musculaire qui travaille, p0a peut diminuer jusqu'à zéro. En raison de la différence de pression partielle de l'oxygène, sa transition progressive se produit dans les poumons, puis à travers les parois des capillaires dans le sang et du sang vers les cellules tissulaires.
Le dioxyde de carbone des cellules tissulaires pénètre dans le sang, du sang dans les poumons, des poumons dans l'air atmosphérique, car le gradient de pression partielle du dioxyde de carbone (CO2) est dirigé dans la direction opposée par rapport à p0a (dans les cellules CO2 - 50 -60 , dans le sang - 47, dans l'air alvéolaire - 40, dans l'air atmosphérique - 0,2 mm Hg).
Système digestif et excréteur. Le système digestif comprend la bouche, les glandes salivaires, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, le foie et le pancréas. Dans ces organes, les aliments sont traités mécaniquement et chimiquement, les substances alimentaires entrant dans l'organisme sont digérées et les produits digestifs sont absorbés.
Le système excréteur est formé par les reins, les uretères et la vessie, qui assurent l'excrétion des produits métaboliques nocifs du corps avec l'urine (jusqu'à 75 %). De plus, certains produits métaboliques sont excrétés par la peau (avec les sécrétions des glandes sudoripares et sébacées), par les poumons (avec l'air expiré) et par le tractus gastro-intestinal. Avec l'aide des reins, le corps maintient l'équilibre acido-basique (pH), le volume d'eau et de sels requis et une pression osmotique stable (c'est-à-dire l'homéostasie).
Système nerveux Le système nerveux est constitué d'un w central (cerveau et moelle épinière). sections périphériques (nerfs s'étendant du cerveau et de la moelle épinière et situés à la périphérie des ganglions nerveux). Le système nerveux central coordonne les activités de divers organes et systèmes du corps et régule cette activité dans un environnement externe changeant à l'aide du mécanisme réflexe. Les processus qui se produisent dans le système nerveux central sont à la base de toute activité mentale humaine.
Sur la structure du système nerveux central. La moelle épinière se situe dans le canal rachidien formé par les arcs vertébraux. La première vertèbre cervicale est le bord supérieur de la moelle épinière et le bord inférieur est la deuxième vertèbre lombaire. La moelle épinière est divisée en cinq sections comportant un certain nombre de segments : cervical, thoracique, lombaire, sacré et coccygien. Au centre de la moelle épinière se trouve un canal rempli de liquide céphalo-rachidien. Dans une coupe transversale d’un échantillon de laboratoire, les matières grise et blanche du cerveau se distinguent facilement. La matière grise du cerveau est formée par une accumulation de corps de cellules nerveuses (neurones) dont les processus périphériques, faisant partie des nerfs spinaux, atteignent divers récepteurs dans la peau, les muscles, les tendons et les muqueuses. La substance blanche entourant la matière grise est constituée de processus qui relient les cellules nerveuses de la moelle épinière ; sensoriel ascendant (afférent), reliant tous les organes et tissus (sauf la tête) au cerveau ; voies motrices descendantes (efférentes) allant du cerveau aux cellules motrices de la moelle épinière. Ainsi, la moelle épinière remplit une fonction réflexe et conductrice de l'influx nerveux. Dans diverses parties de la moelle épinière se trouvent des motoneurones (cellules nerveuses motrices) qui innervent les muscles des membres supérieurs, du dos, de la poitrine, de l'abdomen et des membres inférieurs. Les centres de défécation, de miction et d'activité sexuelle sont situés dans la région sacrée. Une fonction importante des motoneurones est qu'ils fournissent en permanence le tonus musculaire nécessaire, grâce auquel tous les actes moteurs réflexes s'effectuent en douceur et en douceur. Le tonus des centres de la moelle épinière est régulé par les parties supérieures du système nerveux central. Les lésions de la moelle épinière entraînent divers troubles associés à une défaillance de la fonction de conduction. Toutes sortes de blessures et de maladies de la moelle épinière peuvent entraîner des troubles de la douleur et de la sensibilité à la température, une perturbation de la structure des mouvements volontaires complexes et du tonus musculaire.
Le cerveau est un ensemble d’un très grand nombre de cellules nerveuses. Il se compose de sections antérieure, intermédiaire, moyenne et postérieure. La structure du cerveau est incomparablement plus complexe que celle de n’importe quel organe du corps humain.
Le cortex cérébral est la partie la plus jeune du cerveau en termes phylogénétiques (la phylogénie est le processus de développement des organismes végétaux et animaux au cours de l'existence de la vie sur Terre). Au cours du processus d'évolution, le cortex cérébral est devenu la partie la plus élevée du système nerveux central, façonnant l'activité de l'organisme dans son ensemble dans ses relations avec l'environnement. Le cerveau est actif non seulement pendant l’éveil, mais aussi pendant le sommeil. Le tissu cérébral consomme 5 fois plus d’oxygène que le cœur et 20 fois plus que les muscles. Ne représentant qu’environ 2 % du poids corporel humain, le cerveau absorbe 18 à 25 % de l’oxygène consommé par l’ensemble du corps. Le cerveau est nettement supérieur aux autres organes en termes de consommation de glucose. Il utilise 60 à 70 % du glucose produit par le foie, même si le cerveau contient moins de sang que les autres organes. La détérioration de l'apport sanguin au cerveau peut être associée à l'inactivité physique. Dans ce cas, des maux de tête de localisation, d'intensité et de durée variables, des étourdissements, une faiblesse surviennent, les performances mentales diminuent, la mémoire se détériore et de l'irritabilité apparaît. Pour caractériser les changements dans les performances mentales, un ensemble de techniques est utilisé pour évaluer ses différentes composantes (attention, mémoire et perception, pensée logique).
Le système nerveux autonome est un département spécialisé du système nerveux, régulé par le cortex cérébral. Contrairement au système nerveux somatique, qui innerve les muscles volontaires (squelettiques) et assure la sensibilité générale du corps et d'autres organes sensoriels, le système nerveux autonome régule l'activité des organes internes - respiration, circulation sanguine, excrétion, reproduction, glandes endocrines. Le système nerveux autonome est divisé en systèmes sympathique et parasympathique (Fig. 2.12).

Riz. 2.12.
/ - mésencéphale, II - moelle allongée, III - moelle épinière cervicale, IV - moelle épinière thoracique, V - moelle épinière lombaire, VI - moelle épinière sacrée, 1 - œil, 2 - glande lacrymale, 3 - glandes salivaires, 4 - cœur , 5 - poumons, 6 - estomac, 7 - intestins, 8 - vessie, 9 - nerf vague, 10 - nerf pelvien, 11 - tronc sympathique avec ganglions narvertébraux, 12 - plexus solaire, 13 - nerf oculomoteur, 14 - nerf lacrymal, 15 - corde tympanique, 16 - nerf lingual
L'activité du cœur, des vaisseaux sanguins, des organes digestifs, des organes d'excrétion, reproducteurs et autres, la régulation du métabolisme, la thermoformation, la participation à la formation de réactions émotionnelles (peur, colère, joie) - tout cela est sous la juridiction du sympathique et système nerveux parasympathique et sous le contrôle de la partie supérieure du système nerveux central.
Récepteurs et analyseurs La capacité de l'organisme à s'adapter rapidement aux changements de l'environnement est réalisée grâce à des formations spéciales - des récepteurs qui, ayant
avec une stricte spécificité, ils transforment les stimuli externes (son, température, lumière, pression) en influx nerveux voyageant le long des fibres nerveuses jusqu'au système nerveux central. Les récepteurs humains sont divisés en deux groupes principaux : les récepteurs extéro- (externes) et intero- (internes). Chacun de ces récepteurs fait partie intégrante d'un système d'analyse appelé analyseur. L'analyseur se compose de trois sections : le récepteur, la partie conductrice et la formation centrale du cerveau.
La section la plus haute de l'analyseur est la section corticale. Listons les noms des analyseurs dont le rôle dans la vie humaine est connu de beaucoup. Il s'agit d'un analyseur cutané (tactile, sensibilité à la douleur, à la chaleur, au froid) ; moteur (les récepteurs des muscles, des articulations, des tendons et des ligaments sont excités sous l'influence de la pression et de l'étirement) ; vestibulaire (situé dans l'oreille interne et perçoit la position du corps dans l'espace) ; visuel (lumière et couleur) ; auditif (son); olfactif (odeur); gustatif (goût); viscéral (état d'un certain nombre d'organes internes).
Système endocrinien Les glandes endocrines, ou glandes endocrines (Fig. 2.13), produisent des substances biologiques spéciales - les hormones. Le terme « hormone » vient du grec « hormo » – j'encourage, j'excite. Les hormones assurent la régulation humorale (par le sang, la lymphe, le liquide interstitiel) des processus physiologiques du corps, atteignant tous les organes et tissus. Certaines hormones ne sont produites que pendant certaines périodes, alors que la plupart sont produites tout au long de la vie d’une personne. Ils peuvent inhiber ou accélérer la croissance du corps, la puberté, le développement physique et mental, réguler le métabolisme et l'énergie, ainsi que l'activité des organes internes. Les glandes endocrines comprennent : la thyroïde, la parathyroïde, le goitre, les glandes surrénales, le pancréas, l'hypophyse, les gonades et plusieurs autres.
Certaines des glandes répertoriées produisent, en plus des hormones, des substances sécrétoires (par exemple, le pancréas participe au processus de digestion, libérant des sécrétions dans le duodénum ; le produit de la sécrétion externe des gonades mâles - les testicules - est le sperme, etc. ). Ces glandes sont appelées glandes à sécrétion mixte.

Figure 2.13.
1 - glande pinéale, 2 - glande pituitaire, 3 - glande thyroïde, 4 - glande parathyroïde, 5 - glande sous-sternale, 6 - glandes surrénales, 7 - pancréas, 8 - gonades
Les hormones, en tant que substances de haute activité biologique, malgré des concentrations extrêmement faibles dans le sang, sont capables de provoquer des changements importants dans l'état de l'organisme, notamment dans la mise en œuvre du métabolisme et de l'énergie. Ils ont un effet à distance et se caractérisent par une spécificité, qui s'exprime sous deux formes : certaines hormones (par exemple, les hormones sexuelles) n'affectent que le fonctionnement de certains organes et tissus, d'autres ne contrôlent que certains changements dans la chaîne des processus métaboliques et dans l'activité des enzymes régulant ces processus. Les hormones sont détruites relativement rapidement et pour en maintenir une certaine quantité dans le sang il faut qu'elles soient inlassablement sécrétées par la glande correspondante. Presque tous les troubles de l'activité des glandes endocrines entraînent une diminution des performances globales d'une personne. La fonction des glandes endocrines est régulée par le système nerveux central ; les effets nerveux et humoraux sur divers organes, tissus et leurs fonctions sont une manifestation d'un système unifié de régulation neurohumorale des fonctions corporelles.
Les systèmes physiologiques suivants existent dans le corps humain (système squelettique, système musculaire, circulatoire, respiratoire, digestif, nerveux, sanguin, etc.).
Le sang est un tissu liquide qui circule dans le système circulatoire et assure l'activité vitale des cellules et des tissus de l'organisme en tant que système physiologique. Il est constitué d'éléments plasmatiques et enzymatiques :
érythrocytes - globules rouges remplis d'hémoglobine, capables de former un composé avec l'oxygène et de le transporter des poumons vers les tissus, et des tissus transférer le dioxyde de carbone vers les poumons, assurant ainsi la fonction respiratoire. L'espérance de vie dans le corps est de 100 à 120 jours. 1 ml de sang contient 4,5 à 5 millions de globules rouges. Pour les athlètes, il atteint 6 millions ou plus.
Les leucocytes sont des globules blancs qui remplissent une fonction protectrice en détruisant les corps oxygénés. Dans 1 ml – 6-8 mille.
Les plaquettes sont impliquées dans la coagulation du sang : dans 1 ml - de 100 à 300 000.
La constance du sang est maintenue par les mécanismes chimiques du sang lui-même et est contrôlée par les mécanismes de régulation du système nerveux central. La lymphe sanguine remplit les fonctions suivantes : renvoie les protéines de l'espace interstitiel vers le sang, délivre les graisses aux cellules des tissus, participe également au métabolisme et élimine les agents pathogènes. La quantité totale de sang représente 7 à 8 % du poids corporel, au repos 40 à 50 %.
La perte d'un tiers de son sang met la vie en danger. Il existe 4 groupes sanguins (I-II-III-IV).
Le système cardiovasculaire
Le système cardiovasculaire comprend la circulation systémique et pulmonaire. La moitié gauche du cœur sert à la circulation systémique, la moitié droite sert à la circulation pulmonaire. La circulation systémique part du ventricule gauche du cœur, traverse les tissus de tous les organes et retourne au ventricule droit. Où commence la circulation pulmonaire, qui traverse les poumons, où le sang veineux, dégageant du dioxyde de carbone et saturé d'oxygène, se transforme en sang artériel et est envoyé vers l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche, le sang circule dans le ventricule gauche et de là dans la circulation systémique. L'activité du cœur consiste en un changement rythmique des cycles cardiaques, qui se composent de trois phases : contraction de l'oreillette, des ventricules et relaxation générale.
Le pouls est une onde de vibrations lorsque le sang est libéré dans l'aorte. En moyenne, la fréquence du pouls est de 60 à 70 battements/min. Il existe 2 types de tension artérielle. Elle est mesurée dans l'artère brachiale. Maximum (systolique) et minimum (dystolique). Chez une personne en bonne santé âgée de 18 à 40 ans, le niveau de repos est de 120/70 mm Hg. Art.
Le système respiratoire comprend la cavité nasale, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. Le processus respiratoire est un ensemble de processus physiologiques et biochimiques, le système circulatoire participe également au processus respiratoire. L'étape de la respiration au cours de laquelle l'oxygène de l'air atmosphérique passe dans le sang et le dioxyde de carbone du sang dans l'air atmosphérique est appelée externe. L'étape suivante est le transfert de gaz par le sang et, enfin, la respiration tissulaire (ou interne) : la consommation d'oxygène par les cellules et la libération de dioxyde de carbone par celles-ci, suite à des réactions biochimiques liées à la formation d'énergie.
Le système digestif comprend la cavité buccale, les glandes salivaires, le pharynx, l'œsophage, le ventricule, l'intestin grêle et le gros intestin, le foie et le pancréas. Dans ces organes, les aliments sont traités mécaniquement et chimiquement, digérés et des produits digestifs se forment.
Le système excréteur est formé par les reins, les uretères et la vessie, qui assurent l'excrétion des produits métaboliques nocifs du corps avec l'urine. Les produits métaboliques sont excrétés par la peau, les poumons et le tractus gastro-intestinal. Avec l'aide des reins, l'équilibre acido-basique est maintenu, c'est-à-dire processus d'homéostasie.
Le système nerveux est constitué d'une partie centrale (cerveau et moelle épinière) et périphérique (nerfs s'étendant du cerveau et de la moelle épinière et situés à la périphérie des ganglions nerveux). Le système nerveux central régule l'activité humaine ainsi que son état mental.
La moelle épinière se situe dans la moelle épinière formée par les vertèbres. La première vertèbre cervicale constitue le bord de la partie supérieure, la deuxième partie inférieure lombaire de la moelle épinière. La moelle épinière est divisée en 5 sections : cervicale, thoracique, lombaire, sacrée, coccygienne. Il y a 2 substances dans la moelle épinière. La matière grise est formée d'un groupe de corps de cellules nerveuses (neurones) qui atteignent divers récepteurs de la peau, des tendons et des muqueuses. La matière blanche entoure la matière grise, qui relie les cellules nerveuses de la moelle épinière.
La moelle épinière remplit des fonctions de réflexe et de conduction de l'influx nerveux. Les lésions de la moelle épinière entraînent divers troubles associés à une défaillance de la fonction de conduction.
Le cerveau est constitué d’un grand nombre de cellules nerveuses. Il se compose de sections antérieure, intermédiaire, moyenne et postérieure.
Le cortex cérébral est la partie la plus élevée du système nerveux central ; le tissu cérébral consomme 5 fois plus d'oxygène que les muscles. Représente 2% du poids du corps humain.
Le système nerveux autonome est une partie spécialisée du système nerveux régulée par le cortex cérébral. Contrairement au système nerveux somatique, qui régule les muscles squelettiques, le système nerveux autonome régule la respiration, la circulation sanguine, l'excrétion, la reproduction et les glandes endocrines. Le système autonome est divisé en système sympathique, qui contrôle l'activité du cœur, des vaisseaux sanguins, des organes digestifs, etc., est impliqué dans la formation de réactions émotionnelles (peur, colère, joie), et le système nerveux parasympathique et sous le contrôle de la partie supérieure du système nerveux central. La capacité du corps à s’adapter aux conditions environnementales changeantes est réalisée par des récepteurs spéciaux. Les récepteurs sont divisés en 2 groupes : externes et internes. La section la plus haute de l'analyseur est la section corticale. Il existe les analyseurs suivants (cutanés, moteurs, vestibulaires, visuels, auditifs, gustatifs, viscéraux - organes internes). Les glandes endocrines ou glandes endocrines produisent des substances biologiques spéciales - les hormones. Les hormones assurent la régulation humorale par le sang des processus physiologiques du corps. Ils peuvent accélérer la croissance, le développement physique et mental et participer au métabolisme. Les glandes endocrines comprennent : la thyroïde, la parathyroïde, les glandes surrénales, le pancréas, l'hypophyse, les gonades et autres ; la fonction du système endocrinien est régulée par le système nerveux central.
2.4 Environnement extérieur et son impact sur l'organisme
et la vie humaine
Une personne est influencée par l'environnement tout au long de sa vie. En étudiant la diversité de ses activités, on ne peut se passer de prendre en compte l'influence de facteurs naturels (pression, humidité, rayonnement solaire - c'est-à-dire l'environnement physique), de facteurs biologiques de l'environnement végétal et animal, ainsi que de facteurs d'ordre social. environnement. Du milieu extérieur, le corps humain reçoit les substances nécessaires à ses fonctions vitales, ainsi que des irritants (utiles et nocifs). L'écologie est un domaine de connaissance et une partie de la biologie, une discipline académique et une science complexe. Par exemple, dans les grandes villes, l’environnement est très pollué. Environ 70 à 80 % des maladies humaines modernes sont le résultat de la dégradation de l’environnement.
2.5 Activité fonctionnelle humaine et relation entre l'activité physique et mentale
L'activité fonctionnelle humaine est associée à divers actes moteurs : contraction des muscles, du cœur, mouvements de la respiration, parole, expressions faciales, mastication et déglutition.
Il existe 2 principaux types de travail : physique et mental. Le travail physique est un type d’activité humaine déterminé par un ensemble de facteurs. Effectuer un travail qui implique un travail pénible. Le travail peut être léger, moyen, dur et très dur. Les critères d'évaluation du travail sont des indicateurs de la quantité de travail, du mouvement des marchandises, etc. Critères physiologiques - le niveau de consommation d'énergie, l'état fonctionnel.
Le travail mental est un moyen de créer des concepts et des jugements, des conclusions et, sur leur base, des hypothèses et des théories. Le travail mental se présente sous diverses formes. Les caractéristiques non spécifiques du travail mental comprennent : la réception et le traitement de l'information, la comparaison, le stockage dans la mémoire humaine, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Avec une intensité de travail élevée, des conséquences négatives peuvent survenir s'il n'y a pas assez de temps pour le réaliser, tout cela protège le système nerveux central. L’intelligence est l’une des caractéristiques les plus importantes de la personnalité. La condition de l’activité intellectuelle est la capacité mentale. L'intelligence comprend l'activité cognitive. La journée scolaire d’un élève est remplie d’une surcharge mentale et émotionnelle importante.
2.6 Fatigue lors du travail physique et mental. Récupération.
Toute activité musculaire vise à réaliser un certain type d'activité. Avec une augmentation de la charge physique ou mentale d'une grande quantité d'informations, une condition se développe dans le corps - la fatigue.
La fatigue est un état fonctionnel qui survient temporairement sous l'influence d'un travail positif ou intense et entraîne une diminution de son efficacité. La fatigue est associée à la fatigue. La fatigue survient lors d'une activité physique et mentale. Elle peut être aiguë, chronique, générale, locale, compensée, non compensée. Une sous-récupération systématique conduit à un surmenage et à une surtension du système nerveux. Le processus de récupération se produit après l'arrêt du travail et ramène le corps humain à son niveau d'origine (super-récupération, super-compensation). Schématiquement, cela peut être représenté comme suit :
1. Élimination des changements et des perturbations du système de régulation neurohumorale.
2. Élimination des produits de désintégration formés dans les tissus et les cellules.
3. Élimination des produits de décomposition de l'environnement interne du corps.
Il existe des phases de récupération précoce et tardive. Les moyens de récupération sont l'hygiène, la nutrition, les massages, les vitamines, ainsi qu'une activité physique positive et adéquate.
2.7 Rythmes et performances biologiques
Les rythmes biologiques sont la répétition régulière et périodique dans le temps de la nature et de l'intensité des processus vitaux d'états et d'événements individuels. Selon leurs caractéristiques, les rythmes sont divisés en cycles physiologiques - de travail associés à l'activité des systèmes individuels et écologiques et adaptatifs. Le rythme biologique peut changer en fonction de la charge effectuée (de 60 battements/min du cœur au repos à 180-200 battements/min). Des exemples d'horloges biologiques sont les « chouettes » et les « alouettes ». Dans les conditions modernes, les rythmes particuliers ont acquis une grande importance et prévalent dans une certaine mesure sur les rythmes biologiques. Les rythmes biologiques sont associés à des facteurs naturels et sociaux : changements de saisons, de jours et rotation de la Lune autour de la Terre.
2.8 Hypokinésie et inactivité physique
Hypokinésie - diminution, réduction, insuffisance, mouvement - une condition particulière du corps humain. Dans certains cas, cela conduit au développement d'une inactivité physique - une diminution du fonctionnement des systèmes du corps humain. Cela est dû dans une large mesure à l’activité professionnelle d’une personne (travail mental).
2.9 Moyens de culture physique qui assurent la résistance à la performance mentale et physique
Le principal moyen de culture physique est l'exercice physique. Il existe une classification physiologique des exercices dans laquelle toutes les activités diverses sont regroupées en groupes distincts selon leurs caractéristiques physiologiques.
Les principales qualités physiques qui garantissent un haut niveau de performance humaine sont la force, la vitesse et l'endurance. La classification physiologique des exercices physiques selon la nature des contractions musculaires peut être statique et dynamique. Statique – activité musculaire dans une position corporelle stationnaire. La dynamique est associée au mouvement d'un corps dans l'espace.
Un groupe important d'exercices physiques est réalisé dans des conditions standards (athlétisme). Non standard – arts martiaux, jeux sportifs.
Deux grands groupes d'exercices physiques associés à des mouvements standards et non standards sont divisés en cycliques (marche, course, natation, etc.) et acycliques (gymnastique, acrobatie, haltérophilie). Ce que les mouvements cycliques ont en commun, c'est qu'ils représentent tous un travail de puissance constante et variable avec des durées variables. En fonctionnement cyclique, on distingue les zones de puissance suivantes :
maximum – 20-30 secondes – 100m-200m
sous-maximal – 20-30 à 3-5 m (400-1500 m)
grand – (de 5 à 50m (1500-10000m))
modéré – (50 ou plus (10 000 m – 42 000 m))
Et les mouvements cycliques ne sont pas répétés par l'activité des mouvements et sont des exercices à caractère sportif (haltérophilie, acrobatie, etc.). Les moyens de culture physique comprennent non seulement l'exercice physique, mais aussi les forces curatives de la nature (soleil, air et eau), les facteurs d'hygiène (travail, sommeil, nutrition), les conditions sanitaires et hygiéniques.
Deuxième partie
2.10 Mécanismes physiologiques et modèles d'amélioration des systèmes corporels individuels sous l'influence
entraînement physique dirigé