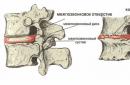Historiquement, le mot « infection » » (lat. inficio - infecter) a été introduit pour la première fois pour désigner les maladies vénériennes.
Infection- la totalité de tous les phénomènes et processus biologiques qui se produisent dans l'organisme lors de l'introduction et de la reproduction de micro-organismes, résultat de la relation entre le macro- et le micro-organisme sous forme d'adaptation et de processus pathologiques dans l'organisme, c'est-à-dire processus infectieux.
Maladie infectieuse- la forme la plus prononcée du processus infectieux.
Infection à terme ou synonyme processus infectieux, un ensemble de réactions physiologiques et pathologiques régénératives et adaptatives qui se produisent dans un macro-organisme sensible dans certaines conditions environnementales à la suite de son interaction avec des bactéries, des champignons et des virus pathogènes ou conditionnellement pathogènes qui y ont pénétré et s'y sont multipliés et sont visant à maintenir la constance de l'environnement interne du macro-organisme (homéostasie). Un processus similaire, mais provoqué par des protozoaires, des helminthes et des insectes - représentants du royaume Animalia, est appelé invasion.
Occurrence, évolution et issue du processus infectieux déterminé par trois groupes de facteurs : 1) caractéristiques quantitatives et qualitatives du microbe - l'agent causal du processus infectieux ; 2) l'état du macroorganisme, le degré de sa susceptibilité au microbe ; 3) l'action de facteurs physiques, chimiques et biologiques de l'environnement externe entourant le microbe et le macro-organisme, qui détermine la possibilité d'établir des contacts entre des représentants de différentes espèces, l'habitat commun de différentes espèces, les connexions alimentaires, la densité et la taille de la population, les caractéristiques du transfert d'informations génétiques, des caractéristiques de la migration, etc. etc. Dans ce cas, par rapport à une personne, il faut d'abord comprendre les conditions environnementales conditions sociales son activité de vie. Les deux premiers facteurs biologiques participent directement au processus infectieux qui se développe dans le macroorganisme sous l'influence d'un microbe. Dans le même temps, le microbe détermine la spécificité du processus infectieux et la contribution intégrale décisive à la forme de manifestation du processus infectieux, à sa durée, à la gravité des manifestations et à son issue est apportée par l'état du macroorganisme, principalement par le facteurs de sa résistance non spécifique, qui sont assistés par des facteurs d'immunité spécifique acquise. Le troisième facteur, environnemental, a un effet indirect sur le processus infectieux, réduisant ou augmentant la susceptibilité du macro-organisme, ou réduisant ou augmentant la dose infectieuse et la virulence de l'agent pathogène, activant les mécanismes d'infection et les voies de transmission correspondantes, etc.
Mutualisme- relations mutuellement bénéfiques (par exemple, microflore normale).
Commensalisme- un partenaire (le microbe) en profite sans causer beaucoup de tort à l’autre. Il convient de noter qu'avec tout type de relation, un micro-organisme peut manifester ses propriétés pathogènes (par exemple, des microbes commensaux opportunistes chez un hôte immunodéficient).
Pathogénicité(« donnant la maladie ») - la capacité d'un micro-organisme à provoquer une maladie. Cette propriété caractérise les espèces génétique caractéristiques des micro-organismes, leurs caractéristiques génétiquement déterminées, leur permettant de vaincre les mécanismes de défense de l’hôte et de manifester leurs propriétés pathogènes.
Virulence - phénotypique expression quantitative (individuelle) du pouvoir pathogène (génotype pathogène). La virulence peut varier et peut être déterminée par des méthodes de laboratoire (le plus souvent - DL50 - 50 % de dose mortelle - le nombre de micro-organismes pathogènes pouvant provoquer la mort de 50 % des animaux infectés).
Selon leur capacité à provoquer des maladies, les micro-organismes peuvent être divisés en pathogène, opportuniste, non pathogène. Les micro-organismes opportunistes se trouvent à la fois dans l’environnement et dans la microflore normale. Dans certaines conditions (états d'immunodéficience, blessures et opérations avec pénétration de micro-organismes dans les tissus), ils peuvent provoquer infections endogènes.
3) Facteurs de pathogénicité des micro-organismes : adhésines. Facteurs d'invasion et d'agression. Tropisme microbien. Relation entre la structure des cellules microbiennes et les facteurs de pathogénicité.
Principaux facteurs de pathogénicité des micro-organismes- adhésines, enzymes pathogènes, substances qui suppriment la phagocytose, toxines microbiennes, sous certaines conditions - capsule, motilité microbienne. La virulence est associée à toxicogénicité(la capacité de former des toxines) et caractère envahissant(la capacité de pénétrer dans les tissus de l'hôte, de se multiplier et de se propager). La toxigénicité et le caractère invasif ont un contrôle génétique indépendant et sont souvent inversement liés (un agent pathogène très toxique peut avoir un faible caractère invasif et vice versa).
Adhésines et facteurs de colonisation - le plus souvent, les structures superficielles d'une cellule bactérienne, à l'aide desquelles les bactéries reconnaissent les récepteurs sur les membranes cellulaires, s'y attachent et colonisent les tissus. La fonction d'adhésion est assurée pili, protéines de la membrane externe, LPS, acides teichoïques, hémagglutinines virales. L'adhésion est un déclencheur pour la réalisation des propriétés pathogènes des agents pathogènes.
Facteurs d'invasion, de pénétration dans les cellules et les tissus de l'hôte. Les micro-organismes peuvent se multiplier à l’extérieur des cellules, sur les membranes cellulaires et à l’intérieur des cellules. Les bactéries sécrètent des substances qui aident à surmonter les barrières de l'hôte, à pénétrer et à se reproduire. Chez les bactéries à Gram négatif, ce sont généralement des protéines de la membrane externe. Ces mêmes facteurs incluent les enzymes pathogènes.
Enzymes pathogènes- ce sont des facteurs d'agression et de protection des micro-organismes. La capacité à former des exoenzymes détermine en grande partie le caractère invasif des bactéries - la capacité à pénétrer les muqueuses, le tissu conjonctif et d'autres barrières. Ceux-ci comprennent diverses enzymes lytiques - hyaluronidase, collagénase, lécithinase, neuraminidase, coagulase, protéases. Leurs caractéristiques sont détaillées dans le cours sur la physiologie des micro-organismes.
4) Toxines bactériennes : exotoxines et endotoxines, nature et propriétés, mécanismes d'action.
Les facteurs de pathogénicité les plus importants sont pris en compte toxines, qui peut être divisé en deux grands groupes - exotoxines et endotoxines.
Exotoxines sont produits dans l'environnement externe (organisme hôte), généralement de nature protéique, peuvent présenter une activité enzymatique et peuvent être sécrétés par des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Ils ont une toxicité très élevée, sont thermiquement instables et présentent souvent des propriétés antimétabolites. Les exotoxines sont hautement immunogènes et provoquent la formation d'anticorps neutralisants spécifiques - antitoxines. Selon le mécanisme d'action et le point d'application, les exotoxines diffèrent - cytotoxines (entérotoxines et dermatonécrotoxines), toxines membranaires (hémolysines, leucocidines), bloqueurs fonctionnels (cholérogène), exfoliants et érythrogénines. Les microbes capables de produire des exotoxines sont appelés Toxigène.
Endotoxines sont libérés uniquement lorsque les bactéries meurent, sont caractéristiques des bactéries à Gram négatif et sont des composés chimiques complexes de la paroi cellulaire (LPS) - pour plus de détails, voir la conférence sur la composition chimique des bactéries. La toxicité est déterminée par le lipide A, la toxine est relativement stable à la chaleur ; les propriétés immunogènes et toxiques sont moins prononcées que celles des exotoxines.
La présence de capsules dans les bactéries complique les premières étapes des réactions protectrices - reconnaissance et absorption (phagocytose). Un facteur important du caractère invasif est la mobilité des bactéries, qui détermine la pénétration des microbes dans les cellules et dans les espaces intercellulaires.
Les facteurs de pathogénicité sont contrôlés :
Gènes chromosomiques ;
Gènes plasmidiques ;
Gènes introduits par les phages tempérés.
Il ne fait aucun doute que « infection », « processus infectieux » et « maladie infectieuse » sont d'une certaine manière associés à des microbes pathogènes et en même temps à un macro-organisme (humain, animal, etc.). On peut noter que les microbes pathogènes situés dans le milieu extérieur ne constituent pas encore une infection, car ils peuvent modifier considérablement leur métabolisme et perdre certains facteurs pathogènes (spores). La microflore du corps humain, qui ne provoque pas de processus pathologique, n'est pas non plus une infection, et des processus tout à fait mutuellement bénéfiques « commencent » souvent entre elle et le corps.
Le terme « infection » signifie « j'infecte », « je pollue » et est plus étroitement associé aux micro-organismes pathogènes qui ne sont pas en dormance ou en dehors du corps humain, mais en opposition au macro-organisme. Les micro-organismes pathogènes n’interagissent pas avec le corps humain et les deux camps, s’opposant, tentent de briser la résistance de chacun.
Ainsi, l'infection est un terme généralisé désignant des micro-organismes qui présentent leur degré inhérent de pathogénicité dans un corps humain sensible et provoquent un processus infectieux, dont la forme de manifestation la plus élevée est une maladie infectieuse.
Cela reflète l'essence du processus infectieux et de la maladie infectieuse, ainsi que les facteurs impliqués. Cela correspond pleinement au terme « source d'infection » par rapport aux patients présentant un processus infectieux évident ou latent, qui libèrent des microbes pathogènes dans l'environnement extérieur qui, par une grande variété de contacts, peuvent provoquer cette maladie chez d'autres personnes sensibles.
Il existe différentes options pour infecter les personnes avec un principe infectieux, qui est déterminé par diverses raisons :
1. Surinfection- une superposition d'infections répétées, qui peuvent à nouveau provoquer une maladie infectieuse d'étiologie identique chez une personne malade. Cette option est possible en l'absence d'immunité (gonorrhée et autres infections)
2. Réinfection- une stratification d'infections répétées, qui provoquent une maladie infectieuse d'étiologie identique chez la personne malade. L'option est similaire à la précédente.
3. Infection secondaire- superposition d'une nouvelle infection, qui amène le patient à développer une maladie d'étiologie différente dans le contexte d'une maladie infectieuse primaire.
4. Auto-infection- il s'agit de sa propre infection (anciennement microflore opportuniste, opportuniste), qui a provoqué une maladie infectieuse chez une personne affaiblie (hypothermie, carence vitaminique, maladies aiguës et chroniques, stress, etc.).
5. Infections mixtes- ce sont des polyinfections qui provoquent une maladie infectieuse polyétiologique chez une personne sensible.
6. Monoinfection– une infection d’une espèce qui provoque chez une personne sensible une maladie monoinfectieuse caractéristique de cette espèce.
Par origine, l'infection peut être exogène ou endogène.
Infection exogène- ce sont des microbes pathogènes qui ont pénétré dans un organisme sensible depuis l'environnement extérieur (sol, eau, nourriture, jouets, mains, air, médicaments, etc.), à travers de nombreux facteurs et voies d'infection.
Infection endogène- c'est la microflore du corps humain, qu'il ne remarque normalement pas, mais elle peut provoquer certaines maladies infectieuses lorsque les défenses de l'organisme sont affaiblies, la peau et les muqueuses sont endommagées, etc.
Si le nom d'une maladie ou d'un type de bactérie est ajouté au terme « infection », alors un agent infectieux plus spécifique ou un agent causal d'une maladie infectieuse ou d'un groupe de telles maladies apparaîtra, par exemple une infection intestinale, une infection typhoïde, etc. .
Le processus d'infection pénétrant dans le corps d'une personne sensible, en général, peut être décrit comme infection, c'est à dire. un processus qui combine des étapes appelées adhésion, colonisation et invasion. Si des micro-organismes pathogènes pénètrent dans des objets environnementaux et les contaminent, ce processus est alors appelé microbien. contamination ou contamination.
Le processus infectieux est un complexe de processus internes à plusieurs niveaux et multisystèmes, y compris pathologiques, se produisant dans le corps en réponse aux effets pathogènes de l'infection. L'accumulation de processus internes se transforme souvent en pathologie, qui se manifeste par des signes manifestes (externes). Cela indique l'apparition d'une maladie infectieuse. Il arrive que les processus internes, reflétant le degré de résistance de l'organisme à l'infection, ne se développent pas sous une forme manifeste, bien que la durée du processus interne puisse être importante (par exemple, persistance, etc.).
Ainsi, une maladie infectieuse est une manifestation manifeste d'un processus infectieux se produisant dans l'organisme en réponse aux effets pathogènes d'une infection, qui peuvent être d'origine exogène ou endogène.
En relation avec la maladie prédominante des personnes ou des animaux, on distingue les principaux groupes de maladies infectieuses suivants :
n anthroponotique(la plupart des gens sont malades, par exemple le choléra, la fièvre typhoïde, la gonorrhée, etc.),
n zoonotique(les animaux sont principalement malades, par exemple la peste porcine, le choléra du poulet, l'anémie infectieuse des chevaux, etc.),
n anthropozoonotique(des personnes et des animaux sont malades, par exemple tularémie, leptospirose, peste, brucellose, etc.).
Dans le même temps, ces gradations sont tout à fait arbitraires et sont générées par le niveau de connaissance de la science moderne. Par exemple, la shigellose (dysenterie) a longtemps été considérée comme une maladie anthroponotique, mais des données importantes se sont actuellement accumulées sur la shigellose chez les vaches, les porcs et d'autres animaux et oiseaux avec un tableau clinique et l'isolement de la shigelle. Certains types de virus qui affectaient auparavant les singes provoquent désormais des maladies chez l'homme (VIH, Ebola, etc.).
Infection(infectio - infection) - le processus de pénétration d'un micro-organisme dans un macro-organisme et sa reproduction dans celui-ci.
Processus infectieux– le processus d'interaction entre un micro-organisme et le corps humain.
Le processus infectieux a diverses manifestations : du portage asymptomatique à une maladie infectieuse (avec guérison ou décès).
Maladie infectieuse- Il s'agit d'une forme extrême du processus infectieux.
Une maladie infectieuse se caractérise par :
1) Disponibilité certain agent pathogène vivant ;
2) contagiosité , c'est à dire. des agents pathogènes peuvent être transmis d'une personne malade à une personne en bonne santé, ce qui entraîne une propagation généralisée de la maladie ;
3) la présence d'un certain période d'incubation Et changement séquentiel caractéristique périodes au cours de l'évolution de la maladie (incubation, prodromique, manifeste (l'apogée de la maladie), revalescence (récupération) );
4) développement symptômes cliniques caractéristiques de cette maladie ;
5) disponibilité réponse immunitaire (immunité plus ou moins durable après une maladie, développement de réactions allergiques en présence d'un agent pathogène dans l'organisme, etc.)
Les noms de maladies infectieuses sont formés à partir du nom de l'agent pathogène (espèce, genre, famille) additionné des suffixes « oz » ou « az » (salmonellose, rickettsiose, amibiase, etc.).
Développement processus infectieux dépend:
1) sur les propriétés de l'agent pathogène ;
2) sur l'état du macroorganisme ;
3) en fonction des conditions environnementales , ce qui peut affecter à la fois l'état de l'agent pathogène et l'état du macro-organisme.
Propriétés des agents pathogènes.
Les agents responsables sont des virus, des bactéries, des champignons, des protozoaires, des helminthes (leur pénétration est une invasion).
Les micro-organismes pouvant causer des maladies infectieuses sont appelés pathogène , c'est à dire. pathogène (pathos - souffrance, génos - naissance).
Il y a aussi opportuniste micro-organismes qui provoquent des maladies avec une forte diminution de l'immunité locale et générale.
Les agents de maladies infectieuses ont des propriétés pathogénicité Et virulence .
Pathogénicité et virulence.
Pathogénicité– il s’agit de la capacité des micro-organismes à pénétrer dans un macro-organisme (infectivité), à s’enraciner dans l’organisme, à se multiplier et à provoquer un complexe de changements pathologiques (perturbations) chez les organismes qui y sont sensibles (pathogénicité – capacité à provoquer un processus infectieux). La pathogénicité est un trait ou un caractère génétiquement déterminé spécifique à une espèce. trait génotypique.
Le degré de pathogénicité est déterminé par le concept virulence. La virulence est une expression quantitative ou pathogénicité. La virulence est trait phénotypique. Il s'agit d'une propriété d'une souche qui se manifeste sous certaines conditions (avec variabilité des micro-organismes, modifications de la susceptibilité du macro-organisme).
Indicateurs quantitatifs de virulence :
1) DLM(Dose letalis minima) – dose mortelle minimale– le nombre minimum de cellules microbiennes provoquant la mort de 95 % des animaux sensibles dans des conditions expérimentales spécifiques données (type d'animal, poids, âge, mode d'infection, moment du décès).
2) LD 50 – la quantité qui provoque la mort de 50 % des animaux de laboratoire.
La virulence étant un trait phénotypique, elle change sous l’influence de causes naturelles. Cela peut aussi être changer artificiellement (haut ou bas). Promotion réalisée par passages répétés dans le corps d’animaux sensibles. Rétrogradation - à la suite d'une exposition à des facteurs défavorables : a) température élevée ; b) antimicrobiens et désinfectants ; c) culture sur des milieux nutritifs défavorables ; d) défenses de l'organisme - passage d'animaux légèrement sensibles ou insensibles à travers l'organisme. Micro-organismes avec virulence affaiblie sont utilisés pour obtenir vaccins vivants.
Les micro-organismes pathogènes ont également spécificité, organotropie et toxicité.
Spécificité– capacité à provoquer certain maladie infectieuse. Vibrio cholerae provoque le choléra, Mycobacterium tuberculosis provoque la tuberculose, etc.
Organotropie– la capacité d'infecter certains organes ou tissus (l'agent causal de la dysenterie est la muqueuse du gros intestin, le virus de la grippe est la membrane muqueuse des voies respiratoires supérieures, le virus de la rage est les cellules nerveuses de la corne d'Ammon). Il existe des micro-organismes capables d’infecter n’importe quel tissu, n’importe quel organe (staphylocoques).
Toxicité– capacité à former des substances toxiques. Les propriétés toxiques et virulentes sont étroitement liées.
Facteurs de virulence.
Les caractéristiques qui déterminent la pathogénicité et la virulence sont appelées facteurs de virulence. Ceux-ci incluent certains morphologique(présence de certaines structures - capsules, paroi cellulaire), signes physiologiques et biochimiques(production d'enzymes, de métabolites, de toxines ayant un effet néfaste sur le macro-organisme), etc. Par la présence de facteurs de virulence, les micro-organismes pathogènes se distinguent des micro-organismes non pathogènes.
Les facteurs de virulence comprennent :
1) adhésines (assurer l’adhérence) – des groupes chimiques spécifiques à la surface des microbes, qui, telle une « clé de serrure », correspondent aux récepteurs des cellules sensibles et sont responsables de l'adhésion spécifique de l'agent pathogène aux cellules du macro-organisme ;
2) capsule – protection contre la phagocytose et les anticorps ; les bactéries entourées d'une capsule sont plus résistantes à l'action des forces protectrices du macroorganisme et provoquent une évolution plus sévère de l'infection (agents pathogènes du charbon, de la peste, des pneumocoques) ;
3) substances situées en surface de la capsule ou de la paroi cellulaire de diverses natures (antigènes de surface) : protéine A de staphylocoque, protéine M de streptocoque, antigène Vi des bacilles typhoïdes, lipoprotéines de bactéries gram « - » ; ils remplissent les fonctions d'immunosuppression et de facteurs de protection non spécifiques ;
4) enzymes d'agression : protéases, détruisant les anticorps ; coagulase, coagulation du plasma sanguin ; fibrinolysine, dissolvant les caillots de fibrine ; lécithinase, détruisant les membranes de lécithine ; collagénase, qui détruit le collagène ; hyaluronidase, détruisant l'acide hyaluronique de la substance intercellulaire du tissu conjonctif ; neuraminidase, détruisant l'acide neuraminique. Hyaluronidase , décomposant l'acide hyaluronique, augmente la perméabilité muqueuses et tissu conjonctif;
toxines - poisons microbiens - de puissants facteurs d’agression.
Les facteurs de virulence fournissent :
1) adhésion – fixation ou adhésion de cellules microbiennes à la surface des cellules sensibles du macro-organisme (à la surface de l'épithélium) ;
2) la colonisation – reproduction à la surface des cellules sensibles ;
3) pénétration – la capacité de certains agents pathogènes à pénétrer (pénétrer) à l'intérieur des cellules - épithéliales, leucocytes, lymphocytes (tous les virus, certains types de bactéries : Shigella, Escherichia) ; dans ce cas, les cellules meurent et l'intégrité de la couverture épithéliale peut être perturbée ;
4) invasion – la capacité de pénétrer à travers les barrières muqueuses et du tissu conjonctif dans les tissus sous-jacents (grâce à la production des enzymes hyaluronidase, neuraminidase) ;
5) agression - la capacité des agents pathogènes à supprimer les défenses non spécifiques et immunitaires de l'organisme hôte et à provoquer le développement de dommages.
Toxines.
Les toxines sont des poisons d’origine microbienne, végétale ou animale. Ils ont un poids moléculaire élevé et provoquent la formation d'anticorps.
Les toxines sont divisées en 2 groupes : les endotoxines et les exotoxines.
Exotoxinesressortir dans l'environnement pendant la vie d'un micro-organisme. Endotoxinesétroitement lié à la cellule bactérienne et ressortir dans l'environnement après la mort cellulaire.
Propriétés des endo et des exotoxines.
|
Exotoxines |
Endotoxines |
|
Lipopolysaccharides |
|
|
Thermolabile (inactivé à 58-60°C) |
Thermiquement stable (résiste à 80 - 100С) |
|
Très toxique |
Moins toxique |
|
Spécifique |
Non spécifique (action générale) |
|
Activité antigénique élevée (provoque la formation d'anticorps - antitoxines) |
Antigènes faibles |
|
Sous l'influence du formol ils se transforment en anatoxines (perte des propriétés toxiques, préservation de l'immunogénicité) |
Partiellement neutralisé par le formaldéhyde |
|
Formé principalement par des bactéries gramme «+» |
Formé principalement par des bactéries gram « - » |
Les exotoxines forment les agents responsables de ce qu'on appelle toxinémique infections, qui comprennent difthérie, tétanos, gangrène gazeuse, botulisme, certaines formes d'infections staphylococciques et streptococciques.
Certaines bactéries produisent simultanément des exo- et des endotoxines (Escherichia coli, Vibrio cholerae).
Obtention d'exotoxines.
1) cultiver une culture toxigène (formant des exotoxines) dans un milieu nutritif liquide ;
2)filtration à travers des filtres bactériens (séparation de l'exotoxine des cellules bactériennes) ; D'autres méthodes de nettoyage peuvent être utilisées.
Les exotoxines sont ensuite utilisées pour produire des anatoxines.
Obtention d'anatoxines.
1) 0,4% de formol est ajouté à la solution d'exotoxine (filtrat d'un bouillon de culture de bactéries toxigènes) et maintenu dans un thermostat à 39-40°C pendant 3-4 semaines ; il y a une perte de toxicité, mais les propriétés antigéniques et immunogènes sont préservées ;
2) ajouter un conservateur et un adjuvant.
Anatoxines Ce sont des vaccins moléculaires. Ils sont utilisés pour prévention spécifique des infections toxinémiques , et obtenir des sérums antitoxiques thérapeutiques et prophylactiques, également utilisé pour les infections toxinémiques.
Obtention d'endotoxines.
Diverses méthodes sont utilisées destruction des cellules microbiennes , puis effectuez le nettoyage, c'est-à-dire séparation de l'endotoxine des autres composants cellulaires.
Puisque les endotoxines sont des lipopolysaccharides, elles peuvent être extraites de la cellule microbienne en la détruisant avec du TCA (acide trichloroacétique), suivie d'une dialyse pour éliminer les protéines.
Établissement d'enseignement budgétaire de l'État
"ACADÉMIE MÉDICALE D'ÉTAT DE KIROV"
Ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie
DÉPARTEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES
Tête Département Docteur en Sciences Médicales, Professeur
Lignes directrices pour les étudiants
Étudiant en 1ère année à la Faculté des Expertises et Sciences Commodités
domaines de formation : « Commodity Science » sur des
travail parascolaire dans la discipline « Épidémiologie »
Sujet "Processus infectieux. Principes de classification des maladies infectieuses"
Cible: maîtriser les fondements théoriques de l’infectologie.
Tâches:
1. Considérez la doctrine du processus infectieux.
2. Étudier les classifications existantes des maladies infectieuses.
3. Enseigner un algorithme pour étayer le diagnostic d'une maladie infectieuse.
L'étudiant doit savoir :
Avant d'étudier le sujet (connaissances de base) :
Biologie générale : caractéristiques biologiques des micro-organismes.
Après avoir étudié le sujet :
Groupes d'agents pathogènes de maladies infectieuses. Classifications des maladies infectieuses. Propriétés des micro-organismes. Facteurs de protection du macroorganisme. Variantes de l'évolution d'une maladie infectieuse.
L'étudiant doit être capable de :
Appliquer la connaissance de la doctrine générale du processus infectieux lors de l'identification d'une maladie infectieuse. Connaître l'algorithme permettant de justifier le diagnostic d'une maladie infectieuse.
Devoirs pour le travail extrascolaire indépendant des étudiants sur le sujet spécifié :
2) Répondez aux questions pour la maîtrise de soi.
3) Testez vos connaissances à l'aide du contrôle de test.
4) Effectuer des tâches pratiques.
PARTIE THÉORIQUE
CLASSIFICATION DES MALADIES INFECTIEUSES, informations générales
Infection- des mots latins : infectio - pollution, infection - un concept large qui caractérise la pénétration d'un agent pathogène (virus, bactérie, etc.) dans un autre organisme végétal ou animal plus organisé et leur relation antagoniste ultérieure.
Processus infectieux- il s'agit d'une interaction complexe et limitée dans le temps entre des systèmes biologiques micro (pathogènes) et macro-organismes, se produisant dans certaines conditions environnementales, se manifestant aux niveaux submoléculaire, subcellulaire, cellulaire, tissulaire, organique et de l'organisme et se terminant naturellement par la mort du macro-organisme ou sa libération complète du pathogène.
Maladie infectieuse- il s'agit d'une forme spécifique de manifestation du processus infectieux, reflétant le degré de son développement et présentant des signes nosologiques caractéristiques.
Les maladies infectieuses constituent un grand groupe de maladies causées par des agents pathogènes.
Contrairement à d’autres maladies, les maladies infectieuses peuvent se transmettre d’une personne ou d’un animal infecté à une personne en bonne santé (contagiosité) et sont capables de se propager massivement (épidémie).
Les maladies infectieuses se caractérisent par :
- spécificité de l'agent étiologique,
- contagiosité,
- flux cyclique,
- formation de l'immunité.
Dans la structure globale des maladies humaines, les maladies infectieuses représentent 20 à 40 %.
Classement moderne
Le nombre de types d'agents pathogènes à l'origine du processus infectieux est important. Dans le même temps, les maladies infectieuses causées par une espèce micro-organismes(c'est la majorité absolue) sont appelés monoinfection, provoqué simultanément par plusieurs types, - infections mixtes ou mixtes.
En considérant les infections exogènes d'un point de vue purement épidémiologique selon un critère tel que la contagiosité, on peut distinguer les groupes de maladies infectieuses suivants :
non contagieux ou non infectieux(pseudotuberculose, botulisme, intoxication à l'entérotoxine staphylococcique, paludisme, etc.) ;
peu contagieux(mononucléose infectieuse, ornithose, HFRS, brucellose) ;
contagieux(dysenterie, grippe, fièvre typhoïde, etc.) ;
très contagieux(variole, choléra).
Les infections exogènes peuvent être classées selon le lieu d'introduction de l'agent pathogène dans l'organisme (porte d'entrée).
Le point d'entrée de certains agents pathogènes est la peau (paludisme, typhus, leishmaniose cutanée), pour d'autres - les muqueuses des voies respiratoires (grippe, rougeole, rubéole), du tube digestif (dysenterie, fièvre typhoïde) ou des organes génitaux ( gonorrhée, syphilis). Cependant, dans certaines maladies infectieuses, l'agent pathogène peut pénétrer dans l'organisme de diverses manières, ce qui affecte également le tableau clinique (diphtérie : oropharynx et plaies ; peste : formes cutanées buboniques et pneumoniques ; tularémie : bubonique, oculobubonique, angineuse bubonique, intestinale, pulmonaire et formes généralisées).
A proximité de cette classification se trouve la systématisation des infections selon des principes cliniques et anatomiques, se divisant en infections du syndrome général et local :
infections généralisées;
infections à localisation prédominante processus dans certains organes et systèmes, mais avec des réactions générales prononcées ;
local (d'actualité) infections sans réaction générale prononcée.
Une autre option pour cette classification est la division des infections en fonction du tropisme (affinité) de l'agent pathogène pour certains systèmes, tissus et même cellules. Par exemple, l'agent causal de la grippe est principalement lié à l'épithélium des voies respiratoires, les oreillons - au tissu glandulaire, la rage - aux cellules nerveuses de la corne d'ammon, la variole - aux cellules d'origine ectodermique (peau et muqueuses), la dysenterie. - aux entérocytes, au typhus - aux cellules endothéliales, etc.
Sur la base de principes biologiques, les infections peuvent être divisées en
anthroponoses (poliomyélite, infection méningococcique, hépatite virale, etc.),
les zoonoses (rage, brucellose, leptospirose, charbon, tularémie, fièvre aphteuse, etc.),
sapronoses (légionellose).
infections focales naturelles (encéphalite à tiques, HFRS)
invasions (maladies à protozoaires - paludisme, amibiase, leishmaniose, etc. ; helminthiases).
Cliniquement, les maladies infectieuses sont caractérisées par des manifestations (manifestes et inapparentes), par gravité (légère, modérée, sévère et extrêmement sévère), par des formes cliniques (par exemple, une infection méningococcique peut se manifester sous forme de rhinopharyngite, méningite, méningoencéphalite, méningococcémie ), par cours ( typique et atypique ; cyclique et acyclique ; fulminant ou fulminant, aigu, subaigu ou prolongé et chronique).
Une forme unique d’interaction entre les virus et le corps humain est une infection lente. Cela diffère en ce que malgré le développement du processus pathologique, en règle générale, dans un organe ou dans un système tissulaire (généralement le système nerveux), il existe une période d'incubation de plusieurs mois, voire de plusieurs années, après quoi les symptômes du la maladie se développe lentement mais régulièrement, se terminant toujours par la mort [, 1988]. À lent Les infections humaines comprennent actuellement des maladies causées par des prions (protéines infectieuses exemptes d'acide nucléique) - maladie de Kuru, maladie de Creutzfeldt-Jakob, syndrome de Gerstmann-Schreusler, leucospongiose amyotrophique, ainsi que par des virions - panencéphalite sclérosante subaiguë de la rougeole, leucoencéphalite subaiguë post-rougeoleuse, progressive rubéole congénitale, etc. Le nombre d'infections lentes découvertes par les scientifiques est en constante augmentation et dépasse actuellement les 30.
L’une des classifications les plus courantes et les plus fréquemment citées repose principalement sur le principe de la prise en compte du mécanisme de transmission de l’infection. Il prévoit la division de toutes les infections en cinq groupes : 1) intestinale ; 2) voies respiratoires ; 3) « sang » ; 4) tégument externe ; 5) avec différents mécanismes de transmission. Dans ce cas, par exemple, le groupe des infections intestinales comprend la dysenterie et les helminthiases, le botulisme et les intoxications par l'entérotoxine staphylococcique, l'amibiase, la trichenellose ; dans le groupe du « sang » (à transmission vectorielle) - paludisme, rickettsiose, tularémie. De toute évidence, une telle classification est imparfaite du point de vue d'un médecin spécialiste des maladies infectieuses, car des maladies complètement différentes en termes d'agent pathogène (virus, bactéries, protozoaires, champignons, helminthes) et de pathogénèse appartiennent à un seul groupe.
A cet égard, une classification basée sur un principe étiologique semble plus logique. Il s'agit de l'isolement des bactérioses (infections bactériennes), des intoxications par des toxines bactériennes, des maladies virales, des rickettsioses, des chlamydia, des mycoplasmoses, des maladies à protozoaires, des mycoses et des helminthiases. Dans chacun de ces groupes, les maladies peuvent être regroupées selon un principe pathogénétique, selon le mécanisme de transmission ou selon le tropisme du pathogène.
Processus infectieux- l'un des processus biologiques les plus complexes de la nature, et les maladies infectieuses sont des facteurs redoutables et destructeurs pour l'humanité, causant des dommages économiques colossaux.
Une seule maladie infectieuse - la variole - peut être considérée comme conditionnellement éliminée de la planète, car, malgré trente ans d'absence d'enregistrement officiel, le virus de la maladie persiste dans un certain nombre de laboratoires et la couche de personnes non immunisées est très important et en croissance constante.
En revanche, le nombre d’infections connues par la science augmente. Qu'il suffise de rappeler que si en 1955 il y en avait 1 062 (), il y en a actuellement plus de 1 200 [et al., 1994]. D'où l'émergence de problèmes nouveaux (SIDA, etc.) tant pour les spécialistes que pour la société dans son ensemble.
Les maladies infectieuses comprennent traditionnellement également les maladies causées non pas par un agent pathogène vivant, mais par ses produits métaboliques accumulés en dehors du macro-organisme (par exemple dans les produits alimentaires). Dans ce cas, le processus infectieux ne se développe généralement pas, mais seule une intoxication est observée. Parallèlement, la présence d'un agent étiologique, la formation d'une immunité (antitoxique) et la possibilité de développer un processus infectieux permettent de classer ces maladies comme infectieuses (botulisme, etc.).
L'agent pathogène détermine non seulement l'apparition du processus infectieux, mais également sa spécificité.
Ainsi, l'agent causal de la peste provoque la peste, le choléra - le choléra, etc. Il est intéressant de noter que, puisque les maladies infectieuses sont devenues connues de l'humanité plus tôt que les micro-organismes qui les provoquent, leur agent causal a généralement reçu un nom correspondant à la maladie. .
Mais la spécificité n’est pas absolue.
Une maladie infectieuse peut être causée par différents agents pathogènes (septicémie) et, à l'inverse, un agent pathogène (streptocoque) peut provoquer différentes maladies (scarlatine, érysipèle, amygdalite).
Tout au long de sa vie, une personne entre en contact avec un vaste monde de micro-organismes, mais seule une partie infime de ce monde (environ 1/30 000) est capable de provoquer un processus infectieux. Cette capacité est largement déterminée par le pouvoir pathogène de l’agent pathogène.
Pathogénicité (pathogénicité)- une espèce caractéristique d'un micro-organisme, fixée génétiquement et caractérisant la capacité à provoquer une maladie. Sur cette base, les micro-organismes sont divisés en superpathogènes, pathogènes, opportunistes et non pathogènes (saprophytes).
Les principaux facteurs déterminant la pathogénicité sont
-virulence, toxigénicité, caractère invasif.
Virulence- il s'agit du degré de pathogénicité inhérent à une souche particulière d'un agent pathogène pathogène.
Toxicité- c'est la capacité de produire et de sécréter diverses toxines (exo- et endotoxines).
Caractère invasif(agressivité) - la capacité de pénétrer et de se propager dans les tissus et organes d'un macro-organisme.
On pense [et al., 1989] que les propriétés pathogènes sont déterminées par des gènes qui font partie d'éléments génétiques mobiles (plasmides, transposons, etc.). L’avantage de l’organisation mobile des gènes réside dans la capacité des bactéries à s’adapter rapidement aux conditions environnementales. Ce mécanisme de variabilité explique la formation de nouveaux types d'agents pathogènes de maladies infectieuses. Le gène qui détermine la synthèse du facteur de pathogénicité, lorsqu'il pénètre dans une autre bactérie, peut interagir différemment avec les facteurs de pathogénicité existants, provoquant différents degrés de virulence et, par conséquent, un changement dans le schéma du processus infectieux.
Les facteurs de pathogénicité des agents infectieux sont très divers.
Parmi eux figurent l'induction du stress, les réactions hémorragiques (lésions vasculaires), les réactions allergiques et immunopathologiques, l'auto-immunité (jusqu'à des lésions systémiques sévères), l'effet toxique direct sur les cellules et les tissus, l'immunosuppression, le développement de tumeurs, etc.
Les agents pathogènes ont également des propriétés qui empêchent l'influence sur eux des facteurs de protection du macroorganisme (présence d'une capsule, production de facteurs inhibiteurs de la phagocytose, exo- et endotoxines, localisation intracellulaire).
L'état du macroorganisme et ses propriétés déterminent non seulement la possibilité d'apparition et la nature de l'évolution du processus infectieux, mais également la probabilité que ce dernier se manifeste sous la forme d'une maladie infectieuse.
Les facteurs de protection du corps (résistance) sont divisés en
- spécifique (immunitaire) et
- non spécifique, constituant l'ensemble du complexe obtenu mécanismes héréditaires et acquis individuellement.
Le système microécologique intestinal est la partie la plus importante du système de permanence de l'organisme (représenté par plus de 400 espèces de micro-organismes, dont 98 % sont des anaérobies obligatoires). Il dispose de nombreux mécanismes qui assurent la suppression de la microflore pathogène (stimulation du péristaltisme, production de substances antibiotiques, induction de mécanismes de défense immunologiques, etc.). Un indicateur intégral des mécanismes spécifiques et non spécifiques de protection du tractus gastro-intestinal (GIT) est la résistance à la colonisation (l'état de l'épithélium, le lysozyme actif, l'acidité et l'activité enzymatique du suc gastrique, la teneur en complément, les interférons, les macrophages, les immunoglobulines). Sa diminution (dysbactériose) entraîne une incidence plus fréquente de diverses infections intestinales.
Remplit ses fonctions de protection et de barrière de la même manière cuir(son imperméabilité à la plupart des microbes, propriétés bactéricides) et des voies respiratoires (cils de l'épithélium des voies respiratoires, élimination mécanique des agents pathogènes des voies respiratoires lors de la toux, sécrétion d'immunoglobulines, etc.).
Ensuite, le processus de protection comprend les éléments suivants : facteurs d'immunité naturelle, tels que les phagocytes (micro- et macrophages), les anticorps (naturels) précédents, le lysozyme, l'interféron, etc.
Dans la plupart des cas, une réponse immunitaire acquise (cellulaire et humorale) ainsi qu'une tolérance immunologique se développent.
L'interaction d'un agent pathogène pathogène et d'un organisme sensible se produit sur une certaine période de temps et se caractérise par cyclicité, c'est-à-dire un changement naturel dans les phases de développement, une augmentation et une diminution des manifestations du processus infectieux. A cet égard, lors du développement d'une maladie infectieuse, il est d'usage de distinguer plusieurs périodes successives : incubation, initiale, pic et récupération.
Période d'incubation(du moment de l'infection jusqu'au début de la maladie), en règle générale, n'a aucune manifestation clinique, seulement dans certaines maladies (typhus, rougeole) et chez quelques patients dans les derniers jours de cette période, les symptômes les plus généraux et les plus vagues apparaissent (présages, phénomènes prodromiques), sur la base desquels, en l'absence de données épidémiologiques, il est même difficile de suspecter une maladie infectieuse.
Chaque maladie infectieuse a sa propre durée d'incubation (avec de légères variations en fonction de la virulence, de la dose de l'agent pathogène et de la réactivité de l'organisme). Elle varie de plusieurs heures (grippe, infections toxiques) à plusieurs semaines, mois (tétanos, rage, hépatite virale) voire années (infection par le VIH).
Période initiale caractérisé par un grand nombre de signes différents, qui constituent ensemble un complexe de symptômes cliniques ou clinico-laboratoires permettant d'établir un diagnostic préliminaire ou final de la maladie. Par conséquent, le diagnostic précoce des maladies infectieuses signifie le diagnostic dans la période initiale (), c'est-à-dire avant la formation d'un tableau clinique complet de la maladie avec ses manifestations typiques (par exemple, une éruption cutanée dans la fièvre typhoïde, une jaunisse dans une hépatite virale, un bubon dans tularémie).
Période haute caractérisé par des symptômes typiques d'une maladie donnée, atteignant leur gravité maximale et déterminant toute son originalité.
Période de récupération caractérisé par l'extinction des manifestations cliniques de la maladie et la restauration progressive des fonctions corporelles altérées. Durant cette période, avec certaines maladies infectieuses, des rechutes (retour de la maladie) sont possibles.
Les rechutes doivent être distinguées des exacerbations, qui ne se développent pas après la maladie, mais dans le contexte de symptômes cliniques persistants. Une maladie répétée qui se développe à la suite d’une nouvelle infection par le même agent pathogène est appelée réinfection.
Algorithme pour étayer le diagnostic d'une maladie infectieuse :
1. Le diagnostic repose sur des preuves épidémiologiques. données, tableau clinique caractéristique de la maladie.
2. Les résultats des méthodes de recherche en laboratoire et instrumentales.
3. Méthodes de confirmation étiologique du diagnostic :
Examen microscopique
· Recherches bactériologiques, virologiques (détermination des propriétés spécifiques du pathogène).
· Infection des animaux de laboratoire
· Méthodes sérologiques (détermination des anticorps contre certains pathogènes - RA, RPGA, RSK, etc.)
2. QUESTIONS ET TÂCHES POUR LA Maîtrise de soi des étudiants :
1. Définir les notions « infection », « processus infectieux ».
2. Nommer les principales caractéristiques distinctives des maladies infectieuses des maladies thérapeutiques.
3. Comment les maladies infectieuses peuvent-elles être classées ?
Définir les notions de forme manifeste, subclinique, (inapparente), effacée, persistante (latente), infection lente, réinfection, surinfection.
5. Nommez les périodes en clinique des maladies infectieuses.
6. Définir le pouvoir pathogène, la virulence, la toxigénicité et le caractère invasif.
Énumérer les méthodes de laboratoire pour vérifier le diagnostic. Nommez l'algorithme permettant de justifier le diagnostic d'une maladie infectieuse.
3. Testez des questions de contrôle pour tester les connaissances(la bonne réponse est marquée *) :
1. LE PROCESSUS INFECTIEUX EST :
A) la propagation des maladies infectieuses chez les animaux
B) la présence d'agents pathogènes dans l'environnement
B) interaction des micro- et macro-organismes *
D) infection par des agents infectieux de vecteurs
D) la propagation des maladies parmi les personnes
2. INDIQUEZ LA DÉCLARATION INCORRECTE. LES MALADIES INFECTIEUSES SONT CARACTÉRISÉES PAR :
A) spécificité de l'agent pathogène
B) la présence d'une période d'incubation
B) contagiosité
D) formation de l'immunité
D) flux acyclique *
3. PARMI LES MALADIES SPÉCIFIÉES, LES SAPRONOSES COMPRENNENT :
A) escherichiose
B) la rage
B) hépatite virale B
D) légionellose*
D) brucellose
4. INDIQUEZ LA DÉCLARATION INCORRECTE. MALADIES DANS LESQUELLES LES PATIENTS SONT NON CONTAGIEUX POUR LES AUTRES :
A) tularémie
B) la rage
B) amibiase *
D) leptospirose
D) brucellose
5. INDIQUEZ UNE DÉCLARATION INCORRECTE. POUR LE DIAGNOSTIC DES MALADIES SUIVANTES UTILISÉES :
A) dysenterie - examen bactériologique des selles
B) hépatite virale - test sanguin immunologique
B) fièvre hémorragique avec syndrome rénal - prise de sang bactériologique*
D) tularémie - test d'allergie intradermique
D) paludisme - bactérioscopie d'un frottis sanguin
4. À l'aide d'une situation-problème comme exemple, analysez l'algorithme permettant de justifier le diagnostic d'une maladie infectieuse.
Le patient B., 30 ans, a été admis au service des maladies infectieuses au 7ème jour de maladie. La maladie a commencé de manière aiguë lorsque, après un frisson, la température corporelle a atteint 38,5 ° C, des maux de tête et des maux de gorge sont apparus. Elle a été observée par un thérapeute local ; le traitement prescrit pour les infections respiratoires aiguës n'a apporté aucune amélioration. Au 7ème jour de la maladie, le patient a remarqué un ictère dans la sclère ; L'urine s'est assombrie et les selles sont devenues plus claires. Avec l’apparition de la jaunisse, la température corporelle est revenue à la normale et ma santé s’est quelque peu améliorée. Cependant, la faiblesse persistait, l'appétit diminuait, des nausées et une lourdeur au niveau du foie apparaissaient.
D'après l'anamnèse : le mari a souffert d'une hépatite virale il y a 4 semaines ; rapports sexuels non protégés et interventions parentérales au cours des 6 derniers mois. nie.
Objectivement : l'état est de gravité modérée. Le jaunissement de la sclère et de la peau est déterminé. La langue est humide et recouverte d'une couche blanchâtre. L'abdomen est mou, douloureux dans l'hypocondre droit. Le foie est à +3 cm du dessous du bord de la côte le long de la ligne médio-claviculaire droite, le bord est élastique et sensible. L'urine est foncée, la diurèse est banale. La chaise est légère.
Test sanguin général : Hb - 120 g/l, euh. - 4,0x1012/l, CP - 0,9, tromx109/l, lei. - 3,6x109/l, tombé. - 1%, séparé. - 39%, éoz. - 2%, limite. - 41%, lun. - 17%, VS - 1 mm/h.
Test sanguin biochimique : total. bilirubine 93 µmol/l (direct 63 µmol/l, indirect 30 µmol/l), ALT 1015 U/l, AST 734 U/l, test thymol 21 U S-H, PI 66 %, total. protéines 65 g/l, albumine 45 %, globulines 55 %, phosphatase alcaline 371 unités/l, GGTP 92 unités/l.
ELISA : IgM anti-VHA (+).
Diagnostic clinique« Hépatite A aiguë, forme ictérique, de sévérité modérée. »
Raisonnement. Le diagnostic a été posé sur la base :
Anamnèse (contact domestique avec le mari 4 semaines avant le début de la maladie), cliniques (apparition aiguë, court - moins d'une semaine - prodrome grippal, amélioration du bien-être avec apparition d'un ictère), syndromes : intoxication hépatique , ictère, douleur, hépatomégalie, données de laboratoire : taux élevés de syndrome de cytolyse, inflammation mésenchymateuse, hépatodépression, cholestase intrahépatique, résultats d'une méthode de recherche (sérologique) spécifique - des IgM anti-VHA ont été détectées en ELISA.
LITTÉRATURE:
Principal:
1., Maladies de Danilkin et épidémiologie : Manuel. - M. : GEOTAR-MED, 2009. - 816 p.
2. Yushchuk N.D., Maladie de Vengerov - M : GEOTAR. – 2011. – 724 p.
Supplémentaire:
3. Guide de formation pratique en épidémiologie des maladies infectieuses / Ed. , . – M. : GEOTAR-Média, 2007. – 768 p.
Sites Internet:
2.www. consilium
3.www. médecin. suis. *****
Des lignes directrices ont été préparées par :
Professeur agrégé du Département des maladies infectieuses, Ph.D.
Les instructions méthodologiques ont été approuvées lors d'une réunion du département
N° de " " 20
Tête Département des maladies infectieuses
L'infection est la pénétration et la reproduction d'un micro-organisme pathogène (bactérie, virus, protozoaire, champignon) dans un macro-organisme (plante, champignon, animal, humain) sensible à ce type de micro-organisme. Un micro-organisme capable d’infecter est appelé agent infectieux ou pathogène.
L'infection est avant tout une forme d'interaction entre un microbe et l'organisme affecté. Ce processus s'étend dans le temps et ne se produit que dans certaines conditions environnementales. Afin de souligner l’étendue temporelle de l’infection, le terme « processus infectieux » est utilisé.
Maladies infectieuses : quelles sont ces maladies et en quoi diffèrent-elles des maladies non infectieuses
Dans des conditions environnementales favorables, le processus infectieux acquiert un degré extrême de manifestation, au cours duquel certains symptômes cliniques apparaissent. Ce degré de manifestation est appelé maladie infectieuse. Les pathologies infectieuses diffèrent des pathologies non infectieuses des manières suivantes :
- La cause de l'infection est un micro-organisme vivant. Le micro-organisme qui provoque une maladie particulière est appelé l’agent causal de cette maladie ;
- Les infections peuvent être transmises d'un organisme affecté à un organisme sain - cette propriété des infections est appelée contagiosité ;
- Les infections ont une période de latence (cachée) - cela signifie qu'elles n'apparaissent pas immédiatement après l'entrée de l'agent pathogène dans le corps ;
- Les pathologies infectieuses provoquent des changements immunologiques - elles stimulent une réponse immunitaire, accompagnée d'une modification du nombre de cellules immunitaires et d'anticorps, et deviennent également la cause d'allergies infectieuses.
Riz. 1. Assistants du célèbre microbiologiste Paul Ehrlich avec des animaux de laboratoire. A l’aube du développement de la microbiologie, un grand nombre d’espèces animales étaient conservées dans des vivariums de laboratoire. De nos jours, ils se limitent souvent aux rongeurs.
Facteurs de maladies infectieuses
Ainsi, pour qu’une maladie infectieuse survienne, trois facteurs sont nécessaires :
- Microorganisme pathogène ;
- L'organisme hôte y est sensible ;
- La présence de conditions environnementales dans lesquelles l'interaction entre l'agent pathogène et l'hôte conduit à l'apparition de la maladie.
Les maladies infectieuses peuvent être causées par des micro-organismes opportunistes, qui sont le plus souvent des représentants de la microflore normale et ne provoquent des maladies que lorsque les défenses immunitaires sont réduites.

Riz. 2. Candida fait partie de la microflore normale de la cavité buccale ; ils ne provoquent des maladies que dans certaines conditions.
Mais les microbes pathogènes, lorsqu'ils sont présents dans le corps, ne peuvent pas provoquer de maladie - dans ce cas, ils parlent de portage d'un micro-organisme pathogène. De plus, les animaux de laboratoire ne sont pas toujours sensibles aux infections humaines.
Pour qu'un processus infectieux se produise, un nombre suffisant de micro-organismes pénétrant dans l'organisme, appelé dose infectieuse, est également important. La susceptibilité de l'organisme hôte est déterminée par son espèce biologique, son sexe, son hérédité, son âge, sa suffisance nutritionnelle et, surtout, l'état du système immunitaire et la présence de maladies concomitantes.

Riz. 3. Le plasmodium du paludisme ne peut se propager que dans les zones où vivent ses porteurs spécifiques, les moustiques du genre Anopheles.
Les conditions environnementales sont également importantes, dans lesquelles le développement du processus infectieux est facilité autant que possible. Certaines maladies sont caractérisées par un caractère saisonnier, certains micro-organismes ne peuvent exister que dans un certain climat et certains nécessitent des vecteurs. Récemment, les conditions de l'environnement social sont venues au premier plan : la situation économique, les conditions de vie et de travail, le niveau de développement des soins de santé dans l'État, les caractéristiques religieuses.
Processus infectieux en dynamique
Le développement de l'infection commence avec la période d'incubation. Pendant cette période, il n'y a aucune manifestation de la présence d'un agent infectieux dans le corps, mais l'infection s'est déjà produite. Pendant ce temps, l’agent pathogène se multiplie jusqu’à un certain nombre ou libère une quantité seuil de toxine. La durée de cette période dépend du type d'agent pathogène.
Par exemple, dans le cas de l'entérite à staphylocoques (une maladie qui survient lors de la consommation d'aliments contaminés et se caractérise par une intoxication grave et une diarrhée), la période d'incubation dure de 1 à 6 heures et, dans le cas de la lèpre, elle peut durer des décennies.

Riz. 4. La période d’incubation de la lèpre peut durer des années.
Dans la plupart des cas, cela dure 2 à 4 semaines. Le plus souvent, le pic d’infectiosité survient à la fin de la période d’incubation.
La période prodromique est une période de précurseurs de la maladie - symptômes vagues et non spécifiques, tels que maux de tête, faiblesse, vertiges, modifications de l'appétit, fièvre. Cette période dure 1 à 2 jours.

Riz. 5. Le paludisme se caractérise par de la fièvre, qui possède des propriétés particulières dans différentes formes de la maladie. En fonction de la forme de la fièvre, on peut présumer du type de plasmodium qui l'a provoquée.
Le prodrome est suivi d'une période au plus fort de la maladie, caractérisée par l'apparition des principaux symptômes cliniques de la maladie. Il peut se développer soit rapidement (on parle alors d'apparition aiguë), soit lentement, lentement. Sa durée varie en fonction de l'état de l'organisme et des capacités de l'agent pathogène.

Riz. 6. Typhoïde Mary, qui travaillait comme cuisinière, était porteuse saine du bacille de la fièvre typhoïde. Elle a infecté plus d’un demi-millier de personnes atteintes de fièvre typhoïde.
De nombreuses infections se caractérisent par une augmentation de la température au cours de cette période, associée à la pénétration dans le sang de substances dites pyrogènes - substances d'origine microbienne ou tissulaire qui provoquent de la fièvre. Parfois, une augmentation de la température est associée à la circulation de l'agent pathogène lui-même dans la circulation sanguine - cette condition est appelée bactériémie. Si en même temps les microbes se multiplient également, on parle de septicémie ou de sepsis.

Riz. 7. Virus de la fièvre jaune.
La fin du processus infectieux s’appelle le résultat. Les options de résultats suivantes existent :
- Récupération;
- Résultat mortel (décès);
- Transition vers une forme chronique ;
- Rechute (réapparition due à un nettoyage incomplet de l'agent pathogène du corps) ;
- Transition vers un portage microbien sain (une personne, sans le savoir, est porteuse de microbes pathogènes et peut dans de nombreux cas en infecter d'autres).

Riz. 8. Les Pneumocystis sont des champignons qui constituent la principale cause de pneumonie chez les personnes immunodéprimées.
Classification des infections

Riz. 9. La candidose buccale est l’infection endogène la plus courante.
Par la nature de l'agent pathogène, on distingue les infections bactériennes, fongiques, virales et protozoaires (causées par les protozoaires). En fonction du nombre de types d'agents pathogènes, on les distingue :
- Monoinfections – causées par un type d’agent pathogène ;
- Infections mixtes ou mixtes - causées par plusieurs types d'agents pathogènes ;
- Secondaire – survenant dans le contexte d’une maladie préexistante. Un cas particulier est celui des infections opportunistes causées par des micro-organismes opportunistes dans le contexte de maladies accompagnées d'immunodéficiences.
Par origine on distingue :
- Infections exogènes, dans lesquelles l'agent pathogène pénètre de l'extérieur ;
- Infections endogènes causées par des microbes présents dans le corps avant le début de la maladie ;
- Les auto-infections sont des infections dans lesquelles l'auto-infection se produit en transférant des agents pathogènes d'un endroit à un autre (par exemple, une candidose buccale causée par l'introduction d'un champignon du vagin avec des mains sales).
Selon la source de l'infection, il y a :
- Anthroponoses (source – humains) ;
- Zoonoses (source : animaux) ;
- Anthropozoonoses (la source peut être à la fois humaine et animale) ;
- Sapronoses (source - objets environnementaux).
En fonction de l'emplacement de l'agent pathogène dans le corps, on distingue les infections locales (locales) et générales (généralisées). Selon la durée du processus infectieux, on distingue les infections aiguës et chroniques.

Riz. 10. Lèpre à Mycobacterium. La lèpre est une anthroponose typique.
Pathogenèse des infections : schéma général de développement du processus infectieux
La pathogenèse est le mécanisme de développement de la pathologie. La pathogenèse des infections commence par la pénétration de l'agent pathogène par la porte d'entrée - les muqueuses, le tégument endommagé, à travers le placenta. Le microbe se propage ensuite dans tout l'organisme de diverses manières : par le sang - par voie hématogène, par la lymphe - par voie lymphogène, le long des nerfs - par voie périneurale, dans le sens de la longueur - en détruisant les tissus sous-jacents, par des voies physiologiques - par exemple le système digestif ou appareil génital. La localisation finale de l'agent pathogène dépend de son type et de son affinité pour un type particulier de tissu.
Ayant atteint le site de localisation finale, l'agent pathogène exerce un effet pathogène, endommageant diverses structures mécaniquement, avec des déchets ou en libérant des toxines. L'isolement de l'agent pathogène du corps peut se produire avec des sécrétions naturelles - selles, urine, crachats, écoulements purulents, parfois avec de la salive, de la sueur, du lait, des larmes.
Processus épidémique
Un processus épidémique est le processus de propagation des infections parmi la population. Les maillons de la chaîne épidémique comprennent :
- Source ou réservoir d'infection ;
- Voie de transmission ;
- Population réceptive.

Riz. 11. Virus Ebola.
Un réservoir diffère d'une source d'infection en ce que l'agent pathogène s'y accumule entre les épidémies et, dans certaines conditions, il devient une source d'infection.
Principales voies de transmission des infections :
- Fécal-oral – avec des aliments contaminés par des sécrétions infectieuses, les mains ;
- Aéroporté - dans les airs ;
- Transmissible - via un transporteur ;
- Contact – sexuel, par contact, par contact avec du sang infecté, etc. ;
- Transplacentaire - d'une mère enceinte à un enfant en passant par le placenta.

Riz. 12. Virus de la grippe H1N1.
Les facteurs de transmission sont des objets qui contribuent à la propagation de l'infection, par exemple l'eau, la nourriture, les articles ménagers.
Sur la base de la couverture d'un certain territoire par le processus infectieux, on distingue :
- Les endémies sont des infections « liées » à un territoire limité ;
- Les épidémies sont des maladies infectieuses couvrant de vastes territoires (ville, région, pays) ;
- Les pandémies sont des épidémies qui s’étendent sur plusieurs pays, voire sur plusieurs continents.
Les maladies infectieuses représentent la part du lion de toutes les maladies auxquelles l'humanité est confrontée. Ils sont particuliers en ce sens qu'au cours de ceux-ci, une personne souffre de l'activité vitale d'organismes vivants, bien que des milliers de fois plus petits que lui-même. Auparavant, ils se terminaient souvent par une issue fatale. Malgré le fait qu'aujourd'hui le développement de la médecine a permis de réduire considérablement le taux de mortalité des processus infectieux, il est nécessaire d'être vigilant et conscient des particularités de leur apparition et de leur développement.