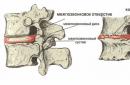1. Sigmatismes des sifflements
Caractéristiques des sons sh, zh, ch, shch et leur articulation
Pour identifier le son principal (de base) parmi les sifflements, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de chaque son et de les comparer (voir la figure au dos de la page de garde).
Tous les sons de ce groupe par lieu d'origine lingual avant, par méthode d'éducation - fendu,
à l'exception de h, lequel est occlusif-frictionnel, c'est-à-dire que lors de son articulation, la partie avant de l'arrière de la langue se ferme d'abord avec les alvéoles, puis un espace se forme entre elles.
Articulation du son et w présence de voix.
Articulation des sons sch Et h différent de l'articulation du son w soulèvement supplémentaire de la partie médiane de l'arrière de la langue jusqu'au palais.
Ainsi, pour les sifflements sh, zh, shch, ch, l'articulation principale du son sh est, ce qui signifie qu'elle sera fondamentale pour ce groupe.
Si le son sh est prononcé correctement, alors :
En ajoutant la montée de la partie médiane de l'arrière de la langue, on obtient sch;
En additionnant la montée de la partie médiane de l'arrière de la langue et l'arc devant l'espace, on obtient h.
Par conséquent, les perturbations sonores f, sch, h sont les mêmes que ceux w. Pour vous familiariser avec les principales violations des sifflements et les moyens de les corriger, tournons-nous vers le tableau 2 « Violations du son sh et leurs corrections ».
Violations du son sh et leurs corrections
I. Articulation correcte du sonw
Interdentaire.
Dents : les dents sont rapprochées, mais ne se touchent pas, la distance entre elles est de 2-3 mm ; les incisives supérieures et inférieures sont visibles.
Le bout de la langue est large, s'élève jusqu'aux alvéoles ou à la partie antérieure du palais dur et forme avec elles un espace ;
La partie antérieure de l'arrière de la langue est large, relevée jusqu'au palais derrière les alvéoles (rappelant la forme du bord avant d'une louche), mais ne la touche pas, mais forme un espace avec elles ;
La partie médiane de l'arrière de la langue est abaissée, se penche vers le bas (la dépression au milieu forme pour ainsi dire le fond d'une louche) ;
L'arrière de la langue est relevé et tiré vers l'arrière (qui rappelle le dos d'une louche) ;
Les bords latéraux sont pressés contre les molaires supérieures (qui rappellent par leur forme les bords latéraux d'une louche) et ne permettent pas au courant d'air qui s'échappe de passer à travers les côtés.
Le flux d’air est fort, large, chaud et peut être facilement ressenti lorsque le dos de votre main est porté à votre bouche.
Troubles sonores : avec une articulation correcte, un bruit semblable à un sifflement se forme ; Si les organes d'articulation sont dans une mauvaise position, le son sh est déformé ou remplacé par un autre son.
Facteurs prédisposants : divers troubles de la structure ou des mouvements des organes de l'appareil articulatoire.
Étape préparatoire. En l'absence de son w, le travail commence par la formation d'une articulation correcte du son ; sont produits:
La capacité de pousser légèrement les lèvres arrondies vers l'avant ;
Relever le large bord antérieur de la langue jusqu'aux tubercules derrière les molaires supérieures ;
Un flux d'air de longue durée coule au milieu de la langue.
Réalisation sonore. En utilisant la technique de l’imitation et en attirant en même temps l’attention de l’enfant sur la position correcte des organes de l’appareil articulatoire, ils obtiennent la prononciation correcte du son sh.
Côté.
Lèvres : L’un des coins de la bouche peut être légèrement abaissé et tiré vers l’arrière.
Dents : Il peut y avoir un léger déplacement de la mâchoire inférieure vers la droite ou la gauche.
Bout de la langue:
a) relevé et repose sur les racines des incisives supérieures ;
b) abaissé derrière les incisives inférieures ;
Dos antérieur de la langue :
a) forme une connexion avec les alvéoles ;
b) la moitié gauche (droite) forme une fermeture avec les alvéoles, la moitié droite (gauche) est omise ;
Partie médiane de l'arrière de la langue :
a) monte jusqu'au palais et forme un arc avec eux ;
b) la moitié gauche (droite) est courbée, fermée avec le palais, la moitié droite (gauche) est abaissée ;
Partie postérieure de la langue :
a) élevé ;
b) la gauche (droite) est relevée, la droite (gauche) est abaissée ;
Bords latéraux :
a) omis ;
b) le bord gauche (droit) de la langue est abaissé.
Le palais mou est relevé, pressé contre la paroi arrière du pharynx et ferme le passage dans la cavité nasale.
Jet d'air :
a) sort des deux côtés de la langue ;
b) va latéralement vers la droite (gauche)
Troubles sonores : bruit de silencieux.
Facteurs prédisposants:
Béance latérale ;
Faiblesse des muscles d'une moitié de la langue.
Étape préparatoire. Des exercices sont réalisés pour :
Renforcement des bords latéraux de la langue ;
Soulever uniformément les deux moitiés de la pointe et la partie avant de l'arrière de la langue vers le haut ;
Développement d'un courant d'air courant au milieu de la langue ;
Les sons sont pratiqués T Et Avec.
Réalisation sonore. A l'aide d'une assistance mécanique (manche plat, étroit et légèrement incurvé d'une cuillère à café), soulevez la langue large par les dents supérieures, repoussez-la jusqu'aux tubercules (les bords de la cuillère sont approximativement au niveau des quatrièmes incisives), posez l'enfant doit serrer légèrement la cuillère avec ses dents et la maintenir longtemps en prononçant le son s (les dents de devant sont visibles tout le temps).
Automatisation du son.
Différenciation sonore
Nasale.
Dents : ouvertes.
Le bout de la langue est abaissé et tiré profondément dans la bouche ;
La partie avant de l'arrière de la langue est abaissée, enfoncée profondément dans la bouche et ne forme pas d'espace avec le palais ;
La partie médiane de l’arrière de la langue est tirée vers l’arrière ;
L'arrière de la langue est relevé ; se connecte au palais mou;
Les bords latéraux sont omis.
Le palais mou est tombant.
Le flux d'air traverse la cavité nasale.
Troubles sonores : le son est remplacé par un ronflement (dans le nez) ou un son semblable à un x profond avec une teinte nasale.
Facteurs prédisposants : tension excessive sur le dos de la langue.
Étape préparatoire. Compétences développées :
Gardez une langue largement écartée sur votre lèvre supérieure ;
Diriger le flux d'air vers le bout large de la langue relevé sur la lèvre supérieure (souffler le coton du bout du nez) ;
Distinguer les sons à l'oreille w avec prononciation nasale et orale;
Les sons sont pratiqués T Et Avec.
Réalisation sonore. L'enfant se voit proposer :
La bouche ouverte, prononcez le son r longuement, sans voix, et avec le bout du manche d'une cuillère à café amené vers le frein sublingual, arrêtez la vibration de la partie avant de la langue - un sifflement se fera entendre . Après des répétitions uniques, vous pouvez provoquer un sifflement en approchant à peine la cuillère du frein hyoïde ; vous pouvez ensuite retirer la cuillère et, en rapprochant vos dents, obtenir le son correct de sh.
- s'il n'y a pas de son r, alors le son sh est fabriqué à partir du son s avec une aide mécanique.
Automatisation du son
Différenciation sonore. Avec les sigmatismes, le travail sur le son se termine par l'étape d'automatisation, puisque dans tous ces cas il n'y a pas de remplacement du phonème b par un autre phonème.
2. Parasigmatismes.
2.1.Labiodentaire.
Lèvres : occupent une position neutre.
Dents : dents inférieures non visibles, dents supérieures légèrement exposées.
Le bout de la langue est abaissé, légèrement éloigné des incisives inférieures ;
La partie avant de l'arrière de la langue est abaissée et légèrement repoussée ;
La partie médiane de l’arrière de la langue est relevée et légèrement tirée vers l’arrière ;
Le palais mou est relevé, pressé contre la paroi arrière du pharynx et ferme le passage dans la cavité nasale.
Le flux d'air est plus étroit et plus froid.
Troubles sonores : le son w est remplacé par le son f (chapeau - « fapka », voiture - « muffin », douche « duf »).
Facteurs prédisposants : prognathie, laxité de la partie antérieure de l'arrière de la langue, altération de l'audition phonémique.
Étape préparatoire. L'enfant apprend à comparer et à distinguer à l'oreille les sons sh-f, à l'aide d'images-symboles. Des exercices sont réalisés pour :
Pratiquer les mouvements de la lèvre inférieure de bas en haut,
Soulever le large bord avant de la langue vers le haut.
Réalisation sonore. Ils font le son sh par imitation, en utilisant le contrôle visuel : l'enfant regarde devant le miroir pour que la lèvre inférieure soit immobile, exposant les incisives inférieures (on peut tenir la lèvre avec un doigt placé dans la fossette en dessous). Vous pouvez également émettre le son sh from s avec une assistance mécanique, attirant l’attention de l’enfant sur la bonne position des organes de l’appareil articulatoire.
Automatisation du son. Le son délivré est introduit séquentiellement en syllabes (directes, inversées, avec une combinaison de consonnes), de mots et de phrases.
Différenciation sonore. Avec le parasigmatisme, le travail sur les sons se termine par l'étape de différenciation du son sh et du son de substitution : sh-f.
2.2. Prizubny.
Lèvres : occupent une position neutre.
Dents : légèrement ouvertes.
Le bout de la langue rencontre les alvéoles derrière les dents supérieures ;
La partie antérieure de l'arrière de la langue est fermée par les alvéoles ;
La partie médiane de l'arrière de la langue est abaissée, aucune rainure ne se forme ;
L'arrière de la langue devient plus convexe ;
Les bords latéraux sont adjacents aux molaires supérieures.
Le palais mou est relevé, pressé contre la paroi arrière du pharynx et ferme le passage dans la cavité nasale.
Le flux d’air est saccadé.
Troubles sonores : le son w est remplacé par le son t (chapeau - « pantoufle », voiture - « matina », douche - « dut »).
Facteurs prédisposants : occlusion fermée, perte auditive, déficience auditive phonémique.
Étape préparatoire.
Compétences développées :
Comparez et distinguez les sons à l'oreille à l'aide d'images-symboles,
Sur la base des sensations tactiles, distinguez les sons sh-t par le flux d'air (avec sh - longue durée, avec t - saccadé).
Des exercices sont réalisés pour développer :
Jet d'air dirigé et de longue durée ;
La position du large bord antérieur de la langue au niveau des tubercules derrière les incisives supérieures,
Le son est en cours de traitement.
Réalisation sonore. En utilisant le contrôle visuel de l'articulation correcte, ainsi que les sensations tactiles, la prononciation correcte du son sh est obtenue.
Automatisation du son. Le son délivré est introduit séquentiellement en syllabes (directes, inversées, avec une combinaison de consonnes), de mots et de phrases.
Différenciation sonore. Avec le parasigmatisme, le travail sur les sons se termine par l'étape de différenciation du son sh et du son de substitution : sh-t.
2.3. Sifflant.
Lèvres : arrondies et légèrement poussées vers l'avant.
Dents : ouvertes, les sommets des incisives sont visibles.
Le bout de la langue est abaissé, s'éloigne des incisives ou repose sur les gencives inférieures ;
La partie avant de l’arrière de la langue est tendue ;
La partie médiane de l'arrière de la langue est tendue, courbée, aucun sillon ne se forme ;
L’arrière du dos de la langue est relevé ;
Les bords latéraux sont abaissés et ne rencontrent pas les molaires.
Le palais mou est relevé, pressé contre la paroi arrière du pharynx et ferme le passage dans la cavité nasale.
Le flux d'air se propage sur toute la surface de la langue.
Troubles sonores : le son est similaire au son d'un sh doux (chapeau - "sh'apka", machine - "mash'ina", douche - "dush'").
Facteurs prédisposants : progénie, perte auditive, déficience auditive phonémique.
Étape préparatoire. L'enfant apprend à comparer et à distinguer à l'oreille les sons sh-shch à l'aide d'images-symboles. Compétences développées :
Soulevez le large bord avant de la langue jusqu'aux tubercules derrière les incisives supérieures ;
Mouvements alternés du bout large de la langue depuis la base des incisives supérieures jusqu'à l'avant du palais dur (d'avant en arrière).
Réalisation sonore. On demande à l'enfant de prononcer longuement le son s. Dans ce cas, à l’aide du manche d’une cuillère à café placée sous le devant de la langue (en travers), soulevez la langue vers le haut et reculez-la légèrement jusqu’à ce que le son sh se fasse clairement entendre.
Automatisation du son. Le son délivré est introduit séquentiellement en syllabes (directes, inversées, avec une combinaison de consonnes), de mots et de phrases.
Différenciation des sons. Avec le parasigmatisme, le travail sur les sons se termine par l'étape de différenciation du son sh et du son de substitution : sh-sch.
2.4.Sifflement.
Lèvres : tendues sans tension, comme si elles souriaient légèrement.
Dents : 1 à 2 mm plus rapprochées.
Le bout de la langue est large, se situe à la base des incisives inférieures, sans toucher leurs sommets ;
La partie antérieure de l'arrière de la langue est large, relevée, vers les alvéoles et forme avec elles au milieu un espace en forme de rainure ;
La partie médiane de l'arrière de la langue est abaissée, une rainure longitudinale est formée au milieu de celle-ci ;
L'arrière du dos de la langue est légèrement surélevé ;
Les bords latéraux s'ajustent étroitement à l'intérieur des molaires supérieures, fermant le passage du flux d'air sur les côtés.
Le palais mou est relevé, pressé contre la paroi arrière du pharynx et ferme le passage dans la cavité nasale.
Le courant d’air est étroit, froid et longe la ligne médiane de la langue.
Troubles sonores : le son w est remplacé par le son s (chapeau - « sapka », voiture - « masina », douche - « dus »).
Facteurs prédisposants : perte auditive, déficience auditive phonémique.
Étape préparatoire.
L'enfant apprend à comparer et à distinguer les sons s-sh à l'oreille, à l'aide d'images-symboles ; l'enfant est autorisé à ressentir la différence dans le flux d'air sortant lorsque l'enseignant prononce les sons s et w (avec s - un flux froid, avec w - un flux chaud).
Mouvements de pratique :
Langue large vers le haut, vers l’avant du palais dur ;
Une nette alternance de mouvements de la langue large est obtenue, d'abord pour les dents inférieures puis pour les dents supérieures ;
Mouvements alternés des lèvres : s'étirer en sourire, avancer fermées.
Réalisation sonore. En utilisant la technique de l'imitation, en faisant attention à l'articulation correcte, on obtient la prononciation correcte du son sh.
Automatisation du son. Le son délivré est introduit séquentiellement en syllabes (directes, inversées, avec une combinaison de consonnes), de mots et de phrases.
Différenciation des sons. Avec le parasigmatisme, le travail sur les sons se termine par l'étape de différenciation du son sh et du son de substitution : sh-s.
Correction des sons sh, zh, ch, shch pour divers types de violations
Absence de sons sh, zh, ch, sch
Son sh
Étape préparatoire. Lorsque vous commencez à travailler sur les sifflements, vous devez vérifier si l'enfant peut soulever le bout de la langue par les dents supérieures et s'il peut élargir la langue (l'écarter). Si ces mouvements rendent la tâche difficile à l’enfant, ils sont pratiqués.
Pour développer la capacité de garder la langue large et librement écartée, il est demandé à l'enfant de la placer sur la lèvre inférieure, puis de gifler légèrement ses lèvres, comme s'il prononçait les combinaisons sonores cinq, cinq, cinq.
Ensuite, ils développent la capacité de plier la langue large vers le haut en forme de cuillère. Pour ce faire, il est préférable de sortir légèrement votre langue large et de montrer comment son bord avant peut appuyer contre la lèvre supérieure. Si le mouvement de l’enfant échoue, l’enseignant place le manche d’une cuillère à café sous le bout de sa langue et, en la soulevant, l’appuie contre sa lèvre supérieure.
Ayant maîtrisé le mouvement, l'enfant peut le répéter la bouche grande ouverte, en déplaçant progressivement sa langue derrière ses dents supérieures. Vous devez garder votre langue suspendue dans votre bouche, sans toucher le bout de votre langue au palais.
Réalisation sonore. Une fois que l'enfant a appris à écarter sa langue et à la plier vers le haut, l'enseignant lui suggère : « Ouvrez légèrement la bouche, soulevez votre langue large sur vos dents supérieures, comme moi. Maintenant, souffle sur ta langue. Entendez-vous le bruissement du vent ? (L'air passant à travers un petit espace entre le bord avant de la langue et le palais crée un bruit ressemblant à un sifflement.)
Il arrive qu'un enfant souffle avec le son x, puis le flux se dissipe, le son s'avère flou et déformé. Dans ce cas, il faut lui dire : « Soufflez sur le bout de votre langue avec le son s ». Développer le bon son nécessite des répétitions répétées et l'utilisation d'images variées (le vent fait du bruit, une oie siffle, de l'air sort d'un ballon éclaté, etc.).
La forme ludique de l’explication combinée à la démonstration concentre rapidement l’attention de l’enfant. Petit à petit, sous la supervision du professeur, il commence à effectuer les mouvements requis (rapprocher les dents et avancer légèrement les lèvres) et prononcer correctement le son sh.
Il ne faut pas oublier que lors de l'introduction d'un son, vous ne devez jamais l'appeler un enfant, afin de ne pas l'amener à le mal prononcer habituellement.
Automatisation du son. L’enseignant dessine dans le cahier de l’enfant des objets dont les noms contiennent le son w.
Au début du mot : vilain, pardessus, pneu, épines, églantier, poinçon, chocolat, cou, manteau de fourrure, écumoire, rondelle, échecs, bâtard, shampoing, casquette, couture, armoire, casque, bateau, chapeau, dormeurs , ficelle, haltère, baïonnette ;
Au milieu : souris, voiture, galoches, portefeuille, bouillie, oreilles, sac, peluches, cruche, cible, capuche, piquet, millet, collier, oreillettes, tour, chat, cerises, cailloux, moulinet, oreiller, pétard, cône, baignoire, bâton, pistolet;
A la fin : douche, souris, louche, mascara, bébé, muguet, cabane, roseaux, galet, clés. L'enfant nomme ces mots.
Après avoir automatisé le son sh dans les mots, l'enseignant, avec l'enfant, invente des phrases et, sous sa dictée, les note dans son cahier, par exemple : Les vilaines étaient bruyantes et coquines. Un chapeau et un manteau de fourrure - c'est notre Mishutka. Natasha coud un casque. Misha marche à grands pas. Masha a des épingles à cheveux dans sa boîte.
Son
Après avoir automatisé le son sh en mots, vous pouvez mettre le son zh. Tout d'abord, l'enfant a la possibilité de ressentir la vibration des cordes vocales lorsqu'il prononce le son z. L’enseignant place le dos de sa main sur le devant de sa nuque. Ensuite, l'adulte et l'enfant prononcent le son w et ajoute une voix. D'une main, l'enfant ressent la vibration des cordes vocales de l'enseignant et de l'autre, en lui-même. Un son isolé est renforcé par des onomatopées (imitation du bourdonnement d'un scarabée, d'une abeille, d'un bourdon, etc.).
Pour l'automatisation du son g en mots, l'enseignant dessine des images dans le cahier de l'enfant, au nom desquelles il est
Au début : crapaud, dard, veste, ventre, gilet, animal, gland, scarabée, jaune, perle, gelée, jeton,
Au milieu : pyjama, mûres, flaque d'eau, manchette, couteaux, sols, flaques d'eau, serpents, aubergine, poignard, pelouse, scie à métaux, veste, flocon de neige, botte, drapeau, hérisson, pluie, vêtements, ciseaux, perce-neige.
Les mots se terminant par z ne sont pas pris, car dans cette position ils sont assourdis et sonnent comme sh.
Avec les mots pratiqués, des phrases sont inventées et écrites sous l'image correspondante, par exemple : Le crapaud vivait dans une flaque d'eau. Le scarabée bourdonne. Zhenya avait des serpents vivants. Zhanna mange de la gelée pour le dîner.
Son h
Le son h peut être placé à partir du son t : avec la pointe de la langue relevée, elle est déplacée plus vers l'intérieur des incisives supérieures. L'enseignant montre sur lui-même où se trouve la langue et de combien elle recule. Lorsque l'enfant copie fidèlement les mouvements, il faut avancer ses lèvres (en appuyant sur ses joues) pendant qu'il prononce t-t-t-t-t. Le résultat sera le son H. L'enfant doit être félicité (« Vous l'avez dit correctement, eh bien, répétez-le encore »). On peut dire que ce son rappelle le gazouillis d'une sauterelle (« Il saute haut dans l'herbe, tout comme ta langue saute derrière tes dents supérieures. Tu entends, ch - sauté, encore ch - sauté »).
Si le son h ne peut pas être produit par imitation, son son correct peut être obtenu en prononçant ensemble la combinaison de sons tsh, d'abord à un tempo lent, puis à un tempo rapide.
Livré le son est automatisé dans les mots dans lesquels on le trouve
A la fin : nuit, fille, four, poutre, épée, pleurs, clé, rouleau, épouvantail, tracteur, balle, chouette ;
Au milieu : tonneau, point, fille, poêle, allumette, bourgeon, butte, meute, oiseau, mât, lunettes, pompon, papillon, canne à pêche, tuyau, brindille, brindille, bouquet, réservoir, nuage, tas, tête de chou , garçon, beignet, biscuits, balançoire ;
Et seulement alors au début (si le son n'est pas fixé dans les positions précédentes, au début du mot, au lieu de h, deux sons peuvent être entendus : tsh) : thé, chèque, bas, turban, navette, casquette, mouette , théière, fonte, peluche, valise, Cippolino , montre, ail, lentilles.
Avec l'enfant, l'enseignant imagine et écrit des phrases avec des mots commençant par H. Par exemple : Le garçon a une pipe et un canard. Tanya, ne pleure pas, le ballon ne coulera pas. Olechka se balançait sur une balançoire et l'oiseau se balançait sur une branche. Une fille boit du thé avec des biscuits.
Schéma sonore
Le son shch apparaît souvent automatiquement après l'introduction des sons sh, zh, ch. Pour évoquer shch, il faut montrer à l'enfant que si, en prononçant le son sh, on avance la langue, plus près des dents, le son shch sera entendu.
Compte tenu de la relation entre les mouvements des muscles des lèvres et de la langue, vous pouvez demander à l'enfant, lorsqu'il prononce sh longuement, d'étirer ses lèvres en un sourire ; à ce moment la langue avance et le son sch se fait entendre. Le son obtenu est renforcé par des onomatopées (« Montre-moi comment un œuf brouillé grésille dans une poêle... Quel bruit fait une brosse quand on nettoie des choses avec », etc.).
Pour l'automatisation Le son u dans les mots dessine des images au nom desquelles on le retrouve :
Au début du mot : soupe aux choux, bouclier, crack, brochet, joues, chiot, chardonneret, oseille, chips, brosse, poils, loquet, pince ;
Au milieu : des choses, des tiques, du Kashchei, une boîte, un prédateur, une zone, des légumes, une botte, une tige ;
A la fin : brème, tique, lierre, manteau.
A la demande de l'enseignant, l'enfant compose des phrases avec des mots appris. Par exemple : Les camarades ont sorti du brochet et de la brème. Petya, prends la pince et nous retirerons le clou.
(Matériel supplémentaire pour l’automatisation audiosch voir p. 218.)
Des questions.
Pourquoi le son sh est-il le son de base dans le groupe des sifflements ?
Quels types de sigmatisme de sifflements connaissez-vous ?
Quels types de parasygaatisme de sifflements connaissez-vous ?
En quoi le travail au stade préparatoire avec le sigmatisme des sifflements diffère-t-il du même travail avec le parasigmatisme des sifflements ?
A quel stade et pourquoi le travail se termine-t-il par le sigmatisme et le parasigmatisme des sifflements ? Donnez des exemples précis.
Quelle est la principale façon de produire le son sh ?
Quelles sont les caractéristiques de la manifestation de la prononciation interdentaire du son sh et de sa correction ?
Quelles sont les caractéristiques de la manifestation de la prononciation latérale du son sh et de sa correction ?
Quelles sont les caractéristiques de la manifestation de la prononciation nasale du son sh et de sa correction ?
Comment le son délivré est-il automatisé ? Donnez des exemples de sifflements.
Dans quel ordre les sons sont-ils placés dans un groupe de sifflements ?
Pygargue à tête blanche de mer
Son envergure dépasse deux mètres et sa masse est de cinq kilogrammes. Il vit généralement au bord de la mer, mais il trouve parfois les rives des lacs et même des rivières attrayantes, oùse concentre sur les poissons et les oiseaux.
Wapiti
Un herbivore qui vit près de l'eau. Il se nourrit de végétation dans les eaux peu profondes des rivières et des lacs. Lorsqu'un prédateur apparaît, le wapiti cherche son salut directement dans l'eau. Il est capable de nager plusieurs kilomètres. Une vache orignal donne naissance à un ou deux bébés, qui quittent leur mère au bout de neuf mois.
Loutre
Il est parfaitement adapté à la vie dans l’eau et ne s’en éloigne jamais. Elle passe la journée dans un trou qu'elle creuse elle-même ou occupe l'abri d'un autre animal. Au crépuscule, elle quitte le trou et chasse des poissons, des crustacés, des amphibiens et même des petits mammifères. Pour faciliter la détection des poissons, la loutre grimpe souvent sur des endroits élevés, tels que des branches suspendues au-dessus de l'eau, d'où elle se jette sur ses proies.
Loup
De nombreuses meutes de loups vivent et chassent dans les grandes forêts canadiennes. Les loups n'aiment pas être seuls ; de plus, ils ont développé des techniques complexes de chasse en groupe, ce qui témoigne de leur intelligence et de leur capacité d'apprentissage.
Castor
Le castor est un mammifère du genre des rongeurs. Il a une épaisse fourrure brune. Le castor est un animal assez gros, il peut peser jusqu'à trente kilogrammes et atteindre plus d'un mètre de longueur (queue comprise). Vit en colonies le long des rivières forestières, nage et plonge bien. La peau du castor est recouverte de deux types de fourrure. Certains poils sont longs, noirs et brillants, d’autres sont plus courts et plus doux, formant un sous-poil dense qui empêche l’eau d’entrer en contact avec la peau. Le castor se nourrit principalement d'écorces d'arbres, ainsi que de roseaux, d'orties et de jeunes pousses d'arbres.
Pour abattre un arbre, le castor commence à mordre profondément dans le tronc d'un côté et continue à travailler en cercle jusqu'à ce que l'arbre tombe au sol.
Le castor creuse un trou sous terre, mais fait son entrée et sa sortie sous le niveau de l'eau, ce qui le protège des prédateurs. Le trou est grand : il doit contenir toute la famille et une réserve de nourriture pour l'hiver.
Le castor vit dans les forêts au bord des rivières et des lacs, principalement en Amérique du Nord et en Russie ; parfois trouvé en Europe occidentale.
Le castor se déplace maladroitement sur terre, mais dans l’eau il est très mobile. C'est l'eau qui constitue le véritable habitat de cet animal. Lorsqu'il y a peu d'approvisionnement, le castor abat des arbres pour construire un barrage et augmenter la zone où il peut creuser un terrier.
Le nez, les yeux et les oreilles du castor, comme celui de nombreux autres animaux aquatiques, sont situés de manière à ce qu'il puisse voir, entendre et respirer en nageant sans lever la tête.
En s’entraidant, les castors construisent avec les troncs et les branches tombés une structure qui semble, à première vue, chaotique. En fait, il s’agit d’une structure très durable qui peut résister même aux hautes eaux.
Le castor possède quatre incisives longues et pointues recouvertes d'émail jaune-orange. Les muscles de la mâchoire sont si forts qu’ils développent une pression pouvant atteindre 100 kg. Le castor a besoin de telles incisives pour abattre les arbres et arracher l'écorce dont il se nourrit.
Un autre constructeur. Un autre rongeur peut également construire des terriers complexes faits de roseaux et de roseaux dans les zones riveraines des lacs. C'est un rat musqué originaire d'Amérique du Nord. Des colonies de rats musqués sauvages se trouvent également en Europe.
Raton laveur
Le raton laveur rayé est l'espèce la plus commune de la famille des ratons laveurs. Il s'adapte facilement et a appris, comme beaucoup d'autres animaux, et notamment les oiseaux, à vivre à proximité des habitations humaines et à manger des déchets alimentaires ou des aliments laissés sans surveillance par les humains. Le raton laveur a les habitudes d'un animal nocturne : on peut parfois le voir fouiller dans les poubelles la nuit. Dans son habitat naturel, le raton laveur se nourrit de petits animaux, vivant principalement dans l'eau, qu'il attrape en ratissant le fond des eaux peu profondes avec les griffes de ses pattes avant. Sur terre, le raton laveur creuse le sol à la recherche de vers de terre, de larves et d'insectes divers.
Le raton laveur grimpe bien. Dans les forêts de feuillus, il grimpe aux arbres, où il trouve non seulement de la nourriture, mais aussi une protection contre d'éventuels ennemis. Le raton laveur n'aime pas les forêts de conifères.
Pourquoi un raton laveur est-il appelé raton laveur ? Seuls les ratons laveurs élevés en captivité, avant de manger de la nourriture, la plongent dans l'eau, comme s'ils voulaient la laver. Ce comportement peut être considéré comme une précaution car dans la nature, ils sont habitués à laver le sable et autres saletés de leurs proies.
Les oursons naissent dans un trou creusé dans un arbre creux, parfois à une hauteur considérable. Vers cinq ou six mois, ils commencent à mener une vie indépendante.
À l’approche de l’automne, le raton laveur ajoute à son alimentation des fruits, des glands et des baies. La femelle emmène avec elle les bébés, âgés de trois mois déjà, et ne les lâche pas en les appelant avec un cri aigu.
Lynx
Contrairement aux autres membres de la famille des félins, le lynx a une queue très courte. En effet, la longue queue sert de gouvernail à l'animal, l'aidant à changer brusquement de direction lorsqu'il poursuit une proie. Le lynx est plus adapté à la chasse en embuscade, qu'il dispose dans les branches des arbres. Mais elle a de très longues jambes, ce qui lui permet de faire de longs sauts. Le seul habitat du lynx est la forêt, où il peut tendre des embuscades en se cachant dans les branches des arbres.
La proie la plus recherchée du lynx est le chevreuil ou le cerf, mais il s'attaque également aux animaux domestiques comme les chèvres et les moutons.
En Amérique du Nord vit le lynx roux, qui apparaît silencieusement la nuit près des villages et des maisons individuelles. Cachée dans les branches des arbres, elle se prépare à attaquer les animaux domestiques. Seules des empreintes dans la neige, semblables à celles d'un énorme chat, trahissent sa présence.
En règle générale, une femelle donne naissance à deux à quatre petits lynx. Elle prépare à l'avance un trou dans un endroit isolé, comme une grotte ou un creux. Les petits restent avec leur mère jusqu'à l'âge de dix mois, puis la quittent. Le lynx est un animal solitaire et possède son propre territoire de chasse.
Les pattes postérieures, très développées et musclées, permettent au lynx de sauter haut lorsqu'il chasse les oiseaux qui tentent de s'en échapper en s'envolant du sol.
Composition
Mon animal préféré est un chat. Depuis mon enfance, je voulais avoir un chat. Et finalement, mon rêve est devenu réalité : un chat siamois, Kuzya, est apparu à la maison. Kuzi a un museau brun clair, des oreilles, des pattes foncées et une longue queue rayée ; un corps allongé et flexible, une grosse tête ronde, une moustache hérissée sur le museau, une barbe et des yeux bleu vif. La couleur des yeux change lorsqu'il est en colère ou menaçant, les pupilles deviennent rouges ou vertes. Les oreilles d'un chat sont toujours alertes ; ils captent le moindre bruissement.
Kuzya est un animal capricieux. S'il est de bonne humeur, il joue, se laisse caresser, permet à un autre animal de manger dans sa gamelle, mais s'il est de mauvaise humeur, il prévient avec une sorte de miaou, alors il vaut mieux ne pas pour le toucher. Kuzya est un chat sérieux et combattant. Quand nous étions au village, il se battait avec tous les chats. Il n’est pas le premier à entrer dans un combat. Au début, il semble avertir : il hurle d'une voix méchante. Fait pivoter le cou de près de cent quatre-vingts degrés ; sa fourrure se dresse et sa queue « se transforme » en une brosse duveteuse et hérissée. Il n'a aucune pitié pour son adversaire. Il se bat jusqu'à ce que l'ennemi prenne la fuite. Kuzya est un chat très intelligent. Il a appris à utiliser ses pattes pour ouvrir le réfrigérateur ; portes d'armoires; Si la porte d'entrée n'est pas verrouillée, elle restera accrochée à la poignée jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Kuzya adore regarder la télévision, chasser les lézards, les grenouilles et les oiseaux. Et pourtant c'est un chat très gentil et aime ses maîtres. J'aime beaucoup notre chat.