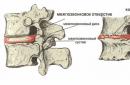L'ostéosynthèse est une opération de jonction de fragments osseux à l'aide de moyens de fixation spéciaux, utilisée pour le traitement des fractures et divers types d'interventions chirurgicales orthopédiques.
L'ostéosynthèse est la méthode la plus utilisée pour traiter les fractures osseuses et les fausses articulations. Avec l'ostéosynthèse, le déplacement des fragments osseux est éliminé et leur fixation solide dans la bonne position est assurée, les conditions les plus favorables à la formation de callosités sont créées, les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement sont améliorés, ainsi que la durée du traitement et la durée du handicap sont réduits.
Les indications de l'ostéosynthèse des fractures peuvent être absolues et relatives.
L'ostéosynthèse est absolument indiquée pour les fractures de la rotule, de l'olécrane, certaines fractures du col fémoral avec déplacement de fragments, pour les fractures avec déplacement important et irréparable de fragments, interposition de tissus mous et risque de lésion des gros vaisseaux et des nerfs. Une indication relative de l'ostéosynthèse est la nécessité de raccourcir la période de traitement et d'éliminer les déplacements mineurs de fragments. L'ostéosynthèse est également indiquée pour les fractures ouvertes après un traitement chirurgical approprié des tissus mous. Contre-indications à l'ostéosynthèse : état général sévère du patient, état de choc, maladies infectieuses actives et aiguës, maladies chroniques sévères et maladies respiratoires. L’opération d’ostéosynthèse peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale.
Riz. 1. Cerclage de fragments de tibia pour fracture spirale oblique. Riz. 2. Ostéosynthèse avec plaque Lena pour fractures du tibia. Riz. 3. Fixation intra-osseuse du fémur avec une tige métallique. Riz. 4. Ostéosynthèse du col fémoral avec un clou à trois lames.
Pour l'ostéosynthèse, les fixateurs métalliques (clous, plaques, vis - voir Instruments orthopédiques) et plastiques, soie, boyau et autres matériaux, ainsi que (voir). Les structures métalliques pour l'ostéosynthèse sont constituées d'une qualité d'acier spéciale ; ils peuvent rester longtemps dans les tissus sans les affecter négativement ni se corroder. Sur la base de la méthode de fixation des fragments, on distingue les types d'ostéosynthèse suivants. 1. Cerclage (suture enveloppante, Fig. 1) - réalisé à l'aide de fil ou de ruban métallique (ruban de cerclage). 2. Suture osseuse - réalisée en faisant passer des fils ou des fils métalliques dans des canaux osseux percés dans les fragments pour les rapprocher jusqu'à ce qu'ils se touchent. 3. Ostéosynthèse avec vis, boulons et plaques métalliques Lena. Les vis et les boulons sont passés à travers l’os perpendiculairement à son axe, à travers les deux fragments. Des plaques métalliques sont placées à la surface de l’os et servent d’« attelle » externe supplémentaire (Fig. 2). 4. Ostéosynthèse avec poutres métalliques. Un côté du faisceau est transporté dans le canal médullaire, l’autre est placé à la surface de l’os. 5. Fixation intra-osseuse des fractures à l'aide de tiges métalliques ou de broches osseuses. Ils sont insérés dans le canal médullaire des deux fragments, c’est-à-dire qu’ils servent d’« attelle » interne.
L'ostéosynthèse peut être réalisée par voie ouverte avec exposition chirurgicale des extrémités des fragments ou par voie fermée (insertion d'une tige dans le canal médullaire sans ouvrir le foyer de fracture).
Le choix de la méthode d'ostéosynthèse dépend de la localisation et de la nature de la fracture. Pour les fractures diaphysaires des os tubulaires longs (hanches, os, clavicule, etc.), la fixation intra-osseuse avec une tige métallique (clous de Kuncher, Dubrov, CITO, Bogdanov) est devenue la plus répandue. En cas de fixation intra-osseuse du fémur (Fig. 3), aucun plâtre n'est appliqué, la mise en charge du membre est autorisée après 1 mois. après la chirurgie, récupère après 3 mois. Lorsque la fixation intra-osseuse des os de l'avant-bras et du bas de la jambe nécessite une immobilisation supplémentaire avec un plâtre. Sa durée dépend du type de fracture et de la durée de l'opération, mais elle est en moyenne de 2 à 3 mois. pour les fractures du tibia et 2 mois. pour les fractures de l'avant-bras.
En cas de fractures du col fémoral, l'ostéosynthèse de fragments est réalisée avec un clou à trois lames (Fig. 4) à l'aide de divers appareils (appareils Petrov-Nenov, Kaplan, broches de guidage, etc.).
Aucune immobilisation plâtrée supplémentaire n’est requise. L'opération est réalisée principalement sur des patients âgés et ne permet pratiquement que la guérison de la fracture. L'ostéosynthèse facilite la prise en charge de ces patients, prévient leur apparition, etc. La guérison d'une fracture incluse du col fémoral se produit après 6 à 8 mois, en même temps une charge complète sur le membre est autorisée.
Pour l'ostéosynthèse des fractures des tibias, diverses plaques et boulons sont plus souvent utilisés. A l'aide d'un boulon métallique, les surfaces articulaires du tibia sont restaurées en cas de fractures du condyle intra-articulaire et de divergence en « fourche ». Pour les fractures de la cheville, une fixation avec une vis métallique est utilisée.
Les fixateurs utilisés pour l'ostéosynthèse doivent être retirés après guérison complète de la fracture, confirmée par radiographie. L'exception concerne les clous à trois lames insérés pour les fractures du col fémoral. Ils ne sont retirés que pour des indications particulières (infection, pénétration des ongles, etc.). Un maintien trop long du fixateur est indésirable et dans certains cas dangereux (infection, lésions osseuses, difficulté de retrait tardif). Les indications pour le retrait immédiat des structures de fixation en cas de fracture non unifiée sont le développement de processus purulents dans la zone de fracture (avec fixation avec des plaques et des rubans), la rupture et le déplacement du fixateur et d'autres complications.
Les complications possibles de l'ostéosynthèse peuvent être une suppuration de la plaie, une ostéomyélite, un tissu adipeux, une pseudarthrose de fragments, etc.
La prise en charge d'un patient après une chirurgie d'ostéosynthèse diffère peu de la prise en charge habituelle des patients opérés. Une attention particulière doit être portée à l'état du pansement sur la plaie et à la bonne position du membre opéré.
L'ostéosynthèse (du grec ostéon - os et synthèse - connexion) est la connexion opératoire de fragments osseux juxtaposés et leur fixation solide à l'aide de divers matériaux. L'ostéosynthèse est utilisée aussi bien pour les fractures fraîches qu'anciennes (mal fusionnées, non unies), la pseudarthrose, après des ostéotomies et des opérations de reconstruction des os.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des méthodes d'ostéosynthèse utilisant des broches, des vis, des plaques et certains types de fixation transosseuse et extraosseuse des fractures ont été proposées. G. Kuntscher a développé en détail la méthode et la technique de fixation intra-osseuse des fractures à l'aide d'un long clou en acier inséré dans le canal médullaire et retenant fermement les fragments osseux. Plus tard, diverses broches, tiges, clous, sondes ont été proposées pour la fixation intra-osseuse des fractures, et diverses plaques, poutres, vis et boulons ont été proposées pour maintenir des fragments osseux par ostéosynthèse extramédullaire ou transosseuse.
Divers alliages résistants à la corrosion ont été utilisés comme matériaux pour l'ostéosynthèse, par exemple le vitalium - un alliage composé de 65 % de cobalt, 30 % de chrome, 5 % de molybdène ; De nos jours, l'acier inoxydable et certains matériaux synthétiques biologiquement inertes sont le plus souvent utilisés. Dans la pratique chirurgicale, dans certains cas, des matériaux osseux sont également utilisés - broches, plaques en os auto-, homo- ou hétérogène. Le procédé de traitement de matériaux osseux homo- et hétérogènes par congélation permet d'y recourir, par exemple, lors du remplacement de défauts osseux importants.
Les indications de l'ostéosynthèse peuvent être absolues et relatives. L'ostéosynthèse est absolument indiquée pour les fractures avec interposition de tissus mous entre fragments, les fractures avec lésions des vaisseaux sanguins, les nerfs mal fusionnés avec raccourcissement et altération grave de la fonction des membres et les fausses articulations ; L'ostéosynthèse absolue est indiquée pour les fractures de la rotule, du col fémoral, de l'olécrane avec déplacement prononcé de fragments osseux, ainsi que pour de nombreuses fractures perturbant la forme du membre et la fonction des articulations (coude, genou, cheville). Les indications relatives de l'ostéosynthèse sont les fractures de la clavicule avec déplacement de fragments, du col fémoral chez l'enfant, les fractures mal cicatrisées du tibia avec déplacement angulaire et violation de l'axe. L'ostéosynthèse peut également être utilisée pour des fractures ouvertes fraîches, sous réserve d'un débridement chirurgical minutieux de la plaie des tissus mous et des fragments osseux eux-mêmes. Le succès de l'ostéosynthèse est facilité par : la fourniture d'un équipement spécial, une technique chirurgicale élevée, une asepsie stricte de l'opération et l'utilisation d'antibiotiques.
Contre-indications à l'ostéosynthèse : état général grave du patient, choc, diabète, tuberculose active, maladies chroniques sévères des systèmes respiratoire et cardiovasculaire, état inflammatoire de la peau, des tissus mous et des os au niveau de la fracture, maladies infectieuses aiguës.
Les fractures fraîches par balle sur le terrain peuvent être soumises à une ostéosynthèse selon des indications absolues après un traitement chirurgical primaire radical de la plaie musculo-squelettique, une administration systématique d'antibiotiques et, si possible, une observation directe du blessé dans les 5 à 6 premiers jours suivant l'intervention chirurgicale. Pour réussir l'opération, vous devez choisir la méthode d'anesthésie appropriée, avoir des radiographies claires en deux projections, utiliser l'accès le plus pratique et le moins traumatisant, sélectionner le matériel nécessaire, ainsi que les instruments - à la fois chirurgicaux généraux et spéciaux pour les opérations sur les os. .
Le type d'ostéosynthèse le plus simple est une suture osseuse, liant les fragments entre eux avec du fil d'acier inoxydable, dont deux ou quatre sutures sont serrées avec des pinces spéciales et tordues pour assurer un contact étroit des fragments (Fig. 1, 1 et 2). Ce type d'ostéosynthèse est généralement utilisé pour les fractures obliques présentant une grande surface de fracture. Cependant, une telle méthode, notamment lors de l'utilisation d'un fil rond fin, peut provoquer des modifications atrophiques indésirables des fragments comprimés par le fil. Cette dernière doit être retirée avec consolidation plus ou moins prononcée de la fracture 2 à 3 mois après l'intervention chirurgicale. Il est préférable d'utiliser du fil lamellaire plutôt que du fil rond.
Un fil de suture est parfois utilisé pour les fractures intra-articulaires ou périarticulaires de l'olécrane (Fig. 2), pour les fractures des condyles ou des épicondyles de l'épaule, pour les luxations de l'articulation acromio-claviculaire, pour les fractures de la rotule (Fig. 3). .

Riz. 1. Lier les fragments avec du fil 1 - ligature osseuse avec du fil ; 2 - ligature osseuse avec ruban Putti - Parama.

Riz. 2. Suture osseuse pour une fracture de l'olécrane. 
Riz. 3. Suture enveloppante pour une fracture de la rotule.

Riz. 4. Brackets métalliques pour l'ostéosynthèse lors des opérations de reconstruction : 1 - Moore - Blunt ; 2 - Revenko.
Figure 5. Extracteur à clou à trois dents.
Selon la localisation de la fracture, il est nécessaire de recourir à des méthodes d'ostéosynthèse plus complexes. Pour les fractures et la pseudarthrose du col fémoral, les fragments sont cloués ensemble avec un clou de Smith-Petersen à trois lames avec un canal à l'intérieur pour une broche de guidage (extracteur avec clou - voir Fig. 5).
Le clou sans canal Petrov-Yasnov, inséré à l'aide d'un guide, peut être utilisé avec succès. Lors des opérations de reconstruction des défauts de la tête et du col du fémur, de la coxa vara, des luxations congénitales et pathologiques, il est nécessaire de maintenir le fragment introduit dans la cavité articulaire jusqu'à la fusion. Les supports métalliques de Moore-Blunt et T.A. Revenko sont les plus adaptés à cet effet (Fig. 4, 1 et 2). Ce dernier est constitué de deux pièces de liaison, ce qui facilite son retrait.
Selon la forme de la fracture du fémur, différents types d'ostéosynthèse sont utilisés. Pour les fractures comminutives transversales, une ostéosynthèse métallique intra-osseuse est utilisée (Fig. 7) ; pour les fractures obliques avec déplacement, une fixation externe des fragments est ajoutée avec des sutures de cerclage - des bandes en fil d'acier en tôle (Fig. 6).
Riz. 6. Ostéosynthèse combinée pour une fracture de hanche : tige métallique intramédullaire et sutures de cerclage.
Riz. 7. Ostéosynthèse métallique intra-osseuse à l'aide d'un clou métallique Dubrov.
Riz. 8. Ostéosynthèse combinée : tige métallique et greffe osseuse.

Figure 9. Vissage des condyles fémoraux cassés au lit osseux.
Riz. 10. Ostéosynthèse avec une vis métallique pour une fracture du tibia et une tige dans le péroné : 1 - projection directe ; 2 - projection latérale.
Pour stimuler les processus de régénération, notamment dans la pseudarthrose, après ostéosynthèse, une greffe osseuse est renforcée au site de la fracture avec une tige (Fig. 8).
Les fractures des condyles fémoraux, en forme de T et de V, présentant un déplacement important et non comparable sans sang, font l'objet d'un traitement chirurgical par vissage des fragments au lit osseux (Fig. 9). L'ostéosynthèse avec vis est également utilisée pour les fractures des condyles tibiaux, ainsi que pour les fractures de la cheville du tibia (Fig. 10, 1 et 2).
Pour les fractures transversales de la diaphyse du tibia, il est conseillé d'utiliser l'ostéosynthèse centromédullaire avec des tiges de Küncher, et pour les fractures obliques, avec des plaques de Lenn, des poutres K. M. Klimov et des anneaux métalliques à plaques. Dans tous les cas sur le bas de la jambe, l'opération est complétée par l'application d'un plâtre aveugle pendant une durée de 1,5 à 2 mois pour éviter le détachement des fragments, la flexion voire la fracture de la tige.
La technique d'insertion d'une tige métallique Küncher pour les fractures de la hanche est la suivante. Une incision est pratiquée le long de la face antérieure et externe de la cuisse, le long de la ligne de projection reliant la fourmi spina-iliaque. souper. avec le côté externe de la rotule. Après avoir exposé le foyer de fracture, l'extrémité du fragment fémoral proximal est soulevée, une tige métallique est insérée dans son canal dans le sens rétrograde, l'œil en avant, et le clou est enfoncé à coups de marteau rares mais vigoureux. Son extrémité s'étend près du grand trochanter au-delà de l'os. Les tissus mous sont disséqués au-dessus du point de sortie du clou et, après avoir placé un impacteur à l'extrémité de la tige, la tige est martelée dans le sens opposé à coups de marteau. Lorsque l'extrémité de la tige apparaît à la surface de la fracture, le fragment distal est mobilisé, il est comparé avec précision au fragment proximal et la tige est insérée dans le canal médullaire à une profondeur suffisante pour une fixation solide de la fracture (donc que l'extrémité distale de la tige se trouve dans le tissu spongieux de la métaépiphyse inférieure du fémur).
En cas de fracture du tibia, une tige métallique de Küncher est insérée à travers le fragment proximal, à travers la métaphyse supérieure du tibia en y perçant un canal oblique, pénétrant dans la cavité médullaire.
En cas de fractures de la clavicule, des os métacarpiens ou métatarsiens, ainsi que des phalanges des doigts avec déplacement important, les fragments peuvent être fixés avec un fil de Kirschner dont l'extrémité libre est ressortie pour une extraction ultérieure lorsque les fractures guérissent .
En cas de fractures du col de l'omoplate avec un déplacement important, il est conseillé de réaliser une ostéosynthèse avec une plaque métallique avec des vis (Fig. 11).

Figure 11. Ostéosynthèse d'une fracture de la scapula à l'aide d'une plaque métallique avec vis.

Figure 12. Arthrodèse ostéoplasique de l'articulation du genou selon Novachenko (étapes 1 à 3 de l'opération).
Le traitement des fractures diaphysaires de l'épaule par ostéosynthèse est réalisé, comme pour la hanche. Les mêmes tiges sont utilisées, mais de longueur et d'épaisseur plus courtes (F.R. Bogdanova, Kuncher), du fil torsadé. Les tiges sont généralement insérées à partir de l'extrémité distale de l'humérus, du côté postérieur, au-dessus de la fosse ulnaire (fossa olecrani) de l'humérus à travers un canal oblique percé dans celle-ci et communiquant avec la cavité médullaire. Les fragments peuvent également être reliés par le faisceau de K. M. Klimov. La proximité du nerf radial nécessite une attention particulière lors d'interventions sur l'humérus.
En cas de fractures de la tête humérale avec déplacement ou luxation, ses fragments sont assemblés à l'aide de clous courts, de vis, de broches osseuses, etc. Les fragments séparés des condyles huméraux sont reliés à l'aide d'une suture osseuse ou de vis.
Les fractures diaphysaires de l'avant-bras avec déplacement de fragments sont traitées par ostéosynthèse intra-osseuse avec de fines tiges métalliques spéciales, qui sont insérées dans le canal osseux du radius à partir du fragment distal du radius, et dans l'ulna, au contraire, de haut en bas. en bas, du côté de l'olécrane.
Récemment, la méthode d'ostéosynthèse par compression s'est généralisée, qui consiste à rapprocher des fragments d'os sous une pression provoquée par des structures métalliques particulières (G. A. Egiazarov, O. N. Gudushauri, etc.).
Certains types d'ostéosynthèses spéciales sont utilisés à la fin des opérations ostéoplastiques : arthrodèse de l'articulation du genou selon N. P. Novachenko (Fig. 12) ; ostéosynthèse lors d'une transplantation homoplastique d'une semi-articulation pour fixer le greffon à la diaphyse fémorale après résection selon A. A. Korzh (Fig. 13) ; ostéosynthèse avec un « château russe » (Fig. 14) ; ostéosynthèse intra-extramédullaire ostéoplasique selon V. D. Chaklin (Fig. 15).

Figure 13. Ostéosynthèse d'une demi-articulation homogène avec le fémur : 1 et 2 - préparation du greffon ; 3 - connexion avec la diaphyse fémorale.

Figure 14. Schéma d'ostéosynthèse selon le type « château russe ».
Figure 15. Ostéosynthèse avec greffe osseuse selon Chaklin.
Dans certains cas, lors de l'ostéosynthèse, des broches osseuses de formes, longueurs et épaisseurs diverses sont utilisées pour fixer des fragments : pour les fractures marginales des os du bassin, pour les fractures des condyles du fémur, du tibia, de l'épaule, du scaphoïde de la main, de la tête de le radius, l'éminence intercondylienne du tibia, etc.
Dans de tels cas, la réparation des fractures est généralement complétée par l'application de plâtres pendant la période requise. Il convient de garder à l'esprit que lorsqu'un clou est inséré par voie intra-osseuse dans l'humérus, le fragment distal glisse souvent du clou sous l'influence du poids de l'avant-bras. Pour empêcher les fragments de glisser, des clous vissés sont utilisés ou un plâtre est appliqué.
Si l'ostéosynthèse est mal réalisée, des erreurs sont possibles : 1) insertion de la tige à une profondeur insuffisante, ce qui ne permet pas une bonne fixation des fragments ; 2) réduction insuffisamment précise de la fracture avec rotation du fragment périphérique sur les côtés ; 3) pénétration de l'extrémité de la tige dans les joints ; 4) dommages aux gros vaisseaux et aux nerfs ; 5) diastases entre fragments osseux ; 6) traumatisme tissulaire majeur et infection de la plaie ; 7) l'utilisation de fixateurs qui ne permettent pas une forte fixation des fractures.
L'ostéosynthèse est reconnue comme une méthode d'intervention chirurgicale. Cette opération est réalisée en cas de fractures graves afin de fixer des parties des os dans un état immobile. La fixation réalisée chirurgicalement permet de stabiliser la zone fracturée et d’assurer sa bonne cicatrisation.
L'ostéosynthèse est la méthode optimale pour traiter les fractures des os tubulaires longs, caractérisées par une résistance réduite chez les patients plus âgés. Le médecin utilise les instruments suivants comme fixateurs artificiels :
- des vis;
- des vis;
- clous;
- épingles;
- des aiguilles à tricoter
Les éléments utilisés pour assurer la position statique du tissu osseux se caractérisent par une inertie chimique, physique et biologique.
Finalités de l'opération
Un traumatologue orthopédiste réalise le traitement chirurgical d'une fracture par ostéosynthèse dans le but de :
- Créer des conditions optimales pour la fusion osseuse ;
- Réduire les traumatismes des tissus mous situés à proximité de la fracture ;
- Restaurer le fonctionnement des parties endommagées du membre.
Méthodes d'ostéosynthèse
La fixation des structures osseuses cassées ou autrement endommagées en fonction du moment de la mise en place peut être :
- primaire;
- retardé.
Selon la technique d'insertion du loquet, l'opération est :
- externe La technique de compression-distraction transosseuse de type externe se distingue par la capacité de ne pas exposer le site de fracture. Les traumatologues utilisent des aiguilles à tricoter et des clous en métal durable comme outils supplémentaires. Ces éléments traversent des sections brisées de structures osseuses. La direction correspond à la perpendiculaire à l'axe de l'os ;
- submergé. L'opération consiste à insérer un fixateur osseux dans la zone de la fracture. Il existe 3 types de cette méthode d'intervention chirurgicale : extra-osseuse, intra-osseuse et transosseuse. La division de l'ostéosynthèse en types est due aux différences dans l'emplacement du composant de fixation. Dans les cas difficiles, les médecins peuvent utiliser des techniques complexes combinant plusieurs méthodes de fixation.
Chirurgie intra-osseuse
Il s’agit d’une technique chirurgicale utilisant des tiges, à savoir des épingles et des clous. Une opération fermée est réalisée lorsque les fragments sont comparés en utilisant une incision éloignée de la zone de fracture. Le fixateur est inséré sous contrôle radiologique. La méthode ouverte consiste à exposer la zone touchée.
Ostéosynthèse périostée
Le médecin relie l'os à l'aide de vis de différentes épaisseurs et formes ; en outre, des bandes métalliques, des fils et des anneaux peuvent être utilisés.
Ostéosynthèse transosseuse
Le traumatologue orthopédiste place des vis ou des broches de fixation dans une direction transversale oblique ou transversale. Les instruments sont insérés à travers les parois du tube osseux.
Méthode intramédullaire
L'ostéosynthèse centromédullaire verrouillée consiste à pratiquer une incision cutanée sous contrôle radiologique et à insérer une tige en acier ou en titane dans le canal médullaire. Les vis assurent une position sûre de la tige. Cette conception réduit la charge sur la zone endommagée. La chirurgie fermée garantit un minimum de dommages aux tissus mous.
Selon le domaine d'intervention chirurgicale, l'opération est réalisée sous les formes suivantes :
- Ostéosynthèse de la hanche. Elle est souvent nécessaire chez les personnes âgées présentant des lésions pertrochantériennes et sous-trochantériennes, ainsi que des fractures du col fémoral. Le but de l’intervention est de restaurer la capacité motrice d’une personne. Le médecin utilise une fixation intra-osseuse ou extra-osseuse ;
- Ostéosynthèse du tibia. Les chirurgies fermées sont préférées pour réduire la récupération des tissus osseux et musculaires. Les méthodes de compression-distraction et intramédullaires sont courantes ;
- Ostéosynthèse de la cheville. L'opération est réalisée pour des fractures chroniques compliquées par des structures osseuses non réduites ou non fusionnées. Après de nouvelles blessures, il est recommandé d'intervenir 2 à 5 jours après la blessure ;
- Ostéosynthèse de la clavicule. Les blessures à ces zones osseuses sont courantes chez les athlètes et les nouveau-nés. Les os sont maintenus ensemble par des plaques et des vis, et des structures spécialisées peuvent être nécessaires pour maintenir l'extrémité acromiale de la clavicule ;
- Ostéosynthèse de l'humérus. Des tiges, des broches en forme de vis et des plaques métalliques avec des vis sont utilisées pour sécuriser ces fractures osseuses.

Indications d'utilisation de l'ostéosynthèse
L'ostéosynthèse du col fémoral ou d'un autre os est utilisée comme principale méthode de restauration en présence des facteurs suivants :
- la fracture ne guérit pas sans assistance chirurgicale ;
- il y a une fracture mal cicatrisée ;
- il existe un risque élevé de dommages aux muscles, aux nerfs, à la peau et aux vaisseaux sanguins dus à des parties des structures osseuses.
- avec déplacements secondaires d'éléments osseux;
- lorsque le processus de restauration de l'intégrité osseuse ralentit ;
- s'il est impossible d'effectuer une réduction fermée ;
- avec formation d'hallux valgus;
- dans le but de corriger les pieds plats.
Contre-indications à l'ostéosynthèse
L'ostéosynthèse du fémur ou de toute autre zone affectée par une lésion ne doit pas être réalisée si les contre-indications suivantes sont présentes :
- état grave du patient;
- contamination des tissus mous;
- fractures ouvertes accompagnées de dommages importants ;
- infection de la zone touchée;
Le traitement de la perte totale ou partielle de l’intégrité osseuse peut être conservateur ou chirurgical. Mais dans chaque cas, cela réside dans la connexion correcte des fragments osseux - le repositionnement. L'utilisation de méthodes conservatrices repose sur la comparaison manuelle des fragments et la fixation de leur immobilité avec un matériau solide, par exemple du plâtre. Malheureusement, le traitement conservateur ne donne pas toujours les résultats souhaités ou est totalement inapproprié. Dans de tels cas, la chirurgie (ostéosynthèse) est utilisée.
Objectif de l'ostéosynthèse
La réduction chirurgicale est utilisée dans le traitement des blessures fraîches, des fractures non unies ou mal fusionnées et de la pseudarthrose, ainsi que dans la connexion du tissu conjonctif dense après sa dissection.
Un traumatologue réalise un traitement chirurgical d'une fracture selon la méthode du repositionnement afin de :
- fixation stable de la zone endommagée jusqu'à sa restauration complète ;
- réduire le risque de blessure des tissus mous adjacents à la blessure ;
- restituer les fonctions de la partie problématique du membre.
Des vis, des clous, des aiguilles à tricoter, du fil, des plaques et d'autres éléments biologiquement inertes sont utilisés comme éléments de fixation.
Parmi toutes sortes d’opérations, les plus fréquemment réalisées sont :
- repositionnement du bas de la jambe, de la cheville ;
- ostéosynthèse transpédiculaire ;
- repositionner le rayon.
Les indications
Le repositionnement chirurgical est utilisé comme principale méthode de restauration pour :
- les fractures qui ne guérissent pas sans l'aide d'un traumatologue, par exemple les fractures déplacées de l'olécrane et de la rotule, certains types de blessures au col fémoral ;
- dommages avec possibilité de perforation de la peau (transformation d'une blessure fermée en une blessure ouverte) ;
- violations de l'intégrité osseuse avec piégeage des tissus mous entre des fragments osseux ou fractures compliquées par des lésions d'une grosse artère/nerf.
Une intervention chirurgicale est possible si :
- divergences répétées des fragments osseux;
- inaccessibilité de la réduction fermée;
- fractures à récupération lente et pseudarthroses ;
- pseudarthrose.
Contre-indications
- blessures ouvertes, caractérisées par une vaste zone de dommages ou de contamination des tissus adjacents ;
- état général insatisfaisant du patient ;
- infection de la zone touchée;
- maladie osseuse systémique progressive;
- pathologies prononcées des organes internes;
- insuffisance veineuse des extrémités.
Classification des méthodes de restauration osseuse
Selon le moment de l'opération, on distingue le repositionnement primaire et différé. La première est réalisée lors des soins d'urgence lors de l'admission de la victime à l'hôpital, mais au plus tard 24 heures après la fracture. Une intervention chirurgicale différée est réalisée à une date ultérieure.
Selon la technique d'insertion du fixateur, on distingue les principales méthodes de repositionnement : externe ; interne (submersible).
L'ostéosynthèse par ultrasons mérite une attention particulière - une méthode permettant de relier des fragments brisés, de remplir la cavité osseuse et de créer des conglomérats osseux afin de restaurer l'intégrité des zones endommagées grâce au soudage par ultrasons.
La fixation obtenue grâce à l'utilisation de diverses structures peut être :
- relativement stables - des micromouvements mineurs entre fragments brisés sont autorisés, ils ne provoquent pas de douleur et favorisent même la fusion des fragments en formant un cal du côté du périoste (réunion).
- absolu - caractérisé par une absence totale de mouvement entre les fragments osseux dans la zone endommagée.
Conseil: seul un traumatologue expérimenté peut décider quand il est nécessaire et acceptable d'utiliser l'un ou l'autre type de fixation.
Caractéristiques des méthodes d'ostéosynthèse
L'ostéosynthèse extrafocale est réalisée à l'aide de dispositifs de distraction. La méthode de compression permet de ne pas exposer la zone à problèmes et permet de charger le membre sans risque de divergence des fragments. De plus, aucune fixation supplémentaire en plâtre n'est requise. Comme outils auxiliaires, les traumatologues utilisent des aiguilles à tricoter ou des clous solides, qui passent à travers les fragments perpendiculairement à l'axe osseux.
Le repositionnement par immersion est réalisé dans le but d'introduire un fixateur dans la zone endommagée. Cette méthode d'intervention chirurgicale est de trois types - intra-osseuse (intramédullaire), extramédullaire (extramédullaire) et transosseuse. Cette séparation est due à des différences dans l'emplacement de l'élément de fixation. Dans des situations difficiles, les traumatologues peuvent utiliser des techniques complexes, combinant plusieurs méthodes de fixation.
intramédullaire

Il peut être fermé ou ouvert. Dans le premier cas, après avoir connecté les fragments à l'aide de dispositifs spéciaux, une tige métallique est insérée à l'intérieur de la diaphyse (la partie médiane de l'os tubulaire) le long d'un conducteur et sous le contrôle d'un appareil à rayons X. Ensuite, le conducteur est retiré et une suture est placée sur la plaie.
Dans la réduction ouverte la plus courante, la zone endommagée est exposée, les fragments osseux sont alignés, puis une tige mécanique est insérée dans le canal médullaire. Aucun équipement spécial n'est requis ici.
Conseil: La méthode ouverte est plus accessible et plus simple, mais elle augmente le risque d’infection et augmente le volume des tissus mous endommagés.
Extramédullaire

Il est utilisé pour diverses violations de l'intégrité osseuse, quels que soient la localisation, le type de fracture ou les caractéristiques de la diaphyse. Pour la réduction extramédullaire, des plaques de différentes épaisseurs et formes sont utilisées, fixées avec des vis. La plupart des modèles de plaques sont équipés de mécanismes de rapprochement (amovibles et non amovibles). En fin d’intervention, une immobilisation plâtrée est souvent utilisée.
La réduction extramédullaire des fractures hélicoïdales et obliques peut être réalisée à l'aide de fils métalliques, de rubans, d'anneaux spéciaux et de demi-anneaux en acier inoxydable. Cependant, ce type de fixation, notamment la fixation par fil, est rarement utilisé comme méthode indépendante.
Transosseux

Les éléments de fixation sont réalisés dans une direction oblique ou transversale à travers les parois osseuses de la zone endommagée. Un sous-type spécial d’opération prend la forme d’une suture osseuse. Dans ce cas, des tubules sont percés dans des fragments d'os, à travers lesquels sont tirées des ligatures en fil de fer ou en soie. Ils sont ensuite rassemblés et liés. Une suture osseuse est utilisée pour les fractures de la rotule et de l'olécrane. Avec cette réduction, une immobilisation plâtrée est généralement réalisée.
Complications postopératoires
Après repositionnement chirurgical, des complications telles que :
- suppuration dans la zone de fixation de la structure métallique;
- embolie graisseuse;
- ostéomyélite (processus purulent-nécrotique se développant dans les os, la moelle osseuse et les tissus mous voisins) ;
- non-union de fragments;
- rupture du fixateur et sa migration ultérieure dans les tissus mous ;
- nécrose des bords de la plaie.
Conseil: Après le repositionnement chirurgical, le patient a besoin des mêmes soins que les autres patients opérés. Un soin particulier doit être apporté à la surveillance de l'état du bandage et de la position correcte du membre problématique.
L'idée de relier chirurgicalement des fragments osseux après une fracture a considérablement accéléré le processus de traitement et de rééducation des patients présentant des lésions osseuses ouvertes et graves. Malgré la variété des méthodes de traitement, chacune d'elles est nécessaire et importante à sa manière. En résumé, nous pouvons souligner une fois de plus que l'ostéosynthèse est une partie essentielle de la traumatologie, sans laquelle le traitement moderne des os endommagés lors de situations difficiles est impensable.
Vidéo
Attention! Les informations présentes sur le site sont présentées par des spécialistes, mais sont uniquement à titre informatif et ne peuvent être utilisées à des fins de traitement indépendant. Assurez-vous de consulter votre médecin!
Ostéosynthèse extracorticale (extracorticale) est une opération visant à restaurer l'intégrité d'un os après une fracture en y appliquant une plaque spécialement sélectionnée. Effectué de manière ouverte. Les plaques modernes permettent de fixer solidement des parties de l'os en bloquant les têtes de vis dans les trous insérés dans les fragments d'os.
Les indications de ce type de chirurgie pour les fractures peuvent inclure des fragments osseux qui ne peuvent pas être réduits par une méthode fermée, la présence d'un ou plusieurs fragments osseux ou des fractures impliquant des articulations (fractures intra-articulaires).
Caractéristiques de l'ostéosynthèse osseuse
Ce type d'opération est réalisé à l'aide de plaques de titane de différentes tailles. La dernière réalisation dans ce domaine concerne les plaques de type compression dotées de trous spéciaux sur toute leur longueur. Ils permettent de fixer les têtes de vis dans la plaque, qui à leur tour sont insérées dans le tissu osseux des fragments. Après avoir serré les vis, une fixation maximale des fragments osseux est assurée et une compression est créée entre eux.
Cette méthode d'installation des plaques permet une cicatrisation osseuse plus rapide et assure une bonne fixation. Cela élimine la possibilité d'une mauvaise fusion ou d'autres complications.
D'en haut, le site de fracture est recouvert de tissus mous viables du patient.
Avant même de réaliser une chirurgie d’ostéosynthèse externe, il est important de choisir la bonne plaque. Le choix dépend:
- type de blessure
- nombre de fragments d'os,
- localisation de la fracture,
- forme anatomique de l'os.
Une plaque correctement sélectionnée permet de restaurer complètement la forme anatomique de l'os endommagé. Cela aide le patient à reprendre ses activités normales le plus rapidement possible.
Rééducation après ostéosynthèse
Le processus de récupération après ostéosynthèse externe avec plaques est assez long. La période de rééducation complète est individuelle et dépend de la gravité de la blessure et de la complexité de l'opération. Dans certains cas, cela prend 1 à 2 mois, dans d'autres, de 2 à 4 mois.
En période postopératoire, il est important de respecter scrupuleusement les recommandations du médecin. Pour accélérer la récupération et éviter les complications, il est recommandé :
- effectuez une série d'exercices recommandés par votre médecin ;
- limiter la charge sur l'os, l'augmenter progressivement conformément aux recommandations du traumatologue ;
- procédures physiothérapeutiques : échographie, électrophorèse et autres ;
- massothérapie.
- C'est dans les conditions modernes la méthode la plus courante et la plus efficace pour traiter les blessures aux os et aux articulations. De nos jours, différents types sont utilisés. Le plus souvent, un tel traitement est nécessaire pour restaurer les os tubulaires des extrémités. Auparavant, la méthode la plus populaire pour traiter de telles blessures, avec le plâtre, était l'utilisation de dispositifs de fixation transosseux. Mais ils sont encombrants et peu pratiques, et provoquent souvent des infections des plaies. Par conséquent, l’ostéosynthèse intramédullaire est désormais considérée comme plus efficace pour restaurer l’intégrité des os tubulaires.
Qu'est-ce que l'ostéosynthèse
Pour traiter les lésions osseuses, la chirurgie est désormais de plus en plus utilisée plutôt que le plâtre. La chirurgie d'ostéosynthèse assure une fusion osseuse plus efficace et plus rapide. Cela consiste dans le fait que les fragments d'os sont combinés et fixés avec des structures métalliques, des épingles, des aiguilles à tricoter ou des vis. L'ostéosynthèse, selon le mode d'application de ces dispositifs, peut être externe ou submersible.
La deuxième méthode est divisée en ostéosynthèse intramédullaire - fixation de l'os à l'aide de tiges insérées dans le canal médullaire, extramédullaire, lorsque les fragments sont combinés à l'aide de plaques et de vis, et transosseuse - réalisée par des dispositifs externes spéciaux à broche.
Caractéristiques de la méthode
L'idée de la fixation intra-osseuse de fragments a été proposée pour la première fois par le scientifique allemand Kushner dans les années 40 du 20e siècle. Il fut le premier à réaliser l'ostéosynthèse intramédullaire du fémur. La tige qu'il utilisait avait la forme d'un trèfle.
Mais ce n’est que vers la fin du siècle que la technique de l’ostéosynthèse intramédullaire s’est développée et a commencé à être largement utilisée. Des tiges et autres implants d'ostéosynthèse verrouillée ont été développés, qui permettent de fixer solidement des fragments osseux. Selon le but d'utilisation, leur forme, leur taille et leur matériau varient. Certaines broches et tiges permettent de les insérer dans l'os sans percer le canal, ce qui réduit le caractère traumatisant de l'opération. Les tiges modernes pour l'ostéosynthèse centromédullaire ont une forme qui suit les courbures du canal osseux. Ils ont une conception complexe qui leur permet de fixer fermement l'os et d'empêcher les fragments de bouger. Les tiges sont fabriquées à partir d’acier médical ou d’alliages de titane.
Cette méthode est dépourvue de nombreux inconvénients et complications des structures externes. C'est désormais le moyen le plus efficace de traiter les fractures périarticulaires, les lésions des os tubulaires de la jambe, du fémur, de l'épaule et, dans certains cas, même des articulations.
La technique d'ostéosynthèse centromédullaire est efficace pour les fractures périarticulaires des membres
Indications et contre-indications d'utilisation
Cette opération est réalisée pour les fractures fermées du fémur, de l'humérus et du tibia. Ces blessures peuvent être transversales ou obliques. Il est possible de recourir à une telle opération si une fausse articulation se développe en raison d'une mauvaise fusion osseuse. Si la blessure s'accompagne de lésions des tissus mous, il est conseillé de reporter l'ostéosynthèse, car le risque d'infection du site de fracture est élevé. Dans ce cas, l’opération est plus difficile à réaliser, mais elle sera aussi efficace.
L'ostéosynthèse intramédullaire n'est contre-indiquée que dans les fractures ouvertes complexes présentant des lésions étendues des tissus mous, ainsi qu'en présence d'une maladie cutanée infectieuse à l'endroit où la broche doit être insérée. Cette opération n'est pas utilisée chez les patients âgés, car en raison de modifications dégénératives du tissu osseux, l'introduction supplémentaire de broches métalliques peut entraîner des complications.
Certaines maladies peuvent également devenir un obstacle à l’ostéosynthèse intramédullaire. Il s'agit de l'arthrose à un stade avancé de développement, de l'arthrite, des maladies du sang, des infections purulentes. L'opération n'est pas réalisée sur les enfants en raison de la faible largeur du canal osseux.
Types
L'ostéosynthèse intramédullaire fait référence à chirurgie intra-osseuse. Dans ce cas, les fragments sont repositionnés et fixés avec une épingle, une tige ou des vis. Selon le mode d'introduction de ces structures dans le canal osseux, l'ostéosynthèse centromédullaire peut être fermée ou ouverte.
Auparavant, la méthode ouverte était le plus souvent utilisée. Elle se caractérise par l'exposition de la zone endommagée de l'os. Les fragments sont comparés manuellement, puis une tige spéciale est insérée dans le canal médullaire pour les fixer. Mais c'est plus efficace méthode fermée d'ostéosynthèse. Cela ne nécessite qu’une petite incision. À travers celui-ci, une tige est insérée dans le canal osseux à l'aide d'un guide spécial. Tout cela se passe sous le contrôle d’un appareil à rayons X.

Avec l'ostéosynthèse intramédullaire, une tige est insérée dans le canal médullaire
Les broches dans le canal peuvent être installées librement ou avec verrouillage. Dans ce dernier cas, ils sont en outre renforcés des deux côtés par des vis. Si l'ostéosynthèse est réalisée sans blocage, cela augmente la charge sur la moelle osseuse et augmente le risque de complications. De plus, une telle fixation n'est pas stable en cas de fractures obliques et hélicoïdales ou sous des charges de rotation. Il est donc plus efficace d’utiliser des tiges de verrouillage. Maintenant, ils sont produits avec des trous pour les vis. Cette opération non seulement fixe fermement même plusieurs fragments, mais n'entraîne pas de compression de la moelle osseuse, ce qui préserve son apport sanguin.
De plus, l'opération diffère par la méthode d'insertion de la tige. Il peut être introduit avec un forage préalable du canal médullaire, ce qui entraîne sa lésion. Mais récemment, des tiges minces spéciales sont le plus souvent utilisées, qui ne nécessitent pas d'expansion supplémentaire du canal.
Il existe des types encore moins courants d'ostéosynthèse intramédullaire. Les fragments peuvent être fixés avec plusieurs tiges élastiques. Une tige droite et deux tiges courbées opposées l'une à l'autre sont insérées dans l'os. Leurs extrémités sont courbées. Avec cette méthode, aucun plâtre n’est nécessaire. Une autre méthode a été proposée dans les années 60 du 20e siècle. Le canal médullaire est rempli de morceaux de fil afin de le remplir hermétiquement. On pense que cette méthode peut permettre une fixation plus durable des fragments.
Lors du choix du type d’ostéosynthèse, le médecin est guidé par l’état du patient, le type de fracture, sa localisation et la gravité des lésions tissulaires associées.
Pour l'ostéosynthèse intramédullaire, des tiges de différentes conceptions sont utilisées
Ostéosynthèse ouverte
Cette opération est plus courante car plus simple et plus fiable. Mais, comme toute autre opération, elle s'accompagne d'une perte de sang et d'une violation de l'intégrité des tissus mous. Par conséquent, les complications surviennent plus souvent après une ostéosynthèse intramédullaire ouverte. Mais l'avantage d'utiliser cette méthode est la possibilité de l'utiliser dans un traitement complexe avec divers dispositifs de fixation transosseuse. L'ostéosynthèse intramédullaire ouverte séparément est désormais très rarement utilisée.
Pendant l'opération, la zone de fracture est exposée et les fragments osseux sont comparés manuellement sans utiliser d'appareils. C’est précisément l’avantage de la méthode, surtout lorsqu’il y a de nombreux fragments. Après avoir comparé les fragments, ils sont fixés avec une tige. La tige peut être insérée de trois manières.
En cas d'insertion directe, il est nécessaire d'exposer un autre morceau d'os au-dessus de la fracture. À cet endroit, un trou est percé le long du canal médullaire et un clou y est inséré, l'utilisant pour comparer les fragments. En cas d'insertion rétrograde, ils commencent par le fragment central, en le comparant au reste, en enfonçant progressivement le clou dans le canal médullaire. Il est possible d'insérer la tige le long du conducteur. Dans ce cas, cela part également du fragment central.
Avec l'ostéosynthèse intramédullaire du fémur, l'alignement des fragments est généralement si fort que l'application de plâtre n'est pas nécessaire. Si l’intervention chirurgicale est pratiquée sur le bas de la jambe, l’avant-bras ou l’humérus, elle se termine généralement par l’application d’un plâtre.
Ostéosynthèse fermée
Cette méthode est désormais considérée comme la plus efficace et la plus sûre. Une fois réalisé, il ne reste aucune trace. Par rapport aux autres opérations d’ostéosynthèse, elle présente plusieurs avantages :
- lésions mineures des tissus mous ;
- peu de perte de sang;
- fixation stable des os sans intervention dans la zone fracturée;
- temps de fonctionnement court ;
- restauration rapide des fonctions des membres;
- pas besoin de plâtrer le membre ;
- Possibilité d'utilisation pour l'ostéoporose.
L'essence de la méthode d'ostéosynthèse intramédullaire fermée est qu'une broche est insérée dans l'os par une petite incision. L'incision est pratiquée à distance du site de fracture, les complications sont donc rares. Tout d’abord, à l’aide d’un appareil spécial, les fragments osseux sont repositionnés. L'ensemble du processus opératoire est surveillé par radiographie.

L’opération d’ostéosynthèse intramédullaire fermée est peu traumatisante et sûre
Récemment, cette méthode a été améliorée. Les broches de fixation comportent des trous sur chaque bord. Des vis y sont insérées à travers l'os, ce qui verrouille la broche et l'empêche ainsi que les fragments d'os de bouger. Cette ostéosynthèse verrouillée assure une fusion osseuse plus efficace et prévient les complications. Après tout, la charge pendant le mouvement est répartie entre l'os et la tige.
La fixation du site de fracture à l'aide de cette méthode est si forte que dès le lendemain, vous pouvez appliquer une charge dosée sur le membre blessé. Effectuer des exercices spéciaux stimule la formation de callosités. Par conséquent, l’os guérit rapidement et sans complications.
Une caractéristique de l’ostéosynthèse centromédullaire verrouillée est sa plus grande efficacité par rapport aux autres méthodes de traitement. Il est indiqué pour les fractures complexes, les blessures combinées et en présence de nombreux fragments. Cette opération peut être utilisée même chez les patients obèses et les patients souffrant d'ostéoporose, puisque les broches qui fixent l'os sont fermement fixées à plusieurs endroits.
Complications
Les conséquences négatives de l'ostéosynthèse intramédullaire sont rares. Ils sont principalement liés à la mauvaise qualité des tiges de fixation, qui peuvent se corroder, voire se briser. De plus, l'introduction d'un corps étranger dans le canal médullaire provoque une compression et une perturbation de l'apport sanguin. Une destruction de la moelle osseuse peut survenir, provoquant une embolie graisseuse, voire un choc. De plus, les tiges droites ne comparent pas toujours correctement les fragments d'os tubulaires, en particulier ceux qui ont une forme incurvée - tibia, fémur et radius.

Habituellement, après une telle opération, la récupération se produit rapidement; la charge mesurée sur le membre peut être appliquée presque immédiatement
Récupération après la chirurgie
Le patient est autorisé à bouger après une ostéosynthèse intramédullaire fermée dans un délai de 1 à 2 jours. Même en cas de chirurgie du bas de la jambe, vous pouvez marcher avec des béquilles. Au cours des premiers jours, une douleur intense au membre blessé est possible, qui peut être soulagée par des analgésiques. Le recours à des procédures physiothérapeutiques est indiqué pour accélérer la guérison. Assurez-vous d'effectuer des exercices spéciaux, d'abord sous la direction d'un médecin, puis par vous-même. La récupération prend généralement de 3 à 6 mois. L’opération de retrait de la tige est encore moins traumatisante que l’ostéosynthèse elle-même.
L'efficacité de la fixation osseuse dépend du type de blessure et de l'exactitude de la méthode choisie par le médecin. Les fractures aux bords lisses et avec un petit nombre de fragments guérissent mieux. L'efficacité de l'opération dépend également du type de tige. S'il est trop épais, il peut y avoir des complications dues à la compression de la moelle épinière. Une tige très fine n’offre pas une bonne tenue et peut même se briser. Mais aujourd'hui, de telles erreurs médicales sont rares, car toutes les étapes de l'opération sont contrôlées par un équipement spécial, qui prévoit tous les aspects négatifs possibles.
Dans la plupart des cas, les avis des patients sur la chirurgie d'ostéosynthèse intramédullaire sont positifs. Après tout, il vous permet de reprendre rapidement une vie normale après une blessure, entraîne rarement des complications et est bien toléré. Et l’os guérit bien mieux qu’avec les méthodes de traitement conventionnelles.