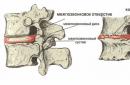Le cerveau est divisé par la fissure interhémisphérique longitudinale en 2 hémisphères, chacun comportant 5 lobes distincts. Les lobes frontal, temporal, pariétal et occipital forment la surface du cerveau ; L'insula est cachée sous le lobe temporal. Bien que des fonctions spécifiques soient associées à l’activité de lobes individuels, la plupart des fonctions cérébrales nécessitent une coordination de l’activité de nombreuses zones des deux hémisphères. Par exemple, bien que le cortex occipital contienne le centre de traitement visuel cortical, des parties fonctionnelles des lobes pariétal, temporal et frontal des deux côtés sont également impliquées dans le traitement de stimuli visuels complexes.
Du point de vue de la réalisation d'activités spécifiques, les fonctions des hémisphères cérébraux sont assez clairement latéralisées. Les signaux visuels, tactiles et moteurs du côté gauche du corps sont envoyés principalement vers l’hémisphère droit, et vice versa. Les deux hémisphères sont impliqués dans l’exercice de certaines fonctions complexes, mais un contrôle prédominant est exercé par un seul hémisphère. Par exemple, l’hémisphère gauche domine dans la parole et l’hémisphère droit domine dans l’orientation spatiale.
Le cortex cérébral contient des aires sensorielles et motrices primaires, ainsi que de multiples aires d'association. Les zones sensorielles primaires reçoivent des informations somatosensorielles, auditives, visuelles, olfactives et gustatives des récepteurs périphériques. Les signaux sensoriels sont traités dans des zones d'association associées à un ou plusieurs organes sensoriels. La zone motrice principale du cortex cérébral assure les mouvements volontaires du corps ; les zones motrices associatives sont impliquées dans la planification et l’exécution d’activités motrices complexes.
Les zones d'association hétéromodales dans les lobes frontaux, temporaux et pariétaux intègrent des signaux sensoriels, des retours moteurs et d'autres informations avec des schémas instinctifs et des compétences acquises. Cette intégration favorise l’apprentissage et façonne les pensées, les émotions et les comportements.
Lobes frontaux. Les lobes frontaux du cerveau assurent l'autorégulation de l'activité mentale dans des éléments tels que la définition d'objectifs en relation avec des motivations et des intentions, la formation d'un programme pour atteindre un objectif et le suivi de sa mise en œuvre. Le rôle des lobes frontaux dans l'organisation des mouvements et des actions, le développement des compétences est dû aux connexions directes des sections antérieures avec le cortex moteur - zones motrices et prémotrices. Les lobes frontaux contiennent au moins 4 régions fonctionnellement distinctes : le cortex moteur primaire dans le gyrus précentral, le cortex médial, le cortex antérieur et le cortex latéral.
La division médiale est responsable des fonctions d'activation, de tonus et de motivation. La section antérieure contrôle le comportement social, la section inférolatérale contrôle la production de la parole ; la région dorsolatérale contrôle la mémoire de travail.
Avec des dommages importants aux parties médiales des lobes frontaux impliquant le pôle antérieur du lobe frontal, les patients présentent des traits de manque de volonté dans leur comportement. Les patients présentant des lésions des lobes frontaux antérieurs peuvent également devenir à la fois émotionnellement labiles et indifférents aux stimuli externes et aux conséquences de leurs actions. Ils peuvent être tour à tour euphoriques, spirituels, vulgaires et indifférents, faisant fi des normes de comportement généralement acceptées. Une lésion bilatérale aiguë des régions préfrontales se manifeste cliniquement par une verbosité incontrôlée, un comportement agité et une intrusion sociale. Avec l’âge, notamment au cours du développement, les lobes frontaux dégénèrent, entraînant une désinhibition et un comportement pathologique.
Les dommages au cortex frontal inférolatéral sont à l'origine du développement de l'aphasie expressive - une détérioration de la prononciation des mots. Les lésions du cortex frontal dorsolatéral peuvent altérer la capacité à stocker des informations et à les traiter en temps réel.
Certaines zones corticales contrôlent des fonctions motrices et sensorielles spécifiques du côté opposé du corps. La surface du cortex contrôlant des parties spécifiques du corps varie ; par exemple, la zone du cortex qui contrôle la main est plus grande que la zone qui contrôle l'épaule. Une carte de ces zones est appelée un homoncule.
Les zones prémotrices et motrices du cortex frontal de chaque hémisphère régulent les mouvements du côté opposé du corps. Étant donné que 90 % des fibres motrices de chaque hémisphère traversent la ligne médiane du tronc cérébral, les lésions du cortex moteur d’un hémisphère provoquent une faiblesse ou une paralysie du côté opposé du corps.
Lobes pariétaux. La zone située derrière la fissure rolandique des lobes pariétaux intègre des signaux proprioceptifs, des informations somatosensorielles, et est impliquée dans les processus de reconnaissance et de récupération de mémoire d'informations sur la forme des objets, leur texture et leur poids. Dans le cortex somatosensoriel primaire, situé dans les lobes pariétaux antérieurs, toutes les fonctions somatosensorielles d'un côté du corps sont contrôlées par le côté controlatéral. La plupart des parties postérolatérales des lobes pariétaux sont responsables de la formation de relations visuo-spatiales, intégrant ces perceptions avec d'autres sensations, ce qui permet de comprendre les trajectoires de mouvement des objets. Ces divisions déterminent également la proprioception. Une zone du cortex située dans le lobe pariétal moyen de l'hémisphère dominant, appelée zone de Gerstmann, est responsable du comptage, de l'écriture, de la distinction entre les côtés droit et gauche et de la reconnaissance des doigts. Le gyrus angulaire voisin est responsable de la reconnaissance des mots, et ses dommages provoquent une « cécité des mots », c'est-à-dire incapacité à lire. Le lobe pariétal sous-dominant est responsable de la perception de l'espace du côté controlatéral, de la relation des différentes parties du corps entre elles, de la relation des objets dans l'espace, ce qui est important, par exemple, pour le dessin.
Les lésions du lobe pariétal antérieur sont associées au développement d'une agnosie tactile. Les symptômes de lésions des sections latérales sont l'acalculie, l'agraphie, la capacité de distinguer les côtés droit et gauche, ainsi que l'agnosie des doigts - la capacité de reconnaître les doigts. Les symptômes de lésions aiguës du lobe pariétal sous-dominant comprennent : l'ignorance de l'espace du côté opposé, ce qui provoque une violation de l'orientation de son propre corps, une apraxie constructive et la méconnaissance de la paralysie. Avec des lésions plus petites, une apraxie de l'habillage ou une perte d'autres compétences habituelles se développe.
Lobes temporaux. Les structures du lobe temporal sont importantes pour l’audition, la perception de la parole, la mémoire verbale et visuelle et les émotions. Les patients présentant des lésions du lobe temporal droit perdent généralement l'acuité de perception des stimuli auditifs non verbaux. Lorsque le lobe temporal gauche est endommagé, des troubles de la gnose, de la mémoire, de la compréhension et de la construction de la parole surviennent. Les patients présentant des foyers épileptogènes dans la région limbique médiale du lobe temporal, responsable de la formation des émotions, développent des crises partielles complexes avec des sensations incontrôlables et des troubles transitoires des fonctions autonomes, cognitives et affectives. Au cours de la période intercritique, les patients atteints du lobe temporal peuvent subir des changements de personnalité sous la forme d'une violation du sens de l'humour, d'une tendance à philosopher, au mysticisme et à l'obsession ; chez les hommes, il y a un affaiblissement de la sexualité.
Lobe occipital. Le lobe occipital contient le cortex visuel primaire et les structures d'association visuelle. Lorsque le cortex visuel primaire est endommagé, une cécité centrale se développe en combinaison avec une anosognosie simultanée de la cécité, appelée syndrome d'Anton ; le déni de la perte totale de la vision est apparemment dû à l'émergence d'images visuelles confabulaires, qui sont considérées par les patients comme de véritables impressions visuelles. L'activité épileptogène dans le lobe occipital peut provoquer des hallucinations visuelles, souvent constituées de lignes ou de boucles colorées s'étendant dans la zone visuelle controlatérale.
Lobe insulaire. L'insula intègre les impulsions sensorielles et autonomes provenant des organes internes. L'insula est impliquée dans certaines fonctions du langage, comme en témoigne le développement d'aphasie chez les patients présentant des lésions insulaires. L'insula traite la perception de la douleur, de la température et éventuellement du goût.
Causes du dysfonctionnement cérébral
Les déficiences des fonctions cérébrales allant de minimes à graves peuvent être de nature focale ou diffuse. Les dommages focaux et diffus aux structures sous-corticales perturbent leur influence activatrice sur le système nerveux central, provoquant des troubles de la conscience et de la pensée.
Les lésions focales sont basées sur des changements ou des dommages structurels et morphologiques. Les manifestations cliniques dépendent de la localisation de la lésion, de la taille et du stade de développement du processus pathologique. Les processus pathologiques à progression lente de moins de 2 cm de diamètre peuvent être asymptomatiques. Lorsque la lésion est plus grande, se développe rapidement ou touche les deux hémisphères, les symptômes sont plus susceptibles d’apparaître.
En règle générale, le dysfonctionnement général de l'activité intégrative du cerveau est le résultat de troubles toxiques et métaboliques, moins souvent - la conséquence d'un processus inflammatoire diffus, d'une vasculopathie, de lésions traumatiques étendues et de métastases multiples. Les conditions pathologiques énumérées entraînent une grande variété de dysfonctionnements cérébraux.
Les lésions focales de la substance blanche peuvent perturber les connexions entre les parties du cerveau et provoquer un syndrome de déconnexion.
La guérison d'un traumatisme crânien est déterminée en partie par le degré de plasticité de la partie intacte restante, qui varie en fonction de l'âge et de l'état de santé de la victime. La plasticité maximale est caractéristique du cerveau en développement. Par exemple, en cas de dommages importants au centre de la parole dans l'hémisphère dominant avant l'âge de 8 ans, le deuxième hémisphère remplace généralement presque complètement la fonction perdue. Malgré le maintien d'une plasticité cérébrale assez élevée après la première décennie de la vie, des dommages massifs après l'âge de 10 ans sont susceptibles d'entraîner la formation d'un déficit fonctionnel permanent. La réorganisation macroscopique des fonctions cérébrales suite à une lésion chez l'adulte est rare, bien que la plasticité locale persiste dans la plupart des régions du cerveau tout au long de la vie.
Principaux syndromes de dysfonctionnement cérébral. Les syndromes spécifiques comprennent l'agnosie, l'amnésie, l'aphasie et l'apraxie. Ces manifestations sont également observées dans certains troubles mentaux. Le diagnostic final est posé sur la base d'un examen clinique et neuropsychologique. L'identification de la cause de la maladie nécessite généralement des tests de laboratoire supplémentaires et l'utilisation de méthodes d'imagerie structurelle ou fonctionnelle.
Insula (îlot)
situé dans les profondeurs du sillon latéral, recouvert d'un tegmentum formé de parties des lobes frontal, pariétal et temporal. La profonde fissure circulaire de l’insula sépare l’insula des parties environnantes du cerveau. La partie inférieure de l'insula est dépourvue de rainures et présente un léger épaississement - le seuil de l'insula. À la surface de l'insula, on distingue un gyrus long et un gyrus court.
Surface médiale de l'hémisphère cérébral.
Tous ses lobes, à l'exception du lobe insulaire, participent à la formation de la surface médiale de l'hémisphère cérébral. Le sillon du corps calleux le contourne par le haut, séparant le corps calleux du gyrus lombaire, descend et avance et continue dans le sillon de l'hippocampe.
Le sillon cingulaire s'étend au-dessus du gyrus cingulaire, qui commence en avant et en bas du bec du corps calleux. En s'élevant, le sillon se retourne et s'étend parallèlement au sillon du corps calleux. Au niveau de sa crête, sa partie marginale s'étend vers le haut à partir du sillon cingulaire, et le sillon lui-même se poursuit dans le sillon sous-pariétal. La partie marginale du sillon cingulaire limite le lobule péricentral en arrière et le précuneus, qui appartient au lobe pariétal, en avant. En bas et en arrière à travers l'isthme, le gyrus cingulaire passe dans le gyrus parahippocampique, qui se termine en avant par un crochet et est délimité supérieurement par le sillon hippocampique. Le gyrus cingulaire, l'isthme et le gyrus parahippocampique sont regroupés sous le nom de gyrus voûté. Le gyrus denté est situé profondément dans le sillon hippocampique. Au niveau du splénium du corps calleux, la partie marginale du sillon cingulaire se ramifie vers le haut à partir du sillon cingulaire.
La surface inférieure de l'hémisphère cérébral présente le relief le plus complexe. Devant se trouve la surface du lobe frontal, derrière elle se trouve le pôle temporal et la surface inférieure des lobes temporal et occipital, entre lesquels il n'y a pas de frontière claire. Entre la fissure longitudinale de l'hémisphère et le sillon olfactif du lobe frontal se trouve un gyrus droit. Latéralement au sillon olfactif se trouvent les gyri orbitaux. Le gyrus lingual du lobe occipital est limité sur le côté latéral par le sillon occipitotemporal (collatéral). Ce sillon passe à la surface inférieure du lobe temporal, divisant les gyri parahippocampique et occipitotemporal médial. En avant du sillon occipitotemporal se trouve le sillon nasal, qui borde l'extrémité antérieure du gyrus parahippocampique - l'uncus. Le sillon occipitotemporal sépare les gyri occipitotemporal médial et latéral.
Sur les surfaces médiale et inférieure, il existe un certain nombre de formations liées au système limbique (du latin Limbus-border). Il s'agit du bulbe olfactif, du tractus olfactif, du triangle olfactif, de la substance perforée antérieure, des corps mamillaires situés sur la face inférieure du lobe frontal (partie périphérique du cerveau olfactif), ainsi que du cingulaire, du parahippocampe (avec le crochet) et gyri denté. Les structures sous-corticales du système limbique sont l'amygdale, les noyaux septaux et le noyau thalamique antérieur.
Le système limbique est relié à d’autres zones du cerveau : avec l’hypothalamus, et à travers lui avec le mésencéphale, le cortex temporal et le lobe frontal. Ce dernier régule apparemment les fonctions du système limbique. Le système limbique est un substrat morphologique qui contrôle le comportement émotionnel d’une personne et contrôle son adaptation générale aux conditions environnementales.
Tous les signaux provenant des analyseurs, en route vers les centres correspondants du cortex cérébral, traversent une ou plusieurs structures du système limbique. Les signaux descendants du cortex cérébral traversent également les structures limbiques.
La structure du cortex cérébral.
Le cortex cérébral est formé de matière grise, qui se trouve à la périphérie (à la surface) des hémisphères cérébraux. Le cortex cérébral est dominé par le néocortex (environ 90 %) - le nouveau cortex, apparu pour la première fois chez les mammifères. Les zones phylogénétiquement plus anciennes du cortex comprennent l'ancien cortex - l'archécortex (gyrus denté et base de l'hippocampe) ainsi que l'ancien cortex - le paléocortex (régions prépériforme, préamygdale et entorhinale). L'épaisseur du cortex dans différentes parties des hémisphères varie de 1,3 à 5 mm. Le cortex le plus épais est situé dans les parties supérieures des gyri précentral et postcentral et au niveau du lobule paracentral. Le cortex de la surface convexe des gyri est plus épais que celui des rainures latérales et inférieures. La surface du cortex cérébral d'un adulte atteint 450 000 cm2, dont un tiers recouvre les parties convexes des gyri et les deux tiers recouvrent les parois latérales et inférieures des sillons. Le cortex contient 10 à 14 milliards de neurones, chacun formant des synapses avec environ 8 à 10 000 autres.
1.1. Cerveau
Cerveau est une formation composée de deux hémisphères du cerveau - droit et gauche, qui sont reliés par une commissure blanche massive (corps calleux), formée de gros faisceaux de fibres associatives myélinisées, et de deux petits hémisphères - le cervelet.
Chez les nouveau-nés, le poids du cerveau est en moyenne de 340 g, double à 6 mois et triple à 3 ans (respectivement 600 et 1 018 g). Vers l'âge de 7 à 8 ans, la masse cérébrale devient égale à la masse du cerveau adulte et n'augmente plus (normalement, les fluctuations individuelles de la masse cérébrale peuvent être importantes).
La surface totale du cortex cérébral (cape) est de 2500 cm2, avec 2/3 de la surface située dans les profondeurs des sillons, et 1/3 sur la surface visible des hémisphères.
Selon les caractéristiques anatomiques et physiologiques de la structure, on distingue :
Cerveau antérieur (deux hémisphères cérébraux, noyaux gris centraux sous-corticaux) ;
Diencéphale (thalamus, hypothalamus, métathalamus, sous-thalamus, épithalamus) ;
Mésencéphale ;
Cerveau postérieur (tronc cérébral, cervelet).
La plus grande partie du cerveau est hémisphères cérébraux. Dans chaque hémisphère, il y a les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux et l'insula (Fig. 1.1).
La surface latérale des hémisphères est parsemée de nombreuses rainures dont les principales sont les latérales (silvieva) sillon séparant les lobes frontal et pariétal du lobe temporal, central (Rolandova) un sillon séparant le lobe frontal du lobe pariétal et un sillon pariéto-occipital, courant le long de la surface interne de l'hémisphère et séparant le lobe pariétal du lobe occipital. Devant
Riz. 1.1.Hémisphères cérébraux:
UN- face latérale supérieure de l'hémisphère droit : lobe frontal (gyrus précentral, sillon précentral, gyrus frontal supérieur, gyrus frontal moyen, gyrus frontal inférieur, sillon central, sillon latéral), lobe pariétal (gyrus postcentral, sillon postcentral, sillon intrapariétal, supramarginal gyrus, gyrus angulaire), lobe occipital, lobe temporal (gyrus temporal supérieur, sillon temporal supérieur, gyrus temporal moyen, sillon temporal moyen, gyrus temporal inférieur ;
b- face médiale de l'hémisphère droit : lobule paracentral, précuneus, sillon pariéto-occipital, coin, gyrus lingual, gyrus occipitotemporal latéral, gyrus parahippocampique, uncus, fornix, corps calleux, gyrus frontal supérieur, gyrus cingulaire ; V- face inférieure du cerveau : fissure longitudinale cérébrale, sillons orbitaires, nerf olfactif, chiasme optique, sillon temporal moyen, uncus, gyrus temporal inférieur, corps mastoïde, base du pédoncule cérébral, gyrus occipitotemporal latéral, gyrus parahippocampique, sillon collatéral, cingulaire gyrus, gyrus lingual, sillon olfactif, gyrus droit
du sulcus central se trouve le gyrus central antérieur, dans lequel est représenté l'analyseur moteur - le centre le plus élevé de régulation des mouvements. Il est formé de cellules de forme pyramidale (cellules de Betz), donnant naissance aux voies corticobulbaire et corticospinale (voie pyramidale). Grâce à lui, des signaux de régulation des mouvements volontaires sont envoyés aux noyaux des nerfs crâniens et aux cellules des cornes antérieures de la moelle épinière.
Lobe frontal séparé du sillon central pariétal et du sillon temporal par le sillon latéral. Sur la surface externe du lobe frontal, il y a quatre gyri : verticaux (précentral) et trois horizontaux (supérieur, moyen et inférieur). Le gyrus vertical est situé entre les sillons central et précentral. Le gyrus frontal supérieur est situé au-dessus du sillon frontal supérieur, celui du milieu se situe entre le sillon frontal supérieur et inférieur, celui du bas se situe entre le sillon frontal inférieur et le sillon latéral. Sur la surface inférieure (basale) des lobes frontaux, on distingue les gyri directs et orbitaux, qui sont formés par les sillons olfactifs et orbitaux. Le gyrus recta se situe entre le bord interne de l'hémisphère et le sillon olfactif. Au fond du sillon olfactif se trouvent le bulbe olfactif et le tractus olfactif. La fonction des lobes frontaux est associée à l'organisation d'un programme de mouvements volontaires, de mécanismes moteurs de la parole, de régulation de formes complexes de comportement et de processus de pensée.
Lobe pariétal séparé du sillon central frontal, du temporal - par le sillon latéral, de l'occipital - par une ligne imaginaire allant du bord supérieur du sillon pariéto-occipital jusqu'au bord inférieur de l'hémisphère. Dans le lobe pariétal, sur la surface externe, il y a un gyrus postcentral vertical et deux lobules horizontaux - le pariétal supérieur et le pariétal inférieur. Le gyrus postcentral est délimité par les sillons central et postcentral ; Le lobe pariétal supérieur est situé au-dessus du sillon intrapariétal horizontal et le lobe inférieur est situé en dessous du sillon intrapariétal. La partie du lobule pariétal inférieur située au-dessus de la partie postérieure du sillon latéral est appelée gyrus supramarginal, et la partie entourant le processus ascendant du sillon temporal supérieur est appelée gyrus angulaire. La fonction du lobe pariétal est principalement associée à la perception et à l'analyse des stimuli sensoriels, à l'orientation spatiale et à la régulation de mouvements ciblés.
Lobe temporal séparé des lobes frontaux et pariétaux par le sillon latéral et diffère fortement par sa structure des autres lobes du cerveau. La partie externe du lobe temporal est le nouveau cortex (néocortex), la partie interne - l'hippocampe - comprend l'ancien (paléocortex) et l'ancien cortex (archicortex). Sur la surface externe du lobe temporal, on distingue les gyri temporaux supérieur, moyen et inférieur. Le gyrus temporal supérieur est situé entre le sillon temporal latéral et supérieur, le milieu - entre le sillon temporal supérieur et inférieur, l'inférieur - vers le bas à partir du sillon temporal inférieur. Sur la surface basale inférieure du lobe temporal se trouvent le gyrus occipitotemporal latéral, bordant le gyrus temporal inférieur, et plus médialement le gyrus hippocampique. La fonction du lobe temporal est associée à la perception des sensations auditives, gustatives, olfactives, à l'analyse et à la synthèse des sons de la parole et aux mécanismes de mémoire.
Dans les profondeurs du sillon latéral, il y a ce qu'on appelle lobe fermé, ou île. L'insula est recouverte par des zones des lobes frontaux, pariétaux et temporaux qui constituent l'opercule, ou opercule L'insula est séparée des sections voisines adjacentes par une rainure circulaire. Le sillon central longitudinal divise l'insula en parties antérieure et postérieure. La fonction de l’insula est liée à la perception du goût.
Hippocampe - une structure appariée située dans les régions temporales médiales des hémisphères. Les hippocampes droit et gauche sont reliés par des fibres nerveuses commissurales passant par la commissure du fornix. Les hippocampes forment les parois médiales des cornes inférieures des ventricules latéraux, situées dans l'épaisseur des hémisphères cérébraux, s'étendent jusqu'aux sections les plus antérieures des cornes inférieures du ventricule latéral et se terminent par des épaississements divisés par de petits sillons en tubercules séparés - les orteils de l'hippocampe. Du côté médial, le fimbria hippocampique, qui est une continuation du pédoncule du télencéphale, est fusionné avec l'hippocampe. Les plexus choroïdes des ventricules latéraux sont adjacents aux fimbriae de l'hippocampe. L'hippocampe appartient à l'un des systèmes cérébraux phylogénétiquement les plus anciens - le cerveau olfactif, qui détermine la polymodalité fonctionnelle de l'hippocampe. L’une de ses fonctions principales est le recodage des informations de la mémoire à court terme d’une personne pour son enregistrement ultérieur dans la mémoire à long terme.
Lobe occipital occupe les sections postérieures des hémisphères ; sur la surface externe, il n'a pas de limites claires le séparant des lobes pariétaux et temporaux. Sur la face interne, le lobe pariétal est séparé du lobe occipital par le sillon pariéto-occipital. Les rainures et circonvolutions de la surface externe du lobe occipital ne sont pas constantes et ont une topographie variable. La surface interne du lobe occipital est divisée en cuneus et en gyrus lingual par le sillon calcarin horizontal. La fonction du lobe occipital est associée à la perception et au traitement des informations visuelles.
Sur la surface médiale des hémisphères au-dessus du corps calleux se trouve le gyrus cingulaire, qui traverse l'isthme derrière le corps calleux dans le gyrus parahippocampique. Le gyrus cingulaire, avec le gyrus parahippocampique, constitue le gyrus voûté. Sur la surface médiale des hémisphères se trouvent des zones du cortex qui font partie d'un complexe de deux systèmes fonctionnels étroitement interconnectés : le cerveau olfactif et le système limbique.
Cerveau olfactif se compose de deux sections - périphérique et centrale. La section périphérique est représentée par le nerf olfactif, les bulbes olfactifs, les centres olfactifs primaires et est reliée aux zones corticales des deux hémisphères. La division centrale comprend le gyrus hippocampique, les gyrus dentés et voûtés. Le cerveau olfactif est l'un des composants les plus importants du système limbique, qui réunit, en plus de lui, des structures sous-corticales - le noyau caudé, le putamen, l'amygdale, le thalamus, l'hypothalamus, ainsi que de nombreuses voies reliant ces formations entre elles. Le système limbique est en lien fonctionnel étroit avec la formation réticulaire du tronc cérébral, constituant le complexe limbique-réticulaire.
Thalamus optique, thalamus. L'essentiel de la matière grise du diencéphale appartient au thalamus visuel, situé de part et d'autre du troisième ventricule. Le thalamus est divisé en noyaux par des couches de substance blanche, qui sont actuellement au nombre de 150. Cependant, les principaux sont les noyaux antérieur, ventrolatéral, médial, postérieur et intralamellaire. Le thalamus est de forme ovoïde, sa partie antérieure est pointue (tubercule antérieur) et la partie postérieure est arrondie et épaissie (coussin). Extérieurement, le thalamus visuel est limité par la capsule interne. Le thalamus visuel a de nombreuses connexions afférentes et efférentes avec le cortex, le striatum
corps, noyau rouge, colliculus supérieur, région hypothalamique, formation réticulaire et cervelet, structures du système limbique.
Métathalamus représenté par les corps géniculés médial et latéral.
Le thalamus et le métathalamus sont les centres afférents les plus importants, collecteurs d'impulsions afférentes ascendantes liées à la sensibilité profonde et superficielle, et analyseurs primaires de la vision, de l'audition et du goût.
À épithalamus inclure la laisse et la glande pinéale. Le corps pinéal est relié au cerveau par deux plaques de matière blanche : celle du haut passe dans les laisses, reliées entre elles par l'adhésion des laisses, et celle du bas descend jusqu'à la commissure postérieure du cerveau. Le corps pinéal appartient au système endocrinien, entretient des relations fonctionnelles étroites avec l'hypophyse (lobe antérieur) et les glandes surrénales, participe à la régulation du développement des caractères sexuels (notamment pendant l'enfance et la puberté), ainsi qu'au sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien.
Hypothalamus. À partir du thalamus optique se trouve un groupe de noyaux hautement différenciés (32 paires) qui constituent l'hypothalamus. Les noyaux de l'hypothalamus sont divisés en 3 groupes : antérieur, moyen et postérieur, chacun ayant sa propre signification fonctionnelle. Les sections antérieures de l'hypothalamus sont liées à l'intégration de la partie à prédominance parasympathique du système nerveux autonome, les sections postérieures - la sympathique et les sections médianes assurent la régulation de l'activité des glandes endocrines et du métabolisme.
Les fibres autonomes de l'hypothalamus forment des connexions avec l'hypophyse, la glande pinéale, la matière grise autour du troisième ventricule et l'aqueduc sylvien, les noyaux végétatifs de la moelle allongée, la formation réticulaire, les cellules des cornes latérales de la moelle épinière. Il existe également de nombreuses connexions entre les noyaux de l'hypothalamus et du thalamus optique, le système striopallidal, le cerveau olfactif et le noyau amygdale.
Actuellement, dans la région hypothalamique, il existe ce qu'on appelle région sous-thalamique, incluant le noyau subthalamique de Lewis, la zone indéterminée de la région de Trout (H 1 et H 2) et quelques autres formations. Fonctionnellement, la région sous-thalamique fait partie du système extrapyramidal.

Riz. 1.2.Coupe frontale du cerveau au niveau des corps mastoïdiens :
I - fissure longitudinale interhémisphérique ; 2 - coffre-fort ; 3 - corps calleux; 4 - plexus choroïde du ventricule latéral ; 5 - éclat du corps calleux ; 6 - noyau médial du thalamus ; 7 - queue du noyau caudé ; 8 - hippocampe ; 9 - noyau sous-thalamique ; 10-III ventricule ;
II - corps mastoïdiens ; 12 - base du pédoncule cérébral ; 13 - amygdale; 14 - tractus optique ; 15 - corne inférieure du ventricule latéral ; 16 - sillon temporal supérieur ; 17 - clôture ; 18 - île ; 19 - rainure latérale ; 20 - pneu; 21 - coquille; 22 - globe pallidus ; 23 - capsule interne ; 24 - noyaux latéraux du thalamus ; 25 - noyau caudé ;
26 - plaque médullaire du thalamus ;
27 - noyaux antérieurs du thalamus
Dans la partie inférieure de l'hypothalamus se trouvent le tubercule gris et l'infundibulum. L'entonnoir se termine par l'appendice inférieur du cerveau - l'hypophyse.
Pituitaire est l’une des glandes endocrines les plus importantes ; phylogénétiquement et fonctionnellement, il est étroitement lié à l'hypothalamus. L'hypophyse est divisée en un lobe antérieur (adénohypophyse), un lobe postérieur (neurohypophyse) et une partie intermédiaire, située comme bordure dans la partie postérieure du lobe antérieur. Le lobe antérieur se développe à partir de l'épithélium de la poche pharyngée de Rathke et le lobe postérieur se développe à partir du processus infundibulaire de l'hypothalamus.
Sur une coupe horizontale du cerveau au niveau des pôles des lobes frontaux et occipitaux, ventricules du cerveau, qui ont la forme d'un papillon : au milieu se trouve le troisième ventricule, sur les côtés, comme les ailes, se trouvent les ventricules latéraux, dans lesquels se distinguent le corps, les cornes antérieures, postérieures et inférieures. Entre les cornes postérieures des ventricules latéraux se trouve la glande pinéale - épiphyse À l'extérieur du côté concave des ventricules se trouve striatum, constitué des noyaux basaux, qui sont des amas de matière grise : le noyau caudé, le globus pallidus, le thalamus (Fig. 1.2, 1.3). Ces formations constituent le système extrapyramidal. Les noyaux basaux sont traversés par une bande de substance blanche, en forme de boomerang, entre le noyau caudé et le thalamus optique, d'une part, et le noyau lenticulaire, d'autre part. Ce capsule intérieure, constitué de fibres de projection et présentant une coupe horizontale
vue d'un angle obtus, ouverte vers l'extérieur. Dans la capsule intérieure se trouvent jambe antérieure, jambe postérieure et les connecter genou. Toutes les sections de la capsule sont représentées par des fibres ascendantes et descendantes reliant le cortex cérébral aux sections sous-jacentes du cerveau et de la moelle épinière. Jambe avant la capsule interne est représentée par des fibres efférentes, dirigées
du cortex frontal au thalamus optique (voie corticothalamique) et au cervelet en passant par le pont (voie cortico-ponto-cérébelleuse). Au genou et aux 2/3 antérieurs de la jambe postérieure les fibres descendantes passent du gyrus central antérieur aux cornes antérieures de la moelle épinière - le tractus corticospinal (dans les 2/3 antérieurs du pédoncule postérieur) et aux noyaux moteurs des nerfs crâniens - le tractus corticonucléaire (genou de l'interne capsule). Dans le tiers postérieur de la patte arrière les fibres sensorielles ascendantes passent du thalamus visuel au gyrus central postérieur (voie thalamocorticale), les voies ascendantes des analyseurs visuels et auditifs se dirigeant respectivement vers les lobes occipitaux et temporaux, ainsi que les fibres efférentes descendantes provenant des parties inférieures de l'occipital et les lobes temporaux à travers le pont menant au cervelet (voie occipito-temporoponto-cérébelleuse).
Une couche massive et dense de matière blanche qui unit diverses parties du cortex et des formations sous-corticales au sein d'un hémisphère.

Riz. 1.3.Coupe horizontale du cerveau au niveau du corps calleux :
I - genre du corps calleux ; 2 - coffre-fort ; 3 - capsule externe ; 4 - capsule la plus externe ; 5 - clôture ; 6 - noyau lenticulaire ; 7-III ventricule ; 8 - capsule interne ; 9 - plexus choroïde du ventricule latéral ; 10 - rayonnement thalamique postérieur ;
II - sillon calcarin ; 12 - fissure interhémisphérique longitudinale ; 13 - splénium du corps calleux ; 14 - corne postérieure du ventricule latéral ; 15 - noyaux latéraux du thalamus ; 16 - noyaux médiaux du thalamus ; 17 - noyaux antérieurs du thalamus ; 18 - île ; 19 - capsule interne
fibres associatives. Ces fibres sont courtes et longues. Les fibres courtes sont généralement arquées. Ils relient les circonvolutions voisines. De longues fibres relient des zones distantes du cortex.
Fibres de projection relier les hémisphères cérébraux aux parties sous-jacentes du cerveau - le tronc et la moelle épinière. Les fibres de projection contiennent des voies transportant des informations afférentes (sensibles) et efférentes (motrices).
Également distingué fibres commissurales, qui relient des zones topographiquement identiques des hémisphères droit et gauche. Les fibres commissurales forment le corps calleux, la commissure antérieure, la commissure du fornix et la commissure postérieure. La majeure partie des fibres commissurales traversent le corps calleux, reliant les zones symétriques des deux hémisphères du cerveau.
corps calleux - plaque mince arquée. La partie médiane allongée du corps calleux se transforme en arrière en un épaississement et, devant, elle se plie et se plie vers le bas de manière arquée. Le corps calleux relie les parties phylogénétiquement les plus jeunes des hémisphères et joue un rôle important dans l'échange d'informations entre elles. Les fibres nerveuses s'étendent du corps calleux jusqu'à la substance blanche des hémisphères cérébraux. Ces fibres divergent radialement et se dirigent vers tous les lobes du cerveau.
Commissure antérieurerelie les zones olfactives des hémisphères droit et gauche du cerveau. La commissure du fornix relie les gyri hippocampiques des hémisphères droit et gauche. Dans la partie postérieure du troisième ventricule se trouvent commissures médullaires postérieures et frénulaires, contenant des fibres reliant les structures du diencéphale.
Une coupe horizontale au niveau du mésencéphale permet de voir le tronc cérébral et ses pédoncules, par lesquels le cerveau est relié au tronc cérébral.
Tronc cérébral comprend le mésencéphale, le pont et la moelle allongée. Le tronc cérébral est à bien des égards analogue à la moelle épinière. Le tronc cérébral est divisé en la base et le tegmentum. À la base se trouvent principalement des voies descendantes, dans le tegmentum - les noyaux des nerfs crâniens et la formation réticulaire.
Formation réticulaire situé dans la partie centrale du tectum du tronc cérébral sur toute sa longueur et constitue un réseau complexe de cellules nerveuses interconnectées. Elle obtient un compte
latérales de presque tous les chemins ascendants et descendants. La formation réticulaire fait partie du système limbique, car elle régule le niveau d'éveil du cortex et le fond émotionnel d'une personne, et est impliquée dans l'activité des centres respiratoires et vasomoteurs de la moelle allongée et du centre du regard pontique ( Fig.1.4).
Partie centrale mésencéphale occupe l'aqueduc cérébral, reliant le troisième ventricule du cerveau au quatrième ventricule situé en dessous. Le toit du mésencéphale est constitué du quadrijumeau, la base est constituée des pédoncules cérébraux ; les noyaux du mésencéphale sont situés dans la partie médiane.
Troncs cérébraux sont des cordons denses de substance blanche contenant des voies descendantes allant du cortex à la corne antérieure de la moelle épinière, aux noyaux moteurs des nerfs crâniens et au cervelet. Divergents vers l'avant, ils forment un espace interpédonculaire perforé à travers lequel passent les vaisseaux cérébraux. Les fibres des voies traversent les pédoncules cérébraux à l'extérieur. Dans la partie médiane se trouvent les noyaux rouges, la substance noire, les noyaux des nerfs III (oculomoteur) et IV (trochléaire), le fascicule longitudinal postérieur et le lemnisque médial. Au-dessus de l'aqueduc du mésencéphale se trouve la plaque du toit du mésencéphale (quadrigéminal), représentée par des fibres et des noyaux liés aux analyseurs de la vision et de l'audition. Il participe à la coordination des mouvements oculaires, en les transformant en stimulation auditive et labyrinthique, c'est-à-dire démarrer le réflexe.
Pont cérébral se situe entre le mésencéphale et la moelle allongée. La partie buccale (antérieure) du pont contient principalement des fibres longitudinales et transversales ; dans la partie caudale, en plus des fibres conductrices, se trouvent les noyaux des nerfs crâniens (de V à VIII). La surface dorsale du pont représente le bas du ventricule IV - la fosse rhomboïde.

Riz. 1.4.Formation réticulaire du tronc cérébral, de ses structures activatrices et des voies ascendantes vers le cortex cérébral (schéma) :
1 - formation réticulaire du tronc cérébral et de ses structures activatrices ;
2 - hypothalamus ; 3 - thalamus ; 4 - cortex cérébral ; 5 - cervelet; 6 - les voies afférentes et leurs collatérales ; 7 - moelle oblongue; 8 - pont cérébral ; 9 - mésencéphale

Graphique 1.5. Cervelet
Sur la section transversale du pont, vous pouvez voir un corps trapézoïdal dont les fibres appartiennent au système d'analyse auditive. Dans la partie ventrale se trouvent les fibres longitudinales du tractus pyramidal. Dans la partie dorsale du pont se trouvent des voies sensorielles : latéralement - le tractus spinothalamique, médialement - le tractus bulbothalamique. Dans la partie buccale du pont, les deux voies sensorielles fusionnent en un seul tronc dense (lemniscus médial), qui traverse dorsolatéralement le pont et le mésencéphale.
Cervelet situé au-dessus du pont et sous les lobes occipitaux, dont il est séparé par la tente du cervelet. Le cervelet est constitué de deux hémisphères et du vermis. Les hémisphères cérébelleux sont recouverts d'un cortex dont la superficie est augmentée en raison de profondes rainures arquées parallèles divisant le cervelet en feuilles (Fig. 1.5).
Selon le principe structurel, fonctionnel et phylogénétique, le cervelet est divisé en 3 parties : 1) cervelet ancien - archicérébellum, associé au système vestibulaire, comprend le flocculus et le nodule ; 2) vieux cervelet - paléocervelet(ver) associé à la moelle épinière; 3) nouveau cervelet - néocervelet(hémisphère), associé au cortex cérébral et impliqué dans la posture verticale.
Dans la substance blanche de l'hémisphère et le vermis cérébelleux, il existe plusieurs noyaux appariés (Fig. 1.6 a). Les noyaux de la tente sont situés de manière paramédiane, le noyau sphérique est situé latéralement et le noyau cortical est encore plus latéral. Les noyaux dentés sont situés dans la substance blanche de l'hémisphère.
Trois paires de pédoncules cérébelleux sont formées par ses vastes voies. Les pédoncules supérieurs du cervelet vont au pédoncule quadrijumeau du mésencéphale, ceux du milieu relient le cervelet au pont et les inférieurs à la moelle allongée.
Principales voies ascendantes en pédoncules cérébelleux inférieurs :
Des cornes postérieures de la moelle épinière (voie spinocérébelleuse postérieure de Flexig) ;
Du noyau vestibulaire de Bechterew (voie vestibulocérébelleuse) ;
Des noyaux de Gaulle et de Burdach (voie bulbocérébelleuse) ;

Riz. 1.6. Cervelet:
UN- structure interne; b- les noyaux cérébelleux et leurs connexions (schéma) : 1 - le cortex cérébral ; 2 - noyau ventrolatéral du thalamus ; 3 - noyau rouge ; 4 - noyau de tente ; 5 - noyau sphérique ; 6 - noyau liégeux ; 7 - noyau denté ; 8 - voies nucléaires dentées-rouges et dentées-thalamiques ; 9 - tractus cérébelleux vestibulaire ; 10 - chemins depuis le vermis cérébelleux (noyau de tente) jusqu'aux noyaux mince et sphénoïde, l'olive inférieure ; 11 - tractus spinocérébelleux antérieur ; 12 - tractus spinocérébelleux postérieur
De la formation réticulaire (voie réticulo-cérébelleuse) ;
De l'olive inférieure (tractus olivocérébelleux).
Toutes les voies ci-dessus se terminent dans le noyau de la tente, à l'exception de la voie olivocérébelleuse, qui se termine dans le cortex cérébelleux. Les pédoncules inférieurs contiennent plusieurs voies efférentes qui mènent finalement à la corne antérieure de la moelle épinière : cérébelloréticulospinale, cérébellovestibulospinale, via le noyau vestibulaire latéral de Deiters, et cérébellolivospinale.
Dans le plus puissant pédoncules cérébelleux moyens Les fibres pontocérébelleuses traversent, qui font partie des voies corticopontocérébelleuses allant du gyrus frontal supérieur et des parties inférieures des lobes occipitaux et temporaux en passant par le pont jusqu'au cortex cérébelleux.
Dans les pédoncules cérébelleux supérieurs passent la voie afférente de la moelle épinière (voie spinocérébelleuse antérieure de Gowers), la voie efférente dentatothalamique et cérébelleuse-rubrospinale descendante, allant du noyau denté de l'hémisphère cérébelleux à travers le noyau rouge jusqu'à l'hémisphère antérieur.
à la corne de la moelle épinière. Cela ferme d’importantes boucles de rétroaction entre le cortex cérébral, les noyaux pontiques, le cortex cérébelleux, le noyau denté et le thalamus. Le cervelet participe à la régulation de la coordination des mouvements et au maintien du tonus musculaire (Fig. 1.6 b).
Noyaux des nerfs crâniens situés à différents niveaux sur toute la longueur du tronc cérébral (Fig. 1.7). Dans le mésencéphale se trouvent les noyaux des nerfs oculomoteurs (III-IV), dans le pont - trijumeau (V), abducens (VI), facial (VII), vestibulocochléaire (VIII), dans la moelle allongée - glossopharyngé (IX), vague (X), accessoire (XI) et sublingual (XII).
Au niveau du foramen magnum, la moelle oblongue devient la moelle épinière. Là, les fibres du tractus corticospinal se croisent, ce qui entraîne des dommages à l'analyseur moteur dans le cortex d'un hémisphère, provoquant une paralysie des membres du côté opposé.

Riz. 1.7.Base du cerveau avec racines nerveuses crâniennes : 1 - glande pituitaire ; 2 - nerf olfactif ; 3 - nerf optique ; 4 - nerf oculomoteur ; 5 - nerf trochléaire ; 6 - nerf abducens ; 7 - racine motrice du nerf trijumeau ; 8 - racine sensible du nerf trijumeau ; 9 - nerf facial; 10 - nerf intermédiaire; 11 - nerf vestibulocochléaire ; 12 - nerf glossopharyngé; 13 - nerf vague; 14 - nerf accessoire ; 15 - nerf hypoglosse; 16 - racines spinales du nerf accessoire ; 17 - moelle oblongue; 18 - cervelet; 19 - nœud trijumeau ; 20 - pédoncule cérébral; 21 - tractus optique. Les chiffres romains indiquent les nerfs crâniens
1.2. Moelle épinière
Moelle épinière situé dans le canal rachidien et se termine chez les nouveau-nés au niveau de la vertèbre lombaire III (L IIL) et chez l'adulte - la vertèbre lombaire II (L II). L'extrémité supérieure de la moelle épinière est considérée comme le site de sortie des premières racines cervicales et le début de la décussation du tractus pyramidal. La moelle épinière présente deux épaississements : cervical et lombaire (Fig. 1.8). Le long de la moelle épinière, il existe deux
plier - cervical et thoracique. Les nerfs spinaux, formés par les racines antérieure (motrice) et postérieure (sensible), partent de la moelle épinière. Un segment de la moelle épinière dont les racines antérieures et postérieures émergent à travers un foramen intervertébral est appelé segment(Fig. 1.9). Il y a 8 segments dans la région cervicale (Cj-C 8), dans la région thoracique - 12 (Thj-Th 12), dans la région lombaire - 5 (Lj-L 5), dans la région sacrée - 5 (S 1 -S 5) et dans la région coccygienne - 1-3 (Co 1 -Co 3). Le long de la moelle épinière, on distingue des épaississements cervicaux et lombaires, innervant respectivement les membres supérieurs et inférieurs. La moelle épinière étant plus courte que la colonne vertébrale (se terminant au niveau de la vertèbre lombaire II - L II), les racines parcourent une distance plus ou moins longue dans le canal rachidien pour atteindre leur ouverture de sortie. Cette distance est plus importante pour les racines lombaires, sacrées et coccygiennes, qui, à l'extrémité du canal rachidien, forment ce qu'on appelle la queue de cheval.
Une coupe transversale de la moelle épinière montre de la matière grise et blanche. La matière grise occupe la partie centrale et est entourée de matière blanche. La forme de la matière grise ressemble à un papillon dont les ailes sont formées de saillies appariées (cornes antérieures, latérales et postérieures). La matière grise des deux moitiés est reliée par un isthme (commissure grise), au centre duquel passe le canal central ou rachidien rempli de liquide céphalo-rachidien.
Riz. 1.8.Moelle épinière et ses segments

Riz. 1.9.Segment de moelle épinière (a, b)
Les cordons postérieurs sont formés de conducteurs ascendants d'une profonde sensibilité. Les conducteurs de sensibilité profonde sont situés médialement par rapport aux membres inférieurs (faisceau mince de Gaulle), latéralement - par rapport aux membres supérieurs (faisceau de Burdach en forme de coin). De plus, les funicules postérieurs contiennent des conducteurs de sensibilité tactile.
Dans les cordons latéraux de la moelle épinière se trouvent des conducteurs descendants et ascendants. Les fibres descendantes comprennent principalement les fibres du tractus pyramidal (corticospinal latéral), ainsi que le tractus rubrospinal et le tractus réticulospinal. Tous les chemins descendants aboutissent dans les cellules des cornes antérieures de la moelle épinière. Les fibres ascendantes comprennent les fibres des voies spinocérébelleuses (antérieures et postérieures), de la sensibilité superficielle (voie spinothalamique latérale) et des voies spinotectales.
Les moelles antérieures de la moelle épinière sont composées principalement de voies descendantes depuis le gyrus central antérieur, la tige et les formations sous-corticales jusqu'aux cornes antérieures de la moelle épinière (voie pyramidale antérieure non croisée, voie vestibulospinale, voie olivospinale et voie tectospinale). De plus, un mince faisceau sensoriel traverse les cordons antérieurs - le tractus spinothalamique antérieur.
Dans les cornes postérieuresil existe des cellules sensorielles (2ème neurone de sensibilité superficielle) et un groupe distinct de cellules appartenant au système proprioception cérébelleux. Cornes avant La moelle épinière contient des cellules motrices dont les processus forment les racines antérieures. Sur le côté et en partie dans les cornes postérieures il existe des noyaux sympathiques autonomes. Au niveau des segments C 8 -C se situent
cellules efférentes du système nerveux sympathique, au niveau desquelles se forme le centre ciliospinal sympathique. Au niveau des segments sacrés S 2 -S 4 se trouve un centre parasympathique spinal pour réguler la fonction des organes pelviens.
Système nerveux périphérique - les formations nerveuses situées en dehors du cerveau et de la moelle épinière : nerfs crâniens et nerfs spinaux (leurs racines, ganglions sensoriels, plexus et troncs). Le système nerveux périphérique comprend également les structures du système nerveux autonome situées en dehors du système nerveux central. Les racines des nerfs spinaux sont représentées par des fibres postérieures (sensibles) et antérieures (motrices). Le long de la racine dorsale se trouve un ganglion intervertébral sensible, qui contient des cellules pseudounipolaires sensibles, ainsi que des cellules afférentes de l'afférentation proprioceptive autonome et cérébelleuse. Derrière le ganglion spinal, les racines antérieures et postérieures se confondent en un tronc commun, formant un nerf spinal mixte. A la sortie du foramen intervertébral, il se divise en 4 branches. La branche antérieure innerve la peau et les muscles des membres et la face antérieure du corps ; le postérieur innerve la surface postérieure du corps ; le méningé innerve les membranes de la moelle épinière et le conjonctif va aux nœuds sympathiques. Les branches antérieures de plusieurs segments adjacents s'unissent pour former des plexus d'où émergent les nerfs périphériques. En règle générale, les nerfs périphériques sont mixtes, c'est-à-dire Ils contiennent des fibres sensorielles, motrices et autonomes. Souvent, ils passent avec les vaisseaux, formant un faisceau neurovasculaire.
Plexus cervical formé par les branches antérieures des nerfs spinaux des quatre segments cervicaux supérieurs. Les nerfs périphériques émergent du plexus cervical, assurant l'innervation de la peau et des muscles de la région occipitale et du cou, ainsi que du diaphragme (nerf phrénique).
Plexus brachial formé par les racines Q-Th 1. Les nerfs périphériques provenant du plexus brachial assurent l'innervation motrice et sensorielle de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs. Les membres supérieurs sont innervés par trois nerfs principaux : médian, cubital et radial. Lorsque le plexus brachial est formé, les nerfs spinaux sont initialement réunis en deux faisceaux : C 5 -C 7 - le faisceau primaire supérieur de plexus et Q-Th 1 - le faisceau primaire inférieur. À cet égard, des lésions isolées du tronc supérieur ou inférieur des fibres du plexus brachial peuvent être observées en clinique.
Plexus lombaire formé par les branches antérieures des trois nerfs spinaux lombaires supérieurs et en partie par les collatérales de Th 12 et L 4. Le plexus lombaire donne naissance au nerf fémoral et à un certain nombre de troncs nerveux plus fins qui assurent une innervation sensible des surfaces antérieure, externe et interne de la cuisse, en partie de la fesse, du pubis, du scrotum et des grandes lèvres, ainsi qu'une innervation des muscles. impliqué dans l’extension, la flexion et l’adduction de la hanche.
Plexus sacré formé par les branches antérieures des nerfs spinaux s'étendant de L 5 à S 4, partiellement à partir des segments L 4 de la moelle épinière. Innerve les muscles de l'arrière de la cuisse, du bas de la jambe, du pied, des muscles fessiers, des abducteurs de la hanche, ainsi que les muscles et la sensibilité du périnée, des organes génitaux, des fesses, de l'arrière de la cuisse, du bas de la jambe, du pied. Les principaux nerfs émergeant du plexus sont le sciatique (ses branches sont les nerfs tibial et péronier), les nerfs fessiers supérieur et inférieur, etc.
Plexus coccygien formé par les branches antérieures des nerfs rachidiens, d'où émergent plusieurs fins nerfs anaux-coccygiens qui se terminent dans la peau à l'apex du coccyx.
1.3. Système nerveux autonome
Système nerveux autonome (autonome) est un ensemble de centres et de voies qui assurent la régulation de l'environnement interne du corps. Le système nerveux autonome régule les processus métaboliques, l'activité des organes internes, des muscles lisses et de l'appareil glandulaire, participant à l'intégration de l'environnement interne du corps en un seul tout (Fig. 1.10). Le système nerveux autonome est classiquement divisé en parties sympathiques et parasympathiques.
Dans la moelle épinière partie sympathique représenté par les cellules des cornes latérales dans les segments C 8 -L 3. Les axones de ces cellules sortent de la moelle épinière en tant que partie des racines antérieures, formant des fibres préganglionnaires, et se terminent dans le tronc sympathique frontalier. Une minorité de fibres se termine dans les nœuds prévertébraux et intra-muros, situés dans les parois des organes internes. Certaines des fibres postganglionnaires, partant des nœuds du tronc sympathique limite, vont aux nerfs spinaux mixtes, l'autre retourne par les racines dorsales jusqu'à la moelle épinière et est envoyée aux plexus autonomes viscéraux. Frontière

Riz. 1.10.Système nerveux autonome:
1 - cortex du lobe frontal du cerveau ; 2 - hypothalamus ; 3 - nœud ciliaire ; 4 - nœud ptérygopalatin ; 5 - nœuds sous-maxillaires et sublinguaux ; 6 - nœud d'oreille; 7 - nœud sympathique cervical supérieur ; 8 - grand nerf splanchnique ; 9 - nœud interne ; 10 - plexus coeliaque ; 11 - nœuds coeliaques ; 12 - petit nerf splanchnique ; 12a - nerf splanchnique inférieur ; 13 - plexus mésentérique supérieur ; 14 - plexus mésentérique inférieur ; 15 - plexus aortique ; 16 - fibres sympathiques aux branches antérieures des nerfs lombaires et sacrés pour les vaisseaux des jambes ; 17 - nerf pelvien ; 18 - plexus hypogastrique ; 19 - muscle ciliaire ; 20 - sphincter de la pupille ; 21 - dilatateur pupillaire ; 22 - glande lacrymale; 23 - glandes de la membrane muqueuse de la cavité nasale; 24 - glande sous-maxillaire; 25 - glande sublinguale ; 26 - glande parotide ; 27 - coeur; 28 - glande thyroïde; 29 - larynx; 30 - muscles de la trachée et des bronches ; 31 - poumon; 32 - estomac; 33 - foie; 34 - pancréas ; 35 - glande surrénale; 36 - rate; 37 - rein; 38 - gros intestin; 39 - intestin grêle; 40 - détrusor de la vessie (muscle qui pousse l'urine) ; 41 - sphincter de la vessie ; 42 - gonades ; 43 - organes génitaux ; III, XIII, IX, X - nerfs crâniens
le tronc sympathique se compose de 20 à 25 nœuds reliés par des fibres longitudinales. Les nœuds du tronc frontalier des régions cervicales et thoraciques sont situés sur les côtés de la colonne vertébrale, les régions lombaire et sacrée sont situées sur la face antérieure de la colonne vertébrale.
La section cervicale du tronc frontalier se compose de trois nœuds : supérieur, moyen et inférieur. Le ganglion sympathique cervical supérieur envoie des fibres postganglionnaires aux quatre nerfs radiculaires cervicaux supérieurs, aux plexus des artères carotides externes et internes, aux nerfs phréniques et hypoglosses ; les deuxième et troisième nœuds sympathiques envoient des fibres postganglionnaires aux nerfs radiculaires C 5 -C 8 et Th 1, à la glande thyroïde, aux artères carotides communes et sous-clavières. Le ganglion sympathique cervical inférieur fusionne souvent avec le premier ganglion thoracique pour former le ganglion étoilé. Des fibres sympathiques en partent vers les nerfs radiculaires C 6 -C 8, vers les artères carotides, sous-clavières, vertébrales, vers le cœur et le nerf récurrent. Ainsi, l'innervation sympathique de la tête (y compris le visage et les yeux) s'effectue à partir du ganglion stellaire.
La section thoracique du tronc frontalier se compose de 10 à 12 nœuds. Les fibres postganglionnaires sont dirigées vers les nerfs intercostaux, vers les vaisseaux et organes des cavités abdominales et thoraciques. Les fibres s'étendent du quatrième au cinquième nœuds thoraciques jusqu'au plexus cardiaque. Du cinquième au dixième nœuds thoraciques, les nerfs coeliaques majeurs et mineurs partent vers le plexus solaire.
La section lombaire du tronc frontalier se compose de 3 à 4 nœuds. Les fibres postganglionnaires vont aux nerfs radiculaires correspondants, au plexus solaire et à l'aorte abdominale. La section sacrée est représentée par 3-4 nœuds. Les fibres postganglionnaires sont dirigées vers les nerfs des racines sacrées et les organes pelviens.
Il n’existe pas de correspondance complète entre l’innervation segmentaire sympathique et somatique. Dans la zone C 8 -Tn 3 sont localisés les centres d'innervation sympathique de la tête et du cou, dans la zone Th 4 -Th 7 - pour l'innervation des bras, dans la zone Th 8 -Th 9 - pour l'innervation de les jambes.
Partie parasympathique du système nerveux autonome représenté par des formations structurelles dans le tronc cérébral et la moelle épinière. Dans le mésencéphale se trouve la section mésencéphalique du système nerveux parasympathique : noyaux parasympathiques (Yakubovich appariés et Perlia central non appariés), à partir desquels les fibres s'étendent dans le cadre du nerf oculomoteur jusqu'au ganglion ciliaire.
La division bulbaire du système nerveux parasympathique est située dans la moelle allongée. Il est représenté par les noyaux sécrétoires, salivaires (supérieur et inférieur) et le noyau postérieur du nerf vague. Dans les segments sacrés de la moelle épinière se trouve la section sacrée S 3 -S 5 du système nerveux parasympathique, d'où partent les fibres qui composent le nerf pelvien, innervant la vessie, le rectum et les organes génitaux.
Les ganglions parasympathiques, contrairement aux sympathiques, ne sont pas situés à proximité de la moelle épinière, mais intra-muros, directement dans l'organe innervé.
Innervation autonome de la tête (y compris le visage, les yeux, les glandes salivaires et lacrymales) varie selon le sujet. L'innervation sympathique est réalisée par le nœud sympathique cervical supérieur (les centres végétatifs sont situés dans les cornes latérales de la moelle épinière au niveau des segments C 6 -C 8). L'innervation parasympathique de la tête est réalisée à partir du mésencéphale (noyaux Yakubovich, Perlia) par le nerf oculomoteur et à partir de la moelle allongée (noyaux sécrétoires, salivaires, noyau postérieur du nerf vague) par les nerfs facial, glossopharyngé et vague.
1.4. Coquilles et ventricules du cerveau et de la moelle épinière
Le cerveau et la moelle épinière sont entourés de trois membranes : molles, directement adjacentes à la surface du cerveau ; arachnoïde, occupant la position médiane ; et dur.
Dure mère se compose de deux feuilles. La feuille externe est adjacente au crâne de l’intérieur et tapisse le canal interne de la colonne vertébrale. La couche interne de la cavité crânienne est fusionnée avec la couche externe sur une grande surface. Aux endroits où ils divergent, des sinus se forment - des lits pour l'écoulement du sang veineux du cerveau. Dans le canal intravertébral, entre les couches de la dure-mère (espace épidural), se trouve du tissu adipeux lâche, équipé d'un réseau veineux développé. Dans la cavité crânienne, l'espace péridural est situé entre la couche externe de la dure-mère et les os du crâne (Fig. 1.11).
Arachnoïde séparé de la dure-mère par l'espace sous-dural capillaire, de la pie-mère par l'espace sous-arachnoïdien. Dans l'espace sous-arachnoïdien, des cordons et des plaques sont tendus entre l'arachnoïde et les membranes molles ; les vaisseaux qui le traversent semblent suspendus dans un entrelacs de trabécules. Pro-

Riz. 1.11.Circulation du liquide céphalo-rachidien [selon Netter] :
1 - dure-mère ;
2 - membrane arachnoïdienne; 3 - espaces sous-arachnoïdiens ; 4 - granulations de la membrane arachnoïdienne (granulations de Pachyon) ; 5 - plexus choroïdiens ; 6 - aqueduc cérébral ; 7 - foramen interventriculaire ; 8 - ouverture latérale du ventricule IV du cerveau ; 9 - ouverture médiale du ventricule IV du cerveau ;
10 - citerne cérébello-cérébrale;
11 - réservoir interpédonculaire
l'espace est rempli de liquide céphalo-rachidien (LCR). La membrane arachnoïdienne ne s'étend pas dans les espaces entre les gyri.
pia mater, étant en contact étroit avec la substance du cerveau, il la recouvre de fines crevasses et sillons et accompagne dans une certaine mesure les vaisseaux sanguins entrant dans le cerveau. Il existe des espaces périvasculaires étroits autour des vaisseaux cérébraux (lors de processus pathologiques, par exemple un œdème cérébral, ils se dilatent fortement), qui peuvent être attribués aux plus petites branches capillaires, ainsi qu'autour des cellules nerveuses (espaces péricellulaires). Les espaces périvasculaires, péricapillaire et péricellulaire sont appelés espaces de Virchow-Robin. Ils sont remplis de liquide céphalo-rachidien (LCR) et sont reliés à l'espace sous-arachnoïdien (Fig. 1.12).
Espace sous-arachnoïdien en a quelques autres ou
dilatations moins importantes remplies de LCR. De telles cavités sont appelées citernes sous-arachnoïdiennes. Le plus puissant est le réservoir cérébello-cérébral (grand), situé entre le cervelet et la moelle allongée. Entouré par le LCR de l’espace sous-arachnoïdien, le cerveau semble « flotter » dedans, de sorte que les influences physiques externes atteignent la substance cérébrale déjà considérablement affaiblie. Autour du tronc cérébral, l’espace sous-arachnoïdien élargi forme plusieurs citernes. Entre

Riz. 1.12.Les membranes du cerveau. Structure des espaces shells et sous-shells :
I - Corps Pachioniens ; 2 - casque aponévrotique ; 3 - diploe; 4 - artères cérébrales ; 5 - dure-mère ; 6 - espace péridural ; 7 - membrane arachnoïdienne; 8 - pie-mère ;
9 - Espace Virchow-Robin ;
10 - espace sous-arachnoïdien ;
II - sinus sagittal supérieur ; 12 - espace sous-dural

Riz. 1.13.Ventricules du cerveau :
1 - ventricule latéral gauche avec cornes frontales, occipitales et temporales ;
2 - foramen interventriculaire ; 3 - troisième ventricule ; 4 - Aqueduc Sylvien ; 5 - quatrième ventricule, évidement latéral
La citerne interpédonculaire est située au niveau des pédoncules cérébraux, et devant elle se trouve la citerne de jonction.
Dans la région de la moelle épinière, l’espace sous-arachnoïdien est assez vaste. Au niveau II de la vertèbre lombaire L II, là où se termine la moelle épinière, l'espace sous-arachnoïdien forme une citerne terminale dont la taille varie en fonction de l'âge. Chez un fœtus de 3 mois, la moelle épinière occupe tout le canal intravertébral, ne laissant aucune place à la citerne. Avec un développement ultérieur, la croissance de la moelle épinière est en retard par rapport à la croissance de la colonne vertébrale. Chez un nouveau-né, l'extrémité de la moelle épinière se situe au niveau de la troisième vertèbre lombaire (L III) ; chez l'enfant de 5 ans, la moelle épinière se termine généralement au niveau des vertèbres lombaires I-II (L I-L II) ; par la suite, la relation établie ne change pas.
En plus de l'espace sous-arachnoïdien, le LCR est contenu dans les quatre ventricules du cerveau et dans le canal central de la moelle épinière. Le système ventriculaire se compose de deux ventricules latéraux, III et IV du cerveau (p. 1.13).
Ventricules latéraux situé dans les hémisphères cérébraux et constitué de la corne antérieure correspondant au lobe frontal, le corps du ventricule, situé
au fond du lobe pariétal, la corne postérieure, située dans le lobe occipital, et la corne inférieure, localisée dans le lobe temporal. Dans les sections antérieures de la surface interne des ventricules latéraux se trouvent des foramens interventriculaires (Monroéens), à travers lesquels ces ventricules communiquent avec le troisième ventricule.
Sur la ligne médiane entre les tubérosités visuelles se trouve III ventricule Il se connecte au quatrième ventricule par l'aqueduc cérébral. Ventricule IV par les ouvertures latérales, il communique avec l'espace sous-arachnoïdien et par l'ouverture médiane du quatrième ventricule avec la grande citerne. Le prolongement direct du quatrième ventricule est le canal rachidien central.
1.5. Liquide cérébro-spinal
Liquide cérébro-spinal Il est produit par les plexus choroïdes des ventricules, qui ont une structure glandulaire, et est absorbé par les veines des méninges molles. La filtration partielle du LCR dans le lit veineux est réalisée à travers des granulations pachioniennes - villosités de la membrane arachnoïdienne du cerveau, faisant saillie dans la cavité des sinus veineux. Les granulations de Pachion chez les enfants sont peu nombreuses, chez les adultes, leur nombre augmente et, par conséquent, leur signification fonctionnelle augmente. La quantité totale de LCR chez un nouveau-né est de 15 à 20 ml, à l'âge de 1 an de 35 ml, chez un adulte de 120 à 150 ml. Dans certaines maladies (hydrocéphalie), la quantité de liquide peut atteindre 800 à 1 000 ml.
Les processus d’absorption et de production de LCR se déroulent de manière continue et intensive. Pendant la journée, le liquide peut être échangé jusqu'à 4 à 5 fois. Étant donné que le LCR est produit dans les ventricules du cerveau et que l'absorption principale est assurée par toute la surface de la pie-mère du cerveau et de la moelle épinière, il existe une situation dans laquelle il existe un déficit constant d'absorption dans la cavité crânienne ( avec une circulation non perturbée du liquide céphalo-rachidien, elle est compensée par l'écoulement du LCR dans l'espace sous-arachnoïdien de la moelle épinière (cerveau), et dans le canal intravertébral, le déficit de production de LCR est compensé par l'afflux de la cavité crânienne. Lorsque la circulation du liquide céphalo-rachidien entre le cerveau et la moelle épinière est perturbée, le LCR s'accumule et se « liquéfie » dans la cavité crânienne, puis est intensément absorbé et concentré dans l'espace sous-arachnoïdien de la moelle épinière.
La circulation du LCR est soumise à diverses influences, notamment les pulsations cérébrales, la respiration, les mouvements de la tête, l'intensité

Riz. 1.14.Modes de circulation de l'alcool :
1 - racine nerveuse spinale;
2 - villosités arachnoïdiennes; 3 - veines péridurales ; 4 - réservoir environnant ; 5 - citerne interpédonculaire ; 6 - citerne chiasmatique ; 7 - villosités arachnoïdiennes; 8 - plexus choriodal ; 9 - citerne cérébello-médullaire
production et absorption du liquide lui-même. Cependant, il est possible d'indiquer la direction principale du flux du LCR : ventricules latéraux - foramens interventriculaires - ventricule III - aqueduc cérébral - ventricule IV - ouverture latérale du ventricule IV et ouverture médiane du ventricule IV - grande citerne et espace sous-arachnoïdien externe de le cerveau - canal central et espace sous-arachnoïdien du cerveau spinal - réservoir terminal (Fig. 1.14).
Le CSF protège mécaniquement le cerveau, le protégeant non seulement des influences extérieures, des chocs, des chocs, mais également des fluctuations de la pression osmotique, qui maintient son équilibre relatif et sa constance dans le tissu cérébral. Le LCS joue également un rôle d’intermédiaire entre le sang et les tissus en termes de nutrition et de métabolisme.
cerveau
Les caractéristiques du liquide céphalo-rachidien sont normales
1. Le volume total chez un adulte est de 90 à 200 ml (en moyenne 140 ml), chez un nouveau-né de 20 à 40 ml.
2. La pression en position couchée latérale atteint 100-180 mm d'eau. Art., en position assise, il monte jusqu'à 250-300 mm d'eau. Art., chez les enfants, la pression est inférieure de 50 à 70 mm d'eau. Art.
3. 89 à 90 % sont constitués d’eau et 10 à 11 % de matière sèche.
4. S'écoule en gouttes séparées, environ 60 gouttes/min.
5. Transparent, incolore (chez les nouveau-nés, il peut être xanthochrome à cause de la bilirubine).
6. Densité - 1003-1008.
L’insula ne peut pas être considérée comme une partie vestigiale du cerveau ; on observe une augmentation progressive de la complexité de l’organisation de l’insula depuis les primates jusqu’aux humains. Ainsi, des études ont montré que chez les macaques (selon les espèces), le lobe insulaire soit n'a pas de circonvolutions ni de sillons, soit il y a un sillon orbito-insulaire. L'insula humaine comporte 5 à 7 rainures et circonvolutions et occupe un volume nettement plus grand que celui d'un lobe similaire chez le singe. Dans le même temps, l'îlot est le plus développé (pour des raisons inconnues) chez les cétacés - jusqu'à 20 sillons.
L'insula est le seul lobe du cerveau qui n'a pas accès à sa surface. Il est caché au-dessus et au-dessous par des parties des lobes frontal, pariétal et temporal, qui forment respectivement trois opercules dont les surfaces en contact forment à leur tour la partie profonde de la fissure sylvienne.
Si le tegmentum du cerveau est retiré, l'insula apparaît sous la forme d'une pyramide inversée dont la base fait face au lobe frontal. Le sillon central de l'insula divise sa surface en deux parties : la plus grande (antérieure) et la plus petite (postérieure). L'antérieur se compose de trois gyri courts séparés (antérieur, moyen, postérieur), ainsi que des gyri accessoires et transversaux, pas toujours trouvés. La partie postérieure du lobe est constituée de deux longues circonvolutions : la antérieure et la postérieure. Toutes les circonvolutions convergent vers le sommet de l'insula, qui représente la partie la plus saillante de l'insula. On distingue également le seuil de l'insula (limen) - un bord légèrement ascendant et arqué situé à la jonction des segments sphénoïdal et operculaire de la fissure sylvienne. Sous la matière grise recouvrant le seuil de l'insula se trouve le fascicule unciné. La substance perforée antérieure est située immédiatement en dessous et en dedans du seuil de l'insula. La distance moyenne entre l'entrée de l'artère lenticulostriée la plus latérale dans la substance perforée antérieure et le bord médial du seuil de l'insula, selon différents auteurs, varie de 15 à 20 mm.
Sous la partie centrale de l'insula dans la direction latéro-médiale se trouvent : la capsule extrême, la clôture, la capsule externe, le putamen, le globus pallidus et la capsule interne (voir figure).
Bonne île. a - vue latérale et légèrement en dessous, b - coupe horizontale au niveau de la commissure de l'arc.
Le périmètre de l'insula est limité par les sillons périinsulaires : supérieur, antérieur et inférieur, qui séparent l'insula du tectum environnant. Sur la face latérale du lobe se trouve le segment M2 de l'artère cérébrale moyenne, d'où partent les vaisseaux perforants alimentant l'insula. Selon une étude de U. Türe et al. , environ 85 à 90 % des artères insulaires sont courtes et irriguent uniquement le cortex insulaire et la capsule extrême, 10 % des artères sont de longueur moyenne et atteignent le septum et la capsule externe, et seulement 3 à 5 % sont longue, fournissant la couronne radiée. Ainsi, des lésions de ces dernières lors de la résection de tumeurs insulaires peuvent conduire à une hémiparésie.
Sous la partie antéro-inférieure de l'insula se trouve le segment M1 de l'artère cérébrale moyenne, d'où naissent les artères lenticulostriées latérales, irriguant les noyaux gris centraux et la capsule interne.
Fonction isolante
Le lobe insulaire appartient au système paralimbique - une partie du système nerveux central, servant de lien entre le système limbique (allocortex) et les hémisphères cérébraux (néocortex), et est représenté par le mésocortex, c'est-à-dire qu'il possède de 3 à 5 couches de neurones.
La fonction de l’insula fait depuis longtemps l’objet d’intenses débats parmi les chercheurs. Et même aujourd’hui, il n’y a pas de consensus sur cette question. Par exemple, les cas cliniques d'infarctus ischémiques localisés uniquement dans le lobe insulaire se manifestent par une variété de symptômes en fonction de la localisation et de la répartition du processus pathologique. C. Cereda et al. Il existe 5 principaux complexes de symptômes de lésions du cortex insulaire du cerveau : déficit somatosensoriel (infarctus du lobe postérieur de l'insula droite/gauche), trouble du sens du goût (lobe postérieur de l'insula gauche), syndrome vestibulaire ( lobe postérieur de l'insula droite/gauche), troubles cardiovasculaires (infarctus du lobe postérieur de l'insula droite), manifestations neuropsychologiques (lésions ischémiques des parties postérieures de l'insula droite/gauche).
Des résultats intéressants ont été obtenus par A. Afif et al. dans une étude portant sur 25 patients atteints d'épilepsie pharmacorésistante qui avaient des électrodes implantées de manière stéréotaxique dans l'insula. Les indications pour leur mise en œuvre dans l'insula étaient à la fois des manifestations cliniques d'attaques (hallucinations gustatives, sensations désagréables dans le larynx, paresthésies et contractions tonico-cloniques des muscles faciaux, hypersalivation) et des données d'électroencéphalogramme vidéo.
À la suite d'une stimulation directe, les auteurs ont reçu le nombre de réponses suivant : troubles de la parole (incapacité de parler ou diminution de l'intensité de la voix) - 8, douleur (douleur dans la région cranio-faciale ou douleur lancinante dans la moitié controlatérale du corps) - 8, manifestations somatosensorielles (paresthésies et sensation de chaleur) - 11, réponses motrices - 11, manifestations oropharyngées (sensation de constriction du larynx et d'étouffement) - 8, phénomènes auditifs (bourdonnement, bourdonnement) - 3, réponses neurovégétatives (attaques de panique) , rougeurs du visage, vertiges, nausées, gêne dans la région épigastrique, sensation de chaleur) - 20.
Ainsi, l'insula est impliquée dans le traitement des impulsions sensorielles (olfactives et gustatives), le contrôle des fonctions autonomes (contrôle sympathique du système cardiovasculaire), des émotions et des réactions comportementales, ainsi que dans la déglutition volontaire et le processus de modulation de la parole. L'insula fait peut-être partie d'un système neuronal reliant le gyrus supramarginal et l'aire de Broca, et peut être impliquée (avec le cortex prémoteur) dans la planification phonétique de la parole.
Classification des tumeurs du lobe insulaire du cerveau
En 1992, M. Yaşargil et al. a publié des résultats préliminaires sur le traitement de patients atteints de tumeurs des systèmes limbique et paralimbique. Dans cet ouvrage, devenu plus tard un classique, les auteurs ont identifié trois principaux types de tumeurs affectant l'insula : le type 3A - la tumeur ne s'étend pas au-delà de l'insula, le type 3B - une lésion occupant de l'espace qui s'étend au tegmentum adjacent de le cerveau, type 5 - la tumeur se propage au-delà de l'opercule frontal et temporal dans les régions orbitofrontales ou temporopolaires. (Autres types de tumeurs de la même classification : 1 - formations occupant l'espace des parties médiobasales du lobe temporal ; 2 - tumeurs du gyrus cingulaire, 4 - lésions du fornix et des corps mamillaires.)
Pendant longtemps, ce classement est resté le seul. Une nouvelle classification n'a été proposée qu'en 2010 par N. Sanai et al. . Les auteurs ont divisé l'insula par deux plans perpendiculaires passant par le foramen de Monro et la fissure sylvienne. En conséquence, le lobe insulaire est divisé en zones IV : I - antéro-supérieur, II - postéro-supérieur, III - postéro-inférieur, IV - antéro-inférieur. Si la tumeur s'étend au-delà d'une zone, elle est désignée comme la somme des zones dans lesquelles elle se situe. Dans les cas où une formation volumétrique couvre toutes les zones et s'étend au-delà d'elles, elle est désignée comme géante.
Caractéristiques des tumeurs gliales du lobe insulaire du cerveau
Selon les dernières données épidémiologiques, les tumeurs gliales du lobe insulaire représentent respectivement environ 10 et 25 % de toutes les tumeurs cérébrales gliales de haut et de bas grade et possèdent des propriétés qui les distinguent des tumeurs situées dans d’autres parties du cerveau.
Conformément aux études épidémiologiques, il existe une nette tendance à une augmentation des cas de bas grade. tumeurs dans l’îlot (Tableau 1).
 Tableau 1. Le ratio des gliomes de haut grade (Grade III-IV) et de bas grade (Grade I-II) du lobe insulaire du cerveau, selon les résultats de l'examen histologique des séries précédentes
Tableau 1. Le ratio des gliomes de haut grade (Grade III-IV) et de bas grade (Grade I-II) du lobe insulaire du cerveau, selon les résultats de l'examen histologique des séries précédentes Chez les patients présentant des tumeurs de bas grade dans l'îlot, une évolution moins agressive du processus tumoral a été notée que chez les patients présentant la même pathologie, mais d'une localisation différente. Un certain nombre de chercheurs soulignent les caractéristiques de la cytoarchitectonique de cette zone (mésocortex), les caractéristiques fonctionnelles du lobe, mais la raison exacte de ce phénomène n'est pas encore tout à fait claire.
Traitement chirurgical des tumeurs de la région insulaire du cerveau
En raison de l'emplacement de l'îlot à proximité des structures vasculaires et nerveuses les plus importantes, il existe un risque élevé d'augmentation du déficit neurologique après l'ablation des tumeurs à cet endroit. Dans la période postopératoire, une hémiparésie sévère peut survenir, ainsi que de graves troubles de la parole, si la tumeur est localisée dans l'hémisphère dominant la parole, c'est pourquoi un certain nombre d'auteurs les considèrent comme inopérables. La méthode de choix dans ce cas est considérée comme une biopsie stéréotaxique avec vérification du diagnostic histologique et administration de radiothérapie et/ou chimiothérapie. Bien qu'il existe de nombreuses controverses concernant la nécessité d'une ablation radicale des gliomes cérébraux, un certain nombre de chercheurs considèrent toujours que cela est important pour améliorer le pronostic de vie des patients.
L'un des premiers fut M. Yaşargil et al. ont étayé la possibilité d'éliminer ces tumeurs avec de bons résultats neurologiques après chirurgie chez un grand nombre de patients. Leur étude a inclus 57 patients atteints de tumeurs insulaires et insulaires-operculaires et 23 patients atteints de tumeurs fronto-insulaires-temporales. Bien que 67 % des tumeurs aient un diamètre supérieur à 5 cm et que 53 % soient localisées dans l'hémisphère gauche, une résection importante semble avoir été réalisée dans la plupart des cas. L'étendue de la résection n'a cependant pas été indiquée pour chaque cas. Chez la plupart des patients, les tumeurs étaient bénignes et n’entraînaient pas de déficits neurologiques significatifs. Après l'intervention chirurgicale, 8 (14 %) patients du groupe 1 et 1 (4 %) du groupe 2 ont développé des troubles neurologiques « modérés » sous forme d'hémiparésie, qui ont nécessité des mesures de rééducation. Rien n'est signalé concernant les troubles de la parole. Après la publication de M. Yaşargil, plusieurs ouvrages ont été publiés dans lesquels un plus petit nombre de patients ont été analysés. Ainsi, V. Vanaclocha et al. ont décrit leur expérience de traitement chirurgical de 23 patients atteints de tumeurs insulaires, localisées dans 70 % des cas dans l'hémisphère gauche. Une résection complète, selon l'IRM, a été réalisée dans 20 des 23 cas. Des déficits postopératoires sous forme d'hémiparésie et de dysphasie sont survenus chez 6 patients. J. Zentner et coll. ont rapporté une analyse détaillée de 30 cas de tumeurs des îlots. De manière générale, compte tenu des IRM pré et postopératoires, une résection totale a été réalisée dans 17 % des cas, une résection sous-totale dans 70 % et une résection partielle dans 13 % des cas. Dans le même temps, une hémiparésie est survenue chez 4 patients et une aphasie chez 3. En conséquence, les auteurs notent que chez 63 % des patients, la période postopératoire a été assez difficile et que le risque d'interventions chirurgicales sur la région insulaire était assez élevé ( Tableau 2).
 Tableau 2. Résultats fonctionnels après chirurgie des tumeurs insulaires intracérébrales
Tableau 2. Résultats fonctionnels après chirurgie des tumeurs insulaires intracérébrales Il existe plusieurs approches chirurgicales principales des tumeurs insulaires : 1) transsylvienne, 2) transcorticale (transfrontale ou transtemporale) et 3) combinée (transcorticale + transsylvienne). Dans leurs travaux pionniers, M. Yaşargil et al. utilisé uniquement l'approche transsylvienne. Cependant, aujourd'hui, dans la littérature mondiale, il n'existe pas d'opinion claire sur laquelle des approches peut être considérée comme la plus optimale du point de vue de la sécurité et de la possibilité d'une visibilité maximale des limites de la tumeur pour sa résection maximale. Un certain nombre d'auteurs ont utilisé l'approche transsylvienne uniquement pour les tumeurs isolées de l'insula, et si elles se sont propagées à la région frontale ou temporale, l'ablation a commencé par l'approche transcorticale et n'a ensuite utilisé que l'approche transsylvienne. D'autres auteurs ont préféré uniquement l'approche transsylvienne, même pour les tumeurs de localisation fronto-insulaire-temporale. Les difficultés de cette approche sont associées à la possibilité de lésions à la fois des veines et des artères de la fissure sylvienne, ce qui conduit à une ischémie et, par conséquent, à une détérioration des fonctions neurologiques après la chirurgie. La traction de la région operculaire lors de cette approche peut également entraîner une détérioration postopératoire. Avec l'accès transcortical, les zones motrices et de parole peuvent être endommagées si la tumeur est située dans l'hémisphère dominant (zones de Broca et de Wernicke).
Pour prévenir les complications lors de l'accès transcortical, H. Duffau et al. Chez tous les patients (51 personnes), une stimulation électrophysiologique du cortex et des voies a été utilisée pendant l'intervention chirurgicale. Parmi eux, dans 16 cas, une craniotomie a été réalisée sans perte de conscience. Malgré une détérioration dans 30 cas (59 %) immédiatement après l'intervention chirurgicale, seules 2 personnes ont présenté par la suite des déficits neurologiques. L'IRM postopératoire a montré que 16 % des résections étaient totales, 61 % sous-totales et 23 % partielles.
F. Lang et al. Lors de l'opération de patients atteints de tumeurs du lobe insulaire (22 personnes), seule l'approche transsylvienne a été utilisée et la navigation sans cadre a été utilisée pour optimiser l'approche chirurgicale. Une stimulation électrophysiologique a été réalisée dans tous les cas. La navigation échographique a permis de contrôler dans une certaine mesure l'étendue de la résection tumorale. En conséquence, chez 10 patients l'ablation était totale, chez les 12 autres elle était divisée à parts égales : sous-totale (6) et partielle (6). Dans la période postopératoire à long terme, le déficit neurologique n'a persisté que chez 2 patients. Les auteurs pensent que la principale raison de cet événement était l’endommagement des artères lenticulostriées lors de l’intervention chirurgicale. Pour réduire la probabilité de traverser ces artères lors de l'ablation de la tumeur, F. Lang et al. soigneusement analysé la relation entre ces artères et la tumeur selon les données IRM préopératoires (en modes standard) et planifié l'étendue de l'intervention chirurgicale en conséquence. Dans des études antérieures, H. Duffau a réalisé à cet effet une angiographie tomodensitométrique avant la chirurgie. La dernière publication proposait une IRM TOF 3D qui, selon les auteurs, reflétait le plus clairement les relations topographiques et anatomiques entre les artères lenticulostriées et la tumeur.
Seules 2 grandes études récentes (M. Simon et al., N. Sanai et al.) ont réalisé une analyse détaillée de la survie des patients atteints de tumeurs de la région insulaire en fonction de leur histologie et de l'étendue de la résection. Les travaux de M. Simon et al. incluaient 94 patients, dont 36 % avaient des gliomes bénins et 64 % des gliomes malins. En conséquence, les taux de survie globale et sans maladie à 5 ans pour les gliomes de grade II étaient respectivement de 68 et 58 %, pour les oligodendrogliomes anaplasiques de 83 et 80 %, pour les astrocytomes anaplasiques de 61 et 51 %, respectivement. Dans une étude récente de N. Sanai et al. Les résultats du traitement de 104 patients sont analysés, dont 60 % présentent des gliomes bénins et 40 % des gliomes malins. En conséquence, le taux de survie globale à 5 ans des personnes opérées pour des gliomes de grade II était de 100 % avec un taux de résection de plus de 90 % et approchait les 84 % avec un taux de résection inférieur à 90 %. Dans le même contexte, pour les gliomes malins, le taux de survie globale à 2 ans était de 91 % pour des taux de résection supérieurs à 90 % et approchait les 75 % pour des taux de résection inférieurs à 90 %. En conséquence, les auteurs ont conclu que l’étendue de la résection affecte de manière significative la survie globale et sans maladie.
Conclusion
Malgré la complexité de l'anatomie de la région insulaire du cerveau, des études récentes ont montré qu'une résection agressive des tumeurs gliales de l'insula est réalisable avec un taux acceptable de déficit neurologique postopératoire.
Des études récentes en neuroimagerie de l'insula ont conduit à un regain d'intérêt pour le rôle de cette région en conditions normales et dans le développement de pathologies. Dans cet article, les auteurs fournissent de brèves informations sur les caractéristiques anatomiques et histologiques de l’insula du cerveau humain. Ce qui suit décrit les fonctions physiologiques de l'insula et met en évidence son implication longtemps sous-estimée dans la pathogenèse des troubles psychiatriques et neurologiques. En conclusion, les auteurs proposent diverses techniques qui permettront de mieux étudier le rôle de l’insula au sein des neurosciences fondamentales et cliniques.
Glossaire:
Région agranulaire (cortex) : zone du néocortex avec des couches II et III relativement indiscernables et l'absence de couche IV.
Réseau exécutif central : un système de neurones dans le cerveau qui comprend le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex pariétal postérieur, qui sont responsables de fonctions cognitives de haut niveau telles que l'attention et la mémoire de travail.
Ressources cognitives : un ensemble de capacités et de ressources mentales liées à l'activité cognitive (attention, mémoire, mémoire de travail, réflexion, etc.).
Réseau cérébral passif : un système de neurones comprenant le cortex préfrontal ventromédian et le cortex cingulaire postérieur responsables des processus d'auto-perception tels que le traitement de la mémoire autobiographique et l'introspection.
Analyse de causalité Granger : approche pour étudier les interactions causales entre les activités neuronales dans des séries successives d’IRMf. La base de l’analyse de causalité est la propriété des causes de précéder les effets. Une subtile analyse statistique et prédictive permet de répondre à la question de la relation de cause à effet entre l’activation des différents domaines.
Région granulaire (cortex) : région du néocortex comportant six couches, dont une couche IV bien définie, qui contient de nombreux neurones granulaires étoilés recevant des afférences thalamocorticales.
Valences (valeurs de stimulus) : valeurs positives (attrayantes) ou négatives (répulsives) des stimuli qui sous-tendent certains comportements. Par exemple, l’attente de plaisir découlant de types de comportement spécifiques, comme manger de la nourriture ou étancher la soif, aura une valeur de stimulus positive.
Intéroception : la sensation et l'intégration de signaux autonomes, hormonaux, viscéraux et immunologiques associés au maintien de l'homéostasie, qui fournissent ensemble des informations sur l'état physiologique du corps. La progression du traitement neuronal de l'insula postérieure à l'insula antérieure est représentée comme suit : l'insula postérieure est responsable des projections primaires (objectives) des signaux intéroceptifs, tandis que l'insula antérieure effectue leur représentation secondaire et leur intégration avec les signaux émotionnels, cognitifs et motivationnels. signaux.
Projection neuronale de l’état du corps : le processus de cartographie topographique de l'état du corps dans le système nerveux central, en particulier dans la partie supérieure du tronc cérébral et du cortex cérébral, y compris l'insula. Par exemple, les réponses corporelles provoquées par des stimuli thermiques et viscéraux s’affichent dans certaines zones de l’insula. Les changements dans ces zones sont constamment surveillés et régulés afin de maintenir les paramètres physiologiques du corps à des valeurs optimales.
Réseau incitatif prioritaire : un système de neurones dans le cerveau, comprenant l'insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur, chargé d'identifier les stimuli saillants et de coordonner les ressources cognitives, telles que l'attention et la mémoire de travail, entre le réseau exécutif central et le réseau de mode passif du cerveau.
JE: perception consciente de sa propre existence. Des sensations subjectives superposées à des informations constamment mises à jour sur l’état objectif du corps permettent de prendre conscience de son « je » physique.
Sentiments subjectifs : sensations conscientes d'états corporels provoquées par des signaux internes (par exemple, soif, essoufflement, manque d'oxygène, toucher, démangeaisons, stimulation du pénis, excitation sexuelle, fraîcheur, chaleur, exercice, battements de cœur, dégustation de vin, distension de la vessie , estomac, etc.)
Les tendances
Grâce aux récentes études d’imagerie cérébrale, l’insula est à nouveau considérée comme une région cérébrale importante non seulement dans le contexte physiologique mais aussi pathologique de la recherche clinique. Le lobule antérieur de l'insula joue un rôle clé dans le maintien des états de sensations subjectives. Il peut également réguler l’implication des sensations dans les processus cognitifs et motivationnels.
Il est très important d’appréhender les états mentaux à travers le prisme des fonctions insula.
Pour surmonter les limites de l’imagerie du cerveau humain, de nombreux travaux doivent être réalisés sur le traitement statistique des données d’imagerie du cerveau humain.
Compte tenu des progrès technologiques récents dans les études précliniques chez les rongeurs, il est raisonnable de s’attendre à une meilleure compréhension du rôle causal de l’insula dans l’activité nerveuse supérieure. Une telle compréhension consiste en des informations à différents niveaux : depuis les gènes, les molécules, les cellules et les réseaux neuronaux jusqu'à la physiologie et le comportement.
Introduction : Il est temps de se concentrer sur l'insula
L'insula du cerveau humain a été décrite pour la première fois comme une « île » du cortex par Johann Christian Reil en 1796 ( île du latin - île). Depuis, l’île est restée longtemps oubliée. L'intérêt pour cette question est revenu en 1994, lorsqu'Antonio Damasio a formulé « l'hypothèse des marqueurs somatiques », selon laquelle la pensée rationnelle est indissociable des sentiments et des émotions, qui sont le reflet de l'état du corps. Des études récentes de neuroimagerie du cerveau humain ont souligné l’importance de l’insula dans de nombreuses maladies de cet organe. Le but de cet article est de mettre en lumière le rôle de l’insula, et notamment la relation entre le dysfonctionnement insulaire et les troubles psychiatriques et neurologiques. Pour atteindre cet objectif, les auteurs décrivent brièvement les caractéristiques anatomiques et histologiques de l'insula humaine. L'attention se porte alors sur les fonctions physiologiques de l'îlot et son rôle dans les pathologies. Enfin, des stratégies prometteuses sont proposées pour mieux comprendre le rôle de l’insula dans le fonctionnement cérébral normal et pathologique.
Anatomie et histologie de l'insula humaine
Le cortex insulaire est situé bilatéralement chez l'homme - dans les profondeurs de la fissure latérale (sylvienne), séparant le lobe temporal des lobes pariétaux et frontaux, au bas de la fosse latérale du cerveau (Fig. 1). En termes simples, le cortex insulaire peut être divisé en lobules antérieur et postérieur, chaque section ayant ses propres caractéristiques cytoarchitectoniques, sa propre configuration de connexions et remplissant donc des fonctions différentes. Les régions postérieures et granulaires (voir glossaire) de l'insula, en plus de l'afférentation des zones d'association des lobes frontal, occipital et temporal, reçoivent des entrées sensorielles ascendantes de la moelle épinière et du tronc cérébral via le thalamus. Ainsi, les signaux somatosensoriels, vestibulaires et moteurs sont intégrés dans ces régions. Les régions antérieures (agranulaires) ont des connexions réciproques avec des structures limbiques telles que le cortex cingulaire antérieur, le cortex préfrontal ventromédian, l'amygdale et le striatum ventral. Le lobule antérieur de l'insula est impliqué dans l'intégration des informations provenant des systèmes viscéraux et autres systèmes autonomes dans les composantes émotionnelles, cognitives et motivationnelles de l'activité nerveuse supérieure.

Source : Cellule
Figure 1. Anatomie de l'insula humaine.
Le cortex insulaire est situé bilatéralement dans les profondeurs de la fissure sylvienne, qui sépare le lobe temporal des lobes frontal et pariétal. L'insula est recouverte de parties des lobes frontal, pariétal et temporal, qui forment ensemble l'opercule. Le périmètre de l'îlot est limité par une rainure insulaire circulaire ; le sillon central profond de l'insula divise l'insula en parties antérieure et postérieure. Le lobule antérieur de l'insula a trois gyrus courts et le lobule postérieur en a deux longs. En tenant compte de la cytoarchitectonique, l'îlot peut être clairement divisé en sections agranulaires antérieures et granulaires postérieures avec la présence d'une région dysgranulaire transitionnelle entre elles.
L'insula antérieure est l'une des régions les plus différenciées du néocortex humain par rapport aux autres primates. Fonctionnellement et anatomiquement, cette zone est étroitement liée à la partie antérieure du gyrus cingulaire et, par conséquent, la partie antérieure de l'insula peut être conditionnellement considérée comme la « zone sensible du système limbique », associée au gyrus cingulaire antérieur - la « zone motrice du système limbique ». Il est intéressant de noter que l’insula antérieure est très similaire au cortex cingulaire antérieur dans la structure particulière des neurones pyramidaux de la couche 5, à savoir une haute densité de neurones fusiformes appelés neurones de von Economo. Bien que la fonction des neurones de von Economo dans cette région n'ait pas encore été clairement établie, il existe des preuves solides que ces neurones dotés d'axones de grand diamètre sont impliqués dans l'amélioration de l'intégration rapide et à long terme de l'information.
Fonctions physiologiques de l'insula humaine
D'innombrables fonctions sensorielles du cortex insulaire sont unies par le concept d'« intéroception ». L'intéroception est la représentation neuronale (projection) de paramètres corporels importants pour le maintien de l'homéostasie. On pense que l'intéroception devient progressivement plus complexe à mesure que les signaux se déplacent dans une direction caudo-rostrale : premièrement, les signaux primaires (objectifs) arrivent dans l'insula postérieure, où sont traités les stimuli sensoriels d'ordre inférieur. Ces informations sont ensuite transmises à l'insula antérieure, où ces signaux secondaires sont intégrés aux signaux émotionnels, cognitifs et motivationnels collectés dans d'autres zones corticales et sous-corticales telles que l'amygdale, le cortex cingulaire antérieur, le cortex préfrontal dorsolatéral et le striatum ventral (Fig. 2). .
L'insula antérieure joue un rôle clé dans le maintien des sensations subjectives. Il est bien connu que les signaux primaires provenant des récepteurs de divers sens sont projetés vers des zones spécifiques du cortex sensoriel primaire, comme le cortex visuel primaire. De même, l'insula postérieure est le cortex sensoriel primaire pour les signaux intéroceptifs primaires, et chacun de ces signaux a son propre site spécifique au sein de l'insula postérieure. Il est important qu'une telle commutation caudo-rostrale des signaux permette une perception consciente des signaux intéroceptifs ( En raison du fait que les signaux objectifs des intérocepteurs sont intégrés aux informations sur les paramètres subjectifs du psychisme. - environ. éd.), la partie antérieure de l’insula est donc la projection neuronale des sensations subjectives. Les sensations subjectives apparaissant dans l'insula peuvent également être la perception de soi : un certain nombre de chercheurs ont suggéré que la représentation intéroceptive dans l'insula antérieure nous donne une conscience des paramètres du corps en tant qu'êtres sensibles, ce qui pourrait finalement être la base de l'auto-évaluation. conscience.

Source : Cellule
Figure 2. Informations intéroceptives et son intégration avec les signaux émotionnels, cognitifs et motivationnels provenant de plusieurs zones corticales et sous-corticales.
Les informations intéroceptives sur les paramètres corporels en constante évolution arrivent à l'insula postérieure par le biais d'afférences ascendantes provenant de voies spécifiques de la moelle épinière et du tronc cérébral et de commutateurs dans le thalamus. Ces informations sont projetées rostralement vers l'insula antérieure, où elles sont intégrées aux signaux émotionnels, motivationnels et cognitifs provenant des régions corticales et sous-corticales du cerveau. Ainsi, le lobule antérieur donne lieu à des sensations subjectives uniques. De plus, en raison de son emplacement à l’intersection de multiples voies intracorticales associées à des processus cognitifs et motivationnels d’ordre élevé, l’insula antérieure régule l’implication des sensations subjectives dans les processus cognitifs et motivationnels.
Il a été démontré que l’insula joue un rôle important dans la formation de la conscience. Il existe des preuves indiquant que les sensations résultant de la participation de l'insula influencent la conscience : elles déterminent l'importance relative ( saillance) des stimuli compétents, à la suite desquels la priorité d'allocation des ressources cognitives est fixée pour ces stimuli. Nous prêtons attention et nous souvenons d’événements marquants associés à des sentiments de joie et de tristesse, de plaisir et de douleur. Les sensations influencent également les processus de formation d’inférences et de consolidation des croyances. En général, l'insula antérieure met en évidence les informations pertinentes basées sur des sensations subjectives et aide donc les processus cognitifs à sélectionner les informations à traiter ultérieurement.
L'insula joue également un rôle important dans la formation de la motivation, notamment dans la motivation explicite. La motivation explicite est un désir conscient et subjectif de changer de comportement, tandis que la motivation implicite implique un changement de comportement inconscient. La recherche convient que l'insula détermine la valence des stimuli en fonction des sentiments subjectifs évoqués par ces stimuli. Les stimuli enrichissants provoquent un sentiment de plaisir. à son tour, cela conduit à l'émergence d'un désir d'actions appropriées, tandis que les stimuli aversifs provoquent de la douleur, ce qui crée un sentiment de dégoût et définit un comportement d'évitement. Dans ce contexte, les sensations apparaissant dans l’insula médient le comportement humain.
La nécessité d'une interaction dynamique entre la sensation, le comportement et la motivation explique la localisation anatomique unique de l'insula antérieure. Le lobule antérieur de l'insula joue un rôle clé dans la formation des sensations subjectives. De plus, il est relié aux régions dorsolatérale et ventromédiale du cortex préfrontal. Des études récentes ont montré que les informations pertinentes provenant de l'insula antérieure sont collectées dans le cortex préfrontal dorsolatéral, ce qui entraîne un contrôle de l'attention et de la mémoire de travail, tandis que le cortex préfrontal ventromédian, basé sur des sentiments subjectifs, reçoit des informations de l'insula antérieure sur les résultats des précédentes. expérience comportementale, en tenant compte des situations actuelles, puis fixe des objectifs pour prendre des décisions concernant des actions ultérieures.
Toutes ces fonctions assurées par l’insula antérieure sont très similaires à celles exercées par l’amygdale. L'amygdale elle-même joue un rôle clé dans le processus de traitement des émotions, mais la fonctionnalité de l'insula et de l'amygdale est encore quelque peu différente : le travail de l'amygdale est associé à des réponses automatiques (implicites), tandis que le lobule antérieur de l'insula est responsable de l'expérience subjective (explicite) (c'est-à-dire les sensations subjectives). Par conséquent, l'amygdale appartient au système de réponses impulsives et l'insula antérieure appartient au système analytique. Ainsi, en plus de remplir les fonctions de centre d'intéroception, le lobe antérieur de l'insula est également un « standard » dans la régulation des processus cognitifs et de la motivation.
Rôle pathogénétique de l'insula dans les troubles psychiatriques et les maladies neurologiques
En façonnant le comportement humain, les sensations interagissent de manière dynamique avec la conscience et la motivation ; Le dysfonctionnement de ces interactions est à l’origine de nombreux troubles mentaux. En effet, de récentes méta-analyses approfondies d’études d’imagerie structurelle et fonctionnelle du système nerveux central ont confirmé que l’insula est le « noyau commun » affecté dans de nombreux troubles mentaux. Au cours de la recherche génomique, les scientifiques ont découvert la grande polygénicité des troubles mentaux. De plus, ces études ont également démontré la pléiotropie des facteurs de risque génétiques, ce qui a quelque peu miné la position des classifications diagnostiques existantes en termes d'exactitude biologique. Bien que l’approche traditionnelle de classification soit toujours applicable dans la pratique clinique, où la rapidité et la fiabilité sont très appréciées, dans le domaine des neurosciences, il devient de plus en plus important de comprendre les troubles mentaux dans le contexte des fonctions associées aux réseaux neuronaux correspondants du cerveau. Comme indiqué ci-dessus, l’insula joue un rôle dans le traitement des sensations et émotions subjectives. De plus, il assure l'intégrité des processus cognitifs et motivationnels, reliant entre elles les zones du cortex préfrontal responsables de leur formation : respectivement dorsolatérale et ventromédiale. Par conséquent, le dysfonctionnement de l’insula se reflète non seulement dans l’aspect émotionnel, mais affecte également les processus cognitifs et motivationnels dans un large éventail de troubles psychiatriques. Dans certains troubles psychiatriques, le dysfonctionnement insulaire entraîne une distorsion des sensations subjectives.
Des études structurelles (neuroimagerie utilisant la morphométrie voxel) ont montré des réductions significatives du volume de matière grise insulaire chez les patients présentant un trouble dépressif majeur. Dans les études d'imagerie IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle), l'activité insulaire s'est avérée significativement augmentée au cours du traitement émotionnel, alors que dans le trouble dépressif majeur, l'activité insulaire dans un paradigme d'état de repos ( Tâche manquante. - environ. traduction) diminue. Des anomalies structurelles et fonctionnelles de l'insula, notamment des voies de développement altérées et une diminution du volume de matière grise, sont également observées chez les patients atteints de trouble bipolaire. . Dans le même temps, aucun changement spécifique à l’IRMf n’a été identifié dans le trouble bipolaire. Outre les troubles affectifs, un traitement inadéquat des sensations subjectives par l'insula peut être à l'origine du développement de nombreux autres troubles psychiatriques accompagnés de troubles de la sphère émotionnelle. Par exemple, les déficits structurels et fonctionnels de l’insula sont associés à des troubles anxieux, à des troubles du traitement émotionnel dans la schizophrénie, à des anomalies dans le traitement des émotions sociales telles que l’empathie pour la douleur dans la psychopathie et à une image corporelle déformée dans l’anorexie mentale. Les modifications pathologiques de l'insula sont également impliquées dans les maladies neurologiques : dans la maladie de Huntington et la sclérose en plaques, il se produit une altération du traitement des expressions faciales, dans la maladie d'Alzheimer, la perception de soi est perdue. Le dysfonctionnement de l’insula est également à l’origine de troubles cognitifs dans un large éventail de troubles mentaux.
L'imagerie fonctionnelle utilisant l'analyse de causalité de Granger a montré une force réduite des influences causales du réseau insula à priorité de stimulus sur les réseaux exécutifs centraux et en mode par défaut du cerveau chez les patients atteints de schizophrénie. L'insula assure la commutation dynamique entre le réseau exécutif central et le réseau en mode passif, facilitant l'accès aux ressources cognitives telles que l'attention et la mémoire de travail lorsqu'un stimulus prioritaire se produit. Ainsi, les changements dans la force des connexions dans ces réseaux sont à l’origine des troubles cognitifs qui surviennent dans certaines formes de schizophrénie. Un hypofonctionnement du réseau insulaire a également été constaté chez des patients atteints de troubles du spectre autistique, ce qui peut s'inscrire dans le concept de facteurs de risque génétiques et biologiques communs aux troubles du spectre autistique et à certaines formes de schizophrénie. La pathologie insula contribue également à la consolidation de fausses croyances dans les délires.
Le dysfonctionnement de l’insula est à l’origine de déficits de motivation, par exemple en cas de toxicomanie. Un certain nombre de méta-analyses d'études d'imagerie fonctionnelle ont montré que les signaux liés à la drogue provoquent une explosion d'activité dans l'insula chez les personnes dépendantes. Sur la base du rôle physiologique de l'insula dans la motivation évoqué ci-dessus, il est probable que les sensations de plaisir liées à la drogue puissent influencer la signification motivationnelle des stimuli liés à la drogue, qui à leur tour influenceront la prise de décision. Les déficits de motivation chez les patients souffrant d’anhédonie peuvent également être associés à un dysfonctionnement de l’insula. De nouvelles preuves suggèrent que les déficits de détermination observés chez les patients atteints d'anhédonie pourraient être associés à des changements structurels et fonctionnels dans l'insula. Au niveau moléculaire, une corrélation a été trouvée entre la force de la réponse dopaminergique dans l'insula (bilatéralement) et la volonté de dépenser de l'énergie pour obtenir une récompense.
Vers une meilleure compréhension des rôles physiologiques et pathologiques de l’insula.
Les études d'imagerie cérébrale chez l'homme ont permis de mieux comprendre les fonctions physiologiques de l'insula et son rôle en pathologie. Cependant, il est beaucoup plus difficile de déduire des relations de cause à effet entre différents phénomènes en utilisant uniquement la neuroimagerie. Les données obtenues à partir de l’imagerie du cerveau humain sont limitées en résolution spatiale et temporelle. De plus, les bases physiologiques de la neuroimagerie fonctionnelle (par exemple, le signal BOLD - une modification du niveau du signal MR avec une modification locale du degré d'oxygénation du sang) n'ont été que partiellement étudiées. Pour surmonter ces limites, des efforts importants sont nécessaires pour traiter statistiquement les données de neuroimagerie. Par exemple, l’analyse de causalité Granger peut être utile pour étudier les relations de cause à effet qui existent dans les réseaux neuronaux. En outre, les progrès récents dans les technologies de stimulation cérébrale non invasive, telles que la stimulation magnétique transcrânienne, peuvent aider les scientifiques à étudier de nouvelles propriétés et connexions de l’insula sans violer les normes éthiques de la recherche.
Les études animales offrent une excellente opportunité d’explorer les rôles causals de l’insula en extrapolant les observations des études humaines. De plus, les expériences sur les animaux sont utiles pour surmonter les limitations spatiales et temporelles relatives aux études d’imagerie cérébrale menées chez l’homme. La connaissance de l'anatomie fonctionnelle comparée est importante pour adapter correctement les observations animales à l'homme. Compte tenu de la cytoarchitectonique et de l’ensemble des connexions similaires, nous pouvons parler d’un certain degré d’homologie entre les îlots des humains et des rongeurs. Les expériences sur les animaux nous permettent d'identifier les relations causales en nous permettant d'effectuer des interventions invasives directes sur le cerveau sans violer les normes éthiques fondamentales associées à la recherche humaine.
Les progrès technologiques récents dans les études précliniques chez la souris ont permis aux neuroscientifiques de formuler une image complexe de l'architecture des réseaux neuronaux et de leur activité dans diverses situations comportementales. Tout d’abord, grâce aux technologies de modification génétique, telles que le marquage spécifique des cellules des réseaux neuronaux par recombinaison Cre, une identification anatomique et génétique très précise des liens et connexions des réseaux neuronaux est devenue possible. Les « coordonnées » anatomiques et génétiques des éléments et connexions des réseaux de neurones peuvent alors être comparées avec des données sur leur activité et/ou l’évolution de leur activité dans certaines situations. Cela fournira une image complète des fonctions des réseaux de neurones en relation avec le comportement. Les outils désormais disponibles pour déterminer la représentation des fonctions cérébrales comprennent l'imagerie in vivo de l'activité neuronale chez des souris au comportement libre utilisant des microscopes miniatures pour enregistrer l'activité, et des approches opto/chimiogénétiques pour contrôler l'activité neuronale (Fig. 3, dessin principal). Des marqueurs moléculaires cliniquement détectables des réseaux biologiques affectés par des maladies peuvent être découverts à l’aide de techniques modernes telles que le séquençage de nouvelle génération et l’analyse de cellules uniques. Les rôles physiopathologiques de ces marqueurs dans les troubles psychiatriques peuvent ensuite être étudiés à plusieurs niveaux – cellulaire, neuronal, physiologique et comportemental – en utilisant des modèles animaux pertinents tels que des souris transgéniques et mutantes knock-out/knockin. En résumé, les auteurs fondent de grands espoirs sur l’utilisation d’approches translationnelles et rétro-traductionnelles pour interpréter correctement les données cliniques et précliniques et parvenir à une compréhension globale de la structure et de la fonction de l’insula (voir Questions ouvertes).