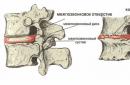Uretère(uretère) est un tube musculaire lisse, creux et quelque peu aplati, de 26 à 31 cm de long, qui relie le bassinet du rein à la vessie. Il se compose de trois parties : l'une est située dans l'espace rétropéritonéal, pars abdominalis, la seconde est dans le tissu sous-péritonéal du petit bassin, pars pelvina, et la troisième, la plus petite, se trouve dans la paroi de la vessie, pars intramuralis.
L'uretère a trois rétrécissements. Celui du haut se situe à son début, à la sortie du bassin. Ici, son diamètre est de 2 à 4 mm. Le rétrécissement moyen (jusqu'à 4-6 mm) est situé à l'intersection des vaisseaux iléaux et de la limite de l'uretère. Inférieur (jusqu'à 2,5-4 mm) - directement au-dessus du site de perforation de la paroi de la vessie par l'uretère. Dans les endroits de rétrécissement, les calculs urinaires sortant du bassin sont le plus souvent retardés. Entre les rétrécissements se trouvent des expansions : celle du haut mesure jusqu'à 8 à 12 mm de diamètre, celle du bas jusqu'à 6 mm.
Projections des uretères.
Sur la paroi abdominale antérieure l'uretère est projeté dans les zones ombilicales et pubiennes, le long du bord externe du muscle droit de l'abdomen. La projection postérieure de l'uretère, c'est-à-dire sa projection sur la région lombaire, correspond à la ligne verticale reliant les extrémités des apophyses transverses des vertèbres lombaires.
Uretère, comme le rein, est entouré de couches de fascia rétropéritonéal, fascia extraperitonealis et de fibres, paraurétérium, situées entre elles. Sur toute sa longueur, l'uretère est rétropéritonéal.
En descendant, du dehors vers le dedans, croisements d'uretères muscle majeur du psoas et n. génito-fémoral.
Ce proximité de l'uretère au nerf explique l'irradiation de la douleur au niveau de l'aine, du scrotum et du pénis chez l'homme et au niveau des grandes lèvres chez la femme lorsqu'un calcul traverse l'uretère.
Uretère droit est situé entre la veine cave inférieure de l'intérieur et le caecum et le côlon ascendant de l'extérieur, et celui de gauche est entre l'aorte abdominale de l'intérieur et le côlon descendant de l'extérieur.
En avant de l'uretère droit localisé : pars descendantens duodeni, péritoine pariétal du sinus mésentérique droit, a. et v. testiculaire (ovarica), a et v. ileocolicae et radix mesenterii avec des ganglions lymphatiques situés à proximité.
En avant de l'uretère gauche il existe de nombreuses branches de a. et v. mesentericae inférieures, a. et v. testiculaire (ovarica), mésentère du côlon sigmoïde et au-dessus - le péritoine pariétal du sinus mésentérique gauche.
Uretères sont reliés assez fermement au péritoine pariétal, de sorte que, lorsque le péritoine est décollé, l'uretère reste toujours sur sa face postérieure.
Lors de la transition vers le petit bassin uretère droit coupe généralement a et v. iliaques externes, gauche - a. et v. communes iliacées. Les contours de l'uretère dans ce segment sont parfois clairement visibles à travers le péritoine.
L'uretère dans le tiers supérieur fournit du sang branches de l'artère rénale, au milieu - branches de a. testiculaire (ovarique). Le sang veineux circule dans les veines du même nom que les artères.
Drainage lymphatique des uretères dirigé vers les ganglions lymphatiques régionaux du rein et ensuite vers les ganglions aortiques et caves.
Innervation des uretères abdominaux réalisée à partir du plexus rénal, pelvien - à partir du plexus hypogastrique.
Le système urinaire humain se compose de plusieurs organes, chacun étant chargé d'accomplir certaines tâches. Un fonctionnement altéré d'au moins un de ces organes conduit toujours au développement de maladies du système urinaire, qui s'accompagnent de nombreux symptômes et inconforts désagréables.
En particulier, dans le corps de chaque personne, il existe un organe apparié appelé uretère. En apparence, il s'agit d'un tube creux dont la longueur ne dépasse pas 30 cm et le diamètre est de 4 à 7 mm. Dans cet article, nous vous expliquerons pourquoi les uretères sont nécessaires, quelle est leur structure et quelles fonctions remplit cet organe.
La structure de l'uretère chez la femme et l'homme
Les uretères du corps des deux sexes proviennent du bassinet du rein. Ces tubes descendent ensuite derrière le péritoine et atteignent la paroi à travers laquelle ils pénètrent en direction oblique.
La paroi de chaque uretère comporte 3 couches :
- coque externe constituée de tissu conjonctif ;
- couche musculaire;
- membrane muqueuse recouvrant l'intérieur de l'uretère.
Le diamètre des uretères est une valeur relative et peut varier de manière assez significative selon les zones. Ainsi, normalement, chaque personne présente plusieurs rétrécissements anatomiques de cet organe apparié aux endroits suivants :
- à la jonction du bassinet du rein et de l'uretère ;
- avant la sortie de l'uretère dans le bassin ;
- à certains endroits du bassin ou sur toute sa longueur ;
- avant l'entrée de chaque uretère dans la vessie.
La longueur de cet organe peut également varier d'une personne à l'autre, en fonction du sexe, de l'âge et des caractéristiques anatomiques individuelles de la personne. 
Ainsi, l’uretère féminin est normalement 20 à 25 mm plus court que celui de l’homme. Dans le bassin des belles dames, ce tube est obligé de se plier autour des organes génitaux internes, il a donc un parcours légèrement différent.
Les uretères féminins s'étendent d'abord le long du bord libre des ovaires, puis le long de la base du ligament large de l'utérus. Ensuite, ces tubes passent obliquement dans la vessie à proximité immédiate et un sphincter musculaire se forme au niveau du site de transition.
Fonction de l'uretère dans le corps humain
La tâche principale des uretères est de transporter l’urine du bassin rénal vers la vessie. La présence d'une couche musculaire dans la paroi de cet organe lui permet de changer constamment de largeur sous la pression de l'urine circulant dans la cavité interne du tube, ce qui la « pousse » à l'intérieur. À son tour, l'urine ne peut pas revenir, car une partie de l'uretère à l'intérieur de la vessie agit comme une valve et un fusible.
Le système urinaire humain se compose de plusieurs organes interconnectés qui aident à éliminer l'excès de liquide du corps. Chaque organe a ses propres caractéristiques fonctionnelles. L'urine des reins pénètre dans les uretères.
Structure et anatomie topographique de l'uretère chez la femme quelque peu différent de l'uretère chez l'homme en raison de la localisation des organes du système génito-urinaire. En quoi consiste l'uretère et à quoi il ressemble, nous y réfléchirons plus loin.
Qu'est-ce que c'est, combien y en a-t-il et où se trouvent-ils - topographie
L'organe qui conduit le liquide des reins vers la vessie s'appelle l'uretère.
L'uretère relie les reins et la vessie. C'est un orgue double qui ressemble à deux tubes creux parallèles. Ces tubes sont composés de tissu musculaire lisse et sont visuellement légèrement aplatis. L'uretère transporte l'eau du bassinet du rein vers la cavité vésicale.
Fonctions de l'uretère
L'uretère sert pour transporter le liquide vers la vessie. L'organe a un fonctionnement spécifique autonome moteur.
Le rythme des contractions est assuré par un stimulateur cardiaque situé au sommet du bassin de l'uretère. La cyclicité, la vitesse et la fréquence du rythme dépendent du volume d’accumulation de liquide, de la position du corps de la personne, de son activité physique, de l’état du système nerveux et de l’irritation des voies urinaires.
Envie de couper déterminé par la concentration en calcium dans la structure fibreuse de l'uretère.
Quel est le système d’approvisionnement en sang ?
En fonction de la longueur de l'organe, l'apport sanguin (innervation) de l'uretère apporté par les vaisseaux sanguins sur toute sa longueur.

Les vaisseaux sont concentrés dans l'enveloppe externe de l'organe urinaire. Dans la partie initiale du tube urétéral, les branches artérielles proviennent des plexus artériels rénaux, dans la partie inférieure - des vaisseaux sanguins de l'artère iliaque (leur base est constituée des vaisseaux ombilicaux, utérins et vésicaux).
L'écoulement du sang veineux s'effectue dans les veines du même nom, parallèles aux veines artérielles. Dans la partie inférieure de l'organe, les ganglions lymphatiques iliaques sont considérés comme régionaux, dans la partie inférieure - les ganglions lymphatiques lombaires. L'innervation est réalisée par des amas nerveux autonomes dans la cavité pelvienne ainsi que dans la cavité péritonéale.
Péristaltisme
Le mouvement du liquide à l'intérieur de l'uretère est assuré par son péristaltisme, qui est assuré par stimulateur cardiaque (stimulateur cardiaque). Il peut s'agir d'un ou de plusieurs. Dans ce cas, chaque section de l'uretère fonctionne de manière autonome.
Au moment de l'accumulation de liquide dans la partie proximale du bassin, la paroi de la partie urétéropelvienne de l'organe est étirée, ce qui donne une impulsion au péristaltisme des parois de l'uretère.
vague en mouvement transmet l'impulsion sur toute la longueur de l'organe, qui est assuré par la contraction des faisceaux musculaires. Le liquide est libéré dans le tube urétéral. La compression des muscles du bassin ferme la libération de l'excès de liquide dans l'uretère. Les muscles circulaires externes déplacent le liquide le long de l'uretère jusqu'à la vessie.
Avant que l'urine ne soit libérée dans la cavité vésicale, les contractions s'arrêtent et le péristaltisme diminue.
La pression dans l'organe apparié fournit libre circulation de l'urine dans la vessie. La prochaine vague péristaltique contribue à l'épaississement et au raccourcissement de la section intra-muros, et les valvules à l'embouchure de l'uretère empêchent l'évacuation de l'urine.
L'onde péristaltique peut se produire 2 à 5 fois par minute.
L'action synchronisée des éléments péristaltiques libère les reins de l'excès de liquide et assure son écoulement uniforme dans la vessie.
Ainsi, l’uretère est un organe important du système urinaire. Grâce à l'uretère, il est assuré vider les reins de l'excès de liquide, le travail de l'organe apparié est directement lié à l'état des reins et à leur fonctionnement.
Regardez la vidéo pour voir à quoi ressemble réellement l'uretère :
Cliquez pour voir (ne surveillez pas les impressionnables)
Les uretères sont des tubes qui relient les organes qui produisent l'urine (les reins) à une structure non appariée, la vessie, qui la stocke et la libère du corps.
L'anatomie de l'uretère comprend :
- sa structure ;
- dimensions principales ;
- localisation par rapport aux organes environnants ;
- caractéristiques de l'approvisionnement en sang et de l'innervation.
L'uretère chez la femme n'a des caractéristiques distinctives que dans la partie pelvienne. Le reste de la structure est la même que celle du mâle.
Localisation par rapport aux organes et au péritoine
La sortie du rein est formée par l’ouverture rétrécie du bassin. L'orifice de l'uretère est situé à l'intérieur de la vessie. Il traverse la paroi et forme des ouvertures bilatérales en forme de fente sur la membrane muqueuse de la vessie. Au confluent de la partie supérieure, se forme un pli recouvert d'une muqueuse.
Il est d'usage de distinguer 3 sections de l'uretère.
Abdominal - traverse le tissu rétropéritonéal de la paroi postérieure de l'abdomen, puis longe la surface latérale jusqu'au petit bassin, jouxtant le muscle grand psoas en avant. La partie initiale de l'uretère droit se situe derrière le duodénum et plus près de la région pelvienne - derrière le mésentère du côlon sigmoïde.
Le point de référence à gauche est la paroi postérieure du pli entre le duodénum et le jéjunum. Dans la zone de transition vers la partie pelvienne, l'uretère droit se situe derrière la base du mésentère.
Pelvien - chez la femme, il est situé derrière l'ovaire, s'incurve autour du col sur le côté, longe le ligament large de l'utérus et s'insère entre la paroi de la vessie et le vagin. Chez l'homme, le tube urétéral passe vers l'extérieur et en avant du canal déférent, en le traversant, pénètre dans la vessie presque sous le bord supérieur de la vésicule séminale.
Section distale (la plus éloignée du rein) - traverse l'épaisseur de la paroi de la vessie. Il mesure jusqu'à 1,5 cm de longueur. C'est ce qu'on appelle l'intra-muros.
En pratique clinique, il est plus pratique de diviser l'uretère sur sa longueur en trois parties égales :
- haut;
- moyenne;
- bas.
Dimensions
Chez un adulte, la longueur de l'uretère est de 28 à 34 cm, elle dépend de la croissance et est déterminée par la hauteur des reins lorsqu'ils sont déposés dans l'embryon. Chez les femmes, la longueur de l'organe est de 2 à 2,5 cm plus courte que chez les hommes. L'uretère droit est un centimètre plus court que celui de gauche, car l'emplacement du rein droit est légèrement plus bas.
La lumière du tube n'est pas la même : des rétrécissements alternent avec des zones d'expansion. Les parties les plus étroites sont :
- à côté du bassin;
- à la limite des sections abdominales et pelviennes ;
- en entrant dans la vessie.
Ici, le diamètre de l'uretère est respectivement de 2 à 4 mm et de 4 à 6 mm.

Lors du diagnostic, les changements pathologiques sont déterminés segment par segment
Les segments se distinguent entre les zones rétrécies :
- ci-dessus – segment pyélo-urétral ;
- zone d'intersection avec les vaisseaux iliaques ;
- segment inférieur – vésico-urétéral.
Les sections abdominales et pelviennes de l'uretère diffèrent par la lumière :
- au niveau de la paroi abdominale, elle est de 8 à 15 mm ;
- dans le bassin – expansion uniforme ne dépassant pas 6 mm.
Cependant, il convient de noter qu'en raison de la bonne élasticité de la paroi, l'uretère est capable de s'étendre jusqu'à 8 cm de diamètre. Cette capacité aide à résister à la rétention et à la congestion urinaires.

En coupe transversale, la lumière de l'organe a une forme en forme d'étoile.
Structure histologique
La structure de l'uretère est soutenue par :
- de l'intérieur - la membrane muqueuse;
- dans la couche intermédiaire - tissu musculaire;
- à l’extérieur – adventice et fascia.
La membrane muqueuse est constituée de :
- épithélium transitionnel situé sur plusieurs rangées ;
- plaque contenant des fibres élastiques et de collagène.
La coque intérieure forme des plis longitudinaux sur toute sa longueur, qui protègent son intégrité lorsqu'elle est étirée. Les fibres musculaires se développent dans la couche muqueuse. Ils vous permettent de fermer la lumière du flux inverse de l'urine de la vessie.

Le numéro 1 montre un épithélium transitionnel à plusieurs rangées ; la détection de cellules dans le sédiment urinaire indique une pathologie.
La couche musculaire est formée de faisceaux de cellules s'étendant dans les directions longitudinale, oblique et transversale. L'épaisseur des cellules musculaires varie. La partie supérieure comprend deux couches musculaires :
- longitudinal;
- circulaire.
La partie inférieure est renforcée de trois couches :
- 2 longitudinaux (internes et externes);
- la moyenne entre eux est circulaire.
Les cellules myocytaires sont reliées par de nombreux ponts (nexus). Entre les faisceaux se trouvent des fibres de tissu conjonctif qui passent ici de la plaque de la membrane muqueuse et de l'adventice.
Approvisionnement en sang
Les tissus de l'uretère sont nourris par le sang artériel. Les vaisseaux se trouvent dans la membrane adventice (externe) et l'accompagnent sur toute sa longueur, pénétrant profondément dans la paroi avec de petits capillaires. Les branches artérielles naissent dans la partie supérieure de l'artère ovarienne chez la femme et de l'artère testiculaire chez l'homme, ainsi que de l'artère rénale.
Le tiers moyen reçoit le sang de l'aorte abdominale, des artères iliaques internes et communes. Dans la partie inférieure - des branches de l'artère iliaque interne (branches utérines, vésicales, ombilicales, rectales). Le faisceau vasculaire dans la partie abdominale passe devant l'uretère et dans le petit bassin - derrière lui.
Le flux sanguin veineux est formé par les veines du même nom, situées parallèlement aux artères. De la partie inférieure, le sang circule à travers elles vers les branches de la veine iliaque interne et de la partie supérieure vers la veine ovarienne (testiculaire).
Le drainage lymphatique passe par ses propres vaisseaux jusqu'aux ganglions lymphatiques iliaques internes et lombaires.
Caractéristiques de l'innervation
Les fonctions des uretères sont contrôlées par le système nerveux autonome via les ganglions nerveux de la cavité abdominale et pelvienne.
Les fibres nerveuses font partie des plexus urétéral, rénal et hypogastrique inférieur. Les branches du nerf vague se rapprochent de la partie supérieure. Celui du bas a la même innervation que les organes pelviens.
Mécanisme de réduction
La tâche principale des uretères est de pousser l’urine du bassin vers la vessie. Cette fonction est assurée par la contractilité autonome des cellules musculaires. Dans le segment urétéropelvien, il y a un stimulateur cardiaque (pacemaker), qui définit le taux de contractions requis. Le rythme peut varier en fonction :
- position du corps horizontale ou verticale ;
- taux de filtration et de formation d'urine ;
- « indications » des terminaisons nerveuses ;
- état et préparation de la vessie et de l'urètre.

L'évacuation de l'urine s'effectue grâce à l'activité des cellules musculaires.
L'effet direct des ions calcium sur la fonction contractile des uretères a été prouvé. La force des contractions dépend de la concentration dans les cellules musculaires lisses de la couche musculaire. Une pression est créée à l’intérieur de l’uretère qui dépasse celle dans le bassin et la vessie. Dans la partie supérieure, cela équivaut à 40 cm d’eau. Art., plus proche de la vessie – atteint 60.
Cette pression est capable de « pomper » l’urine à un débit de 10 ml par minute. L'innervation commune de l'uretère avec la partie adjacente de la vessie crée les conditions de coordination des efforts musculaires de ces organes. La pression dans la vessie « s’ajuste » à la pression urétérale, de sorte que, dans des conditions normales, le reflux inverse de l’urine (reflux vésico-urétéral) est évité.
Caractéristiques structurelles dans l'enfance
Chez un nouveau-né, la longueur de l'uretère est de 5 à 7 cm et a une forme alambiquée en forme de « genoux ». Ce n'est qu'à l'âge de quatre ans que la longueur atteint 15 cm. La partie intravésicale passe également progressivement de 4 à 6 mm chez les nourrissons à 10 à 13 mm à l'âge de 12 ans.
Dans la partie pelvienne, l’uretère s’étend selon un angle de 90 degrés, associé à la formation du bassinet rénal au cours de la première année de la vie du bébé.
La couche musculaire de la paroi est peu développée. L'élasticité est réduite en raison des fines fibres de collagène. Cependant, le mécanisme de contraction assure une évacuation assez importante des urines, le rythme des contractions est constamment fréquent.
Les malformations congénitales sont considérées :
- atrésie - absence totale du tube ou de la sortie urétérale ;
- mégalouremètre – expansion prononcée du diamètre sur toute la longueur ;
- ectopie - localisation ou connexion perturbée de l'uretère, comprenant la communication avec les intestins, l'entrée dans l'urètre, le contournement de la vessie, la connexion avec les organes génitaux internes et externes.
Méthodes d'étude de la structure de l'uretère
Pour identifier la pathologie, il faut des méthodes qui révèlent l'image caractéristique de la lésion. Pour cette utilisation :
- clarification des antécédents médicaux, plaintes;
- palpation de l'abdomen;
- Examens aux rayons X ;
- techniques instrumentales.
Le plus souvent, la pathologie des uretères s'accompagne de symptômes douloureux. Typique pour eux :
- caractère – douleurs constantes ou coliques paroxystiques ;
- irradiation - au bas du dos, au bas de l'abdomen, à l'aine et aux organes génitaux externes, et chez les enfants à la région du nombril.
Par répartition, on peut juger de la localisation du processus pathologique :
- si les troubles se situent dans le tiers supérieur de l'uretère, alors la douleur se dirige vers la région iliaque (dans l'hypocondre) ;
- de la partie médiane - jusqu'à l'aine ;
- du tiers inférieur - vers les organes génitaux externes.
Les plaintes du patient concernant la douleur pendant la miction et les envies fréquentes sont dues à une pathologie des parties pelviennes et intra-muros de l'organe.
Par palpation, un médecin expérimenté déterminera la tension musculaire de la paroi abdominale antérieure le long de l'uretère. Pour une palpation plus détaillée de la partie inférieure, une approche bimanuelle (à deux mains) est utilisée. Une main avec deux doigts est insérée dans le rectum, le vagin chez la femme, l'autre effectue des contre-mouvements.
Dans un test d'urine en laboratoire, on trouve de nombreux leucocytes et globules rouges, ce qui peut indiquer une lésion des voies urinaires inférieures.
Cystoscopie - en insérant un cystoscope à travers l'urètre jusqu'à la vessie, vous pouvez examiner les ouvertures (orifices) des uretères de l'intérieur. Ce qui compte, c'est la forme, l'emplacement, la libération du sang et du pus.
Par chromocystoscopie avec injection préalable d'un colorant dans la veine, le taux de libération de chaque ouverture est comparé. Ainsi, on peut suspecter la présence d’un blocage unilatéral (calcul, pus, tumeur, caillot sanguin).
Le cathétérisme de l'uretère est réalisé avec un cathéter fin à travers le trou de la vessie jusqu'au niveau de détection de l'obstacle. Une approche similaire à l'urétéropyélographie rétrograde vous permet de vérifier l'anatomie radiologique des uretères, la présence de perméabilité des goulots d'étranglement et la tortuosité.
Un urogramme d'enquête ne montre pas les uretères, mais en cas de calcul existant (ombre de calculs), sa localisation peut être suspectée.

Les contours montrent des rétrécissements physiologiques et l'état des segments entre eux ; dans ce cas, une violation du passage du contraste a été révélée, pouvant aller jusqu'à l'obstruction complète de la lumière.
Le plus révélateur est l'urographie excrétrice. Une série d'images après administration intraveineuse de produit de contraste permet de retracer l'évolution des uretères et d'identifier une pathologie. L'ombre ressemble à un ruban étroit avec des limites claires et lisses. Le radiologue détermine l'emplacement par rapport aux vertèbres. Dans la cavité pelvienne, 2 courbures sont observées : d'abord sur le côté, puis à l'approche de la vessie vers le centre.
L'urotomographie est réalisée en cas de doute sur l'importance des lésions des organes et tissus voisins. Les images couche par couche permettent de les séparer de l'uretère.
Les capacités motrices sont étudiées à l'aide de la leçonographie. La méthode vous permet d'identifier une diminution ou une augmentation du tonus des muscles des parois. Les appareils modernes permettent de voir sur l'écran la contraction de différentes parties de l'uretère et d'étudier l'activité électrique des cellules.
La connaissance de la structure et de la localisation des uretères est nécessaire au diagnostic des maladies du système urinaire, pathologie comparative accompagnée d'une rétention urinaire. Chaque intervention chirurgicale en urologie opératoire doit prendre en compte les caractéristiques anatomiques liées à l'âge et l'approche des faisceaux neurovasculaires. En langage médical, on les appelle topographie.
Le terme « orifice urétéral » est utilisé pour définir l'un des composants du système excréteur, dont les tâches fonctionnelles comprennent l'excrétion de l'urine et la prévention du mouvement de l'urine dans la direction opposée. Ces segments peuvent être caractérisés comme étant étroits, avec de petites ouvertures qui unissent les parois de l'organe et les uretères en un seul système. En raison de leur fonction anatomique, les orifices sont constitués principalement de tissu musculaire.
Parmi leurs caractéristiques physiologiques figure également le diamètre de la sortie, dont la largeur est d'environ un millimètre. Compte tenu de cet aspect, c'est cette section du système urétéral qui est le plus souvent obstruée par des néoplasmes pathologiques tels que des calculs et de grosses particules de sable.
Caractéristiques anatomiques
Dans le corps d'un adulte, l'orifice est anatomiquement situé dans la partie centrale de la vessie, formant des plis mineurs dans les parois tissulaires de l'organe, constitués principalement de tissu musculaire. Au milieu entre les uretères se trouve également un pli formé par un muscle lisse, appelé triangle de la vessie ou une petite zone de tissu constituée exclusivement de muqueuses.
L'orifice de l'uretère est la section la plus étroite, ce qui prédispose au blocage de la lumière lors de la formation et de la libération ultérieure de calculs, c'est-à-dire de sable et de calculs. Ce processus pathologique s'accompagne de sensations douloureuses et peut conduire au développement d'un certain nombre de complications.
La longueur de l'uretère peut varier quelque peu et est généralement comprise entre vingt-huit et trente-deux centimètres. Dans le même temps, les tailles des éléments droit et gauche du système urinaire diffèrent également, cela est dû au fait que les reins sont situés à des niveaux différents.
Le diamètre de l'uretère a également des valeurs numériques différentes. L'orifice, par exemple, est l'un des trois rétrécissements anatomiques, chacun étant caractérisé comme un segment à risque d'obstruction par des calculs. Il convient également de noter qu'au repos, le diamètre de la bouche ne dépasse pas un millimètre, mais que dans le contexte d'une activité active, la valeur augmente légèrement, en règle générale, jusqu'à trois millimètres.
Il en existe trois conditionnels, dont les caractéristiques anatomiques peuvent différer légèrement selon le sexe et la localisation :
- Abdominal. Normalement, cette section de l'uretère est située au tout début, à proximité immédiate des parois externes du tissu musculaire de la région lombaire.
- Gauche. L'emplacement de cette section est le suivant : la surface postérieure du coude située entre le duodénum et le jéjunum.
- Pelvien. La localisation de ce segment de l'uretère chez la femme est caractérisée par les éléments suivants : sur la face antérieure des ovaires, passant derrière la paroi de l'utérus et située entre les tissus de la vessie et du vagin. Les uretères chez l'homme passent à proximité des canaux séminaux.
En raison des particularités de la structure anatomique des uretères chez l'homme, avec des pathologies de cet organe, il est tout à fait possible de perturber l'activité des organes du système reproducteur.
Tâches fonctionnelles
Les uretères circulant dans la vessie, ainsi que les orifices, effectuent des tâches fonctionnelles identiques : en raison de la prédominance du tissu musculaire, ces éléments du système excréteur poussent l'urine et empêchent son retour vers les reins. Cette activité est possible grâce à la structure des uretères et aux fibres musculaires élastiques situées dans la structure de leurs tissus.
En fonction de l'influence négative de divers facteurs, une perturbation ou une perte totale de cette fonction est possible. Dans le contexte de telles pathologies, la manifestation de telles variantes de dysfonctionnement des uretères et des orifices est possible, telles que le reflux d'urine dans les reins, le blocage des lumières par des calculs, la stagnation de l'urine, ainsi qu'un certain nombre d'autres. .
Symptômes de maladies et pathologies
L’une des pathologies les plus fréquemment diagnostiquées, entraînant le développement de complications et une détérioration significative de l’état du patient, est la formation de sable ou de calculs dans les canaux urétéraux. Selon les spécialistes en exercice, une telle maladie peut être la conséquence d'une mauvaise alimentation, de mauvaises habitudes ou d'un mode de vie majoritairement malsain.
Afin d'identifier rapidement une maladie existante, il est nécessaire de savoir quels signes cliniques peuvent en être la manifestation. Ceux-ci incluent, par exemple :

- L’un des symptômes les plus courants est une crise aiguë et soudaine de douleur intense. Le plus souvent, l'inconfort survient lors de la marche rapide, de la course ou d'autres activités actives.
- Incontinence urinaire. En règle générale, un tel symptôme est de nature ponctuelle et se produit dans le contexte d'un blocage du conduit suivi de sa libération.
- Envie fréquente et très forte d’uriner.
- Si les calculs ont bloqué la zone de la bouche, c'est-à-dire la zone où l'uretère se jette dans la vessie, il existe une forte probabilité de perturbation de l'écoulement de l'urine, d'apparition de symptômes d'intoxication générale du corps, qui comprennent : pâleur de la peau, léthargie, faiblesse, augmentation de la température corporelle générale, nausées sévères.
Une perturbation de l'activité des uretères due à l'influence négative de tout facteur, entre autres choses, peut provoquer un empoisonnement du corps par des produits de désintégration, des toxines et des déchets. Pour prévenir d'éventuelles complications, vous devez consulter un médecin immédiatement après l'apparition de symptômes inquiétants.
Méthodes de diagnostic
Pour identifier les calculs dans les uretères, il est nécessaire d'utiliser un certain nombre de mesures de diagnostic qui aideront non seulement à déterminer la présence de calculs, mais également leur taille, leur nombre et leur zone de localisation. Tout d’abord, une étude des antécédents médicaux du patient est nécessaire, suivie d’un examen physique, associé à une palpation de la zone où est localisé le syndrome douloureux.

Une analyse d'urine en laboratoire est également requise. Cette méthode est efficace pour déterminer les calculs dans les organes du système excréteur, leur taille et leur quantité approximatives. De plus, une telle étude permet d'étudier la composition chimique des calculs et d'identifier la cause probable de l'apparition de néoplasmes pathologiques dans les organes du système excréteur.
Pour une détermination visuelle plus précise des calculs, ainsi que de leur nombre, de leur forme et de leur emplacement, il est nécessaire d'utiliser des techniques telles que la radiographie, la tomodensitométrie et l'échographie. Cette dernière méthode présente un petit nombre de contre-indications et de limites et est donc particulièrement souvent utilisée.
Options de traitement
Il existe plusieurs options de base grâce auxquelles vous pouvez éliminer les calculs des uretères et des organes du système excréteur, ainsi que prévenir l'apparition de néoplasmes pathologiques à l'avenir. En règle générale, au début, diverses options de médicaments et de physiothérapie sont utilisées. La combinaison combinée de ces méthodes permet d'éliminer la douleur et également de stimuler l'élimination des calculs.
L'utilisation de médicaments n'est possible que si la taille des calculs individuels ne dépasse pas trois millimètres. Le plus souvent, le patient doit prendre les médicaments suivants :

- Des analgésiques qui aident à éliminer l'inconfort ainsi que les processus inflammatoires. Parmi eux : Naproxène, Ibuprofène, Noshpa.
- Agents urolitiques qui favorisent une dissolution douce et l'élimination ultérieure des calculs : Tamsulosine, Nifédipine.
En règle générale, l'élimination des calculs des cavités de l'uretère n'est effectuée que si la formation pathologique est de taille importante ou n'est pas excrétée du corps même après une longue période d'utilisation de médicaments spécialement destinés à cet effet.
La médecine traditionnelle
Des produits très efficaces et relativement sûrs, préparés conformément aux conseils de la médecine alternative, aideront à éliminer les néoplasmes pathologiques des uretères, ainsi que d'autres parties du système excréteur. Mais il convient de noter qu’ils ne peuvent être utilisés qu’après avoir reçu l’accord du médecin traitant.
Les recettes les plus populaires sont les suivantes :

- Traitement aux pastèques. Afin de se débarrasser des calculs ou du sable dans l'uretère grâce à l'utilisation de cette baie sucrée, il est important de s'approvisionner en grande quantité de pastèques. Les fruits doivent être consommés au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Vous pouvez également inclure une petite quantité de pommes et de pain de seigle dans votre alimentation. Vous devriez manger des pastèques pendant au moins cinq jours.
- Traitement à base de plantes. Il est également recommandé d'effectuer un traitement à domicile avec des herbes médicinales aux propriétés diurétiques prononcées. Ceux-ci incluent, par exemple, la réglisse et le séné. Afin de préparer une boisson médicinale, vous devez préparer une demi-cuillère à café de matière première avec un verre d'eau bouillante, la laisser refroidir et la boire tout au long de la journée.
Le retrait des calculs peut s'accompagner de douleurs intenses. Afin de les réduire quelque peu, lors de la prochaine crise de colique néphrétique, vous devriez prendre un bain chaud. Cette mesure permettra d'éliminer les tumeurs pathologiques plus rapidement et sans douleur.
Lors du traitement visant à éliminer les calculs et à normaliser l'activité des uretères, il convient de rappeler qu'une mesure thérapeutique obligatoire, ainsi qu'une méthode de prévention de la formation de sable, consiste à maintenir une alimentation équilibrée. Tout d'abord, il est nécessaire d'augmenter considérablement la quantité de liquide consommée tout au long de la journée. Il est recommandé de boire fréquemment, par petites portions, en choisissant des thés, des boissons aux fruits, des compotes à base de baies et de fruits aigres naturels.
La nutrition doit être aussi légère que possible, mais riche en énergie. Il est important d'éviter les assaisonnements et épices piquants, il est également recommandé de limiter considérablement la quantité de sel. L’alimentation doit être naturelle : vous ne devez manger que des légumes, des fruits, des viandes maigres, du poisson et des pâtisseries à base de blé dur. Vous devez suivre une alimentation douce non seulement pendant la période de traitement, mais également après la guérison. Cette mesure contribuera à prévenir la formation de calculs à l'avenir.