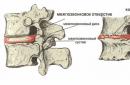Les lésions de la glande salivaire par adénome pléomorphe (tumeur mixte) ont été décrites pour la première fois par Minssen en 1874. Cette tumeur représente jusqu'à 60 % de toutes les lésions oncologiques de cet organe. Les infections des voies respiratoires sont beaucoup moins fréquentes. Shirokova A.P. et al. (1985) n'ont identifié que 3 adénomes pléomorphes sur 137 tumeurs bronchiques bénignes. Au niveau du larynx, cette tumeur a été décrite chez 5 patients dans la littérature nationale [Darovsky B.P. et al., 1973; Chumakov F.I. et coll., 1982; Klyuchikhin A.L. et coll., 1996 ; Samsonov V.A., 1995].
Une tumeur mixte de la trachée a été décrite pour la première fois par S. Kay (1970). Par la suite, le nombre de ces messages a commencé à croître rapidement. À ce jour, plus de 30 autres observations ont été décrites à l'étranger.
La tumeur fait généralement saillie dans la lumière de la trachée sous la forme d'un polype à base large ou sur une tige (Fig. 29 a, b). La paroi postérieure est le plus souvent touchée. En cas de croissance exotrachéale, elle peut atteindre des tailles importantes. Une particularité est la présence de structures épithéliales très différenciées caractéristiques des bronches et des bronchioles. Il existe des éléments de type papillaire, tubulaire, de l'épithélium cuboïde et des éléments similaires aux cellules de Clara.
La maladie a un pronostic généralement favorable. En raison de la rareté relative de cette variante tumorale, les caractéristiques de son échec ont été étudiées en profondeur. La question de l'existence de formes malignes d'adénome pléomorphe est discutée depuis longtemps. Il était généralement admis que dans la plupart des cas, les désaccords survenaient en raison d'erreurs de diagnostic : d'autres tumeurs dysontogénétiques, notamment le carcinosarcome ou la tumeur mucoépidermoïde, sont confondues avec un adénome.
Cependant, S. Mori (1997) a décrit une résection circulaire de la trachée pour un adénome pléomorphe chez un patient de 69 ans. Le diagnostic a été posé par biopsie. Cependant, l'échantillon a révélé un cancer provenant d'un adénome et des éléments malins ont été trouvés le long du bord de la résection. Une radiothérapie supplémentaire a été réalisée à la dose de 60 Gy. Le patient a été observé sans rechute pendant un an. Transformation maligne de l'adénome pléomorphe glande salivaire 12 à 37 ans après la résection non radicale ont été observés par S.W. Duck (1992). On sait que les tumeurs de cet organe deviennent malignes dans 1,4 à 5,3 % des cas.
Caractéristiques cytologiques. La composante épithéliale est représentée par des cellules à cytoplasme clair et à noyaux hyperchromes. Les mitoses pathologiques sont rares. Il peut y avoir des structures ressemblant à des éléments de l'épithélium pavimenteux (28 a)...
La composante mésenchymateuse est déterminée sous la forme de tissu conjonctif, de zones chondroïdes myxoïdes et parfois de fragments de foyers de formation osseuse (?). Le rapport des composants épithéliaux et mésenchymateux peut être différent. Dans le contexte du tissu interstitiel, on trouve des cellules en prolifération présentant des signes morphologiques d'épithélium glandulaire. Les cellules sont disposées sous forme de brins ou « noyées » dans une substance interstitielle, de caractère et de couleur hétérogènes : des masses homogènes non formées sont associées à des zones de matière fibreuse de couleur rose-violet (Fig. 30 a).
. L'adénome pléomorphe, comme une tumeur similaire de la glande salivaire, a une structure microscopique variée : excroissances d'épithélium pavimenteux avec des signes de kératinisation, cellules de petites cellules à cytoplasme homogène (myoépithélial), abondance de structures avec un revêtement épithélial binucléaire (imitation de canaux), des structures glandulaires de cellules légères et riches en glycogène (leur cytoplasme contient des granules sécrétoires) et, enfin, des zones myxomateuses riches en mucopolysaccharides dans le stroma avec la présence d'inclusions chondroïdes et chondromateuses (Fig. 30 b).
Les éléments tumoraux sont localisés soit dans un tissu fibreux dense, soit dans des zones myxoïdes ou chondroïdes, soit parmi des cellules fusiformes regroupées en faisceaux entrelacés. Les zones de mucus riches en mucopolysaccharides avec une réaction négative au bleu alcian et à la mucicarmine sont spécifiques de l'adénome pléomorphe.
La membrane muqueuse de la trachée ne s'ulcère généralement pas. Les cellules tumorales, les tubes et les glandes sont situés dans l'épaisseur de la paroi, s'étendant au-delà des plaques cartilagineuses sans leur destruction.
Ultrastructure. La microscopie électronique révèle des cellules glandulaires sécrétoires, des éléments de l'épithélium pavimenteux, un grand nombre de cellules myoépithéliales et des éléments mésenchymateux du stroma.
Les cellules myoépithéliales sont situées en groupes autour de lacunes au contenu amorphe. Le contenu des myofilaments peut être en quantité importante, puis ils poussent, sous forme de faisceaux longitudinaux, le noyau vers la périphérie. Il existe peu d'organites avec un grand nombre de myofilaments. La membrane basale et les desmosomes sont clairement définis. Il est caractéristique que dans la zone d'accumulation du myoépithélium, la substance intercellulaire présente un motif fibrillaire délicat.
Éléments de l'épithélium pavimenteux - avec différents degrés de différenciation. Certains d’entre eux contiennent une abondance de tonofibrilles, des desmosomes distincts et de nombreux ribosomes. Les cellules présentant une différenciation épithéliale pavimenteuse distincte prédominent. Les cellules glandulaires ont de gros noyaux, un réticulum endoplasmique rugueux bien développé avec un nombre variable de vacuoles sécrétoires délimitées par des membranes. En général, dans les adénomes pléomorphes et les tumeurs mucoépidermoïdes, les éléments squameux et glandulaires ont une organisation ultrastructurale similaire. Cependant, l'adénome contient du tissu conjonctif et des éléments cellulaires cartilagineux typiques.
L'histogenèse d'une tumeur « mixte », ainsi que la possibilité de sa transformation en cancer, sont généralement associées à l'épithélium et au myoépithélium des conduits (cellules de réserve), et les modifications du stroma sont le résultat de l'influence du « secret » du myoépithélium (I.V. Dvorakovskaya, 1979 ; N. T. Raikhlin et al., 1981 ; T. A. Belous, 1982).
Il convient de garder à l'esprit qu'un examen cytologique peut faire suspecter une tumeur maligne de bas grade, ce qui entraîne une expansion injustifiée de la portée de l'opération [Klyuchikhin A.L. et coll., 1996].
Caractéristiques histologiques. La tumeur contient une composante épithéliale et une composante myoépithéliale dominante. Une quantité excessive de myxoïde avec des foyers de matrice chondroïde se trouve dans le stroma.
L'examen immunohistochimique révèle des kératines de faible poids moléculaire. Les anticorps dirigés contre d’autres types de kératine, d’actine et de vimentine étaient moins courants. Les éléments cellulaires réagissent différemment à la protéine S-100 et à la protéine acide des fibrilles gliales. Chez les patients présentant des symptômes atypiques Avec l'image de la tumeur après la chirurgie dans les 2-3 ans, il existe une forte probabilité de rechute.
A. Hemmi et al. (1988) ont décrit une variante maligne de l'adénome trachéal pléomorphe chez un patient de 65 ans. 11 ans après l'ablation complète d'une lésion primaire polypoïde sous-muqueuse de 1,3 cm de diamètre, des métastases ont été découvertes dans le poumon et la paroi thoracique. La tumeur primaire était constituée d'éléments épithéliaux (structures glandulaires) et d'un stroma myxochondroïde ; des zones de métaplasie squameuse ont été identifiées. De nombreuses cellules tumorales étaient d’origine myoépithéliale, confirmée par microscopie électronique. L'examen immunohistochimique a révélé la protéine S-100 et GFAP??. La composante épithéliale apparaît atypique, avec de multiples mitoses. La croissance infiltrante de la tumeur était remarquable.
Nous avons opéré 5 patients présentant un adénome trachéal pléomorphe. Les caractéristiques des observations sont présentées dans le tableau 15. Aucune observation n’a permis d’établir la nature de la tumeur avant l’intervention chirurgicale. La conclusion la plus typique : adénome, cylindrome, polype. Une rechute est survenue 8 ans plus tard lors d'une observation chez un patient de 65 ans après excision économique de la tumeur (trachéofissure) sans irradiation. Après radiothérapie à la dose totale de 46 Gy, le patient est en vie sans rechute depuis 4 ans.
Tableau 15. Résultats du traitement des patients atteints d'adénome pléomorphe
| Sol | Âge | Durée antécédents médicaux | Taille de la tumeur (cm) | Opération | Irradiation (bétatron) | Rechute (en années) | Vivant (années) |
| ET | 54 | 12 | 4,5* | cirque. rés. | — | — | 15 |
| ET | 60 | 2** | 1,5 | cirque. rés | — | — | 14 |
| ET | 44 | 2 | 2,5 | cirque. rés. | 2 X 46 Gy | — | 13 |
| ET | 65 | ? | ? | éco. rés. | — | 8 | 11 |
| M. | 32 | 3 | 2,5 | cirque. rés. | 2 X 46 Gy | — | 12 |
Ainsi, il convient de souligner que les dommages à la trachée, ainsi qu'aux glandes salivaires, peuvent survenir à la fois de manière maligne et bénigne. Le pronostic est déterminé avec assez de confiance par la taille de la lésion primaire, la nature de l'infiltration frontalière et le degré d'activité mitotique de la tumeur. De plus, la méthode de traitement joue également un rôle important. Dans la plupart des cas, un traitement combiné avec une irradiation postopératoire à deux ou trois champs (ROD 2 Gy, SOD 46 Gy) doit être préféré.
Tumeur mixte des glandes salivaires
Le nom de tumeur mixte est dû à la variété de tissus inclus dans la structure de cette tumeur, localisée dans les grandes et petites glandes salivaires.
Parmi les grosses glandes salivaires, une tumeur mixte touche principalement les glandes parotides, puis les glandes sous-maxillaires et enfin les glandes sublinguales.
En plus des grosses, une tumeur mixte peut être localisée dans des glandes salivaires mineures, situées à de nombreux endroits de la muqueuse buccale : au niveau du palais dur et mou, des joues, de la langue, au fond de la bouche, et aussi dans les lèvres.
Parmi les patients atteints de tumeurs mixtes, les femmes prédominent. Cette tumeur s'observe à tout âge. Des tumeurs congénitales mixtes des glandes salivaires parotides et sous-maxillaires ont été décrites.
Nous avons examiné le matériel chirurgical dans 134 cas, dans lesquels le diagnostic de « tumeur mixte » a été confirmé histologiquement. Cela comprenait des variantes particulières de tumeurs des glandes salivaires, également d'origine épithéliale : cylindrome et tumeur mucoépidermoïde.
Sur les 134 observations, les tumeurs mixtes concernaient 71 femmes et 63 hommes. Par âge, les patients étaient répartis comme suit : 10-20 ans - 12 patients, 21-30 ans - 27, 31-40 ans - 20, 41-50 ans - 41, 51-60 ans - 19, 61-70 ans - 13 ans, plus de 70 ans - 2 patients.
Macroscopiquement, la taille d'une tumeur mixte peut être de la taille d'une noisette ou plus grande, atteignant parfois des tailles plus grandes. K.K. Alkalaev et N.V. Garifulina ont décrit une tumeur mixte de la glande salivaire sublinguale mesurant 5 X 19 X 17 cm. Une tumeur mixte présente généralement une capsule la délimitant des tissus environnants. La surface de la tumeur est souvent grumeleuse, parfois la tumeur est constituée de ganglions fusionnés. Sa consistance est généralement dense, gris blanchâtre ou gris-rougeâtre à la coupe. Des hémorragies, un ramollissement et des kystes peuvent être observés au niveau de la tumeur.
La structure histologique d'une tumeur mixte typique est caractérisée par la présence de complexes de cellules épithéliales de tissu conjonctif fibreux, souvent hyalinisé, muqueux et cartilagineux (Fig. 49).
Les zones épithéliales de la tumeur sont constituées de petites cellules uniformes et polygonales avec de petits noyaux ronds riches en chromatine. L'épithélium se présente sous forme de complexes trabéculaires ou de structures glandulaires. Dans une tumeur mixte, la quantité de tissu muqueux et cartilagineux varie, ou ces tissus peuvent être absents.
Dans certains cas, de vastes zones de tissu cartilagineux, constituées d'une substance principale homogène teintée de rose ou de bleuâtre (lorsqu'elle est colorée à l'hématoxyline-éosine) et de cellules cartilagineuses entourées d'une capsule, sont situées directement à côté de l'épithélium de type transitionnel.
La substance muqueuse avec des cellules étoilées caractéristiques dans une tumeur mixte peut être présente en petites quantités ou occuper de grandes zones, également situées directement à côté ou entre les cellules épithéliales de la tumeur.
L'apparition de tissu muqueux dans les tumeurs mixtes est associée à une dégénérescence muqueuse de l'épithélium et à la transformation muqueuse du tissu mésenchymateux interstitiel de la tumeur, comme le montrent des études histochimiques pertinentes. Parfois, une tumeur mixte contient des îlots de tissu adipeux.
En plus de cette structure typique d’une tumeur mixte, elle peut présenter des déviations structurelles particulières. Ainsi, dans les complexes épithéliaux parmi les cellules polygonales, il peut y avoir des zones d'épithélium pavimenteux, parfois kératinisées, ainsi que de multiples petites pétrifications, généralement de forme ronde.
Certaines tumeurs mixtes présentent des cellules épithéliales considérablement allongées, reliées entre elles par des processus assez longs. Dans les cas où la tumeur présente une hyalinose prononcée de la substance principale, les cellules épithéliales sont situées sous la forme d'un réseau délicat parmi le tissu hyalinisé.
(syn. tumeur maligne de la peau mixte) est une tumeur cutanée rare représentée par la combinaison d'un composant épithélial malin et d'un composant mésenchymateux mature, provoquant un tableau histologique mixte caractéristique.
Il est généralement admis que syringiomes chondroïdes les plus malins surviennent de novo à partir des glandes sudoripares apocrines et eccrines, et non à la suite d'une transformation maligne des syringomes chondroïdes, puisque seulement 6 % des syringomes chondroïdes malins présentent des signes histologiques de syringome chondroïde.
A ce jour, seuls 27 cas ont été décrits dans la littérature. tumeurs malignes de la peau mixte. Cependant, il existe des cas fréquents de tumeurs mixtes bénignes et malignes des glandes salivaires et lacrymales, semblables aux syringomes chondroïdes. Il existe des descriptions d'une tumeur mixte dans la glande mammaire et les poumons.
Syringome chondroïde malin se développe chez les personnes âgées de 13 à 89 ans (en moyenne 52 ans), et dans 2/3 des cas chez la femme.
Tumeurs malignes de la peau mixte ne présentent pas de signes cliniques caractéristiques. Ils sont représentés par des ganglions dermiques denses, généralement douloureux, souvent ulcérés, d'un diamètre de 1 à 15 cm (en moyenne environ 5 cm), fusionnés aux tissus sous-jacents. Ils sont localisés sur les membres inférieurs (dans 50 % des cas - la zone des surfaces plantaires des pieds) et supérieurs, la tête, le cou, le torse.
Syringome chondroïde macroscopiquement malin a généralement l'apparence d'un nœud lobulaire, sur une coupe il est uniforme, de couleur jaune-blanc, avec parfois des cavités kystiques, des zones hémorragiques ou mucoïdes.
Histologiquement, on distingue plus fréquemment les apocrines (80 %) et les eccrines. sous-types de syringome chondroïde malin. L'origine apocrine du syringome chondroïde est confirmée par la détection de la protéine 15 du fluide kystique global dans ses tissus, un marqueur spécifique des tumeurs des glandes sudoripares apocrines. De plus, le syringome chondroïde malin, exprimant des kératines de haut et de bas poids moléculaire, est une tumeur non seulement d'origine tubulaire, mais également d'origine sécrétoire. À cet égard, un certain nombre d’auteurs ont suggéré que les termes « tumeur mixte » et « tumeur mixte maligne » soient considérés comme plus préférables. Le terme « syringome » (du grec syrinx – tube) est plus approprié à réserver pour désigner les tumeurs de la partie tubulaire des glandes sudoripares eccrines. Cependant, le terme « tumeur maligne mixte » n'est pas non plus tout à fait approprié, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'un grand nombre d'autres tumeurs cutanées contiennent des composants mixtes épidermiques et mésenchymateux, par exemple le carcinome basocellulaire.
Structure histologique du syringome chondroïde malin. Le néoplasme est représenté par des complexes de cellules épithéliales à cytoplasme éosinophile ou léger, rassemblées en cordons solides et formant des structures glandulaires syringoïdes et des kystes kératiniques. Le stroma contient des zones collagènes, cellulaires et/ou hyalinisées, ainsi que des foyers myxoïdes riches en mucopolysaccharides et des îlots de tissu cartilagineux. Les atypies cellulaires ne sont détectées que dans un petit nombre de cas et s'expriment par un polymorphisme nucléaire et quelques mitoses. Une composante infiltrante est également détectée.
Signes de malignité consistent tout d’abord dans la perte de communication entre les cellules tumorales et la présence d’un stroma myxoïde contenant des cellules tumorales uniques ou leurs petits agrégats. Les cellules tumorales épithéliales sont souvent binucléées, avec un léger halo, ressemblent à des chondrocytes et donnent au stroma un aspect chondroïde. Des infiltrats lymphoïdes et des follicules lymphoïdes peuvent être détectés dans le stroma tumoral.
Méthodes histochimiques et immunohistochimiques pour diagnostic des syringomes chondroïdes malins ne sont pas suffisamment informatifs et ne sont pas utilisés pour distinguer le syringome chondroïde malin du syringome bénin. Les cellules épithéliales du syringome chondroïde malin expriment des kératines de poids moléculaire élevé et faible. La coloration de l'antigène carcinoembryonnaire est généralement positive, notamment au niveau des éléments canalaires, confirmant l'origine glandulaire de la tumeur. L'expression de l'antigène o-embryonnaire du cancer est observée non seulement dans des cellules qui semblent malignes, mais également dans des cellules complètement bénignes. L'expression de la protéine S-100 a été décrite. Il a été observé dans les structures pitéliales et canalaires, ainsi que dans les cellules individuelles du stroma myxoïde. Une coloration diffuse de la protéine liquide 15 de la maladie kystique globale (GCDFP) a également été observée dans le cytoplasme de la plupart des cellules. Des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone ont également été découverts. En général, ces signes ressemblent à ceux du cancer du sein canalaire.
Diagnostic du syringome chondroïde malin basée sur un examen histologique. À partir du moment où la tumeur apparaît jusqu'à ce que vous consultiez un médecin et posiez un diagnostic, cela prend 1 mois. jusqu'à 20 ans (en moyenne 4,5 ans).
Diagnostic différentiel du syringome chondroïde malin est réalisée tout d'abord avec le syringome chondroïde, dont la variante maligne se distingue par une croissance plus rapide, une plus grande taille, une douleur, une adhérence aux tissus sous-jacents, une ulcération, une fréquence fréquente chez la femme et une localisation dans les extrémités. Lors de l'examen histologique, les difficultés de distinction entre les variantes bénignes et malignes sont créées par la présence de composants épithéliaux et mésenchymateux dans la tumeur. Le syringome chondroïde malin se caractérise par la présence de cellules tumorales atypiques ou de ganglions satellites se développant dans la pseudocapsule proche de la tumeur principale. La composante épithéliale du syringome chondroïde malin est principalement constituée de larges couches et de brins de cellules moins différenciés ; la différenciation glandulaire dans la tumeur est faiblement exprimée. Les cellules épithéliales sont généralement grandes, de forme cuboïde ou polygonale, avec un cytoplasme clair modéré à abondant. Les atypies nucléaires et les figures mitotiques peuvent être focales, parfois minimes ou absentes. Le nombre de figures mitotiques dans le syringome chondroïde malin varie de 0,4 à 30 pour 1 mm2, alors que dans le syringome chondroïde, elles sont pratiquement absentes. S'il y a une activité mitotique dans le syringome chondroïde, il faut penser à la possibilité d'une malignité. Par conséquent, pour une conclusion histologique, il est nécessaire d'étudier l'ensemble de l'échantillon, ceci est particulièrement important pour le syringome chondroïde des extrémités.
Une attention particulière est requise lorsque diagnostic de syringome chondroïde malin Tumeurs mixtes malignes rares de la glande salivaire qui métastasent à la peau.
Du kyste épidermique, du basapiome, du cancer épidermoïde de la peau et d'un certain nombre d'autres tumeurs cutanées syringome chondroïde malin se distingue par la présence d'une véritable différenciation glandulaire et d'un stroma hyalino-mucineux mucopolysaccharide caractéristique. Dans le même temps, il convient de garder à l'esprit que des signes similaires peuvent également être présents dans le chondrosarcome myxoïde extrasquelettique, le chordome métastatique, la tumeur cartilagineuse cutanée, le sarcome synovial, le cancer mucoépidermoïde primitif et métastatique, le cancer eccrin des muqueuses, le cancer mucineux métastatique et le carcinosarcome. comme le carcinome basocellulaire. Toutes ces tumeurs peuvent s’accompagner d’une production de mucine.
Traitement du syringome chondroïde malin chirurgical, nécessite une large excision de la tumeur, avec ablation et examen histologique obligatoire des ganglions lymphatiques régionaux ; cependant, la valeur de la lymphadénectomie prophylactique n’a pas été entièrement déterminée. La chirurgie micrographique de Moh peut être utile à la fois pour éliminer la tumeur primitive et pour préserver les tissus sains environnants, mais il n'y a aucune indication de son utilisation dans la littérature. De nombreux auteurs recommandent une radiothérapie adjuvante pour prévenir les métastases.
Mauvais pronostic du syringome chondroïde malin associée à de multiples rechutes. Le taux de récidive locale après ablation chirurgicale atteint 50 %. Des métastases aux ganglions lymphatiques sont enregistrées chez 45 % des patients ; ils sont généralement régionaux et très rarement éloignés. Dans le même temps, jusqu'à 70 % des patients présentant une atteinte ganglionnaire présentent des métastases à distance, qui se généralisent généralement au moment du décès du patient. Le syringome chondroïde malin métastase souvent aux poumons. Dans l’ensemble, le taux de mortalité par syringome chondroïde malin atteint 20 % ; il est plus élevé lorsque la tumeur est localisée à la tête, au cou, au torse (46 %) et plus faible lorsque la tumeur est localisée aux extrémités (6 %). L’issue du syringome chondroïde malin ne dépend pas de la taille de la tumeur, du sexe ou de l’âge du patient. Dans le même temps, une anaplasie progressive est souvent observée dans les tumeurs récurrentes et métastatiques, mais il n'est pas clair si sa présence affecte l'évolution de la maladie.
Tumeur mixte maligne
Carcinome dans adénome pléomorphe, tumeur mixte métastatique. Il représente jusqu'à 6 % des tumeurs des glandes et jusqu'à 20 % de leurs cancers. Se développe chez les individus âgés de 30 à 60 ans. Localisation - petites glandes parotides, moins souvent sous-maxillaires, du palais. Macroscopiquement visible est un nœud flou, à croissance rapide, blanc-gris et jaunâtre atteignant 25 cm de diamètre. Au microscope, une combinaison d'adénome pléomorphe et de cancer est caractéristique (généralement adénocarcinome peu différencié, adénoïde kystique, mucoépidermoïde, cancer indifférencié). Une tumeur mixte métastatique a la structure d'un adénome, mais il existe des métastases. Un type rare de ce cancer est le carcinosarcome, constitué d'un cancer peu différencié et de composants sarcomateux (chondro- ou ostéosarcome).
Le pronostic est sombre, car après 1,5 à 3 ans, de multiples métastases hémato- et (moins fréquemment) lymphogènes se développent dans les os (dans 50 % des cas) et les poumons (dans 30 %). La mort survient généralement dans les 3 à 4 ans.
Carcinome à cellules acino
Le carcinome à cellules aciniques représente jusqu'à 2 à 3 % des tumeurs des glandes salivaires. Se développe chez les personnes de plus de 50 ans, un peu plus souvent chez les femmes. Localisation - petites glandes parotides, moins souvent sous-maxillaires, dans certains cas - dans l'os de la mâchoire. Dans 5 % des cas, la tumeur présente une croissance multicentrique. Macroscopiquement, on observe un nœud douloureux lobé, densément élastique, brun clair atteignant 4 cm de diamètre, se développant lentement, et donc la formation d'une capsule est possible. Au microscope, les types folliculaires solides, microkystiques, kystiques-papillaires sont caractéristiques, constitués de cellules avec un cytoplasme granulaire PAS-positif, comme dans les cellules acineuses des sections terminales.
Le pronostic est celui de rechutes fréquentes, ainsi que de métastases hémato- et lymphogènes, particulièrement fréquentes dans le type microkystique.
Adénocarcinome basocellulaire
L'adénocarcinome basocellulaire représente jusqu'à 2 % des tumeurs malignes des glandes salivaires. Elle survient chez les personnes de plus de 50 ans au niveau des glandes parotides (dans 90 % des cas) et sous-maxillaires. Il a la structure d'un adénome basocellulaire avec une activité mitotique élevée, une croissance infiltrante, des métastases et une invasion périneurale (dans 30 % des cas). Il est considéré comme un cancer de bas grade (analogue au carcinome basocellulaire cutané) avec un bon pronostic. Des rechutes surviennent chez 25 % des patients, tandis que des métastases aux ganglions lymphatiques cervicaux surviennent chez 12 % des patients. Les métastases hématogènes aux poumons sont extrêmement rares.
Cancer indifférencié des glandes salivaires
Représente 1 % des tumeurs glandulaires chez les personnes de plus de 60 ans. Les glandes parotides, sous-maxillaires et, plus rarement, les petites glandes sont affectées sous la forme d'un nœud flou qui se développe dans la peau et les tissus mous. Au microscope, on distingue les types de cellules lymphoépithéliales, à grandes cellules et à petites cellules. La tumeur est caractérisée par une activité mitotique élevée et une nécrose.
Le pronostic est des rechutes fréquentes, des métastases lympho- et hématogènes, notamment en cas de tumeur d'un diamètre supérieur à 4 cm. Le taux de survie à cinq ans est de 30 à 40 %.
On trouve rarement des cancers papillaires, kystiques et folliculaires des glandes salivaires, ressemblant à un carcinome papillaire et folliculaire de la glande thyroïde.
6774 0
Tumeurs des glandes salivaires
Les tumeurs de la glande salivaire sont rares chez les enfants ; les enfants ne représentent que 1 à 3 % de toutes les tumeurs de la glande salivaire. Presque toutes les formations tumorales de la glande salivaire chez les nouveau-nés et les jeunes nourrissons sont bénignes. La plupart des néoplasmes de la glande salivaire, tant chez les enfants que chez les adultes, sont localisés dans la glande parotide. Cette caractéristique est la plus caractéristique des enfants. Environ la moitié de toutes les lésions solides de la glande parotide chez les enfants sont de nature néoplasique et la moitié d'entre elles sont malignes.Approche clinique. L'examen des enfants présentant des formations ressemblant à des tumeurs de la glande salivaire doit être abordé de manière très méthodique. Tout d'abord, le clinicien doit déterminer si cette formation est néoplasique ou inflammatoire. Une sensibilité, l'apparition récente d'une tumeur et de la fièvre suggèrent une inflammation.
Avec les oreillons (oreillons), la glande parotide est généralement hypertrophiée de manière diffuse, douloureuse et il existe des signes d'intoxication et d'hyperamylasémie. Une paralysie du nerf facial, une croissance rapide, une douleur et une immobilité de la formation peuvent indiquer un processus malin. La salive peut être détectée par canulation du canal ou par biopsie tissulaire par aspiration avec examen cytologique. Dans 2/3 des cas de lésions malignes, la salive est détectée lors de l'examen cytologique.
L'échographie est extrêmement importante dans le diagnostic différentiel ; la tomodensitométrie et l'IRM peuvent également être utiles. L'anatomie du nerf facial et sa relation avec la tumeur sont mieux démontrées par l'IRM.
Tout soupçon, même le plus léger, d'un processus malin est une indication pour une biopsie de la glande salivaire. La biopsie incisionnelle est contre-indiquée sauf en cas de lésions sévères et malignes non résécables. La biopsie par aspiration à l'aiguille fine a été utilisée avec un certain succès chez les adultes, mais son efficacité chez les enfants n'a pas encore été clairement établie. Une biopsie excisionnelle avec une large marge est préférable.
Lorsque la glande parotide est atteinte, la méthode de choix est la lobectomie superficielle de la glande avec préservation du nerf facial. Les données de coupe gelée ne doivent pas être utilisées comme base pour déterminer l’étendue de la résection car cette méthode peut produire des résultats erronés.
Tumeurs bénignes. La tumeur bénigne des glandes salivaires la plus courante chez les enfants est l'angiome et ses variétés, et chez les nourrissons, l'hémangioendothéliome est la tumeur de la glande parotide la plus courante. Bien qu'à la naissance ces tumeurs ne soient généralement pas visibles et non déterminées, le diagnostic correct est généralement établie au cours des 6 premiers mois de la vie.
Les tumeurs sont beaucoup plus fréquentes chez les filles. Cliniquement, ce sont des formations élastiques mobiles de la glande parotide, souvent recouvertes d'une décoloration bleuâtre de la peau. La tumeur peut être tiède au toucher. Ces tumeurs bénignes sont généralement indolores et peuvent grossir progressivement à mesure que l'enfant grandit. Parfois, la tumeur se développe rapidement au cours des premières semaines suivant la naissance. Le diagnostic est généralement évident par simple examen et examen physique.
Bien que l'exérèse chirurgicale de la tumeur soit traditionnellement recommandée, il existe une forte probabilité (90 %) de régression spontanée. Ces néoplasmes sont presque toujours bénins chez les enfants, y compris les nourrissons. Si la tumeur ne disparaît pas spontanément au moment où l’enfant est censé aller à l’école, il s’agit alors d’une indication chirurgicale.
Les néoplasmes rares de la glande parotide qui surviennent à la naissance ou au cours des premiers mois de la vie comprennent les embryons. Cette tumeur encapsulée est souvent située au-dessus de l'angle de la mandibule. Bien que dans la plupart des cas la tumeur soit bénigne, dans 25 % des cas, la malignité est constatée à la fois histologiquement et cliniquement.
Le lymphangiome (hygroma kystique) peut également affecter les glandes parotides et les glandes salivaires mineures chez les enfants. Contrairement à d’autres néoplasmes, cela survient assez souvent. Ces tumeurs sont discutées en détail dans le chapitre suivant (73). Les lymphangiomes juxtaparoïdes (périparotidiens) ou intraparotidiens sont rares. Il s'agit généralement de néoplasmes mixtes avec des composantes lymphoïdes et vasculaires. Ils peuvent subir spontanément une involution, mais si cela ne se produit pas, une ablation chirurgicale est alors indiquée. Lors de la première intervention, il est important d’enlever complètement la tumeur, tout en essayant de conserver intacts le nerf facial et ses branches. Cependant, une nouvelle résection peut parfois être nécessaire. La probabilité de succès du traitement diminue à chaque nouvelle rechute.
L'adénome pléomorphe (tumeur mixte) est la tumeur épithéliale des glandes salivaires la plus fréquente, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Les garçons et les filles sont touchés avec la même fréquence. La tumeur survient principalement entre 10 et 13 ans. C'est une petite formation dense et bien délimitée, palpable dans la glande parotide.
Des rapports font état d'une augmentation de l'incidence de cette tumeur chez les enfants exposés aux rayonnements ionisants, ainsi que chez les enfants dont les parents se trouvaient dans la zone de l'explosion de la bombe atomique. Le traitement de choix est la parotidectomie superficielle avec préservation du nerf facial. Certains cliniciens recommandent une biopsie excisionnelle s'il n'y a aucun signe de malignité. De nombreuses études ont rapporté une incidence significative de récidive locale.
L'adénolymphome (tumeur de Warthin) survient dans 1% des cas parmi toutes les tumeurs des glandes salivaires, alors qu'il occupe en même temps la deuxième place en termes de fréquence parmi les tumeurs épithéliales bénignes des glandes salivaires. Chez les garçons, cette tumeur survient plus souvent, associée à la maladie de Mikulicz (kératoconjonctivite avec xérostomie, anomalies structurelles des glandes lacrymales et tumeur lymphoépithéliale bénigne). Le traitement consiste en l'ablation chirurgicale de la tumeur.
Tumeurs malignes. La plupart des tumeurs malignes des glandes salivaires sont localisées dans la glande parotide. Le pronostic est légèrement meilleur que pour les tumeurs des glandes salivaires mineures. Selon le tableau histologique, on distingue plusieurs grades de tumeurs malignes des glandes salivaires : grade 1 (bien différencié), grade II (degré de différenciation modéré) et grade III (peu différencié).
Le type histologique de la tumeur permet de prédire l'évolution clinique des carcinomes mucoépidermoïdes, mais dans le carcinome à cellules acineuses, la structure histologique n'a aucune valeur pronostique. La plupart de ces tumeurs ont un degré de différenciation faible ou modéré.
Le carcinome mucoépithélial est la tumeur maligne primitive des glandes salivaires la plus courante chez les adultes et les enfants. Cette tumeur peut être confondue avec un processus inflammatoire chronique, car elle est souvent associée à des modifications fibrokystiques et à une inflammation chronique. L'étendue de la lésion primaire détermine directement la probabilité de métastases aux ganglions lymphatiques cervicaux et le risque de récidive après résection. Les jeunes enfants ont une forte tendance aux tumeurs malignes.
Le traitement consiste en une parotidectomie totale ou superficielle, selon la nature de la tumeur. Pour les petites tumeurs peu différenciées et pour certaines tumeurs de grade intermédiaire limitées au lobe superficiel, une parotidectomie superficielle peut être réalisée.
Les ganglions lymphatiques locaux sont biopsiés avec examen par coupe congelée. Si des lésions des ganglions lymphatiques du cou sont détectées, leur élimination radicale est effectuée soit simultanément, soit ultérieurement. Une étude a noté que dans 15 % des cas, il y avait des métastases aux ganglions lymphatiques cervicaux, mais dans aucune de ces observations, les métastases n'étaient cliniquement déterminées.
L’efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie pour les lésions de haut grade est difficile à évaluer en raison de la relative rareté de ces tumeurs. Les rechutes surviennent généralement dans un délai d'un an. En général, 90 % des enfants atteints d’un carcinome mucoépidermoïde de grade I et II vivent longtemps. Le taux de survie pour les tumeurs de grade III est inférieur à 50 %
L'adénocarcinome est le deuxième type de tumeur maligne des glandes salivaires le plus courant chez les enfants. La variante indifférenciée ou solide survient généralement à l'âge préscolaire et est souvent extrêmement agressive. La paralysie faciale, la douleur et l'élargissement rapide de la tumeur sont des signes d'une tumeur anaplasique ou indifférenciée. Le traitement doit être combiné, comprenant l'ablation chirurgicale de la tumeur, la chimiothérapie et la radiothérapie. Les résultats varient.
Le carcinome à cellules aciniques est la troisième tumeur maligne de la glande parotide la plus fréquente chez les enfants, se présentant généralement sous la forme d'une masse indolore entre 10 et 15 ans. Le pronostic est relativement favorable.139
Les tumeurs non épithéliales à cellules rondes ou fusiformes des glandes salivaires entraînent parfois des difficultés de diagnostic. Une étude a rapporté que 5 % des 202 rhabdomyosarcomes ont été découverts dans la parotide et dans d’autres glandes salivaires.
K.U. Ashcraft, T.M. Titulaire