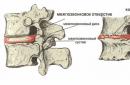1. Méthodes de recherche en laboratoire et instrumentales :
a) radiographie ;
b) Radiographie ;
c) Tomographie ;
d) Bronchographie ;
e) Fluorographie.
2. Examen endoscopique :
a) Bronchoscopie ;
b) Thoracoscopie.
2. Méthodes de diagnostic fonctionnel :
a) Ventilation pulmonaire ;
b) Ponction pleurale.
2. Examen des crachats.
3. Principaux syndromes cliniques des maladies pulmonaires :
a) Syndrome de liquide dans la cavité pleurale ;
b) syndrome d'amarrage pleural ;
c) Syndrome de l'air dans la cavité pleurale ;
d) Syndrome de compactage inflammatoire du tissu pulmonaire ;
e) Syndrome de la cavité pulmonaire ;
f) Syndrome d'atélectasie obstructive ;
g) Syndrome d'atélectasie par compression ;
h) Syndrome d'augmentation de la légèreté des poumons (emphysème pulmonaire) ;
i) Syndrome de bronchospasme ;
j) Syndrome de bronchite aiguë.
Méthodes de recherche en laboratoire et instrumentales.
Examen aux rayons X
Pour examiner les organes respiratoires, la fluoroscopie, la radiographie, la bronchographie et la tomographie des poumons sont utilisées.
radiographie est la méthode de recherche la plus courante qui vous permet de déterminer visuellement les changements dans la transparence du tissu pulmonaire, de détecter des foyers de compactage ou des cavités, d'identifier la présence de liquide ou d'air dans la cavité pleurale, ainsi que d'autres changements pathologiques.
Radiographie utilisé dans le but d'enregistrer et de documenter les changements dans les organes respiratoires détectés lors de la fluoroscopie sur film radiographique. Dans les processus pathologiques des poumons, entraînant une perte de légèreté et un compactage du tissu pulmonaire (pneumonie, infarctus pulmonaire, tuberculose, etc.), les zones pulmonaires correspondantes sur le film négatif ont une image plus pâle que le tissu pulmonaire normal. Une cavité dans le poumon contenant de l'air et entourée d'une crête inflammatoire apparaît sur un film radiographique négatif sous la forme d'une tache sombre de forme ovale entourée d'une ombre plus pâle que l'ombre du tissu pulmonaire. Le liquide présent dans la cavité pleurale, qui transmet moins de rayons X que le tissu pulmonaire, produit une ombre sur le film radiographique négatif qui est plus pâle que celle du tissu pulmonaire. La méthode aux rayons X vous permet de déterminer non seulement la quantité de liquide dans la cavité pleurale, mais également sa nature. S'il y a du liquide inflammatoire ou un exsudat dans la cavité pleurale, le niveau de son contact avec les poumons présente une ligne oblique, progressivement dirigée vers le haut et latéralement à partir de la ligne médio-claviculaire ; lorsque du liquide non inflammatoire ou du transsudat s'accumule dans la cavité pleurale, son niveau est situé plus horizontalement.
Tomographie est une méthode de radiographie spéciale qui permet un examen radiographique couche par couche des poumons. Il est utilisé pour diagnostiquer les tumeurs des bronches et des poumons, ainsi que les petits infiltrats, cavités et cavités situés à différentes profondeurs des poumons.
Bronchographie utilisé pour étudier les bronches. Après une anesthésie préalable des voies respiratoires, un agent de contraste bloquant les rayons X (par exemple Idolipol) est injecté dans la lumière des bronches du patient, puis une radiographie des poumons est réalisée et une image claire du L'arbre bronchique est obtenu sur la radiographie. Cette méthode permet de diagnostiquer une dilatation des bronches (bronchectasie), des abcès et des cavernes pulmonaires, un rétrécissement de la lumière des grosses bronches par une tumeur ou un corps étranger.
Fluorographie est également un type d’examen aux rayons X des poumons. Elle est réalisée à l'aide d'un appareil spécial - un fluorographe, qui permet de prendre une radiographie sur un film photographique de petit format, et est utilisé pour un examen préventif de masse de la population.
Examen endoscopique
Les méthodes de recherche endoscopique comprennent la bronchoscopie et la thoracoscopie.
Bronchoscopie utilisé pour examiner la membrane muqueuse de la trachée et des bronches du premier, du deuxième et du troisième ordre. Elle est réalisée à l'aide d'un appareil spécial - un bronchoscope, auquel sont fixées des pinces spéciales pour la biopsie, l'élimination des corps étrangers, l'élimination des polypes, une fixation photo, etc. Avant d'insérer le bronchoscope, une anesthésie est réalisée sur la membrane muqueuse des voies respiratoires supérieures avec une solution de dicaïne à 1-3%. Le bronchoscope est ensuite inséré par la bouche et la glotte jusque dans la trachée. L'examinateur examine la membrane muqueuse de la trachée et des bronches. À l'aide d'une pince spéciale à long manche, vous pouvez prélever un morceau de tissu d'une zone suspecte (biopsie) pour un examen histologique et cytologique, ainsi que le photographier. La bronchoscopie est utilisée pour diagnostiquer les érosions, les ulcères de la muqueuse bronchique et les tumeurs de la paroi bronchique, éliminer les corps étrangers, éliminer les polypes bronchiques, traiter les bronchectasies et les abcès pulmonaires centraux. Dans ces cas, les crachats purulents sont d'abord aspirés à l'aide d'un bronchoscope, puis des antibiotiques sont injectés dans la lumière ou la cavité bronchique.
Thoracoscopie est réalisée à l'aide d'un appareil spécial - un thoracoscope, composé d'un tube métallique creux et d'un dispositif optique spécial avec une ampoule. Il est utilisé pour examiner les couches viscérales et pariétales de la plèvre, réaliser une biopsie, séparer les adhérences pleurales et effectuer un certain nombre d'autres procédures médicales.
Méthodes de diagnostic fonctionnel
Les méthodes de diagnostic fonctionnel du système respiratoire externe revêtent une grande importance dans un examen complet des patients souffrant de maladies des poumons et des bronches. Ils permettent d'identifier la présence d'une insuffisance respiratoire, souvent bien avant l'apparition des premiers symptômes cliniques, d'établir son type, sa nature et sa gravité, et de retracer la dynamique des modifications des fonctions de l'appareil respiratoire externe au cours du développement. de la maladie et sous l’influence d’un traitement.
Ventilation pulmonaire. Les indicateurs de ventilation pulmonaire n'ont pas de constantes strictes : pour la plupart, ils sont non seulement déterminés par la pathologie des poumons et des bronches, mais dépendent également en grande partie de la constitution et de l'entraînement physique, de la taille, du poids corporel, du sexe et de l'âge de l'individu. personne. Par conséquent, les données obtenues sont évaluées par rapport à ce qu'on appelle valeurs appropriées , prenant en compte toutes ces données et étant la norme pour la personne étudiée. Les valeurs appropriées sont calculées à l'aide de normogrammes et de formules basées sur la détermination du métabolisme basal approprié.
Ponction pleurale
La ponction pleurale est utilisée pour déterminer la nature du liquide pleural afin de clarifier le diagnostic et d'éliminer le liquide de la cavité pleurale et d'y introduire ensuite des médicaments à des fins thérapeutiques. Avant la ponction, le champ de manipulation est traité avec de l'iode et de l'alcool et une anesthésie locale est appliquée au site de ponction. La ponction est généralement réalisée le long de la ligne axillaire postérieure, dans le septième ou huitième espace intercostal le long du bord supérieur de la côte (voir Fig. 1). À des fins de diagnostic, 50 à 150 ml de liquide sont prélevés et envoyés pour examen cytologique et bactériologique. À des fins thérapeutiques, lorsqu'une grande quantité de liquide s'accumule dans la cavité pleurale, 800 à 1 200 ml de liquide sont initialement prélevés. L'élimination d'une plus grande quantité de liquide de la cavité pleurale entraîne un déplacement rapide des organes médiastinaux vers le côté douloureux et peut s'accompagner d'un collapsus. Pour extraire le liquide, utilisez une seringue spéciale d'un volume de 50 ml ou un appareil Poten. Le liquide obtenu à partir de la cavité pleurale peut être d'origine inflammatoire (exsudat) ou non inflammatoire (transsudat). Aux fins du diagnostic différentiel de la nature du liquide, sa densité, la quantité de protéines qu'il contient, les érythrocytes, les leucocytes, les cellules mésothéliales et atypiques sont déterminés. La densité du liquide inflammatoire est de 1,015 ou plus, la teneur en protéines est supérieure à 2-3%, le test Rivald est positif. La densité du transsudat est inférieure à 1,015, la quantité de protéines est inférieure à 2%, le test Rivald est négatif.
Pour Échantillons Rivalda prenez un cylindre d'un volume de 200 ml, remplissez-le d'eau du robinet, ajoutez-y 5 à 6 gouttes d'acide acétique fort, puis déposez-y quelques gouttes de liquide pleural à l'aide d'une pipette. L'apparition d'un nuage trouble au site de dissolution des gouttelettes indique le caractère inflammatoire du liquide pleural contenant une quantité accrue de sérosomucine (réaction positive, ou test de Rivalda). Le liquide non inflammatoire ne produit pas de nuage trouble (test Rivald négatif).
Examen des crachats
Expectorations — sécrétion pathologique du système respiratoire, expulsée lors de la toux et de l'expectoration (la sécrétion bronchique normale est si insignifiante qu'elle est éliminée sans expectoration). Les crachats peuvent contenir du mucus, du liquide séreux, des cellules du sang et des voies respiratoires, des éléments de décomposition des tissus, des cristaux, des micro-organismes, des protozoaires, des helminthes et leurs œufs (rarement). L'examen des crachats permet d'établir la nature du processus pathologique dans les organes respiratoires et, dans certains cas, de déterminer son étiologie.
Il est préférable de prélever les crachats pour examen le matin, frais, si possible avant les repas et après s'être rincé la bouche. Cependant, pour détecter Mycobacterium tuberculosis, les crachats, si le patient en produit peu, doivent être collectés dans un délai de 1 à 2 jours. Dans les crachats rassis, la flore saprophyte se multiplie et détruit les éléments formés.
La quantité quotidienne d'expectorations varie considérablement - de 1 à 1 000 ml ou plus. La libération simultanée d'une grande quantité d'expectorations, notamment lorsque le patient change de position, est caractéristique de la bronchectasie sacculaire et de la formation d'une fistule bronchique avec empyème pleural. L'étude des crachats commence par leur examen (c'est-à-dire examen macroscopique), d'abord dans un bocal transparent, puis dans une boîte de Pétri, placée alternativement sur un fond noir et blanc. La nature des crachats est notée, c'est-à-dire ses principaux composants visibles à l'œil nu. La couleur des crachats et leur consistance dépendent de ces dernières.
Crachats muqueux généralement incolore ou légèrement blanchâtre, visqueux ; séparés, par exemple, dans la bronchite aiguë. Séreux les crachats sont également incolores, liquides et mousseux ; observé avec un œdème pulmonaire. Crachats mucopurulents jaune ou verdâtre, visqueux ; formé lors de bronchite chronique, de tuberculose, etc. Purement purulent , des crachats homogènes, semi-liquides, jaune verdâtre sont caractéristiques d'un abcès lorsqu'ils se rompent. crachats sanglants Elle peut être soit purement sanglante avec hémorragies pulmonaires (tuberculose, cancer, bronchectasie), soit de nature mixte, par exemple mucopurulente avec stries de sang dans les bronchectasies, séreuse-sanglante mousseuse avec œdème pulmonaire, muco-sanglante avec infarctus pulmonaire ou congestion dans le petit cercle, circulation sanguine, purulente-sanglante, semi-liquide, gris brunâtre avec gangrène et abcès pulmonaire. Si le sang n'est pas libéré rapidement, son hémoglobine se transforme en hémosidérine et donne aux crachats une couleur rouille, caractéristique de la pneumonie lobaire.
En position debout, les crachats peuvent se séparer. Les processus suppuratifs chroniques sont caractérisés par des crachats à trois couches : la couche supérieure est mucopurulente, la couche intermédiaire est séreuse, la couche inférieure est — purulent. Les crachats purement purulents sont divisés en 2 couches : séreuse et purulente.
Les crachats n’ont souvent aucune odeur. L'odeur fétide des crachats fraîchement sécrétés dépend soit de la décomposition putréfactive des tissus (gangrène, cancer désagrégé), soit de la décomposition des bords des crachats lorsqu'ils sont retenus dans les cavités (abcès, bronchectasie).
Parmi les éléments individuels visibles à l'œil nu, ils peuvent être trouvés dans les crachats : Spirales Kurshman sous forme de petits fils blanchâtres frisés et denses ; caillots de fibrine - des formations arborescentes blanchâtres et rougeâtres retrouvées dans les bronchites fibrineuses, parfois dans les pneumonies ; lentilles - petits morceaux denses jaune verdâtre constitués de fibres élastiques calcifiées, de cristaux, de cholestérol et de savons et contenant Mycobacterium tuberculosis ; Bouchons Dietrich , semblable aux lentilles en apparence et en composition, mais ne contenant pas de MBT et dégageant une odeur nauséabonde lorsqu'elle est écrasée (trouvée dans la gangrène, l'abcès chronique, la bronchite putréfiante) ; grains de chaux , détecté lors de la désintégration d'anciens foyers de tuberculose; drusen des actinomycètes sous forme de petits grains jaunâtres, rappelant la semoule ; morceaux nécrotiques de tissu pulmonaire et de tumeurs ; les restes de nourriture.
La réaction de l'environnement dans les crachats est généralement alcaline; elle devient acide lors de la décomposition et du mélange de suc gastrique, ce qui aide à différencier l'hémoptysie de l'hématémèse.
Examen microscopique des crachats produit dans des préparations indigènes et colorées. Pour le premier, des grumeaux purulents, sanglants et friables et des fils blancs torsadés sont sélectionnés parmi le matériau versé dans une boîte de Pétri et transférés sur une lame de verre en quantité telle que lorsqu'ils sont recouverts d'un verre de protection, une fine préparation translucide se forme. Cette dernière est observée d'abord à faible grossissement pour l'orientation initiale et la recherche des spirales de Kurshman, puis à fort grossissement pour différencier les éléments façonnés. Spirales Kurshman sont des brins de mucus, constitués d'un fil axial central dense et d'un « manteau » en forme de spirale qui l'enveloppe, dans lequel sont intercalés des leucocytes (souvent éosiophiles) Cristaux de Charcot-Leiden. Les spirales de Kurshman apparaissent dans les crachats lors d'un bronchospasme, le plus souvent en cas d'asthme bronchique, moins souvent en cas de pneumonie, de cancer du poumon.
A fort grossissement, il est possible de détecter dans la préparation native les leucocytes, dont une petite quantité est présente dans toutes les crachats et une grande quantité dans les processus inflammatoires et, en particulier, suppuratifs; leucocytes éosinophiles se distinguent dans la préparation native par leur granularité uniforme, large et brillante, mais elles sont plus faciles à reconnaître lorsqu'elles sont colorées. Des globules rouges apparaissent avec destruction du tissu pulmonaire, avec pneumonie, stagnation de la circulation pulmonaire, infarctus pulmonaire, etc. Épithélium plat pénètre dans les crachats principalement par la cavité buccale et n'a aucune valeur diagnostique. Épithélium cilié colonnaire est présent en petites quantités dans chaque crachat, en grande quantité - en cas de lésions des voies respiratoires (bronchite, asthme bronchique). Macrophages alvéolaires - grosses cellules (2 à 3 fois plus de leucocytes) d'origine réticuloendothéliale. Leur cytoplasme contient d'abondantes inclusions. Ces derniers peuvent être incolores (grains de myéline), noirs à cause des particules de charbon (cellules à poussière) ou jaune-brun de l'hémosidérine (« cellules de malformations cardiaques », sidérophages). Les macrophages alvéolaires sont présents en faible quantité dans chaque crachat ; ils sont plus nombreux dans les maladies inflammatoires ; les cellules des malformations cardiaques apparaissent lorsque les globules rouges pénètrent dans la cavité des alvéoles ; avec stagnation de la circulation pulmonaire, notamment avec sténose mitrale; pour l'infarctus pulmonaire, l'hémorragie et la pneumonie. Pour une détermination plus fiable, la réaction dite au bleu de Prusse est effectuée : un peu d'expectoration est placée sur une lame de verre, 1 à 2 gouttes d'une solution à 5 % de sel de sang jaune sont ajoutées, après 2-3 minutes la même quantité Une solution d'acide chlorhydrique à 2 % est mélangée et recouverte d'une lamelle. Après quelques minutes, les grains d'hémosidérine deviennent bleus.
Cellules tumorales malignes souvent pénétrer dans les crachats, surtout si la tumeur se développe de manière endobronchique ou se désintègre. Dans la préparation native, ces cellules se distinguent par leurs atypies : grandes tailles, différentes... souvent avec une forme laide, un gros noyau et parfois une multinucléation. Cependant, lors des processus inflammatoires chroniques des bronches, l'épithélium qui les tapisse se métaplase et acquiert des caractéristiques atypiques peu différentes de celles des tumeurs. Par conséquent, il n'est possible d'identifier des cellules comme cellules tumorales que si l'on trouve des complexes de cellules atypiques et, de plus, polymorphes, surtout si elles sont situées sur une base fibreuse ou avec des fibres élastiques. L'établissement de la nature tumorale des cellules doit être abordé avec beaucoup de prudence et sa confirmation doit être recherchée dans les préparations colorées.
Fibres élastiques apparaissent dans les crachats lors de la dégradation du tissu pulmonaire : avec tuberculose, cancer, abcès. Avec la gangrène, ils sont souvent absents, car ils sont dissous par les enzymes de la flore anaérobie. Les fibres élastiques ont l'apparence de fines fibres incurvées à double circuit d'épaisseur égale partout, se ramifiant de manière dichotomique, maintenant un arrangement alvéolaire. Comme on ne les trouve pas dans chaque goutte d'expectoration, pour faciliter la recherche, ils ont recours à la méthode de concentration. À cette fin, une quantité égale ou double d’hydroxyde de sodium à 10 % est ajoutée à quelques millilitres d’expectorations et chauffée jusqu’à dissolution du mucus. Dans le même temps, tous les éléments formés des crachats se dissolvent, à l'exception des fibres élastiques. Après refroidissement, le liquide est centrifugé en ajoutant 3 à 5 gouttes d'une solution alcoolique à 1% d'éosine et le sédiment est examiné au microscope. Les fibres élastiques conservent le caractère décrit ci-dessus et se distinguent clairement par leur couleur rouge vif.
Actinomycètes sont détectés en sélectionnant de petits grains jaunâtres denses dans les crachats. Dans une druse écrasée sous un verre couvre-objet dans une goutte de glycérine ou d'alcali, la partie centrale constituée d'un plexus de mycélium et la zone environnante de formations radiantes en forme de flacon sont visibles au microscope. Lorsque les drusen écrasés sont colorés avec une coloration de Gram, le mycélium devient violet et les cônes deviennent roses.
Parmi les autres champignons présents dans les crachats, le plus important est Candida albicans, qui affecte les poumons lors d'un traitement antibiotique de longue durée et chez les patients très affaiblis. Dans la préparation native, on trouve des cellules ressemblant à des levures bourgeonnantes et du mycélium ramifié, sur lesquels les spores sont situées en verticilles.
Des cristaux dans les crachats sont trouvés Cristaux de Charcot-Leiden — octaèdres incolores de différentes tailles, ressemblant à une aiguille de boussole. Ils sont constitués d'une protéine libérée lors de la dégradation des éosinophiles. On les retrouve donc dans les crachats contenant de nombreux éosinophiles ; en règle générale, ils sont plus nombreux dans les crachats rassis. Après une hémorragie pulmonaire, si le sang n'est pas immédiatement libéré avec les crachats, il peut être détecté cristaux d'hématoïdine — formations rhombiques ou en forme d'aiguilles de couleur jaune-brun.
PRINCIPAUX SYNDROMES CLINIQUES DES MALADIES PULMONAIRES (SYNDROMES PULMONAIRES)
La présence de tout processus pathologique dans les poumons est établie grâce à l'utilisation de diverses méthodes d'examen direct du patient, notamment par interrogatoire, examen, palpation, percussion et auscultation. L'ensemble des écarts obtenus par diverses méthodes de recherche pour tout état pathologique est généralement appelé syndrome.
Dans chacune des sections sur les méthodes physiques d'étude des organes respiratoires (palpation, percussion, etc.). Des informations sur les syndromes pulmonaires ont été fournies dans la mesure nécessaire pour assimiler le matériel d'une section particulière. Ces informations sont résumées ci-dessous.
Syndrome du liquide pleural
Une plainte caractéristique de ce syndrome est l’essoufflement. C'est l'expression d'une insuffisance respiratoire due à une compression du poumon, qui entraîne une diminution de la surface respiratoire de l'ensemble des poumons. A l'examen, l'attention est attirée sur la saillie et le retard de la respiration du côté correspondant. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont affaiblis ou absents. La percussion révèle un son sourd ou sourd. A l'auscultation, la respiration est affaiblie ou absente.
Syndrome d'amarrage pleural
L'inflammation des couches pleurales peut laisser un substrat adhésif intrapleural prononcé sous la forme de brins adhésifs, d'adhérences, de superpositions pleurales fibrineuses, appelées amarrage.
Ces patients peuvent ne pas se plaindre, mais en cas d'adhérences sévères, les patients notent un essoufflement et des douleurs thoraciques pendant l'activité physique. Lors de l'examen de la poitrine, il y a une rétraction et un retard dans l'acte de respiration de la moitié « malade », ici vous pouvez également détecter une rétraction des espaces intercostaux lors de l'inspiration. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont affaiblis ou absents. Le son des percussions est sourd ou sourd. A l'auscultation, la respiration est affaiblie ou absente. Un frottement pleural est souvent entendu.
Air dans le syndrome de la plèvre
Pour diverses raisons, de l'air peut apparaître dans la cavité pleurale : par exemple, lorsqu'une cavité ou un abcès situé sous la plèvre y pénètre. Dans ce cas, la connexion créée entre la bronche et la cavité pleurale entraîne une accumulation d'air dans cette dernière, comprimant le poumon. Dans cette situation, une pression accrue dans la cavité pleurale peut entraîner la fermeture du trou dans la plèvre avec des morceaux de tissu endommagé, arrêtant ainsi le flux d'air dans la cavité pleurale et la formation d'un pneumothorax fermé. Si la connexion entre la bronche et la cavité pleurale n’est pas éliminée, le pneumothorax est appelé pneumothorax ouvert.
Dans les deux cas, les principales plaintes sont une suffocation et des douleurs thoraciques qui se développent rapidement. Lors de l'examen, la saillie de la moitié affectée de la poitrine et l'affaiblissement de sa participation à l'acte respiratoire sont déterminés. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont affaiblis ou absents avec un pneumothorax fermé, tandis qu'avec un pneumothorax ouvert, ils sont renforcés. A la percussion, une tympanite est déterminée dans les deux cas. A l'auscultation, avec un pneumothorax fermé, la respiration est fortement affaiblie ou absente ; avec un pneumothorax ouvert, la respiration est bronchique. Dans ce dernier cas, une sorte de respiration bronchique peut être entendue : la respiration métallique.
Syndrome de compactage pulmonaire inflammatoire
Le compactage du tissu pulmonaire peut survenir non seulement à la suite d'un processus inflammatoire, lorsque les alvéoles sont remplies d'exsudat et de fibrine (pneumonie). Le compactage peut survenir à la suite d'un infarctus pulmonaire, lorsque les alvéoles sont remplies de sang, ou lors d'un œdème pulmonaire, lorsque du liquide œdémateux (transsudat) s'accumule dans les alvéoles. Cependant, le compactage du tissu pulmonaire de nature inflammatoire est le plus courant.
Le compactage inflammatoire peut couvrir un lobe entier du poumon (pneumonie lobaire) ou un lobe (pneumonie focale).
Les patients se plaignent de toux, d'essoufflement et, si la plèvre est impliquée dans le processus inflammatoire, de douleurs thoraciques. Lors de l'examen, vous pouvez détecter un retard dans l'acte respiratoire de la moitié affectée de la poitrine, ce qui se produit plus souvent en cas de pneumonie lobaire. Les tremblements de la voix et la bronchophonie dans la zone de compactage sont augmentés. Le son de percussion dans la pneumonie focale est sourd (pas sourd), car la zone de tissu pulmonaire compacté est entourée de tissu pulmonaire normal. Avec la pneumonie lobaire au stade initial, le son est sourd-tympanique, au stade complet, il est sourd ; au stade de la récupération, le son sourd est progressivement remplacé par un son pulmonaire clair. L'auscultation de la pneumonie focale révèle une respiration mixte (broncho-vésiculaire), puisqu'il existe du tissu pulmonaire normal autour du foyer de compactage ; une respiration sifflante sèche et humide peut également être entendue, car dans la pneumonie focale, le processus inflammatoire est également présent dans les bronches ; Dans le même temps, les râles humides sont caractérisés comme sonores, car le compactage inflammatoire du tissu pulmonaire autour des bronches contribue à une meilleure transmission des râles humides qui en proviennent à la surface de la poitrine. Du côté atteint avec une pneumonie lobaire au stade initial, l'auscultation révèle un affaiblissement de la respiration vésiculaire, un indux de crépitation et un bruit de frottement pleural se font entendre ici ; au plus haut de la scène - respiration bronchique, il peut y avoir un bruit de frottement pleural ; au stade de la récupération, la respiration bronchique est progressivement remplacée par une respiration vésiculaire, des crépitations (crepitatio redux), des râles sonores humides se font entendre en raison de la pénétration de l'exsudat liquéfié des alvéoles dans les bronches et des bruits de frottement pleural sont possibles.
Il convient de noter qu'en cas de pneumonie focale, lorsque le foyer de l'inflammation est profond, aucune anomalie ne peut être détectée lors de l'examen physique. Dans le même temps, un foyer d'inflammation important, situé à proximité immédiate de la plèvre viscérale, donne lors de l'examen physique les mêmes anomalies qu'une pneumonie lobaire.
Syndrome de la cavité pulmonaire
Une cavité formée dans le poumon peut être détectée sous certaines conditions : elle doit avoir au moins 4 cm de diamètre, communiquer avec la bronche, être située à proximité de la paroi thoracique et une partie importante de son volume contient de l'air. La cavité est formée par un abcès, une cavité tuberculeuse et la carie d'une tumeur du poumon.
Une plainte courante des patients est une toux accompagnée d'une grande quantité d'expectorations jaune-vert nauséabondes. Lors de l'examen de la poitrine, un retard dans l'acte respiratoire de la moitié affectée est détecté. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont augmentés. La percussion révèle une tympanite. A l'auscultation, la respiration bronchique ou sa variété - râles humides amphoriques, sonores moyennement et grossièrement pétillants.
Syndrome d'atélectasie obstructive
La cause la plus fréquente d’obstruction bronchique, entraînant l’effondrement d’une partie du poumon, est le cancer bronchogénique. Une plainte typique est l’essoufflement ou la suffocation. Lorsqu'on l'examine au-dessus de la zone d'atélectasie, on note une zone de dépression thoracique dont les mouvements respiratoires sont limités. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont affaiblis ou indétectables. Le son des percussions est sourd ou sourd (selon la taille de l'atélectasie). A l'auscultation, la respiration vésiculaire est affaiblie ou inaudible.
Avec une obstruction partielle de la bronche, qui précède son obstruction complète, des symptômes d'atélectasie obstructive incomplète sont détectés. Les patients pendant cette période se plaignent d'un essoufflement croissant. Il y a une rétraction au niveau de l'atélectasie, un décalage de cette région dans l'acte de respirer. Les tremblements de la voix et la bronchophonie au cours de l'atélectasie sont augmentés en raison d'une diminution de la légèreté du tissu pulmonaire. Lors de la percussion, un son tympanique sourd se révèle ici en raison d'une diminution des harmoniques alvéolaires, qui est associée à une diminution de l'amplitude des vibrations des parois des alvéoles partiellement effondrées. L'affaiblissement de la respiration vésiculaire dû à une diminution du flux d'air dans les alvéoles est déterminé par l'ascultation ; Parfois, ils signalent la présence d'une teinte bronchique dans la respiration, conséquence d'une diminution de la légèreté du poumon dans la zone d'atélectasie incomplète.
Il convient de noter que l'établissement d'un syndrome d'atélectasie obstructive constitue la base du diagnostic du cancer du poumon.
Syndrome d'atélectasie par compression
Un poumon comprimé ou une partie de celui-ci est appelé atélectasie de compression. Dans la grande majorité des cas, elle est causée par du liquide présent dans la cavité pleurale. Avec la pleurésie, l'atélectasie est localisée principalement à la racine du poumon, avec l'hydrothorax - au-dessus du niveau de liquide.
La plainte caractéristique que présentent les patients et les données de l'examen sont discutées dans la section « Syndrome de liquide dans la cavité pleurale ». Dans la zone d'atélectasie de compression, la fixation mécanique des parois des alvéoles se produit avec une diminution de leur mobilité et la légèreté du tissu pulmonaire est réduite. Tout cela donne des symptômes caractéristiques lors de la palpation, de la percussion et de l'auscultation. Les tremblements de la voix et la bronchophonie au niveau de la zone d'atélectasie sont augmentés. La percussion produit ici un son tympanique sourd. L'auscultation révèle une respiration bronchique et des crépitements. Ce dernier est associé à une circulation sanguine altérée dans les parois des alvéoles comprimées, c'est pourquoi une quantité modérée de transsudat pénètre dans leur cavité à travers les parois des vaisseaux sanguins.
Syndrome des poumons aériens (emphysème)
La plupart des maladies pulmonaires chroniques entraînent, à un degré ou à un autre, des difficultés respiratoires lors de la phase expiratoire. Pour cette raison, la pression intra-alvéolaire augmente, les alvéoles se dilatent, la teneur en air dans les poumons augmente, mais l'excursion respiratoire des poumons diminue, des processus dégénératifs se produisent dans les parois des alvéoles trop étendues, les échanges gazeux intra-alvéolaires se détériorent, ce qui entraîne à une insuffisance respiratoire et à une diminution du potentiel de vie en général. Avec l'emphysème, la poitrine et les poumons sont dans un état de tension inspiratoire constante. L'emphysème dans les maladies pulmonaires chroniques est une maladie chronique, c'est-à-dire il peut périodiquement augmenter et diminuer, mais ne disparaît pas complètement.
La principale plainte des patients est l’essoufflement, qui s’intensifie à mesure que l’emphysème progresse. Lors de l'examen, la forme de la poitrine est déterminée comme étant emphysémateuse ou en forme de tonneau. Les tremblements de la voix et la bronchophonie dans toutes les parties des poumons sont affaiblis. Le son de percussion sur les deux moitiés de la poitrine est boxy. Avec la percussion topographique, les bords inférieurs des poumons sont abaissés et inactifs lors de la respiration. L'auscultation de la respiration est affaiblie. Si l'emphysème s'accompagne d'une bronchite chronique, alors ses signes se font également entendre : respiration difficile, respiration sifflante silencieuse sèche et humide.
Syndrome de bronchospasme
Le syndrome de bronchospasme est un ensemble de signes cliniques de bronchospasme qui se manifestent sous la forme de crises chez les patients souffrant d'asthme bronchique. Une tendance aux spasmes paroxystiques des bronches peut exister chez les patients présentant des bronches morphologiquement intactes et chez les patients présentant une bronchite chronique.
Au moment du spasme bronchique, le patient subit une crise d'étouffement, au cours de laquelle l'expiration est particulièrement difficile ; au plus fort de la crise, une toux apparaît avec des crachats visqueux très difficiles à séparer. Lors de l'examen, la position du patient est forcée - sédentaire, la respiration est bruyante, une respiration sifflante peut être entendue à distance, l'expiration est fortement prolongée, les veines du cou sont enflées. Les muscles accessoires participent activement à l’acte respiratoire et une cyanose diffuse est visible. La poitrine est en état de tension inspiratoire, c'est-à-dire a un aspect en forme de tonneau.
Cela est dû à de graves difficultés d'expiration et au développement d'un emphysème pulmonaire aigu. Si un patient souffre d'emphysème pendant la période sans crise, la légèreté des poumons augmente encore plus au moment de la crise. Les tremblements de la voix et la bronchophonie sont affaiblis (emphysème). Avec une percussion comparative sur les poumons, un son de boîte est produit, avec une percussion topographique, un déplacement vers le bas des bords inférieurs des poumons est révélé. L'auscultation révèle une expiration fortement prolongée, un affaiblissement de la respiration vésiculaire due à la présence d'emphysème et une diminution de la lumière des bronches, et une grande quantité de respiration sifflante sèche se fait entendre.
Syndrome de bronchite aiguë
En cas d'inflammation des bronches - bronchite - les patients se plaignent d'une toux, sèche au début de la maladie, puis avec des crachats. L’examen n’a révélé aucun écart spécifique par rapport à la norme. Les tremblements vocaux et la bronchophonie n'ont pas été modifiés. La percussion produit un son pulmonaire clair. À l'auscultation, la respiration est difficile; au début de la maladie, on entend des sifflements secs et des bourdonnements sifflants, plus tard - une respiration sifflante humide et silencieuse de différentes tailles.
Les méthodes instrumentales d'étude des organes respiratoires comprennent : la fluoroscopie (examen de la poitrine devant un écran), la radiographie (production d'une radiographie), la bronchographie, la trachéobronchoscopie, la thoracoscopie, la spirométrie, la spirographie, la pneumotachométrie, la pneumotachographie, l'oxygémométrie, l'oxygémographie et certaines d'autres méthodes de recherche.
L'examen aux rayons X est si important que, dans de nombreux cas, il est impossible de s'en passer pour reconnaître correctement les maladies respiratoires.
Compte tenu de l'importance globale de l'examen aux rayons X pour le diagnostic de diverses maladies, la radiologie en général est enseignée dans des départements ou des cours spéciaux. Nous nous limiterons donc ici à une brève présentation des principes de base de cette méthode très importante.
Les rayons X, comme les rayons visibles du soleil, ont la propriété de décomposer le bromure d'argent sur une plaque ou un film sensible à la lumière, de sorte que l'image radiologique peut être capturée par photographie. La méthode de photographie utilisant les rayons X est appelée radiographie, et les images obtenues sont appelées radiographies.
En règle générale, une radiographie pulmonaire est réalisée en clinique ou en milieu hospitalier. Si nécessaire, une radiographie pulmonaire est réalisée pour clarifier le diagnostic et à des fins de documentation.
Chez une personne saine, lors d'une radiographie pulmonaire, les poumons apparaissent sur l'écran comme deux champs lumineux avec un quadrillage constitué de l'ombre des vaisseaux, des grosses et moyennes bronches, plus prononcée au niveau des racines des poumons. Les champs lumineux des poumons et le réseau de vaisseaux et de bronches représentent un motif de racine pulmonaire aux rayons X. Lorsque vous inspirez, les poumons deviennent plus transparents. Ceci est particulièrement clair dans les sinus. En respirant profondément, le mouvement du diaphragme est clairement visible. Ceci permet de juger de l'excursion du bord inférieur des poumons et d'identifier d'éventuelles fusions pleurales, la présence d'un épanchement pleural, etc.
La fluoroscopie et la radiographie thoracique permettent de reconnaître l'apparition de zones denses et sans air dans les poumons (par exemple, en cas de tuberculose pulmonaire, de cancer du poumon, de pneumonie), de déterminer une légèreté accrue des poumons en cas d'emphysème, la présence d'air. contenant des cavités dans les poumons (abcès, caverne), croissance de cordons de tissu conjonctif léger (avec pneumosclérose), compactage et épaississement des parois des vaisseaux pulmonaires (avec leur sclérose), accumulation de liquide ou de gaz dans la cavité pleurale, présence de un corps étranger dans le poumon (balle, fragments de projectile, etc.).
La méthode aux rayons X d'examen des organes thoraciques avec des modifications pathologiques des poumons, des bronches ou de la plèvre permet de faire des observations au cours de la maladie et de comparer les données de recherche pour juger de certains changements dans les organes respiratoires qui se produisent sur un certain temps, et permet également de contrôler l'efficacité du traitement.
Lorsque des produits de contraste bloquant les rayons X, comme l'iodolipol, sont injectés dans les bronches, une image de l'arbre bronchique est obtenue sur la radiographie. Cette méthode d'étude des bronches, appelée bronchographie, permet de diagnostiquer les bronchectasies, la courbure des bronches, le rétrécissement de leur lumière, etc.
La méthode de fluorographie s'est généralisée. Il s'agit de réaliser une série de petites photographies d'images radiographiques sur un écran. Cette méthode permet d'étudier un grand nombre de personnes en peu de temps et est indispensable lors de l'examen de groupes d'écoles, d'usines, d'usines et de fermes collectives. La fluorographie est réalisée à l'aide d'un fluorographe - un accessoire spécial pour un appareil à rayons X. Après développement, les fluorogrammes sont examinés à l'aide d'un agrandisseur photographique spécial.
La méthode de tomographie permet d'obtenir des radiographies couche par couche (à différentes profondeurs). Avec cette méthode d'examen aux rayons X, les images les plus claires sont obtenues uniquement dans un certain plan à une profondeur prédéterminée. Les structures pulmonaires situées dans d'autres plans ne fournissent pas une image nette en raison d'un tube à rayons X spécialement mobile. Cette méthode fournit des données précieuses pour le diagnostic différentiel des tumeurs, infiltrats, abcès, cavités situées à différentes profondeurs. La tomofluorographie permet d'obtenir des fluorogrammes couche par couche.
Trachéobronchoscopie. C'est le nom de la méthode d'examen direct de la trachée (trachéoscopie) et des bronches (bronchoscopie), qui consiste à insérer un tube spécial équipé d'un dispositif d'éclairage (bronchoscope) dans la trachée ou les bronches. Le tube est inséré soit par la bouche dans le larynx (trachéobronchoscopie supérieure), soit, si nécessaire, par l'ouverture de trachéotomie (trachéobronchoscopie inférieure). Cette méthode permet, en examinant la muqueuse de la trachée, des bronches principales et de leurs branches les plus proches, d'y détecter divers processus pathologiques (inflammation, polypes, tumeurs, etc.). Les contre-indications à l'utilisation de la trachéobronchoscopie sont un dysfonctionnement cardiaque sévère, un degré élevé d'hypertension artérielle, une tuberculose laryngée, une pneumonie, une pleurésie aiguë. A l'aide d'un bronchoscope, une biopsie de la muqueuse de la trachée ou des bronches est réalisée (prélèvement d'un morceau de tissu pour examen histologique), lavage des bronches et injection de médicaments directement dans les poumons.
Thoracoscopie. À l'aide d'un appareil spécial - un thoracoscope - la cavité pleurale est examinée et les adhérences entre les viscérales sont séparées. Spiromètre. couches pariétales de la plèvre formées après une pleurésie ou un pneumothorax. Un thoracoscope est un tube doté d'un dispositif optique permettant l'observation visuelle de la cavité pleurale. Le thoracoscope est inséré à travers un trocart spécial après avoir percé la poitrine et appliqué un pneumothorax artificiel.
Spirométrie. La spirométrie est une méthode de mesure de la capacité vitale des poumons.
Pour mesurer la capacité vitale des poumons, on utilise un appareil appelé spiromètre, il se compose de deux cylindres métalliques, le plus petit, avec un fond ouvert, étant inséré dans le plus grand, qui est ouvert en haut. Un grand cylindre est rempli d'eau. Grâce à un large tube en caoutchouc placé sur une valve située dans la paroi supérieure du plus petit cylindre, la personne étudiée, après une inspiration maximale, expire l'air au maximum. L’air entrant dans le petit cylindre le fait s’élever au-dessus de l’eau. La hauteur de son élévation est marquée sur une échelle, indiquant le volume d'air entrant dans le plus petit cylindre.
Comme vous le savez, lors d'une respiration calme, au cours d'un mouvement respiratoire, un adulte en bonne santé inspire et expire en moyenne 500 ohm3 d'air. Cette quantité d’air est appelée volume courant. Si, après une inspiration normale, vous respirez le plus profondément possible, vous pouvez introduire environ 1 500 cm3 d'air dans les poumons. Cette quantité est appelée volume supplémentaire. Si, après une expiration normale, vous expirez le plus profondément possible, vous pouvez expirer environ 1 500 cm3 d'air. Cette quantité est appelée volume de réserve (de rechange). La somme des volumes respiratoires, supplémentaires et résiduels constitue ce qu'on appelle la capacité vitale des poumons.
Normalement, la capacité vitale des poumons chez l'homme est égale à cm3, chez la femme elle est de 00 cm3. Ces valeurs peuvent fluctuer quelque peu en fonction du physique, de l'âge, de la taille, du poids, de l'entraînement, etc. Compte tenu de cela, la valeur diagnostique n'est pas tant la valeur absolue de la capacité vitale des poumons, mais plutôt sa fluctuation dans le même patient à mesure que son état s'aggrave ou s'améliore. La valeur de la capacité vitale des poumons diminue dans un certain nombre de maladies entraînant une diminution de l'excursion respiratoire des poumons et de leur surface respiratoire, par exemple dans l'emphysème, la pneumonie, la tuberculose, les néoplasmes, le poumon congestif, la pleurésie, le pneumothorax, etc. La mesure systématique de la valeur de la capacité vitale des poumons permet de se faire une idée de la progression ou de l'atténuation du processus pathologique.
Spirographie. La mesure et l'enregistrement graphique des volumes courants sont effectués par spirographie. Pour la spirographie, des appareils appelés spirographes sont utilisés. Un spirographe est un spiromètre relié à un kymographe. Le spirogramme est enregistré sur une bande mobile. Connaissant l'échelle du spirographe et la vitesse de déplacement du papier, vous pouvez déterminer les principaux indicateurs de la respiration externe. En plus de déterminer les volumes pulmonaires et la capacité vitale des poumons à l'aide de la spirographie, vous pouvez également déterminer des indicateurs de ventilation pulmonaire : volume respiratoire minute (la somme des volumes courants en 1 min), ventilation maximale des poumons (la quantité maximale d'air qui peut être ventilé en 1 min), le volume d'expiration forcée, ainsi que les indicateurs d'échange gazeux pulmonaire : absorption d'oxygène par minute, libération de dioxyde de carbone et quelques autres indicateurs.
Pneumotachométrie et pneumotachographie. Les méthodes d'étude de la mécanique de la respiration acquièrent une importance significative dans l'étude de la respiration : le taux volumétrique d'inspiration et d'expiration (silencieuse ou forcée), la durée des différentes phases du cycle respiratoire, le volume minute de ventilation, la pression intra-alvéolaire, etc. Ces indicateurs sont enregistrés à l'aide d'instruments - un pneumotachomètre et un pneumotachographe. Le principe de fonctionnement de ces appareils est d'enregistrer les changements de pression du flux d'air qui se produisent pendant la respiration à l'aide d'un manomètre à membrane doté d'un cadran ou d'un indicateur optique. En enregistrement optique, la courbe est enregistrée sur du papier photographique en mouvement.
Oxygémométrie et oxygémographie. Ces méthodes sont utilisées pour étudier la saturation (oxygénation) du sang en oxygène. Le principe de l'oxyhémométrie et de l'oxygémographie repose sur les caractéristiques des spectres d'absorption de l'oxyhémoglobine et de l'hémoglobine réduite. Contrairement à la méthode sanglante d'étude de la saturation en oxygène du sang, lorsque le sang est collecté par ponction de l'artère et que l'étude est réalisée à l'aide d'un appareil van Slyke, l'oxygémométrie et l'oxygémographie sont réalisées sans effusion de sang. À cette fin, des oxymètres ou des appareils oxymétriques sont utilisés. Grâce à ces appareils, il est possible d'étudier les modifications de la saturation en oxygène du sang artériel sur une longue période lors de charges fonctionnelles, d'oxygénothérapie, d'anesthésie, d'opérations, etc. Ces appareils sont constitués d'un capteur auriculaire avec photocellules semi-conductrices, qui constitue la partie photométrique. de l'appareil et une unité de mesure avec une échelle graduée en pourcentage de saturation en oxygène. Les changements de couleur du sang à différents degrés de saturation en oxygène sont capturés par des convertisseurs photoélectriques. À l'aide de photocellules semi-conductrices, les changements de couleur du sang sont convertis en changements de photocourant, qui sont enregistrés par l'appareil. Le capteur auriculaire est placé sur la partie supérieure de l’oreillette de la personne examinée. Un oxymètre est utilisé pour enregistrer graphiquement la saturation en oxygène dans le sang. La courbe de saturation est appelée oxyhémogramme.
Le bref aperçu donné des méthodes de recherche instrumentale n'épuise pas toutes les méthodes existantes pour étudier la fonction de la respiration externe. Outre les méthodes physiques, les méthodes instrumentales fournissent des données précieuses nécessaires pour évaluer l'état fonctionnel des organes respiratoires.
Ponction de la paroi thoracique (thoracentèse). Les méthodes physiques d'examen thoracique, y compris la fluoroscopie, permettent généralement de déterminer la présence de liquide dans la cavité pleurale, mais ne permettent pas de déterminer si le liquide est un exsudat ou un transsudat, et dans le premier cas, la nature de l'exsudat. Un examen général du patient et le suivi de l'évolution de la maladie sont d'une certaine aide à cet égard : en présence de liquide dans la cavité pleurale, augmentation de la température, douleur de côté, toux sèche, bruit de frottement pleural à la limite de la matité. indiquer la présence d'exsudat. L'absence de fièvre et de douleur, un gonflement dans d'autres zones du corps en présence d'une maladie cardiaque ou rénale indiquent la présence de transsudat, surtout si du liquide est détecté dans les deux cavités pleurales. Avec une pleurésie exsudative incontestable, un état plus grave du patient, une température très élevée avec des fluctuations importantes, un essoufflement se développant rapidement et une augmentation de la fréquence cardiaque, des frissons et des sueurs, une pâleur sévère de la peau, une leucocytose élevée et un changement dans la formule leucocytaire à gauche (voir « Examen sanguin ») indiquent un exsudat de nature purulente.
Cependant, la question de la présence de liquide dans la cavité pleurale et de la nature du liquide ne peut être définitivement résolue qu'en l'obtenant et en l'examinant ultérieurement. Pour extraire le liquide de la cavité pleurale, une ponction de la paroi thoracique est utilisée (ponction test de la plèvre, ponction pleurale).
La ponction pleurale est utilisée à la fois à des fins diagnostiques et thérapeutiques, à savoir : s'il est nécessaire d'éliminer du liquide de la cavité pleurale, d'introduire divers médicaments ou gaz dans la cavité pleurale pour comprimer le poumon (pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire).
La ponction de la cavité pleurale est réalisée avec une aiguille spéciale (8 à 10 cm de long) de moyen calibre (plus de 1 mm), montée sur une seringue de 20 grammes. Avant utilisation, la seringue et l'aiguille démontées sont stérilisées par ébullition. Pour éviter le colmatage, l'aiguille doit être équipée d'un mandrin avec lequel elle est stérilisée.
Habituellement, la ponction est pratiquée sous l'angle de la scapula ou entre les lignes axillaires scapulaire et postérieure dans l'espace intercostal VIII ou IX, là où se trouve la plus grande matité. En cas de pleurésie enkystée, la ponction est réalisée à l'endroit de la matité la plus intense. Le site de ponction doit être choisi ni trop bas ni trop proche du niveau supérieur de matité. Si la ponction est trop basse, vous pouvez pénétrer dans le sinus pleural, qui peut ne pas contenir de liquide en raison du collage de la plèvre pariétale et diaphragmatique. Si la ponction est faite trop près du niveau supérieur de matité, vous pouvez alors pénétrer dans le poumon situé au-dessus du liquide, ce qui, en raison de l'atélectasie, peut également donner une matité lors de la percussion et ainsi simuler un niveau de liquide plus élevé.
L'injection est effectuée dans l'espace intercostal plus proche du bord supérieur de la côte sous-jacente afin d'éviter de blesser l'artère intercostale, qui s'étend dans la rainure le long du bord inférieur de la côte sus-jacente. L’indentation de la peau lors du passage de l’aiguille provoque une douleur inutile. Pour éviter cela et pour rendre l'aiguille plus stable, avant l'injection, étirez la peau de l'espace intercostal entre le pouce et l'index de la main gauche, en plaçant l'un sur la côte sus-jacente et l'autre sur la côte sous-jacente. L'aiguille est installée strictement perpendiculairement à la surface de l'espace intercostal, injectée pas trop lentement pour ne pas provoquer de douleur, mais pas trop rapidement pour que l'aiguille ne glisse pas à travers la cavité pleurale dans le poumon ou ne se brise pas en heurtant accidentellement une côte. .
Lors du perçage de la paroi thoracique, une résistance est d'abord ressentie lorsque l'aiguille traverse le tissu de l'espace intercostal, puis une sensation d'aiguille pénétrant dans l'espace creux est créée. Si l'aiguille repose sur la côte, vous devez l'étendre légèrement et changer légèrement la direction de la piqûre. Lorsque du liquide apparaît, ne l'aspirez pas trop rapidement dans la seringue pour éviter d'aspirer l'air ambiant. Si, lorsque vous essayez de retirer le piston, une résistance est ressentie sous forme d'aspiration inverse, cela indique que la pointe de l'aiguille se trouve dans un tissu dense. Le piston est facilement retiré, mais le liquide n'apparaît pas si l'aiguille se trouve dans une cavité contenant de l'air (pneumothorax, bronche) ou lorsque l'aiguille n'est pas fermement fixée à la canule. L’apparence du sang clair dans une seringue peut dépendre de la pénétration de l’aiguille dans un vaisseau sanguin ou dans un tissu pulmonaire. Dans ce cas, l'aiguille doit être immédiatement retirée (sauf s'il existe des preuves que l'apparition de sang dépend de la présence d'un hémothorax).
Pour extraire de grandes quantités de liquide de la cavité pleurale, un appareil Poten est utilisé.
Etude du fluide obtenu par ponction. Tout d’abord, l’étude doit décider si le liquide est un exsudat ou un transsudat. A cet effet, un examen physique, chimique et microscopique du liquide est utilisé. Dans certains cas, pour déterminer l'étiologie de l'inflammation de la plèvre ou d'une autre membrane séreuse, une étude bactériologique est également réalisée.
L'examen physique détermine la couleur, la transparence et la densité du liquide.
Le transsudat est un liquide complètement transparent, légèrement jaunâtre et parfois incolore. L'exsudat séreux et sérofibrineux est généralement de couleur jaune citron plus intense et moins transparent. Dans l'exsudat, lorsqu'il est au repos, des flocons de fibrine plus ou moins abondants tombent, le rendant trouble, mais le transsudat reste transparent et aucun sédiment ne s'y forme, ou ce dernier est très tendre et ressemble à un nuage. .
L'exsudat purulent est épais, verdâtre et opaque. L'exsudat hémorragique est opaque, rouge, parfois brun rougeâtre en raison de la dégradation des érythrocytes dans la cavité pleurale. L'exsudat putride est de couleur brun sale et dégage une odeur gangreneuse désagréable.
Les exsudats purulents, putréfactifs et hémorragiques sont facilement identifiables par leur aspect. Des difficultés peuvent survenir pour différencier le transsudat de l'exsudat séreux, qui peuvent être similaires en couleur et en transparence. Ils peuvent être distingués en déterminant leur densité. En raison de la teneur plus élevée en protéines et en éléments formés dans l'exsudat, sa densité est supérieure à 1016 et celle du transsudat est inférieure à 1014.
L'examen chimique du liquide obtenu par ponction se résume généralement à la détermination du pourcentage de protéines. La présence de plus de 4 % de protéines dans le liquide extrait plaide en faveur de l'exsudat, et en dessous de 2 % - en faveur du transsudat. Il convient cependant de rappeler que dans les transsudats restés longtemps dans les cavités corporelles, le pourcentage de protéines augmente avec le temps, d'une part, en raison de l'absorption des parties liquides du transsudat, et d'autre part. d'autres, dues à la réaction inflammatoire de la membrane séreuse à une irritation prolongée par son liquide stagnant.
Pour distinguer l'exsudat du transsudat, le test Rivalta est également effectué. Ce test sert à détecter un corps protéique spécial contenu dans les exsudats, mais absent ou présent uniquement sous forme de traces dans les transsudats. Ce corps protéique est la sérosomucine.
Le test Rivalta est réalisé comme suit : l'eau dans un cylindre en verre est acidifiée avec 2-3 gouttes d'acide acétique fort (solution à 80 %). Ensuite, quelques gouttes du liquide d'essai sont versées l'une après l'autre d'une pipette dans la solution résultante. Si ce dernier est un exsudat, alors après chaque goutte qui tombe dans l'eau, il y a un nuage blanc rappelant la fumée de cigarette. Si le liquide étudié est un transsudat, ses gouttes tombent au fond du cylindre sans laisser de trace.
L'examen microscopique constitue une autre possibilité de distinguer l'exsudat du transsudat. Le liquide testé est généralement centrifugé et un frottis est préparé à partir du sédiment obtenu sur une lame de verre ; il est examiné au microscope à l'état frais ou préfixé et coloré de la même manière que le sang.
L'importance principale de l'examen microscopique d'un frottis est de déterminer le nombre de leucocytes dans le liquide à tester. Cependant, lors de la centrifugation, la densité du sédiment résultant dépend de la durée de la centrifugation et du nombre de tours par minute. Il est donc préférable d'utiliser un sédiment de liquide non centrifugé (F. G. Yanovsky). Pour des études répétées, le liquide, après l'avoir reçu, est versé dans des tubes à essai identiques au même niveau et laissé pendant le même temps (par exemple 1 heure). Cela élimine un éventuel caractère aléatoire de la répartition des leucocytes dans le sédiment. Une fois le temps spécifié écoulé, utilisez une pipette pour prélever avec précaution (pour éviter de remuer les sédiments meubles) quelques gouttes du fond du tube à essai et appliquez-les sur une lame de verre pour préparer un frottis.
Lorsqu'on les examine au microscope, on trouve souvent des globules rouges dans le frottis. Une abondance de globules rouges dans le frottis est observée avec des exsudats hémorragiques, caractéristiques des néoplasmes malins des membranes séreuses. On les retrouve dans les pleurésies tuberculeuses et traumatiques, dans l'urémie, dans les pleurésies des patients souffrant d'hémorragie, et parfois dans les pleurésies compliquant un infarctus pulmonaire. Une quantité importante de globules rouges frais est parfois observée dans un frottis provenant d'exsudats séreux et même de transsudats. La raison en est le mélange de sang dû au traumatisme du vaisseau lors de la ponction. Ainsi, une impureté peut parfois être détectée macroscopiquement (couleur rosée du liquide), mais seulement dans les premières portions du liquide. De plus, les véritables exsudats hémorragiques ne sont pas rouge vif, comme un liquide en présence de sang frais, mais plutôt rouge brunâtre en raison de l'hémolyse des globules rouges et de l'accumulation de produits de conversion de l'hémoglobine.
Pour décider si le liquide obtenu représente du sang pur provenant d'un vaisseau blessé ou un mélange de sang et d'exsudat, vous pouvez comparer le nombre de globules rouges dans 1 ml du liquide obtenu avec le nombre de globules rouges dans 1 ml de sang de la chair du doigt du même patient. Dans le même but, il est possible de déterminer dans le liquide sanglant obtenu le rapport entre le nombre d'érythrocytes et le nombre de leucocytes dans 1 ml (il est nettement inférieur dans l'exsudat sanguin que dans le sang pur).
Le nombre de leucocytes dans un frottis provenant du liquide à tester revêt une importance diagnostique importante. Une teneur abondante en leucocytes (10-15 ou plus) dans le champ de vision d'un frottis provenant d'un liquide non centrifugé à fort grossissement indique l'origine inflammatoire du liquide. Plus le processus inflammatoire est intense, plus il y a de leucocytes dans l'exsudat. Dans l'exsudat purulent, les leucocytes peuvent couvrir tout le champ de vision, et dans les exsudats purulents d'origine tuberculeuse, les leucocytes sont généralement dans un état de désintégration granuleuse et graisseuse, tandis que dans les exsudats purulents provoqués par des bactéries pyogènes ordinaires (strepto-, staphylo-, pneumocoques ), les leucocytes sont souvent bien conservés. Une autre caractéristique distinctive de l'exsudat purulent tuberculeux est que, au microscope, les bacilles tuberculeux ne sont pas détectés ou sont détectés avec difficulté, puis en utilisant des méthodes spéciales, tandis que dans l'exsudat purulent d'origine non tuberculeuse, l'agent causal de la suppuration est facilement détecté .
L'examen microscopique de frottis d'exsudat colorés peut également déterminer le pourcentage de différents types de leucocytes.
La prédominance des lymphocytes (jusqu'à 70 % et plus) est considérée comme caractéristique de l'exsudat d'étiologie tuberculeuse, tandis que la prédominance des leucocytes neutrophiles est considérée comme caractéristique de l'exsudat d'autres étiologies. La prédominance des lymphocytes est également observée dans les exsudats d'étiologie syphilitique, ainsi que dans les exsudats provoqués par des néoplasmes malins de la plèvre et d'autres membranes séreuses. D'autre part, la prédominance de l'un ou l'autre type de leucocytes dépend également de l'intensité et de la durée du processus inflammatoire. Par exemple, au plus fort de la pleurésie tuberculeuse, les neutrophiles peuvent prédominer dans l'exsudat et, pendant la période de guérison d'une pleurésie non tuberculeuse, un grand nombre de lymphocytes peuvent être trouvés dans le frottis.
L'examen microscopique du transsudat révèle souvent des cellules de l'endothélium exfolié de la membrane séreuse dans le sédiment. Ce sont de grandes cellules polyédriques, soit simples, soit disposées en groupes de 8 à 10, possédant en partie la structure caractéristique de l'endothélium, en partie dégénérées et, par conséquent, ont perdu leur forme et leur taille normales. Leur apparition dépend de la desquamation de l'endothélium due à une irritation mécanique de la séreuse par transsudat.
Dans les néoplasmes de la plèvre ou d'autres membranes séreuses, des cellules tumorales peuvent parfois être détectées au microscope dans l'exsudat.
En cas de leucémie, des formes immatures de leucocytes, caractéristiques de cette forme de leucémie, peuvent être retrouvées dans les exsudats de la cavité. Dans certaines maladies (tuberculose, gangrène, cancer du poumon), dans de rares cas, de nombreux éosinophiles peuvent être retrouvés dans l'exsudat pleural, parfois à plus de 50 %. La raison de leur apparition n’est pas exactement claire. Parfois, cela est dû à la migration des larves d’ascaris.
Dans certains cas, la ponction de la plèvre ou du péritoine produit un liquide qui ressemble à du lait. Il existe trois types de tels liquides : les exsudats chyleux, chyloformes et pseudochyux.
L'exsudat chyleux est le résultat d'une fuite de chyle due à une rupture traumatique du canal thoracique ou d'autres gros vaisseaux lymphatiques. Parfois, même en cas de simple stagnation de la lymphe dans le canal thoracique, de minuscules gouttelettes de graisse peuvent pénétrer dans le liquide de la cavité. Lorsque l’exsudat chyleux se dépose, la graisse s’accumule dessus sous la forme d’une couche crémeuse. Les gouttelettes de graisse dans l'exsudat chyleux sont facilement détectées au microscope avec la coloration appropriée du frottis (elles sont colorées en noir avec de l'acide osmique ou en rouge avec du Soudan III). Cet exsudat devient plus clair en ajoutant de l'éther.
L'exsudat hyloforme contient un grand nombre de cellules adipeuses désintégrées. On l'observe parfois dans la tuberculose, la syphilis et les tumeurs malignes de la plèvre.
L'exsudat du pseudochyle est trouble, a l'apparence du lait dilué avec de l'eau, mais ne contient pas de graisse. Avec l'ajout d'éther, contrairement à l'exsudat chyleux, il ne devient pas clair et, au repos, il ne forme pas de couche supérieure crémeuse. Contrairement à l'exsudat chyloforme, l'examen microscopique ne révèle pas de cellules graisseuses désintégrées. La couleur laiteuse dépend de l'état particulier d'agrégation des corps protéiques. Cet exsudat survient le plus souvent avec la syphilis des membranes séreuses.
Examen respiratoire :
Méthodes instrumentales et de laboratoire pour l'étude des organes respiratoires
Parmi les méthodes radiologiques utilisées pour étudier les organes respiratoires, on utilise la fluoroscopie thoracique, la radiographie, la tomographie, la bronchographie et la fluorographie.
La méthode de recherche la plus courante est fluoroscopie poumons, permettant de déterminer la transparence des champs pulmonaires, de détecter les foyers de compactage (infiltrats, pneumosclérose, néoplasmes) et les cavités du tissu pulmonaire, les corps étrangers de la trachée et des bronches, de détecter la présence de liquide ou d'air dans la cavité pleurale, ainsi que des adhérences et des amarrages pleuraux rugueux.
Radiographie utilisé dans le but de diagnostiquer et d'enregistrer sur film radiographique les changements pathologiques dans les organes respiratoires détectés lors de la fluoroscopie ; certains changements (consolidations focales floues, schéma bronchovasculaire, etc.) sont mieux déterminés par radiographie que par fluoroscopie. Tomographie permet un examen radiographique couche par couche des poumons. Il est utilisé pour un diagnostic plus précis des tumeurs, ainsi que des petits infiltrats, cavités et cavités. Bronchographie utilisé pour étudier les bronches. Après une anesthésie préalable des voies respiratoires, un agent de contraste (iodolipol) est injecté dans la lumière des bronches, qui bloque les rayons X. Des radiographies des poumons sont ensuite réalisées, qui donnent une image nette de l'arbre bronchique. Cette méthode permet de détecter les bronchectasies, les abcès et les cavités pulmonaires, ainsi que le rétrécissement de la lumière bronchique par une tumeur. Fluorographie est un type d'examen aux rayons X des poumons, dans lequel une photographie est prise sur une bobine de film de petit format. Il est utilisé pour un examen préventif de masse de la population.
Actuellement, les méthodes de recherche basées sur les technologies modernes avancées sont largement utilisées - tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique.
Examen endoscopique
Les méthodes de recherche endoscopique comprennent la bronchoscopie et la thoracoscopie. Bronchoscopie utilisé pour examiner la membrane muqueuse de la trachée et des bronches. Elle est réalisée à l'aide d'un appareil spécial - un bronchofiberscope. Le bronchoscope est fixé à une pince spéciale pour la biopsie, l'élimination des corps étrangers, l'élimination des polypes, la fixation de photos, etc.
La bronchoscopie est utilisée pour diagnostiquer les érosions et les ulcères de la muqueuse bronchique et les tumeurs de la paroi bronchique, éliminer les corps étrangers, éliminer les polypes bronchiques, traiter les bronchectasies et les abcès pulmonaires centraux. Dans ces cas, les crachats purulents sont d'abord aspirés à l'aide d'un bronchofibroscope, puis des antibiotiques sont injectés dans la lumière ou la cavité bronchique.
Thoracoscopie est réalisée à l'aide d'un appareil spécial - un thoracoscope, composé d'un tube métallique creux et d'un dispositif optique spécial avec une ampoule. Il est utilisé pour examiner la plèvre viscérale et pariétale et pour séparer les adhérences pleurales qui empêchent l'application d'un pneumothorax artificiel (pour la tuberculose pulmonaire caverneuse).
Méthodes de diagnostic fonctionnel
Les méthodes de recherche fonctionnelle du système respiratoire externe revêtent une grande importance dans un examen complet des patients souffrant de maladies des poumons et des bronches. Toutes ces méthodes ne permettent pas de diagnostiquer la maladie ayant conduit à l'insuffisance respiratoire, mais elles permettent d'identifier sa présence, souvent bien avant l'apparition des premiers symptômes cliniques, d'établir le type, la nature et la gravité de cette insuffisance, de retracer la dynamique des changements dans les fonctions de l'appareil respiratoire externe au cours du développement de la maladie et sous l'influence du traitement.
La spirographie est l'enregistrement des valeurs de ventilation (oscillations respiratoires) sur une bande millimétrique mobile d'un spirographe. Connaissant l'échelle du spirographe et la vitesse de déplacement du papier, les principaux volumes et capacités pulmonaires sont calculés. Les éléments les plus importants pour évaluer la fonction de la respiration externe sont la capacité vitale (VC), la ventilation pulmonaire maximale (MPV) et leur relation.
La spirométrie est une méthode d'enregistrement des modifications des volumes pulmonaires lors des manœuvres respiratoires au fil du temps.
La pneumotachométrie est une méthode qui permet de construire des courbes débit-volume qui fournissent des informations supplémentaires sur les perturbations de la fonction de la respiration externe en analysant la « boucle », qui reflète les changements de vitesse de déplacement de l'air expiré et inhalé en fonction du volume de le poumon. Grâce à la méthode, il est possible d'étudier les troubles de l'obstruction bronchique au niveau des grosses, moyennes ou petites bronches, ce qui est important pour déterminer le traitement de l'obstruction bronchique.
La débitmétrie de pointe est une méthode de mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) - la vitesse maximale de l'air lors d'une expiration forcée après une inspiration complète. L'avènement d'un débitmètre de pointe (un appareil portable à usage individuel) constitue la réalisation la plus importante dans le diagnostic de l'asthme bronchique et le suivi du traitement.
Il existe plusieurs types de débitmètres de pointe. Ils sont tous standardisés. Le patient choisit lui-même n'importe quel type d'appareil et commence à l'utiliser dans un certain ordre :
Place la tête de l'embout buccal sur le débitmètre de pointe ;
Se lève et maintient le débitmètre de pointe horizontalement. Le curseur de l'appareil doit être fixe et situé au début de l'échelle ;
Prend une profonde inspiration, enroule ses lèvres autour de l'embout buccal et expire le plus rapidement possible ;
Marque le résultat. Puis répète la procédure de recherche deux fois. Sélectionne le résultat le plus élevé et le marque. Compare les données reçues avec celles requises.
Méthodes d'examen des poumons
Les méthodes d'étude des organes respiratoires peuvent être divisées en deux groupes : générales et instrumentales de laboratoire. Ci-dessous, nous examinerons chaque groupe séparément.
Méthodes d'examen des poumons
Méthodes générales d'examen pulmonaire
Les méthodes courantes d’examen du système respiratoire comprennent :
L'examen de la poitrine est nécessaire pour déterminer sa forme et sa symétrie, son type de respiration, sa fréquence et son rythme. Au stade de l'examen, les asymétries sont identifiées et l'uniformité de la participation de la poitrine au processus respiratoire est également examinée.
La palpation (palpation) permet d'identifier les zones douloureuses et leur étendue. Il peut également être utilisé pour déterminer l’élasticité de la poitrine et les « tremblements de la voix ».
La percussion (tapotement) est utilisée à la fois pour déterminer les limites des poumons et pour identifier diverses anomalies dans leur fonctionnement. La conclusion sur l'état des organes respiratoires est tirée sur la base du son obtenu lors de la percussion.
Méthodes de laboratoire et instrumentales pour étudier les poumons
La recherche en laboratoire et instrumentale peut être divisée en deux groupes : principale et auxiliaire.
Le groupe principal est constitué d'études réalisées à l'aide de techniques de rayons X. Cela comprend la fluorographie, la radiographie et la fluoroscopie.
La fluorographie est une image des organes respiratoires. Cette méthode est largement utilisée pour les enquêtes de masse. Les images fluorographiques aident à identifier les maladies respiratoires. Si des pathologies sont détectées sur l'image ou si elles sont suspectées, le patient est envoyé pour un examen plus approfondi.
La radiographie est également une image des poumons, mais elle vous permet de voir les organes respiratoires plus en détail, ainsi que d'examiner en détail n'importe quelle partie du poumon. La radiographie permet de prendre des photos des poumons dans différentes projections, ce qui simplifie grandement le diagnostic.
La fluoroscopie est un examen des organes respiratoires. Aucune photo n'est prise lors d'une telle étude, les résultats de l'étude ne sont disponibles qu'en temps réel sur le moniteur, le professionnalisme du radiologue est donc ici d'une grande importance.
Les méthodes auxiliaires de laboratoire et de recherche instrumentale comprennent :
Tomographie calculée et linéaire
La tomodensitométrie linéaire et calculée est une étude couche par couche des poumons. Les images obtenues au cours de ces études aident à identifier les ganglions lymphatiques hypertrophiés dans les racines des poumons et à déterminer la structure des changements pathologiques dans le système respiratoire.
Si des maladies chroniques et des tumeurs sont suspectées, le patient subit une bronchographie (un cathéter est inséré dans les bronches, à travers lequel une substance contenant de l'iode est introduite). La bronchographie est réalisée sous anesthésie locale ou générale, selon la zone des bronches examinée.
Examens des crachats
Les crachats sont examinés de deux manières : microscopique et bactérioscopique.
La bronchoscopie est un type d'examen visuel dans lequel un tube spécial (bronchoscope) est inséré dans la trachée. Cette méthode convient à l'examen des voies respiratoires inférieures. La bronchoscopie est nécessaire pour déterminer les causes d'une toux prolongée, ainsi que si la respiration est difficile en raison de corps étrangers dans les poumons. La bronchoscopie est utilisée non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement des maladies respiratoires. À l'aide d'un bronchoscope, des médicaments sont injectés dans les voies respiratoires et une biopsie peut également être réalisée. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale ou locale.
La laryngoscopie est la principale méthode d'examen du larynx, réalisée à l'aide d'un miroir laryngé (laryngoscopie indirecte) ou de directoscopes (laryngoscopie directe). Étant donné que lors de la laryngoscopie indirecte, un réflexe nauséeux se produit souvent, elle peut être réalisée sous anesthésie locale (application d'anesthésie du pharynx et de la racine de la langue). La laryngoscopie directe est réalisée sous anesthésie générale ou locale.
La thoracoscopie est un examen des poumons et de la plèvre au moyen d'un instrument spécial (thoracoscope). L'intervention se déroule sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation. À l'aide d'un thoracoscope, vous pouvez injecter des médicaments dans les poumons, éliminer le liquide de la cavité pleurale et également prélever des échantillons de tissus à des fins de recherche.
^ Lors d'un examen objectif du patient, une grosseur est palpée au niveau de l'aisselle sur fond de rougeur et de douleur. Il pourrait être: a) furoncle, b) métastases tumorales, c) hidradénite, d) lymphadénite, e) lipome.
Choisissez la bonne réponse : 1) a,b, 2) c,d, * 3) b,d, 4) a,b,c, 5)a,c,e.
6 Des informations très détaillées sur les plaintes, les antécédents médicaux du patient ont été obtenues et de nombreuses données de tests de laboratoire différentes ont été présentées. Est-ce suffisant pour formuler un diagnostic de la maladie ?
1) oui, 2) non.*
^ 7 L'examen échographique est indiqué pour les maladies suivantes : a) cancer de l'estomac, b) cholécystite aiguë, c) ulcère gastroduodénal de l'estomac et des 12 intestins, d) lithiase urinaire, e) hémorroïdes, f) phimosis, g) goitre nodulaire, h) duodénite.
Choisissez la bonne combinaison : 1) b, d, e, 2) a, b, d, g, * 3) g, h, 4) c, d, 5) a, e, g.
^ La laparoscopie est indiquée pour les maladies :
Choisissez la bonne combinaison : 1) a,d,e, 2) a,b,d,g, 3) c,d, 4) e,h, * 5) b,f,g.
^ 9 Quel examen endoscopique montre la couverture séreuse des organes ?
a) bronchoscopie, b) gastroscopie, c) rectoscopie, d) laparoscopie,
e) cholédochoscopie, f) thoracoscopie, Choisissez la bonne combinaison :
1) a,c, 2) b,d, 3) c,e, 4) d,f, * 5) e,f.
^ Pour détecter la propagation métastatique de la tumeur, les éléments suivants sont utilisés :
^ 11 Une description distincte dans les antécédents médicaux de l'état pathologique local est obligatoire pour les maladies suivantes : a) athérosclérose oblitérante des vaisseaux des membres inférieurs, b) abcès post-injection de la région fessière,
c) varices des membres inférieurs, d) hernie inguinale étranglée, e) ulcère gastrique, f) cholécystite calculeuse. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,b,c, 2) d,e,f, 3) a,c,d, 4) b,d,f, 5) toutes correctes.*
^ 12 Avec un ictère obstructif, vous pouvez observer : a) coloration jaune intense de la peau et des muqueuses, b) coloration intense des selles, c) saignement des gencives, saignement utérin, d) vomissements, e) décoloration des selles, f) diminution de la salivation. Choisissez la bonne combinaison :
1) a,c,e, * 2) b,d,e, 3) a,e,f, 4) d,e,f, 5) a,b,d.
^ 13. Le patient dispose de données complètes sur les plaintes, l'anamnèse, les données objectives et diverses données provenant d'études supplémentaires. Ceci est nécessaire pour définir : 1) diagnostic préliminaire, 2) diagnostic de l'établissement de référence, 3) diagnostic clinique, * 4) diagnostic présomptif.
^ Dans quel but des méthodes de recherche supplémentaires sont-elles utilisées ?
^ Comment s'appelle le diagnostic en lien avec le déclin du patient ou son décès : 1) précoce, 2) différencié, 3) préliminaire, 4) clinique, 5) final, * 6) pathologique.
^ 16. Le patient est suspecté de cholécystite calculeuse. Quelles recherches supplémentaires est-il conseillé d’effectuer : a) test sanguin général, b) détermination de la bilirubine sanguine, c) radiographie générale de la cavité abdominale, d) échographie du foie et du pancréas, e) laparoscopie, f) détermination de l'urobiline dans les urines. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,c,e, 2) b,d,f, 3) b,f, 4) a,d, 5) c,d*
Pour poser un diagnostic préliminaire, le médecin s'appuie sur les données de l'examen. Organisez les manipulations nécessaires pour obtenir les données dans l'ordre requis :
18. Un patient a été admis aux urgences avec suspicion d'hémorragie gastro-intestinale (il y a 3 heures, il a vomi du « marc de café »). Quelles études supplémentaires doivent être réalisées : a) prise de sang générale, b) gastroscopie, c) échographie de l'estomac, d) laparoscopie, e) examen radiographique général de la cavité abdominale, f) examen numérique du rectum. Choisissez la bonne réponse : 1) a,b,c, 2) d,e,f, 3) a,b,f, * 4) b,d,e, 5) c,d,e.
^ 19. Si vous soupçonnez la présence de liquide dans la cavité pleurale, vous devez effectuer : a) radiographie simple des poumons, b) spirométrie, c) administration intramusculaire de fortes doses d'antibiotiques, d) ponction pleurale, e) bronchoscopie. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,b, 2) c,d, 3) a,d, * 4) b,e, 5) c,e.
^ 20. Lors de l'examen du patient, une hémorragie gastro-intestinale a été suspectée. Lequel des symptômes suivants correspond à cette suspicion : a) vomissements accompagnés de caillots sanguins, b) selles goudronneuses, c) diminution de la tension artérielle, d) tachycardie, e) pâleur de la peau. Trouvez la bonne réponse :
1) a, 2) a,b, 3) a,b,c, 4) a,b,d,e, 5) tous sont corrects.*
^ À quoi doit penser un médecin lorsqu'un patient se plaint d'un manque d'urine ? ? a) tumeur ou adénome de la prostate, b) insuffisance rénale, c) compression des deux uretères, d) la période immédiatement après une intervention chirurgicale sur les organes abdominaux. Choisissez la bonne réponse : 1) a,b, 2) b,c, 3) a,c, 4) tous sont incorrects ; 5) tout est correct.*
^ 22. Lesquelles des méthodes suivantes pour étudier le système respiratoire sont les rayons X : a) bronchographie, b) bronchoscopie. c) fluorographie, d) échographie, e) tomographie, f) percussion, g) spirographie. Choisissez la bonne réponse : 1) a,b,c, 2) d,e,f, 3) b,d,g, 4) a,c,e, * 5) tous sont corrects.
^ 23. Quels signes de saignement indiquent son origine pulmonaire : a ) le sang est écarlate, mousseux, b) le sang est foncé, en caillots, comme du « marc de café », c) le sang libéré a une réaction alcaline, d) le sang libéré a une réaction acide, e) le sang est libéré avec des quintes de toux.
Choisissez la bonne réponse : 1) toutes sont correctes ; 2) b,d,e, 3) a,c,d, * 4) b,c,e, 5) tout va mal.
^ 24. Un patient se plaint d'hémoptysie. Quelles maladies peut-on suspecter ? a) bronchite aiguë, b) pneumonie lobaire, c) asthme bronchique, d) bronchectasie, e) cancer du poumon. Choisissez la bonne réponse : 1) a,b, 2) c,d, 3) a,e, 4) a,c,d, 5) b,d *
^ 25. Pourquoi une ponction pleurale est-elle pratiquée : a) pour éliminer le liquide de la cavité pleurale à des fins de diagnostic, b) pour éliminer le liquide de la cavité pleurale à des fins thérapeutiques, c) pour introduire des médicaments dans la cavité pleurale, d) pour séparer les adhérences pleurales, e) pour éliminer les crachats de la bronches et rincer les bronches. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,e, 2) b,c,d, 3) c,d,e, 4) a,b,c, * 5) a,d,e.
^ 26. Si vous vous plaignez d'hémorragies gastro-intestinales, à quelles maladies pouvez-vous penser : a) inflammation de la muqueuse gastrique, b) atonie gastrique, c) tumeur maligne de l'estomac, d) lésions érosives et ulcéreuses de l'estomac, e) rupture des varices de l'œsophage et de l'estomac. Choisissez les bonnes combinaisons : 1) a,b,c, 2) b,c,d, 3) c,d,e, * 4) a,b,d, 5) b,d,e.
^ 27. Les méthodes de recherche en laboratoire comprennent : a) prise de sang générale, b) échographie, c) analyse des protéines plasmatiques, d) coagulogramme, e) analyse d'urine générale ; f) examen scatologique, g) collecte d'urine pour examen avec un cathéter. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d,e,f, * 2) b,c,f,g, 3) a,b,d,f, 4) b,d,e,g, 5) d,d,f,g.
^ 28. La méthode d'auscultation permet de déterminer : a) la nature des bruits cardiaques, b) la nature de la respiration, c) la présence de bruits intestinaux, d) la disparition de la matité hépatique, e) le bruit d'une artère sténosée, f) les bords de l'estomac, g ) les frontières du cœur. Choisissez la bonne réponse : 1) a, b, c, d, * 2) a, b, c, d,
3) c, d, e, g, 4) b, d, e, f, 5) d, e, f, g.
^ 29. Laquelle des méthodes de recherche suivantes nous permet de clarifier le cancer de l'estomac : a) gastroscopie, b) laparoscopie, c) échographie, d) coloscopie, e) urographie excrétrice, f) radiographie des organes abdominaux. Choisissez la bonne réponse : 1) a,b,c, * 2) b,c,d, 3) d,e,f, 4) a,b,f, 5) b,d,e.
30. ^ Les méthodes endoscopiques pour examiner les patients chirurgicaux sont : 1) laparoscopie, * 2) gastroscopie, * 3) irrigoscopie, 4) thoracoscopie, * 5) cholédochoscopie, * 6) diaphanoscopie.
^ 31. La palpation permet d'établir : 1) douleur locale, * 2) bruits intestinaux, 3) tension musculaire sur la zone touchée, * 4) présence d'une formation pathologique, * 5) forme, taille, déplacement de la formation.*
^ 32. Indiquez comment les plaintes sont divisées : 1) général, * 2) total,
3) dominant, 4) local, * 5) principal, * 6) auxiliaire,
7) mineur.*
33. L'histoire du développement de la maladie reflète : 1) moment d'apparition des premiers signes, * 2) dynamique du développement de la maladie à ce jour, * 3) maladies antérieures, 4) conditions de vie, de travail, nutritionnelles, 5) traitement antérieur pour cette maladie, * 6) chez la femme – antécédents obstétricaux et gynécologiques, 7) antécédents d'allergies, 8) données sur l'hérédité. 9) antécédents de transfusion sanguine, 10) mauvaises habitudes, risques professionnels.
^ Qu’est-ce qui s’applique aux méthodes cliniques générales d’examen des patients ? : 1) examen, * 2) examen, * 3) palpation, * 4) percussion, * 5) prise de sang générale, 6) analyse d'urine, 7) auscultation, * 8) fluoroscopie, 9) tomodensitométrie.
^ 35. Indiquez quel type d'inspection a lieu : 1) superficiel, 2) profond, 3) local, * 4) général.*
36. Organiser les étapes de l'examen du patient dans le bon ordre: 1) percussion, 2) inspection, 3) palpation, 4) auscultation, 5) étude des résultats des tests disponibles. /2,3,1,4,5/
^ 37. Les méthodes générales de recherche clinique en période préopératoire sont : 1) anamnèse, * 2) palpation, * 3) radiographie, 4) percussion, * 5) auscultation.*
^ 38. Les méthodes de recherche en laboratoire comprennent : 1) analyse d'urine générale, * 2) examen du suc gastrique, * 3) bactérioscopie, * 4) échographie, 5) analyse de sang générale.*
^ 39. Préciser une numération plaquettaire normale (10 9 g/l); 1) 100-140, 2) 140-180, 3) 180-320, * 4) 320-450.
40. Spécifiez les taux d’urée sérique normaux :
1) 0,5 - 4,1 mm/l, ; 2) 4,2 à 8,3 mm/l ; * 3) 8,4-9,5 mm/l.
^ 41. Indiquer les valeurs normales de l'indice de prothrombine (%) : 1) 10-30, 2) 40-60, 3) 70-100.*
42. Indiquer les niveaux normaux de glucose dans le sérum sanguin (mmol/l): 1) 1,2 – 4,1, 2) 4,2 – 6,1.* 3) 6,2 – 7,5, 4) 7,6 – 9,7.
43. La séquence d'examen du patient est-elle correctement indiquée : enregistrement des plaintes, prise d'anamnèse, examen, palpation, percussion, auscultation, données de laboratoire, méthodes de recherche particulières.
1) oui, * 2) non.
^ 44. Pour diagnostiquer les fistules, des méthodes de recherche spéciales sont utilisées :
1) fistulographie, * 2) coloration du trajet de la fistule au bleu de méthylène, * 3) étude de la nature de l'écoulement de la fistule, * 4) électroencéphalographie,
^ 45. L'absence de matité hépatique et de bruit tympanique sous le diaphragme chez un patient présentant des douleurs abdominales aiguës après un traumatisme abdominal fermé permet de suspecter : 1) hémothorax du côté droit, 2) hémorragie gastro-intestinale, 3) pneumopéritoine, * 4) pneumothorax du côté droit.
46 Précisez le temps normal de coagulation sanguine (min) :
1) 0 – 1, 2) 2 – 4; 3) 5 – 10.*
47 Indique les niveaux normaux de protéines totales dans le sang (mmol/l): 1) 23 – 42, 2) 43 – 69, 3) 70 – 90, * 4) 91 – 105.
^ 48. La fonction hépatique comprend : 1) pigmentogène, *
2) Formant des protéines, * 3) Antitoxique.*
49. Est-il correct d’exiger que le médecin examinateur, lorsqu’il effectue la palpation de l’abdomen, s’assoie au chevet du patient dans une position confortable du côté droit et effectue la palpation d’une seule main ?
1) oui ; 2) non.*
^ 50. La palpation doit commencer par les zones 1) là où la douleur est la plus inquiétante ; 2) en bordure des zones touchées ; * 3) le foyer pathologique présumé après l'anesthésie ; 4) peu importe lesquels.
^ 51. La ponction de la cavité pleurale pour pneumothorax est réalisée avec le patient assis le long de la ligne médio-claviculaire dans les espaces intercostaux : onze; 2) 2-3 ; * 3) peu importe lesquels.
^ 52. Pour diagnostiquer l'hémopéritoine après un traumatisme abdominal fermé, effectuez :
1) fluoroscopie du tractus gastro-intestinal ; 2) laparoscopie ; * 3) cystoscopie ; 4) œsophagogastroduodénoscopie.
^ 53. En cas de rupture d'un organe abdominal creux, une radiographie standard de l'abdomen en position assise (debout) peut révéler : 1) liquide libre dans la cavité abdominale ; 2) gaz libres dans la cavité abdominale ; * 3) défaut d'un organe creux ; 4) tout ce qui précède.
^ 54. Est-il possible de réaliser une biopsie pendant une endoscopie ? 1) oui ; * 2) non.
55. Par palpation vous pouvez déterminer : 1) présence de douleur ; * 2) degré de tension musculaire (défense) ; * 3) augmentation ou diminution locale de la température ; * 4) emphysème sous-cutané ; * 5) degré de perte de sang.
^ 56 A la palpation on retrouve :
1) formation pathologique volumétrique ; * 2) mobilité pathologique de l'os lors d'une fracture ; *
3) absence de pouls dans l'artère périphérique ; * 4) infiltrat inflammatoire dans la cavité abdominale ; * 5) type d'agent causal de l'infection de la plaie.
^ 57. Précisez ce qui est décrit dans le statut local : 1) tous les organes et systèmes ; 2) système organique affecté ; * 3) organe affecté ; * 4) l’état du patient à l’instant présent.
^ 58. Lors d'un examen clinique général d'un patient chirurgical, sont examinés :
1) tous les organes et systèmes ; * 2) système organique affecté ; 3) organe affecté.
^ 59 Pour examiner quels organes la palpation profonde est-elle utilisée ? ? a) glande mammaire ; b) artères périphériques ; c) foie ; d) rate ; e) poitrine ; e) les reins ; g) certaines parties du gros intestin ; h) glande thyroïde ; i) Muscles, os, articulations. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,b,c,d ; 2) d, f, g, h ; 3) b, d, h, je ; 4) c, d, f, g ; * 5) a, d, g, je.
60 Pour examiner quels organes la palpation superficielle est utilisée :
1) glande mammaire ; * 2) artères périphériques ; * 3) foie ; 4) rate.
^ 61. Par palpation, vous pouvez déterminer : 1) consistance de l'organe (tissu) ; *
2) fluctuations ; 3) pulsations ; * 4) Ligne Damoiseau ; 5) crépitement.*
62. Pour étudier le gros intestin et ses parties, utilisez: 1) rectoscopie ; * 2) sigmoïdoscopie ; * 3) irrigoscopie ; * 4) fibrocolonoscopie ; * 5) Échographie.*
63 L'examen numérique du rectum ne révèle pas :
tumeur rectale; 2) anthrax rénal ; * 3) paraproctite sous-muqueuse ; 4) état de l'espace Douglas.
^ 64. Est-il vrai que l'examen digital du rectum est obligatoire en cas de maladies aiguës et de blessures de l'abdomen ? 1) oui ; * 2) non.
65. Le critère de Stange est le suivant : 1) le temps de rétention de la respiration pendant l'inspiration ; *
2) le temps de retenue de la respiration pendant l'expiration ; 3) volume de réserve inspiratoire ;
volume de réserve expiratoire ; 5) ventilation minute maximale.
^ 66. Quelle est la durée minimale d'apnée pendant le test de Stange ?
chez les personnes en bonne santé ? 1) 15 à 25 secondes. 2) 30 – 40 secondes.* 3) 45 – 55 secondes. 5) 60 à 65 secondes.
67 La conformité des tests est : 1) temps de rétention de la respiration pendant l'inspiration, 2) temps
Retenir sa respiration en expirant, * 3) volume de réserve inspiratoire, 4) volume de réserve expiratoire, 5) ventilation minute maximale.
68 Normalement, au repos, la pression veineuse centrale est égale à :
0-30mm. eau Art. 2) 60 à 120 millimètres ; * 3) 130-180mm. eau Art.
^ 69. Préciser les taux d’amylase sanguine normaux :
1) 16 – 30, * 2) 31 – 42 , 3) 43 – 50, 4) 51 – 60 .
70 Spécifiez les valeurs ESR normales (mm/heure) :
0 – 15; * 2) 15 – 25; 3) 25 – 35; 4) 35-45.
Préciser les taux normaux de bilirubine dans le sérum sanguin (µmol/l) : 1) 8,55 – 20,52; * 2) 20,53 – 32,52; 3) 32,53 – 45,6.
^ 72. Indiquez quel type de percussion il existe : 1) superficiel ; 2) profond ;
3) comparatif ; * 4) topographique.*
73. Quels sons sont entendus lors des percussions : 1) terne * 2) exprimé,
3) clair pulmonaire, * 4) fort, 5) calme, 6) tympanique, * 7) boîte, * sourd.
^ 74 La percussion topographique est utilisée pour déterminer : 1) bords des poumons, * 2) bords du cœur, * 3) bords du foie, * 4) bords du liquide dans la cavité abdominale, 5) bords de la rate, * 6) bords de l'épanchement pleural .*
^ 75 Lors de la réalisation de percussions topographiques, la position du doigt du pessimètre doit être : 1) parallèle au bord défini de l'organe, * 2) perpendiculaire au bord défini de l'organe.
^ 76. Quelles sont les principales lignes utilisées pour déterminer le bord inférieur des poumons lors de la percussion : a) axillaire antérieur ; b) axillaire moyen ;
B) axillaire postérieur ; d) vertébral ; e) paravertébral ;
E) scapulaire ; g) médiane antérieure ; h) sternal ; i) parasternal ;
K) médio-claviculaire. Choisissez la bonne réponse : 1) a, b, c, d, e, f ;
2) a, b, c, d, f, j ; * 3) b, c, d, e, f, g ; 4) c, d, e, f, g, h ; 5) d, f, g, h, je, j.
^ 77. Quels sont les symptômes d'une hémorragie gastro-intestinale :
A) vomissements avec caillots sanguins ; b) selles noires ; c) selles décolorées ; d) diminution de la pression artérielle ; e) tachycardie ; f) cyanose ; g) pâleur de la peau. Choisis la bonne réponse:
1) a, b, c, d, e; 2) c, d, e, f, g ; 3) a, b, d, e, g ; * 4) c, d, e, f, g ; 5) a, c, d, e, f.
^ Pour les douleurs thoraciques associées à une atteinte pleurale, quels sont les signes caractéristiques ? a) douleur accrue avec respiration profonde et toux ; b) nature lancinante de la douleur ; c) caractère compressif de la douleur ; d) augmentation de la douleur en position couchée sur le côté affecté ; e) réduction de la douleur en position couchée sur le côté affecté ; f) douleur accrue en appuyant sur la poitrine.
^ Ce qui est obligatoire lors de la préparation d'un patient à un examen radiologique de l'estomac parmi les éléments suivants : 1) le jour de l'étude, exclusion de la prise alimentaire ; * 2) un lavement siphon est requis. 3) obligatoire régime sans scories pendant une semaine.
^ L'œsophagogastroscopie peut-elle être réalisée non pas à jeun, mais quelque temps après avoir mangé ? 1) le patient doit être à jeun ; 2) oui, mais dans ce cas il est nécessaire de procéder à un lavage gastrique ; 3) oui, en cas d'urgence, l'étude est réalisée quel que soit le temps écoulé depuis le repas.*
^ Les symptômes d'une péritonite purulente généralisée sont : a) pouls faible et fréquent ; b) tension dans les muscles de la paroi abdominale ; c) ballonnements ; d) accumulation de liquide dans les zones inclinées de l'abdomen ; e) forte fièvre ; e) absence de bruits intestinaux. Choisissez la bonne combinaison :
^ PÉRIODE PRÉOPÉRATOIRE
1 Sélectionner des médicaments pour corriger le métabolisme eau-sel et l'état acido-basique : a) solution de bicarbonate de sodium ;
b) trisol; c) trisamine; d) l'acésol ; e) Solution Ringerra-Lokka ;
Choisissez la bonne réponse : 1) a, b, c, d, e ; * 2) a, b, c ; 3) g,d;
4) a, b, d; 5) a,c,d.
En cas de nutrition parentérale totale, le volume total de perfusion n'est pas inférieur à : 1) 500-1000 ml. 2) 1 500 à 2 000 ml. 3) 2 500 -3 000 ml, * 4) 3 500 ml. 5) plus de 3 500 ml.
3 Préciser le taux minimum de plaquettes requis pour la chirurgie : 1) 50 x 10 /l ;
2) 70 x 10 /l ; 3) 100 x 10 /l ; 4) 150 x 10 /l ; 5) 240 x 10 /l.*
4 L'ensemble de la préparation de la perfusion avant l'intervention chirurgicale comprend : a) la correction de l'équilibre eau-sel ; b) administration d'analgésiques narcotiques ; c) nutrition entérale par sonde ; d) correction du déficit en BCC ; e) administration intramusculaire d'antibiotiques ; f) administration de médicaments immunostimulants spécifiques. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b ; 2) c,e; 3) une, ré; * 4) g,d; 5) g, f.
5 En cas d'intervention chirurgicale d'urgence, la préparation préopératoire comprend : a) la préparation hygiénique de la peau dans la zone opératoire ; b) prémédication ; c) assainissement de la cavité buccale ; d) effectuer une thérapie par perfusion e) analyse des selles pour rechercher des vers ; f) spirométrie ; g) réaliser un ECG. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b ; * 2) g, d, g ; 3) a, b, d; 4) a, b, c, f; 5) c, e, g.
6 Quelles méthodes de prévention de l'infection des plaies doivent être utilisées
avant une opération planifiée : a) exercices de respiration ;
b) activation du patient ; c) désensibilisation du corps ; d) réorganisation
cavité buccale; e) changer le linge du patient ; f) douche hygiénique ;
g) traitement du champ opératoire. Choisissez la bonne combinaison6 1) a,d,e; 2) b,f; 3) a, b, d; 4) c, d; 5) g, d, f, g.*
7 Les tâches de la période préopératoire comprennent :
a) évaluation du risque chirurgical et anesthésique ; b) définition
urgence de l'opération; c) établir un diagnostic ; d) identifier l'état des organes et systèmes vitaux ; e) déterminer la nature de l'opération ; f) préparer le patient à la chirurgie. Choisissez la bonne combinaison : 1) b,d,e ; 2) ré, f; 2) une,c; 4) c,e; 5) tout est correct.*
8 Préparer le tractus gastro-intestinal à une opération planifiée signifie : a) prescrire un jeûne complet ; b) la nomination d'aliments délicats et facilement digestibles ; c) prélèvement du contenu de l'estomac avec une sonde la veille et le jour de l'intervention chirurgicale ; d) prescrire des laxatifs ; d) prescrire des lavements nettoyants. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d ; 2) b,c,d; 3) b,c,d,e; * 4) a, c, d; 5) a, d, d.
La réalisation d'études cliniques et diagnostiques complémentaires en période préopératoire est nécessaire pour : a) choisir une méthode de soulagement de la douleur ; b) correction des perturbations du système d'homéostasie ; c) traitement médicamenteux des complications de la maladie sous-jacente ; d) préparation du champ opératoire ; e) placer le patient sur la table d'opération. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b, c ; * 2) b, c, d ; 3) c, d, d ; 4) a,c,d; 5) a, d, d.
Lors de la préparation d'un patient anémique à une intervention chirurgicale après un saignement, les éléments suivants doivent être administrés : 1) une solution saline ; 2) masse leucocytaire ; 3) polyglucine ; 4) solution de glucose ; 5) masse de globules rouges.*
11 Un patient présentant une sténose pylorique décompensée avec des vomissements constants reçoit des solutions salines intraveineuses pour :
1) arrêter les vomissements ; 2) améliorer la numération globulaire rouge ;
restauration de l’équilibre électrolytique.*
Quand le champ opératoire doit-il être rasé : 1) deux jours avant l’intervention chirurgicale ; 2) à la veille de l'opération ; 3) le jour de l'intervention chirurgicale.*
A quel moment commence la période préopératoire : 1) avec les premiers signes de la maladie ; 2) à partir du moment où le patient visite la clinique ; 3) à partir du moment où le patient est admis à l'hôpital ; * 4) à partir du moment du diagnostic clinique ; 5) à partir du moment où commence la préparation de l’opération.
14 Ce qui doit être administré au patient pour normaliser le métabolisme hydrique et électrolytique : 1) solution de glucose à 5 % ; 2) sang total ; 3) Solution de soude à 4 % ; 4) Solution de sonnerie ; * 5) masse plaquettaire.
La période préopératoire comprend : a) la réalisation de l'opération ; b) traitement médicamenteux ; c) examen ; d) préparation psychologique ; e) retrait des sutures. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b, c ; 2) b,c,d; * 3) c, d, d ; 4) a, c, d; 5) b,c,d.
En période préopératoire, un lavement nettoyant est nécessaire avant les interventions : a) sur les poumons ; b) amputation du membre inférieur ; c) sur les organes génitaux féminins ; d) réparation d'une hernie sous anesthésie ; e) amygdalectomie ; e) concernant l'appendicite aiguë. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b ; 2) une, b, c ; 3) a, b, c, d ; * 4) a, b, c, d, e ; 5) tout est correct.
17 Le patient subira une intervention chirurgicale sous anesthésie par inhalation. Il doit réaliser : a) un test de sensibilité à la novocaïne ;
b) Examen radiologique des poumons ; c) examen endoscopique de l'œsophage ; d) consultation avec un ORL ; e) administration intraveineuse de polyglucine. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,c,d ; 2) b,d; 3) c, ré; 4) b, d ; * 5) b, c, d.
18 Pour prévenir le développement d'une pneumonie postopératoire, il est nécessaire : 1) d'abandonner l'anesthésie par inhalation ; 2) prescrire des antibiotiques immédiatement après la chirurgie ; 3) prescrire des exercices de respiration, des massages vibratoires, * 4) relever le pied du lit ; 5) prescrire des médicaments expectorants.
19 La préparation préopératoire des patients présentant un ictère obstructif comprend : a) l'administration d'un jeûne ; b) prescription d'aliments gras ; c) prescrire des lavements nettoyants ; d) thérapie par perfusion ; e) antibiothérapie ; f) thérapie vitaminique ; g) prescription de médicaments augmentant la coagulation sanguine ; h) prescrire des médicaments qui réduisent la coagulation sanguine. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d ; 2) b, d, f, h ; 3) c, d, g ; 4) b, d, f, h ;
20 Si un patient souffre de diabète sucré, avant une opération planifiée, les mesures suivantes sont prises : a) analyses de sang et d'urine pour le sucre ; b) étude de l'amylase sanguine ; c) étude des hormones hypophysaires ; d) augmenter la posologie des médicaments antidiabétiques jusqu'à un état de coma hypoglycémique ; e) boire du thé sucré avant la chirurgie ; f) interdiction de manger avant la chirurgie. Choisissez la bonne réponse : 1) d, f ;
2) b, d, d ; 3) a, b, c, d ; 4) une, e; * 5) tout est correct.
21 La préparation préopératoire des organes et des systèmes d'homéostasie doit être complète et inclure des mesures : a) stabilisation de l'activité vasculaire ; b) correction de l'insuffisance respiratoire ; c) thérapie de désintoxication ; d) correction du dysfonctionnement rénal ; e) correction des troubles hydriques et électrolytiques ; f) correction des troubles acido-basiques ; Choisissez la bonne réponse : 1) a, b, c ; 2) g,d,f; 3) a, c, d; 4) b, d, f; 5) tout est correct.*
22 La période préopératoire comprend les étapes suivantes : a) l'étape d'observation clinique ; b) étape préhospitalière de préparation préopératoire ; c) étape diagnostique ; d) stade de préparation somatique générale, spéciale, psychologique ; e) l'étape de préparation préopératoire en salle d'opération. Choisissez la bonne réponse : 1) a, b, d ; 2) b, d; 3) a, b, d, f; 4) a, c, d; 5) c, d; *
23 Contre-indications au lavage gastrique : a) saignement gastrique ; b) sténose pylorique ; c) accidents vasculaires cérébraux ; d) infarctus du myocarde ; e) rétrécissement de la sortie de l'œsophage ; f) insuffisance rénale chronique ; g) occlusion intestinale. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d,e ; * 2) g, d, f, g ; 3) b.v.d.e; 4) a, d, f, g; 5) b, d, d, g.
24 Indications des lavements nettoyants : 1) rétention des selles ; * 2) empoisonnement ; * 3) période prénatale ; * 4) lésions ulcéreuses du côlon ; 5) les premiers jours après les opérations sur les organes abdominaux ; 6) préparation aux examens radiologiques et endoscopiques ; * 7) saignements intestinaux.
25 Quelles mesures doivent être prises en cas d'hémorragie gastro-intestinale : 1) assurer un repos complet ; * 2) rhume au ventre ; * 3) administration de vikasol, chlorure de calcium ; * 4) examen endoscopique urgent du tractus gastro-intestinal ; * 5) effectuer un lavement siphon ; 6) effectuer un lavement nettoyant ; 7) lavage gastrique.
26 Un patient atteint d'un cancer de l'estomac à un stade précoce refuse la chirurgie. Que doit faire un médecin : a) informer le patient de la véritable maladie ; b) nommer toute maladie nécessitant un traitement chirurgical ; c) orienter le patient vers un gastro-entérologue pour un traitement conservateur ; d) expliquer aux proches les plus proches la nécessité de convaincre le patient d'accepter l'opération ; d) montrer un patient qui a déjà subi une telle opération. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d ; 2) une, ré, ré; * 3) a, b, d ; 4) b,c,d; 5) tout est correct.
27 Un patient souffrant de lithiase biliaire depuis plusieurs années a été emmené à la clinique chirurgicale de garde avec une autre crise grave. Quelle est la tactique médicale : 1) effectuer une préparation préopératoire et réaliser une opération planifiée ; 2) en l'absence de phénomènes péritonéaux, observer pendant une journée et si l'état ne s'améliore pas, pratiquer une intervention chirurgicale différée ; * 3) effectuer une prémédication et opérer en urgence ; 4) transfert pour traitement conservateur au service de gastro-entérologie ;
28 En période préopératoire, l'introduction d'une sonde gastrique est nécessaire : a) pour préparer l'examen endoscopique afin de clarifier la localisation d'un ulcère gastrique pénétrant ; b) pour vider la cavité gastrique de son contenu lors d'une intervention chirurgicale planifiée pour la sténose du pylore ; c) pour libérer la cavité gastrique du sang lors d'une intervention chirurgicale d'urgence en cas de saignement ulcéreux abondant ; d) pour l'alimentation par sonde comme préparation préopératoire ; e) avec un ulcère perforé
Pour l'administration d'un produit de contraste et l'examen radiologique ultérieur. Choisissez la bonne combinaison :
1) c, b, c ; 2) b,c,d; 3) c, d, d ; 4) une, b; *5) tout est vrai.
Le reste de la période préopératoire est : a) l'identification des maladies concomitantes ; b) formation somatique générale ; c) préparation sanitaire et hygiénique ; d) formation spéciale ; e) choix du soulagement de la douleur ; f) préparation psychologique. Choisissez la bonne combinaison : 1) a, b, c ; 2) g,d,f; 3) b, d, f; 4) a, b, c, d, f ; 5) tout est vrai.*
30 En cas de rétention urinaire aiguë, le diagnostic peut être confirmé par : a) des plaintes de manque d'urine ; b) percussion de la vessie ; c) palpation de la vessie ; d) radiographie simple de la vessie ; d) échographie ; e) douleur dans le bas-ventre. Choisissez la bonne réponse : 1) a,c,d ; 2) b, d, f; 3) a, b, c ; 4) a, b, c, d, f ; *5) tout est vrai.
31 A quoi sert la ponction pleurale ?
cavités : 1) confirmer ou infirmer la présence de liquide dans la cavité pleurale ; 2) restaurer la fonction respiratoire normale des poumons pendant la pleurésie ; * 3) connaître la nature macroscopique du liquide ; * 4) connaître la nature microscopique du liquide ; * 5) introduction d'un produit de contraste pour réaliser un examen radiologique.
Que doit faire un patient présentant une hernie étranglée : 1) administrer des stupéfiants ; 2) effectuer un lavement nettoyant ; 3) insérer une sonde gastrique et rincer l'estomac ; 4) effectuer un examen radiologique ; 5) effectuer une opération d'urgence ; * 6) tout va mal.
33 En l'absence de douleur, un patient présentant un ictère obstructif sévère et des taux sanguins élevés de bilirubine doit : 1) procéder à un examen approfondi et terminer la préparation pour une opération planifiée ; 2) évaluer le fonctionnement des organes vitaux, procéder à une préparation préopératoire accélérée et opérer le patient en urgence ; * 3) effectuer une prémédication et procéder à une intervention chirurgicale d'urgence.
34 Un patient âgé a reçu un diagnostic de gangrène du membre inférieur avec une ligne de démarcation nette dans le tiers inférieur de la jambe. Quelles sont les tactiques : 1) traitement direct pour transfert en gangrène sèche ; 2) réaliser d'éventuelles études pour déterminer le niveau d'amputation ; 3) effectuer un traitement antibactérien actif ; 4) effectuer une thérapie par perfusion pendant une semaine à des fins de désintoxication ; 5) après une courte préparation, effectuez une amputation.*
35 Un patient présentant des ballonnements abdominaux sévères, des vomissements rares, une absence de selles pendant plusieurs jours, une absence de douleurs abdominales et une absence de péristaltisme a été diagnostiqué avec une « occlusion intestinale dynamique ». Pour l'éliminer, il faut : a) rincer l'estomac ; b) effectuer un lavement nettoyant ; c) effectuer un examen radiologique d'enquête ; d) stimuler la fonction motrice intestinale ; e) installer un tuyau de sortie de gaz ; f) effectuer une intervention chirurgicale d'urgence. Choisissez la bonne combinaison : 1) a,g ; 2) g,f; 3) a, b, f; 4) a, b, c, f; 5) a, b, d, d.*
36 Ayant déjà établi une lithiase biliaire, le patient a été admis pour une nouvelle crise de colique biliaire, qui s'est rapidement résolue. Le patient accepte l'opération. Quel est le plan préopératoire ? a) analyse générale de sang et d'urine ; b) Échographie du foie et de l'espace sous-hépatique ; c) coloscopie ; d) test de bilirubine sanguine ; e) RCP ;
e) gastroduodénoscopie. Choisissez la bonne combinaison :
1) a, b, c, d; 2) c, d, e, f; 3) a, b, d, e ; 4) b,c,d,f; 5) a,b,d,e,f.*
37 Indiquer les mesures nécessaires en période préopératoire pour un patient présentant une sténose pylorique décompensée : 1) lavage gastrique quotidien ; * 2) transfusion de plasma sanguin ; * 3) transfusion de substituts sanguins protéiques et de solutions salines ; * 4) contrôle des protéines sanguines totales ; * 5) introduction d'antibiotiques à large spectre.
38 Si, pendant la période de préparation préopératoire, un patient présentant une hernie ventrale postopératoire importante ne porte pas de pansement,
quelles complications sont possibles dans la période postopératoire : 1) les bords de la plaie ne guérissent pas ; 2) un processus adhésif peut être observé ; 3) la capacité d’absorption du côlon sera altérée ; 4) un syndrome du « petit ventre » peut se développer ; * 5) la récidive de la hernie est inévitable.
39 Le patient a été diagnostiqué avec un infiltrat appendiculaire. Quelle est la tactique :
effectuer une intervention chirurgicale d'urgence ; 2) effectuer une opération urgente ; 3) effectuer une opération planifiée après une préparation minutieuse du système cardiovasculaire ; 4) effectuer un traitement anti-inflammatoire jusqu'à disparition complète de l'infiltrat ; * 5) après la sortie du patient, il est fortement recommandé de revenir dans un mois pour une intervention chirurgicale.*
40 Un patient se préparant à une cholécystectomie laparoscopique souffre de varices sévères des membres inférieurs. Sans effectuer quelles manipulations le patient ne peut pas être opéré : 1) consultation avec un neurologue ; 2) consultations avec un gynécologue ; 3) examen numérique du rectum ; 4) lavage gastrique pendant plusieurs jours ; 5) bander les membres inférieurs avec un bandage élastique.*
41 Lors de la préparation d'un patient à une intervention chirurgicale, doit-il être au courant des détails de l'intervention : 1) ne doit pas ; 2) suit en termes généraux, si le consentement nécessaire à l'opération en dépend.*
42 Quand cela n'a aucun sens de parler de période préopératoire : 1) lorsque le patient se prépare à une opération planifiée, de petit volume ; 2) lors de la préparation d'un patient à une intervention chirurgicale d'urgence ; 3) si nécessaire, opérer le patient en urgence ; 4) lorsque le patient est inopérable ; *5) lorsque le patient est dans un état incurable.*
Malgré de grands succès dans le développement de méthodes spéciales d'étude de l'état des organes respiratoires, de nombreuses méthodes d'examen physique décrites par R. Laennec restent encore d'une importance primordiale. Certes, nous essayons désormais d'identifier uniquement les symptômes qui ont réellement une signification diagnostique importante, tout en comprenant que dans certaines maladies pulmonaires (par exemple, le cancer bronchogénique ou la tuberculose), l'apparition de ces symptômes indique souvent un stade assez prononcé de la maladie, et pour un diagnostic précoce, des méthodes plus subtiles doivent être utilisées.
Une autre différence de l'étape moderne de la recherche sur le système respiratoire est une attention nettement plus grande portée à la physiologie de la respiration, à la relation entre les signes cliniques et le dysfonctionnement de la respiration externe, aux changements fonctionnels et pas seulement anatomiques.
L'étape actuelle de compréhension des processus pathologiques qui se produisent dans les organes respiratoires est impossible sans la connaissance des mécanismes de protection qui empêchent la pénétration des micro-organismes, des particules de poussière, des substances toxiques, pollen des plantes etc. Outre les barrières anatomiques (larynx, épiglotte, nombreuses divisions et rétrécissements de l'arbre bronchique), une riche vascularisation de la muqueuse des voies respiratoires, le réflexe de toux, le transport mucociliaire, réalisé par l'épithélium cilié des bronches, joue un rôle très important dans la protection des organes respiratoires, ainsi que dans la formation d'une sécrétion trachéobronchique contenant des substances biologiquement actives (lysozyme, lactoferrine, a1-antitrypsine) et des immunoglobulines de toutes classes synthétisées par les plasmocytes, mais principalement des IgA. Au niveau des bronches terminales, des canaux alvéolaires et des alvéoles, la fonction protectrice est assurée principalement par les macrophages alvéolaires et les granulocytes neutrophiles avec leur chimiotaxie et phagocytose prononcées, ainsi que par les lymphocytes qui sécrètent des lymphokines qui activent les macrophages. Le tissu lymphoïde associé aux bronches (BALT), ainsi que les réactions d'immunité humorale (immunoglobulines de classes A et G), revêtent une importance particulière dans les mécanismes de protection du système respiratoire. Une ventilation adéquate joue un rôle important dans la protection des poumons.
Tous ces mécanismes de protection respiratoire peuvent et doivent désormais être étudiés chez chaque patient, ce qui permet de présenter plus en détail les caractéristiques de la maladie en développement, et donc de choisir un traitement plus rationnel.
Lors de l'examen des organes respiratoires (qui, comme dans tous les autres cas, commence par un interrogatoire, puis sont effectués une inspection, une palpation, une percussion et une auscultation), la principale question à laquelle il faut répondre est la détermination de la localisation prédominante du processus. : voies respiratoires, parenchyme pulmonaire ou plèvre. Souvent, plusieurs parties du système respiratoire sont impliquées simultanément : par exemple, en cas d'inflammation du lobe du poumon (pneumonie lobaire ou lobaire), il y a presque toujours une inflammation des feuillets pleuraux (pleurésie) ; en cas de pneumonie focale, le le processus commence le plus souvent par une inflammation des bronches (bronchite), puis une inflammation péribronchique se développe. Cela rend le tableau clinique d'un certain nombre de maladies pulmonaires diversifié et nous oblige à évaluer les signes détectés sous différentes positions.
Antécédents de maladie dans les maladies respiratoires
Un questionnement continu nous permet d'identifier les caractéristiques du développement de la pathologie pulmonaire - l'anamnèse de la maladie. Le principe général « ne perdez pas de temps pour vous familiariser avec les antécédents médicaux » devrait être pleinement utilisé lors de l'étude des maladies du système respiratoire. La séquence temporelle d'apparition de certains signes de la maladie, les caractéristiques de sa période initiale, les rechutes, leur fréquence et la présence de facteurs provoquants, la nature et l'efficacité du traitement et la survenue de complications sont clarifiées.
Ainsi, dans les maladies pulmonaires aiguës, des symptômes généraux tels que malaises, frissons, fièvre peuvent être détectés plusieurs jours avant les signes pulmonaires (pneumonie virale) ou presque simultanément avec eux (pneumonie à pneumocoque), et un essoufflement sévère survenant de manière aiguë est un signe très important. de l'asthme bronchique, de l'insuffisance respiratoire aiguë et du pneumothorax. Il est nécessaire d'évaluer les résultats obtenus à l'aide de méthodes de recherche particulières (analyses d'expectorations, analyses de sang, radiographie, etc.). Les indications de la présence de réactions allergiques (urticaire, rhinite vasomotrice, œdème de Quincke, bronchospasme) en réponse à des facteurs tels que les aliments, les odeurs, les médicaments (principalement les antibiotiques, les vitamines) sont particulièrement importantes ; Récemment, une attention particulière a été accordée à la possibilité d'aggraver l'évolution de l'asthme bronchique avec l'utilisation d'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (« asthme à l'aspirine »).
Une étape importante du questionnement est la tentative d'établir l'étiologie de la maladie (infectieuse, professionnelle, médicamenteuse).
Un certain nombre de maladies pulmonaires graves sont associées à un contact plus ou moins prolongé avec divers facteurs industriels (professionnels), tels que les poussières contenant de la silice, de l'amiante, du talc, du fer, de l'aluminium, etc. En plus des maladies pulmonaires professionnelles bien connues liées aux poussières ( pneumoconiose), on découvre actuellement de plus en plus un lien entre une maladie pulmonaire telle que l'alvéolite allergique exogène et de nombreux facteurs environnementaux, tels que le foin pourri, les céréales crues, etc. (« poumon du fermier », « poumon du fromager », « poumon d'éleveur de volailles », etc. .P.). Il n'est pas rare que des modifications pulmonaires diffuses surviennent chez les patients recevant des médicaments tels que des cytostatiques, des nitrofuranes, de la cordarone et ses analogues, ainsi qu'une radiothérapie à long terme pour diverses maladies non pulmonaires.
Il est conseillé de présenter finalement toutes les caractéristiques identifiées de l'évolution de la maladie sous la forme d'une image graphique appropriée, dont un exemple est l'observation d'un patient atteint de pneumonie lobaire.
Enfin, des informations importantes peuvent être obtenues en étudiant les antécédents familiaux (prédisposition familiale aux maladies broncho-pulmonaires, comme l'asthme bronchique, la tuberculose ou la présence d'un déficit en a1-antitrypsine, mucoviscidose), ainsi que les mauvaises habitudes : le tabagisme est un facteur de risque généralement reconnu. pour le cancer du poumon, l'abus d'alcool contribue à une évolution défavorable de la pneumonie (suppuration, formation d'abcès).
Le tabagisme (en particulier le tabagisme) occupe une place particulière dans l'histoire du développement de la maladie pulmonaire chez chaque patient, car il provoque ou aggrave cette maladie. Il est donc important que le médecin connaisse (enregistre) à la fois le nombre de cigarettes fumées par jour et la durée pendant laquelle le patient fume (les années dites du « paquet de cigarettes »). C'est chez les gros fumeurs que surviennent principalement la bronchite chronique et l'emphysème, variantes graves de la maladie pulmonaire obstructive chronique ; Le tabagisme est directement lié au cancer bronchogénique – l’une des tumeurs malignes les plus courantes chez les hommes et qui apparaît de plus en plus chez les femmes.
, , , , , ,
Examen des voies respiratoires supérieures
L'examen direct du système respiratoire commence souvent par un examen de la poitrine. Une étude préliminaire de l'état des voies respiratoires supérieures doit encore être considérée comme plus correcte, en raison du rôle important que divers changements pathologiques dans les voies respiratoires supérieures peuvent jouer dans le développement de maladies pulmonaires. Il va sans dire qu'un examen détaillé des voies respiratoires supérieures relève de la compétence d'un oto-rhino-laryngologiste. Cependant, un médecin de toute spécialité (et surtout un thérapeute) doit connaître les principaux symptômes des maladies les plus courantes du nez, du pharynx et du larynx et maîtriser les méthodes les plus simples d'examen des voies respiratoires supérieures.
Tout d'abord, ils précisent avec quelle liberté le patient peut respire par le nez. Pour mieux évaluer la respiration nasale, il est demandé au patient de fermer alternativement les voies nasales, en appuyant successivement les ailes gauche et droite du nez contre la cloison nasale. Les difficultés respiratoires nasales sont une plainte fréquente des patients et surviennent, par exemple, en cas de cloison nasale déviée, de rhinite aiguë et chronique et de sinusite.
Déterminer si le patient a sensation de sécheresse au nez , qui peut apparaître au stade initial de la rhinite aiguë ou être observée de manière constante chez les patients atteints de rhinite atrophique chronique. Une plainte courante des patients est l'apparence écoulement nasal . Dans de tels cas, leur quantité est déterminée (écoulement abondant dans la rhinite aiguë, peu abondant, avec formation de croûtes - dans la rhinite atrophique), la nature (écoulement séreux ou muqueux - dans la rhinite catarrhale aiguë, aqueuse - dans la rhinite vasomotrice, épaisse et purulente - dans la sinusite, sanguine) - avec la grippe, etc.), et notez également si la quantité d'écoulement des voies nasales droite et gauche est la même.
La plainte du patient concernant l'apparition de saignements de nez , qui peuvent être associées à des causes locales (traumatismes, tumeurs, lésions ulcéreuses de la muqueuse nasale) ou à certaines maladies générales (par exemple hypertension, diathèse hémorragique, leucémie, carences vitaminiques, etc.). S'il y a des saignements de nez, renseignez-vous sur leur fréquence (occasionnellement ou régulièrement) chez le patient, s'ils sont rares ou abondants. Les saignements de nez peu abondants s'arrêtent le plus souvent d'eux-mêmes. Les saignements de nez abondants (plus de 200 ml par jour) peuvent s'accompagner de symptômes généraux caractéristiques de tout saignement abondant (faiblesse générale, chute de tension, tachycardie), et nécessiter des mesures d'urgence pour les arrêter (tamponnade nasale). Il convient de garder à l'esprit qu'il n'est pas toujours possible de déterminer correctement le volume des saignements de nez, car le sang qui coule le long de la paroi arrière du nasopharynx est souvent avalé par les patients.
Parfois, les patients se plaignent également d'une aggravation odorat(hyposmie) ou son absence totale. Les troubles de l'odorat peuvent être associés à la fois à des difficultés de respiration nasale et à.
En cas d'inflammation des sinus paranasaux (frontaux, maxillaires, etc.), des douleurs peuvent apparaître à la racine du nez, du front, des pommettes, irradiant parfois vers la région temporale.
Complet inspection L'examen des fosses nasales est effectué par un oto-rhino-laryngologiste par rhinoscopie, qui implique l'utilisation de miroirs nasaux spéciaux. Cependant, la partie antérieure de la cavité nasale peut être très bien examinée sans recourir à des techniques spéciales. Pour ce faire, le patient rejette légèrement la tête en arrière, quatre doigts (II-V) de la main droite sont posés sur le front du patient, et avec le pouce de la même main appuie légèrement (de bas en haut) sur le bout de le nez. Ils font également attention à la présence de douleur lors de la palpation et du tapotement au niveau de la racine du nez, de son dos et des lieux de projection des sinus paranasaux frontaux et maxillaires. Des douleurs, ainsi qu'un gonflement des tissus mous et une hyperémie de la peau dans ces zones, peuvent apparaître avec des lésions des os nasaux ou des maladies inflammatoires des sinus paranasaux.
Un examen complet du larynx n'est possible que par laryngoscopie, réalisée par un oto-rhino-laryngologiste. Dans les cas où l'examen du patient est effectué par un médecin d'une autre spécialité, analyser plaintes patient, indiquant une éventuelle maladie du larynx (par exemple, des douleurs en parlant et en avalant, un aboiement caractéristique ou, à l'inverse, une toux silencieuse), révèlent des changements vote(enrouement, aphonie), on note des troubles respiratoires (forts, tendus, avec difficultés respiratoires), qui apparaissent par exemple avec une sténose laryngée.
À inspection le larynx évalue d'éventuels changements de forme (par exemple, dus à une blessure) ; lors de la palpation de la zone du larynx, la présence d'un gonflement ou d'une douleur est déterminée (en cas de blessures traumatiques, de chondropérichondrite, etc.).
Méthodes supplémentaires pour examiner le système respiratoire
Pour clarifier le diagnostic, le degré d'activité du processus pulmonaire (exacerbation, rémission), l'état fonctionnel du système respiratoire, des méthodes d'examen clinique complémentaires, telles que des analyses de sang (y compris des indicateurs immunologiques), des analyses d'urine, mais surtout d'expectorations, broncho-alvéolaires. liquide de lavage, liquide pleural, ainsi que les méthodes radiologiques, qui ont été complétées ces dernières années par des études tomographiques et tomodensitométriques, des méthodes de radiocontraste (bronchographie, angiopulmonographie), des méthodes radionucléides et endoscopiques (bronchoscopie, thoracoscopie, médiastinoscopie), une biopsie par ponction du poumons, ganglions lymphatiques médiastinaux, recherche cytologique spéciale. Une attention particulière est portée à l'étude de la fonction de la respiration externe.
La nécessité d'utiliser des méthodes de recherche supplémentaires est également due au fait que dans un certain nombre d'observations, l'examen général ne révèle pas de changements, notamment au stade précoce de la maladie, qui ne se manifestent pas cliniquement (par exemple, un cancer bronchogénique, un petit infiltrat tuberculeux). Dans ces cas, le diagnostic dépend de la capacité d'appliquer des méthodes supplémentaires.
, , , , ,
Examen des crachats
L’examen macroscopique des crachats a été discuté précédemment. L'examen microscopique des crachats (frottis colorés) peut révéler une prédominance de neutrophiles, associée à une infection bactérienne (pneumonie, bronchectasie, etc.), qui chez certains patients est en outre confirmée par la détection d'une croissance microbienne lors de la culture des crachats, ou d'éosinophiles. , considérée comme caractéristique de l'asthme bronchique et d'autres maladies pulmonaires allergiques. En cas d'asthme bronchique, des spirales de Courshmann (moulages de bronches spastiquement rétrécies contenant du mucus) et des cristaux de Charcot-Leyden (vraisemblablement des restes d'éosinophiles) peuvent être détectés dans les crachats. La présence de globules rouges dans le frottis indique un mélange de sang, signe d'un saignement bronchique ou pulmonaire. Des macrophages alvéolaires peuvent être détectés, indiquant que le matériau provient des voies respiratoires profondes. S'ils contiennent des dérivés de l'hémoglobine (sidérophages, cellules de malformations cardiaques), on peut penser à la présence d'une stagnation du sang dans la circulation pulmonaire (cardiopathie mitrale décompensée, autres causes d'insuffisance cardiaque). La microscopie générale des crachats peut révéler des fibres élastiques - signe de destruction du tissu pulmonaire (abcès et gangrène des poumons, tuberculose), ainsi que des drusen fongiques. La méthode la plus importante pour étudier les crachats est l'identification des bactéries dans les frottis colorés au Gram, qui fournit des informations précieuses sur la cause du processus inflammatoire, en particulier la pneumonie, et permet un traitement étiologique plus ciblé.
Examen du liquide de lavage
Ces dernières années, examen microscopique du liquide obtenu par rinçage (de l'anglais lavage - flush) avec une solution isotonique des parois des bronches sous-segmentaires - liquide de lavage broncho-alvéolaire (BALF), qui est aspiré avec le même bronchofibroscope avec lequel la solution a été instillée, s'est généralisée. La composition cellulaire normale du BALF chez les non-fumeurs pour 100 à 300 ml de liquide est représentée principalement par les macrophages alvéolaires (jusqu'à 90 %), les leucocytes en bande (1 à 2 %), les lymphocytes (7 à 12 %), ainsi que cellules épithéliales bronchiques (1-5%) . Sur la base des modifications de la composition cellulaire du BALF, de l'activité des macrophages alvéolaires et d'un certain nombre d'autres paramètres immunologiques et biochimiques, d'importantes conclusions diagnostiques sont tirées. Par exemple, dans le cas d'une lésion pulmonaire diffuse aussi courante que la sarcoïdose, les lymphocytes prédominent sur les neutrophiles dans le BALF ; la détection des champignons et des pneumocystis permet de diagnostiquer des variantes rares d'infection bronchopulmonaire.
Ponction pleurale
L'étude du liquide obtenu par ponction pleurale a une certaine valeur diagnostique. Son aspect (léger, transparent, trouble, purulent, sanglant, chyleux), son odeur et la densité relative de sa teneur en protéines sont déterminés. En présence d'exsudat (par opposition au transsudat), la densité relative et la teneur en protéines du liquide obtenu sont élevées, respectivement supérieures à 1,015 et 2,5 % ; Actuellement, au lieu du test Rivolta, ils utilisent la détermination du rapport entre la teneur en protéines du liquide pleural et la teneur en protéines du plasma (en présence d'exsudat, il est supérieur à 0,5).
Méthodes de recherche aux rayons X
Les méthodes aux rayons X sont particulièrement importantes dans le diagnostic des maladies respiratoires, car elles confirment les hypothèses diagnostiques apparues lors des étapes précédentes de l'examen, sont fiables lors de l'observation dynamique et aident dans certains cas à clarifier l'étiologie de la maladie avant même d'obtenir les résultats. d'études bactériologiques et cytologiques. L'importance des méthodes radiologiques pour déterminer la localisation des modifications pulmonaires et comprendre l'essence du processus est indéniable. Par exemple, la bronchopneumonie et les infections fongiques peuvent être détectées dans n'importe quelle partie des poumons ; les modifications lobaires et segmentaires sont principalement caractéristiques de la pneumonie, de l'infarctus pulmonaire et de la croissance de tumeurs endobronchiques.
Actuellement, la fluoroscopie est utilisée beaucoup moins fréquemment, car elle implique une dose de rayonnement plus élevée, l'interprétation des changements est largement subjective et l'observation dynamique comparative est difficile, bien que l'utilisation d'un écran de télévision et l'enregistrement vidéo de l'image permettent d'éviter certains aspects négatifs. L'avantage de cette méthode est la possibilité d'étudier les poumons lors de la respiration, notamment les mouvements du diaphragme, l'état des sinus et la position de l'œsophage.