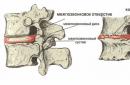Les glandes salivaires produisent par réflexe de la salive.
Ce liquide remplit de nombreuses tâches : il protège la cavité buccale des bactéries pathogènes, assure le maintien d'un environnement buccal optimal, ramollit les aliments et les prépare à la digestion dans d'autres parties du tractus gastro-intestinal.
Normalement, la production de salive est constante, de 1 à 2 litres par jour.
Cependant, la production de salive peut être perturbée par des maladies de la glande salivaire. De quelles maladies s'agit-il, qu'est-ce qui provoque leur apparition et leur développement, comment restaurer la fonctionnalité normale des glandes salivaires ?
- Infection du corps par une infection virale ou bactérienne : grippe, herpès (cytomégalovirus), infection par le VIH, virus Coxsackie, virus Epstein-Barr, paramyxovirus (l'agent causal des oreillons), typhoïde, pneumonie, infections touchant le cerveau, etc.
- La perméabilité des canaux salivaires est altérée en raison d'une blessure, d'une obstruction sous forme de corps étranger ou de la formation de calculs dans les canaux.
- Soins hygiéniques insuffisants de la cavité buccale. Des dents qui ne sont pas traitées à temps et un brossage irrégulier rendent les glandes salivaires vulnérables aux infections.
- Complication après la chirurgie.
- Intoxication aux sels de métaux lourds.
- Déshydratation.
- Régimes amaigrissants déficients en substances nécessaires à l'organisme.
L'infection des glandes salivaires peut pénétrer par le sang, la lymphe ou les canaux salivaires.
Classification des maladies des glandes salivaires
- Sialolithiase. Un corps étranger pénétrant dans le conduit ou un bouchon naturel qui s'y forme provoque un gonflement de la glande salivaire. Un calcul qui a bloqué le conduit empêche le mucus de pénétrer dans la cavité buccale, le faisant ainsi retourner dans la glande. Dans le même temps, la personne ressent une douleur lancinante, la zone où se trouve la glande gonfle. Si le traitement n'est pas démarré rapidement, une infection purulente peut se développer.
- Sialadénite. Inflammation de la glande. La raison en est que des virus ou des bactéries y pénètrent, par exemple une infection à staphylocoque. Les facteurs de risque sont la déshydratation, une mauvaise alimentation. Habituellement, les glandes situées près des oreilles sont touchées et commencent à enfler. Le patient ressent une douleur dans la zone où se trouve la glande enflammée, y compris dans l'oreille. Le pus est libéré dans la bouche. Le plus souvent, les patients diagnostiqués avec une sialadénite sont des adultes, surtout s'ils souffrent d'une maladie active des calculs salivaires. Plus rarement, l'infection est diagnostiquée chez les nouveau-nés. Si le processus purulent n'est pas arrêté à temps, un abcès se produit. Une fois percée, elle peut provoquer une septicémie et une fistule. Signes d'abcès : forte fièvre, faiblesse, manque d'appétit. La maladie peut également se propager à d’autres glandes (pancréas, mammaires ou gonades…). La voie de transmission de la sialadénite est le contact domestique.
- Kyste. En raison de dommages mécaniques aux glandes et de l'entrée de micro-organismes pathogènes dans celles-ci, un kyste peut survenir en raison d'une sialolithiase. Cette pathologie peut aussi être congénitale. Une glande présentant un kyste est douloureuse à la palpation et provoque une gêne lors des repas et de la communication.
- Tumeur. Tumeurs bénignes : adénome pléomorphe (se développe généralement sans symptômes près des oreilles chez les femmes plus âgées), cystadénolymphome (la tumeur se développe généralement symétriquement près des oreilles, plus souvent diagnostiquée chez les hommes que chez les femmes). Les tumeurs malignes comprennent l'adénocarcinome et le cylindrome. L'adénome pléomorphe peut également devenir une tumeur maligne.
- Syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire. En raison de la maladie auto-immune de Gougerot-Sjögren, les glandes salivaires sont affectées symétriquement dans 50 pour cent des cas. Leur augmentation se produit sans douleur, mais le patient souffre de bouche sèche.
Il est utilisé pour le diagnostic précoce des tumeurs et de l'inflammation des glandes salivaires - la méthode n'a aucune contre-indication et est également absolument indolore.
Parlons des fonctions de l'hormone mélatonine.Préparations contenant l'hormone.
La maladie de Basedow est une pathologie dangereuse de la glande thyroïde. les symptômes, les causes et les manifestations visuelles de la maladie sont décrits.
Classification de la sialadénite
Pour la cause de la maladie :

- viral;
- bactérien.
Par emplacement:
- les oreillons (inflammation de la glande salivaire près de l'oreille) ;
- sous-mandibulite (inflammation de la glande salivaire sous la mâchoire) ;
- sublinguitite (inflammation de la glande sous la langue).
Selon les caractéristiques du processus inflammatoire :
- séreux(la salivation diminue, la zone de l'oreille devient douloureuse et gonfle, soulevant le lobe de l'oreille, des douleurs surviennent lors de la salivation, il y a une légère augmentation de la température corporelle, si vous appuyez sur la glande, il n'y a pas de salivation ou une salivation insignifiante) ;
- purulent(douleur intense, le sommeil est perturbé, la température corporelle monte au dessus de 38°C, le visage gonfle : joues, zone des tempes, mâchoire inférieure, hyperémie cutanée au niveau de l'inflammation, si vous appuyez sur la glande, du pus sera libéré dans la bouche, la pression est douloureuse) ;
- purulent-nécrotique (gangreneux) se produisent avec une forte augmentation de la température corporelle, la zone de peau située au-dessus de la glande salivaire est détruite et du pus est libéré à travers elle ainsi que les cellules mortes de la glande.
Selon la forme de la maladie :
- sialadénite aiguë;
- chronique (sialadénite interstitielle ; sialadénite parenchymateuse ; sialodochite, c'est-à-dire lésions des canaux salivaires, c'est pourquoi les personnes âgées présentent une salivation accrue, et pendant les périodes d'exacerbation de la maladie - une augmentation de la taille des glandes, la libération de pus dans le cavité buccale).
Symptômes
Désignons les symptômes de la maladie la plus courante des glandes salivaires – la sialadénite :

- faible salivation, bouche sèche ;
- douleur lancinante dans la zone de la glande enflammée;
- la douleur pénètre dans l'oreille, se fait sentir dans le cou, dans la cavité buccale ;
- ça fait mal de mâcher;
- douleur en ouvrant la bouche;
- gonflement de la peau dans la zone d'inflammation;
- hyperémie de la peau là où se trouve la glande salivaire affectée en dessous ;
- goût purulent dans la bouche;
- Dans la zone d'inflammation, une pression peut être ressentie en raison de l'accumulation de pus.
Diagnostique
Le diagnostic des maladies des glandes salivaires est effectué par un thérapeute ou un dentiste.
Dans le cas d’une pathologie, lors de l’examen, on découvre que les glandes salivaires sont plus grandes qu’elles ne devraient l’être normalement.
Si le patient se plaint que la zone où se trouvent les glandes est douloureuse et qu'il y ressent une pression, un diagnostic de sialadénite sera très probablement posé.
Une méthode de diagnostic telle que la sialographie (l'iodolipol est injecté dans les glandes salivaires, après quoi elles sont examinées aux rayons X) est contre-indiquée en cas de sialadénite aiguë, car elle peut aggraver la situation.
Dans la forme chronique de la maladie, la sialographie est sûre et efficace.
Lorsque le médecin soupçonne un abcès, une tomodensitométrie ou une échographie est prescrite.
Traitement
La méthode de traitement est choisie en fonction du degré de développement de la maladie et des causes de son apparition.
Dans les cas graves de sialadénite, un traitement du patient à l'hôpital est nécessaire. Parmi les indications d'hospitalisation figure une température élevée qui ne peut être abaissée par rien.
Si l'inflammation des glandes salivaires a provoqué une maladie infectieuse ou virale de la bouche, du pharynx, du nez ou des oreilles, il est d'abord nécessaire d'éliminer les processus pathologiques qui s'y trouvent. Lorsque l'agent causal de la maladie est vaincu, la sialadénite disparaît rapidement si aucune complication ne se développe au cours de la maladie.
Nous listons les principales méthodes de traitement des maladies inflammatoires des glandes salivaires :

- Lampe Sollux;
- Thérapie UHF ;
- compresses chaudes avec de l'alcool ou du sel;
- irrigation du nasopharynx avec de la chlorhexidine ;
- se rincer la bouche avec des solutions contenant des antiseptiques (furaciline, eucalyptus, etc.) ;
- compresses analgésiques et anti-inflammatoires au Dimexide ;
- prendre des antibiotiques ou des injections avec eux ;
- agents antifongiques si la maladie est causée par des champignons ;
- médicaments antiviraux;
- les antihistaminiques ;
- injections de sulfamides, médicaments hyposensibilisants ;
- streptomycine, 0,5 pour cent de procaïne, benzylpénicilline (injectée dans le canal salivaire) ;
- remèdes populaires pour le rinçage : décoction de menthe (aide à accélérer la salivation, rafraîchit la cavité buccale, apaise la douleur) ; décoction de camomille (réduit l'inflammation, l'enflure) ; acide citrique (accélère la production de salive); décoction de feuilles de framboisier (soulage l'inflammation, cicatrise les plaies) ; eau avec du soda (désinfecte, réduit l'inflammation et l'enflure);
- une intervention chirurgicale pour drainer la glande salivaire afin d'éliminer l'exsudat et le pus ;
- ablation chirurgicale de la glande salivaire lorsqu'elle fond de manière purulente.
 Si la température corporelle du patient est élevée, il doit rester au lit.
Si la température corporelle du patient est élevée, il doit rester au lit.
La pièce où il se trouve doit être nettoyée à l'eau deux fois par jour.
Le patient doit refuser les aliments susceptibles de blesser la zone d'inflammation.
La nourriture doit être sous forme de purée ou de liquide.
Pour accélérer la récupération, il est recommandé de manger des aliments qui augmentent la salivation (fruits aigres, bouillons de viande, etc.). Grâce à eux, les toxines seront éliminées plus rapidement des zones enflammées. Pendant le traitement, la température des aliments et des boissons consommés doit être d'environ 40 à 45 °C.
Si la sialadénite n'est pas traitée, elle peut entraîner un blocage du canal salivaire ou sa déformation, une nécrose de la glande salivaire, provoquer une septicémie, une fonte des gros vaisseaux du cou et la mort.
Vidéo sur le sujet
Classification des maladies inflammatoires des glandes salivaires
Inflammation aiguë des glandes salivaires.
a) sialadénite d'étiologie virale : oreillons, sialadénite grippale
b) sialadénite causée par des causes générales ou locales (après une chirurgie abdominale, parotidite infectieuse, lymphogène, propagation du processus inflammatoire à partir de la cavité buccale, etc.).
Inflammation chronique des glandes salivaires.
a) non spécifique : sialadénite interstitielle, sialadénite parenchymateuse, sialodochite
b) spécifique : actinomycose, tuberculose, syphilis des glandes salivaires
c) maladie des calculs salivaires.
Il existe plusieurs voies possibles d'infection des glandes salivaires : stomatogène, hématogène, lymphogène et par extension.
Sialadénite aiguë causée par des causes générales et locales
Sialadénite aiguë se produit souvent en raison de divers facteurs défavorables généraux et locaux. Parmi les premiers, les infections passées (grippe, rougeole, scarlatine, varicelle), les troubles de la salivation, la déshydratation, l'état général sévère, l'état postopératoire et les troubles neurovégétatifs sont importants. Les causes locales pouvant contribuer au développement de la maladie comprennent des traumatismes, la présence de gingivite, des poches pathologiques des gencives, de la plaque dentaire, diverses modifications de la zone glandulaire qui perturbent la salivation (entrée de corps étrangers dans le canal, inflammation des ganglions lymphatiques entourant la glande), et une infection lymphogène de la glande est également possible.à proximité de foyers infectieux chroniques sous-jacents. État général des patients atteints de sialadénite modérée. Les oreillons sont plus graves. Le sommeil et l'alimentation sont perturbés, des douleurs apparaissent, qui s'intensifient en mangeant. On note une bouche sèche et la température augmente.
L'inflammation aiguë de la glande salivaire parotide survient plus souvent que d'autres. Un gonflement apparaît dans la zone parotide-mastique, qui se développe rapidement et se propage aux zones voisines. Le lobe de l'oreille dépasse. La peau au-dessus de la glande devient tendue. Un infiltrat inflammatoire dense se forme au niveau de la glande, très douloureux à la palpation. L'infiltrat augmente progressivement en taille et peut s'étendre autour du lobe de l'oreille et en arrière de l'apophyse mastoïde. Le pôle inférieur de l'infiltrat est déterminé au niveau du bord inférieur de la mâchoire inférieure. L'infiltrat inflammatoire reste longtemps dense. Si l'évolution des oreillons est défavorable, une fonte purulente de la glande peut survenir dans certaines zones. Dans ces cas, un ramollissement apparaît, des fluctuations sont déterminées et des symptômes de formation d'abcès apparaissent. Il peut être difficile d'ouvrir la bouche. L'embouchure du canal parotide (Stenon) est dilatée et entourée d'un bord d'hyperémie. La salive n'est pas libérée ou est libérée lors d'un massage intensif de la glande en petites quantités. Sa couleur est trouble, sa consistance est épaisse et visqueuse. Parfois, du pus, des flocons blanchâtres, sont libérés.
En cas d'inflammation aiguë de la glande salivaire sous-maxillaire, un gonflement se produit dans la région sous-maxillaire. Les changements cutanés sont moins prononcés. La glande grossit et est palpée comme une formation dense et douloureuse. L'embouchure du canal sous-maxillaire (canal de Wharton) est dilatée et hyperémique. La salivation est altérée. Lorsque vous massez la glande, une salive trouble est libérée, parfois accompagnée de pus.
Traitement dépend de l’étape du processus. En cas d'inflammation séreuse, les mesures thérapeutiques doivent viser à stopper les phénomènes inflammatoires et à restaurer la salivation. Pour augmenter la salivation, un régime alimentaire approprié est prescrit, 3 à 4 gouttes d'une solution à 1% de chlorhydrate de pilocarpine par voie orale 2 à 3 fois par jour (pas plus de 10 jours consécutifs). Le canal excréteur de la glande salivaire est bougiené, des solutions antiseptiques et des enzymes sont injectées à travers le canal, des compresses de dimexide sont prescrites sur la zone de la glande enflammée et une physiothérapie (UHF, fluctuarisation). Un traitement anti-inflammatoire, antibactérien et désensibilisant est administré. En cas de formation d'abcès – traitement chirurgical.
Les oreillons des nouveau-nés. La maladie survient rarement. Les enfants faibles y sont sensibles. Le développement de la maladie est facilité par la mammite chez une mère qui allaite. Les symptômes cliniques sont typiques des oreillons. Un gonflement de la zone parotide-masticatrice apparaît d'un ou des deux côtés, l'enfant est capricieux, dort mal et tète mal, et la température augmente. La zone glandulaire est compactée et douloureuse à la palpation. L'embouchure du canal excréteur est élargie. Des fluctuations et des écoulements purulents des canaux dilatés peuvent apparaître assez rapidement.
Sialadénite aiguë d'étiologie virale
Oreillons (oreillons) – une maladie infectieuse, parfois compliquée de suppuration. Généralement, seules les glandes parotides sont touchées. L'agent causal des oreillons est un virus filtrable.
Les oreillons touchent principalement les enfants, mais parfois aussi les adultes. Les poussées épidémiques sont limitées et deviennent plus fréquentes par temps froid (janvier - mars). Les sources du virus sont des patients qui restent contagieux jusqu'à 14 jours après la disparition des symptômes cliniques. La période d'incubation dure en moyenne 16 jours, suivie d'une courte étape prodromique, au cours de laquelle survient toujours une stomatite catarrhale.
Clinique. Au début de la maladie, un gonflement d'une glande parotide se produit ; Souvent, la deuxième glande gonfle bientôt. La température corporelle s'élève à 37-39º C, rarement plus. Les enfants souffrent de vomissements, de contractions convulsives et parfois de phénomènes méningés. Il y a des douleurs lancinantes dans la région parotide, des acouphènes et des douleurs lors de la mastication. À l'examen, le gonflement au niveau de la glande parotide est situé en forme de fer à cheval autour du lobe inférieur de l'oreillette, le lobe de l'oreille fait saillie. La peau est d'abord inchangée, puis devient tendue et brillante. Le gonflement des glandes s'accompagne d'un arrêt de la salivation, et parfois d'une salivation abondante. Trois points douloureux peuvent être notés à la palpation : devant le tragus de l'oreille, au sommet de l'apophyse mastoïde, au-dessus de l'échancrure de la mandibule. La durée de la période fébrile est de 4 à 7 jours. Le gonflement disparaît progressivement en 2 à 4 semaines. Dans le sang, il y a une leucopénie, parfois une leucocytose, la VS est augmentée.
Complications. La complication la plus fréquente chez les garçons est l’orchite (inflammation du testicule), qui se développe quelques jours après l’apparition des oreillons. L'orchite se manifeste par une douleur intense et une température élevée, atteignant 40 ºC. L'évolution est généralement favorable ; dans de rares cas, une atrophie testiculaire survient.
Parfois, une suppuration de la glande salivaire est observée, plusieurs foyers purulents se forment. Une fois les ulcères vidés, les oreillons s'inversent. Parfois, des fistules salivaires subsistent. Dans des cas isolés, les oreillons se terminent par une nécrose de la glande salivaire. Il y a également eu des cas de lésions des nerfs périphériques (visage, oreille).
La prévention consiste à isoler les patients pendant toute la durée de la maladie et pendant 14 jours après la disparition de toutes les manifestations cliniques.
Traitement. Alitement, alimentation liquide, soins bucco-dentaires, en l'absence de suppuration, compresses sur la zone glandulaire. Dans les cas prolongés, l'utilisation d'antibiotiques est indiquée pour prévenir les complications. En cas de suppuration - ouverture d'abcès.
Sialadénite grippale. Chez certains patients grippés, sur fond de malaise général et de fièvre, un gonflement apparaît soudainement au niveau des glandes salivaires. Le gonflement augmente rapidement et un infiltrat de densité ligneuse est palpé au niveau des glandes touchées. Les embouchures des canaux des glandes salivaires sont hyperémiques. Il n’y a pas de salivation provenant des glandes affectées. Chez certains patients, la glande affectée forme rapidement un abcès et fond, et du pus est libéré du canal. Les infiltrats au niveau des glandes chez ces patients se résolvent très lentement.
Dans les premiers jours de la maladie, l'utilisation de l'interféron a un effet encourageant. De plus, le même traitement est effectué que pour la sialadénite aiguë provoquée par des causes générales ou locales.
Sialadénite chronique
La maladie est le plus souvent une conséquence d'une sialadénite aiguë. Apparemment, la transition vers une forme chronique d'inflammation est facilitée par un contexte prémorbide défavorable, un traitement irrationnel et insuffisamment intensif pendant la période aiguë de la maladie et une diminution persistante de la résistance immunitaire de l'organisme. Des formes chroniques primaires de la maladie sont également observées.
En fonction du type de lésion tissulaire, la sialadénite est divisée en parenchymateuse et interstitielle.
Parenchymateux sont plus sévères, caractérisés par des exacerbations soudaines, une perturbation de l'état général, une douleur intense et un durcissement de la glande, un écoulement purulent du canal.
Interstitiel la sialadénite est moins fréquente et se caractérise par une évolution plus calme et lente avec des périodes d'exacerbation qui augmentent lentement. Ils ne donnent pas l’image d’une inflammation aiguë. La glande est hypertrophiée, mais légèrement compactée, la nature de la sécrétion change peu. Au début, la sécrétion de salive du canal est réduite et ce n'est que dans les stades ultérieurs qu'elle augmente, la salive devient trouble ou purulente.
La sialadénite peut survenir avec des lésions primaires des conduits - sialodochite . Les manifestations cliniques de cette forme de la maladie ne présentent pas de caractéristiques distinctes clairement définies de la sialadénite et le diagnostic est clarifié après sialographie.
L'exacerbation de la sialadénite chronique se caractérise par tous les signes d'une parotidite aiguë. Les rechutes de la maladie peuvent survenir plusieurs fois par an jusqu'à une fois tous les 1 à 2 ans. Pendant la période de rémission, un gonflement modéré de la glande peut persister. La consistance de la glande est densément élastique, les limites sont claires, la surface est grumeleuse.
La nature des dommages causés aux glandes lors d'une inflammation chronique est clairement visible dans une étude sialographique. Le sialogramme est réalisé dans les surfaces droites et latérales. Le sialogramme avec sialadénite parenchymateuse révèle de petites cavités rondes remplies d'un produit de contraste, les canaux excréteurs se dilatent avec le temps. Les ombres des conduits terminaux deviennent intermittentes. La sialadénite interstitielle se caractérise par un rétrécissement du réseau de canaux glandulaires, sans présence de discontinuité. L'ombre du parenchyme est mal détectée et n'est pas déterminée aux stades ultérieurs. Le sialogramme de la sialodochite chronique montre une expansion inégale des canaux glandulaires aux contours clairs, le parenchyme de la glande reste inchangé. À un stade avancé, les contours des conduits deviennent inégaux, les zones dilatées du conduit alternent avec des zones de rétrécissement.
Traitement une thérapie symptomatique et réparatrice est effectuée. Pendant la période d'exacerbation, les mêmes méthodes de traitement sont utilisées que pour la sialadénite aiguë.
Maladie des calculs salivaires
La maladie des calculs salivaires (sialolithiase, sialadénite calculeuse) se caractérise par la formation de calculs dans les canaux ou le parenchyme des glandes salivaires. La maladie survient aussi souvent chez les hommes que chez les femmes de tous âges. La maladie survient rarement pendant l'enfance. On l'observe plus souvent pendant la puberté.
Parmi l'ensemble des diverses raisons contribuant au développement de la maladie, les principales sont les troubles métaboliques, les carences en vitamines et les modifications des propriétés physico-chimiques de la salive. Une condition nécessaire à la formation d'une pierre est la présence d'un noyau étranger. Ce noyau peut devenir ce qu'on appelle un thrombus salivaire (une accumulation de cellules épithéliales exfoliantes et de leucocytes collés ensemble avec de la fibrine). Dans certains cas, des calculs se forment autour des corps étrangers pénétrant dans le conduit depuis l’extérieur. Les facteurs prédisposant à la formation de calculs sont les blessures et l'inflammation des conduits et des glandes salivaires. Des calculs se forment dans les conduits de la glande, interférant avec le flux de salive. La rétention de salive provoque une expansion du flux. Les conditions sont créées pour l'apparition d'une inflammation secondaire dans la glande et le canal.
Clinique. La maladie se manifeste d'abord par un gonflement de la zone de la glande salivaire affectée et une douleur, qui s'intensifie clairement en mangeant ou juste avant de manger. Le gonflement peut disparaître et se reformer, ce qui est associé à une rétention temporaire de salive. À mesure que la taille de la pierre augmente, elle peut bloquer complètement le conduit, ce qui se manifeste par une douleur intense et éclatante.
Les rayons X et les ultrasons sont utilisés pour établir un diagnostic final. Les calculs salivaires radio-opaques apparaissent bien sur les radiographies.
Traitement. Les petits calculs peuvent être expulsés spontanément. Les méthodes chirurgicales d'élimination des calculs sont plus souvent utilisées. Si le calcul est situé dans le conduit de la glande, le conduit est disséqué, le calcul est retiré et le conduit est drainé. En cas de sialadénite sous-maxillaire calculeuse chronique, la glande salivaire sous-maxillaire est retirée.
Les maladies inflammatoires des glandes salivaires sont appelées sialadénite. La sialadénite survient au cours du parcours
chronique.
Étiologie et pathogenèse.
La sialadénite aiguë est causée par
virus (virus filtrable des oreillons - « oreillons » : virus de la grippe, de l'herpès)
flore bactérienne (streptocoques, staphylocoques, E. coli, etc.).
La propagation d'agents pathogènes peut se produire
de manière hématogène,
lymphogène,
par contact avec les phlegmons des zones parotide-masticatrice, sous-maxillaire et sublinguale),
montant à travers le conduit. Un processus inflammatoire aigu dans la glande salivaire peut se développer lorsqu'un corps étranger pénètre dans le canal excréteur.
La sialadénite bactérienne (généralement les oreillons) se développe généralement de manière postopératoire et post-infectieuse (avec toute maladie grave, le plus souvent avec le typhus)
Classification.
La sialadénite aiguë est classée :
JE. Par étiologie :
Viral
Non spécifique (bactérien)
II. Par localisation :
Oreillons (glande parotide)
Sous-mandibulaire (sous-maxillaire)
Sublingual (sublingual)
III. Selon la nature du processus inflammatoire :
Séreux (viral)
Purulent (bactérien)
Purulent-nécrotique (bactérien)
Clinique
Les principaux signes cliniques de la sialadénite aiguë :
Douleur dans la région des glandes
Une augmentation de la taille de la glande salivaire et, par conséquent, un gonflement dans la zone correspondante, une asymétrie faciale
Hyperémie et tension de la peau sur la glande (avec sialadénite purulente)
Diminution de la salivation
Séparation de l'exsudat du canal (séreux pour les lésions virales et purulent pour les lésions bactériennes)
Détérioration de l'état général
Diagnostic différentiel.
Le diagnostic différentiel des sialadénites virales et bactériennes est important.
Traitement.
1) Thérapie étiotrope :
Antibiotiques, sulfamides pour la sialadénite bactérienne (introduction dans le canal excréteur, utilisation orale et intramusculaire au fur et à mesure de l'avancement du processus)
Interféron, ribonucléase pour la sialadénite virale (rince-bouche, injection dans le conduit, instillation dans le nez)
2) Augmentation de la salivation : chlorhydrate de pilocarpine 5 à 6 gouttes 3 à 4 fois par jour, aliments qui augmentent la salivation (acides)
3) Pour les inflammations séreuses, coussins chauffants, UHF, compresses d'huile
4) Compresse avec une solution de dimexide à 30 % pendant 20 à 30 minutes une fois par jour
5) Anti-inflammatoires non stéroïdiens, thérapie désensibilisante, thérapie vitaminique
6) Bougienage du canal des glandes salivaires pour améliorer l'écoulement de la salive et
exsudat
7) Lors d'un processus purulent-nécrotique, la capsule glandulaire est ouverte
Les syndromes cliniques les plus importants avec atteinte des glandes salivaires sont la xérostomie et la sialorrhée.
Xérostomie(bouche sèche, « syndrome sec ») est provoquée par une diminution ou un arrêt de la sécrétion des glandes salivaires. Le résultat est une tendance à développer des caries, des parodontites, des stomatites, des glossites et une atrophie de la muqueuse buccale.
Sialorrhée(ptyalisme, hypersalivation) se caractérise par une sécrétion accrue de salive, se développe lors de processus inflammatoires aigus de la muqueuse buccale, de poussées dentaires, de prothèses mal ajustées, de grossesse, ainsi que de retard mental, de formes sévères de schizophrénie, d'épilepsie, etc.
Les maladies des glandes salivaires peuvent être indépendantes (lithiase salivaire, tumeurs) ou être des manifestations et complications de maladies systémiques (sialadénite tuberculeuse, infection à cytomégalovirus, etc.).
Classification Les maladies des glandes salivaires comprennent les infections, les blessures traumatiques, les lésions et les tumeurs obstructives, auto-immunes et ressemblant à des tumeurs.
Infections des glandes salivaires (sialodénite) divisé en bactérien et viral, aigu et chronique. La sialadénite peut être une maladie indépendante (primaire), mais le plus souvent il s'agit d'une complication ou d'une manifestation d'une autre maladie (secondaire). Voies de pénétration de l'infection dans les glandes salivaires : stomatogènes par les canaux (intracanaliculaires ascendants), lymphogènes, hématogènes. Les glandes parotides sont le plus souvent touchées, moins souvent les glandes sous-maxillaires et très rarement les glandes sublinguales.
Les bactéries comprennent la sialadénite aiguë purulente, chronique et spécifique.
Sialadénite purulente aiguë. La glande parotide est le plus souvent atteinte (parotidite purulente aiguë). La cause est généralement Staphylococcus aureus et les streptocoques du groupe A, qui pénètrent dans la glande salivaire par son canal excréteur. Ceci est facilité par une diminution de la salivation ou son arrêt, qui peut être due à un déséquilibre de l'équilibre hydrique dû à une température corporelle élevée, à la prise de diurétiques, au jeûne, etc., observé après des opérations sur les organes abdominaux (Fig. 81).
Riz. 81. Sialadénite purulente aiguë. Accumulations massives et diffuses de leucocytes neutrophiles avec foyers d'histolyse, colonies basophiles de bactéries, hyperémie inflammatoire. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 100.
Sialadénite chronique se développe le plus souvent dans la glande sous-maxillaire. Les raisons en sont l'obstruction (blocage) des canaux excréteurs des glandes salivaires par des calculs en cas de maladie des calculs salivaires ou une sténose des canaux. Cela conduit à une sensibilité accrue des glandes à une infection bactérienne rétrograde par le canal excréteur. Avec l'exacerbation, une inflammation purulente de la glande se développe.
Complications et résultats. La sialadénite purulente peut se compliquer de phlegmon ou d'abcès des tissus mous environnants avec développement de fistules s'ouvrant vers l'extérieur ou dans la cavité buccale. À la suite de la maladie, une sclérose ou une cirrhose de la glande, exprimée à des degrés divers, se développe. Cette dernière ressemble cliniquement à une tumeur (« tumeur de Küttner »).
Sialadénite spécifique peut être actinomycotique, tuberculeuse, syphilitique.
La sialadénite virale est causée par Virus Coxsackie A et B, virus ECHO, virus Epstein-Barr, virus de la grippe, parainfluenza, etc. Les plus importants sont le virus des oreillons, responsable des oreillons (voir chapitre Infections de l'enfant) et le cytomégalovirus (Fig. 82).

Riz. 82. Oreillons à cytomégalovirus. Infiltration lymphomacrophage du stroma et du parenchyme de la glande salivaire, modifications dystrophiques des cellules parenchymateuses. Les cellules épithéliales individuelles des conduits et des acini parenchymateux sont de taille significativement augmentée, certaines avec de grandes inclusions nucléaires violettes et des inclusions cytoplasmiques basophiles plus petites. Autour des inclusions intranucléaires se trouve un bord de dégagement du cytoplasme, qui donne à la cellule l'apparence d'un « œil de hibou » ou d'un « œil d'oiseau » (cellules de cytomégalovirus). Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 600.
Dommages aux glandes salivaires par les rayonnements ionisants(fait référence à ses dommages traumatiques et iatrogènes) est observé lors de la radiothérapie des néoplasmes malins de la région de la tête et du cou. Les acini séreux de la glande parotide sont particulièrement sensibles aux radiations. Dans ce cas, une réaction inflammatoire aiguë se développe d'abord dans les glandes touchées, ce qui conduit ensuite à une sialadénite sclérosante chronique.
Lésions obstructives survenir en raison du blocage des canaux excréteurs de la glande salivaire par des calculs, d'une compression par une tumeur, d'une cicatrice ou d'un infiltrat inflammatoire, d'une ligature, d'une flexion. Il existe trois maladies principales causées par une obstruction : la maladie des calculs salivaires (sialolithiase), la mucocèle et le kyste de rétention.
Maladie des calculs salivaires (sialolithiase)– une maladie chronique de la glande salivaire, caractérisée par la formation de calculs salivaires dans ses conduits. Dans la plupart des cas, la glande sous-maxillaire est touchée. Les calculs peuvent être simples ou multiples et sont constitués de sels de calcium, principalement de phosphates, la matrice est constituée de cellules épithéliales desquamées et de mucine. Trois facteurs sont importants dans leur pathogenèse : la stagnation des sécrétions due à une dyskinésie ou à une obstruction des canaux, un déplacement du pH de la salive vers le côté alcalin (jusqu'à 7,1-7,4) et une augmentation de sa viscosité, une infection du canal excréteur ou du glande elle-même. Avec la sialolithiase, une sialodochite (inflammation du canal) et une sialodénite chronique se développent souvent (Fig. 83).

Riz. 83. Sialadénite chronique de la glande salivaire parotide avec maladie des calculs salivaires (sialolithiase). La glande salivaire est agrandie, sa surface est grumeleuse, la glande n'est pas fusionnée avec les tissus environnants et a une consistance élastique dense. Dans la membrane muqueuse dilatée et enflammée, le canal de la glande salivaire contient de petits calculs et de la salive contenant du pus.
L'atrophie du parenchyme de la glande affectée progresse avec la prolifération du tissu conjonctif, souvent avec une métaplasie squameuse ou oncocytaire de l'épithélium canalaire, ainsi que le développement de kystes (Fig. 84).

Riz. 84. Sialodénite chronique de la glande salivaire parotide dans la maladie des calculs salivaires (sialolithiase). Infiltration inflammatoire chronique du stroma, sclérose péricanalaire, adénosclérose, atrophie et lipomatose des lobules parenchymateux, métaplasie de l'épithélium des complexes acineux en épidermoïde stratifié. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 100
Les patients atteints de calculs salivaires se plaignent d'un gonflement de la glande, de douleurs paroxystiques pendant les repas (coliques salivaires associées à un écoulement altéré de la salive). L'évolution à long terme de la sialolithiase entraîne une diminution puis un arrêt de la fonction de la glande affectée.
Mucocèle (kyste muqueux)- la maladie la plus courante des lésions obstructives des glandes salivaires est un kyste contenant du mucus, mesurant généralement jusqu'à 1 cm de diamètre, et est une conséquence d'une lésion traumatique des canaux des glandes salivaires mineures (Fig. 85). Les grandes mucocèles du plancher buccal sont appelées ranulae.

Riz. 85. Mucocèle (kyste muqueux). Kyste mineur des glandes salivaires rempli de mucus éosinophile. La paroi du kyste est tapissée de tissu de granulation. Parmi le tissu de granulation et le mucus de la cavité du kyste se trouvent des macrophages contenant du mucus avec un cytoplasme vacuolé. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 100.
Kystes de rétention sont moins fréquentes que les mucocèles. Ils se développent à la suite d'une dilatation kystique du canal des glandes salivaires due à son obstruction par des calculs salivaires, une compression externe ou une flexion (Fig. 86).
Maladies auto-immunes des glandes salivaires sont représentés par le syndrome de Sjögren, caractérisé par une triade de kératoconjonctivite sèche, de xérostomie et de toute maladie de nature auto-immune (polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie, LED, etc.), et la maladie de Sjögren avec lésions isolées des glandes salivaires, dans lesquelles des anticorps à l'épithélium de leurs conduits sont détectés (voir chapitre maladies rhumatismales).
À lésions ressemblant à des tumeurs des glandes salivaires comprennent la sialadénose (sialose), l'oncocytose, la sialométaplasie nécrosante, les lésions lymphoépithéliales bénignes (maladie de Mikulicz) et les kystes lymphoépithéliaux des glandes salivaires parotides, accompagnant l'infection par le VIH.
Sialadénose (sialose)– une hypertrophie bilatérale récurrente des glandes salivaires parotides, parfois sous-maxillaires, de nature non inflammatoire et non tumorale. Cette lésion est associée à des troubles hormonaux. Caractérisé par une hypertrophie des cellules acineuses séreuses, un œdème interstitiel et une atrophie des canaux striés. En conséquence, une lipomatose des glandes salivaires et une xérostomie se développent.
Oncocytose– transformation oncocytaire d’une partie ou de la totalité des cellules des lobules et des canaux de la glande salivaire (généralement la glande parotide).
Sialométaplasie nécrosante– une maladie d'étiologie inconnue, caractérisée par une combinaison de nécrose acineuse et de métaplasie squameuse de l'épithélium des canaux, principalement des glandes salivaires mineures. Régresse spontanément en 6 à 10 semaines.
Lésion lymphoépithéliale bénigne (maladie de Mikulicz) caractérisé par un infiltrat de cellules lymphoïdes remplaçant le parenchyme glandulaire des lobules des glandes salivaires, une prolifération de cellules épithéliales et myoépithéliales des canaux avec formation d'îlots épithélio-myoépithéliaux remplaçant les canaux intralobulaires. On l'observe notamment dans le syndrome de Gougerot-Sjögren. Il existe un risque élevé de développer un lymphome non hodgkinien ou un cancer.
Kystes lymphoépithéliaux des glandes parotides associés à l'infection par le VIH bordée d'épithélium pavimenteux stratifié et contient des masses cornées. Ils sont considérés comme une manifestation d'adénopathie généralisée persistante (lésions des ganglions lymphatiques intra-organiques).
Des kystes lymphoépithéliaux se trouvent également dans les glandes salivaires parotides, qui n'accompagnent pas l'infection par le VIH.
Tumeurs des glandes salivaires représentent 1,5 à 4 % des néoplasmes humains. 64 à 80 % des tumeurs épithéliales sont localisées dans la glande parotide, 7 à 11 % dans la glande sous-maxillaire, moins de 1 % dans la glande sublinguale, 9 à 23 % dans les glandes salivaires mineures. L'incidence maximale se produit dans les 6e-7e décennies, mais le plus grand nombre d'adénomes pléomorphes, de carcinomes mucoépidermoïdes et à cellules aciniques est détecté dans les 3e-4e décennies.
Dans la classification histologique internationale moderne des tumeurs des glandes salivaires, plus de 20 formes nosologiques de leurs tumeurs bénignes et malignes ont été identifiées.
Tumeurs bénignes des glandes salivaires sont de 54 à 79 %. La plus courante est l'adénome pléomorphe (50 % de toutes les tumeurs).
Adénome pléomorphe survient le plus souvent dans la glande parotide, survient à tout âge, mais principalement entre 50 et 60 ans, se développe lentement et constitue une formation indolore qui peut devenir très volumineuse si elle n'est pas traitée. La tumeur a généralement la forme d'un nœud d'un diamètre de 1 à 6 à 10 cm, entouré dans la plupart des cas d'une capsule fibreuse d'épaisseur variable, bien qu'elle puisse se développer de manière multicentrique (avec des nœuds satellites). La surface des nœuds est souvent lisse, moins souvent grumeleuse. En coupe, le tissu tumoral est de couleur jaune blanchâtre ou gris, avec des kystes et des foyers d'hémorragie ; il est souvent difficile à couper en raison de la présence de zones de tissu semblable à du cartilage (Fig. 86).


Riz. 86. Adénome pléomorphe de la glande salivaire : a – adénome pléomorphe de la glande parotide (localisation la plus typique), b – matériel chirurgical : ganglion tumoral d'environ 4 cm de diamètre, entouré d'une capsule fibreuse. La surface du nœud est grumeleuse. En dehors de la capsule du nœud principal se trouvent des nodules satellites (croissance multicentrique). En coupe, le tissu tumoral est de couleur blanc jaunâtre et est difficile à couper en raison de la présence de zones de tissu cartilagineux. Dans certains endroits, la tumeur est de consistance molle, avec des zones d'hémorragie et de petits kystes. Le nœud tumoral est entouré d'une capsule fibreuse.
La structure histologique de la tumeur est variée. Classiquement, selon la prédominance de certaines structures, on distingue trois variantes histologiques de la structure : tubulaire-trabéculaire avec une composante myxoïde prononcée, avec présence d'une composante chondroïde, et solide (Fig. 87).
| |

Riz. 87. Adénome pléomorphe de la glande salivaire parotide. La tumeur est représentée par des cellules épithéliales formant des trabécules et des structures canalaires avec des formations kystiques individuelles, situées parmi une substance semblable à du mucus. Il existe des structures chondroïdes (semblables à du cartilage) (1), de nombreuses cellules myoépithéliales, s'anastomosant entre elles comme des structures en forme de réseau. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 60.
L'adénome pléomorphe avec une prédominance de la composante myxoïde récidive souvent après son retrait, car sa fine capsule est facilement endommagée lors de l'intervention chirurgicale. De plus, lors d’opérations sur la glande salivaire parotide, il existe un risque élevé de lésion du nerf facial, ce qui limite parfois les actions du chirurgien et rend l’ampleur de l’opération moins radicale. Les rechutes d'adénome pléomorphe ont souvent une structure solide et une tendance à la malignité.
Adénome myoépithélial localisée principalement dans la glande salivaire parotide, survient plus souvent chez les femmes âgées de 40 à 80 ans. La tumeur est de forme nodulaire et apparaît comme un tissu dense blanchâtre sur une coupe. Il est constitué de cellules fusiformes, polygonales, plasmacytoïdes et claires qui forment des cordons anastomosés et des agrégats cellulaires solides situés dans une matrice myxoïde ou hyalinisée. Il existe trois variantes de sa structure histologique : réticulaire à composante myxoïde, solide et mixte. La nature myoépithéliale de la tumeur est confirmée par la réaction immunohistochimique positive des cellules tumorales à la cytokératine, à l'actine des muscles lisses et à la protéine S-100 (Fig. 88, a - c).

Riz. 88, a-c. Adénome myoépithélial. La tumeur est constituée de cellules fusiformes, polygonales, plasmacytoïdes, claires formant des cordons anastomosés et d'agrégats de cellules solides situés dans une matrice myxoïde ou hyalinisée. Expression de la cytokératine 7 (b) et de l'actine des muscles lisses (c) par certaines cellules. a - coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, b, c - méthode immunohistochimique, a, c - x 400, b - x200 (préparations de I.A. Kazantseva)
Adénome basocellulaire dans 80 % des cas, elle se développe au niveau de la glande salivaire parotide. La tumeur est de forme ronde, possède généralement une capsule et est blanc grisâtre une fois coupée. Il se compose de cellules basaloïdes qui forment des structures solides, des cordons, des trabécules, des conduits et sont situées dans un stroma fibreux sous-développé. Il existe quatre sous-types histologiques de tumeur : solide, trabéculaire, tubulaire et membraneuse.
Tumeur de Warthin (adénolymphome, adénolymphome papillaire) Elle est rare (6 % de toutes les tumeurs des glandes salivaires), principalement chez les hommes de plus de 40 ans. Il s'agit d'un nœud encapsulé clairement délimité d'un diamètre de 2 à 5 cm, parfois bilatéral, de coupe transversale gris pâle avec de nombreux petits kystes en forme de fente ou grands remplis de contenu séreux. Histologiquement, elle est représentée par des structures glandulaires et des formations kystiques, tapissées d'une double couche de cellules semblable à l'épithélium des tubes salivaires (Fig. 89).

Riz. 89. Cystadénolymphome papillaire (tumeur de Warthin). Les structures glandulaires et les formations kystiques sont tapissées d'une double couche de cellules semblable à l'épithélium des tubes salivaires. Le cytoplasme des cellules est éosinophile, granuleux (semblable aux oncocytes). Les cellules de la couche interne ont une forme cylindrique avec une localisation apicale du noyau hyperchrome. Il existe des cellules muqueuses et des foyers de métaplasie squameuse. Dans les gros kystes, il existe des excroissances papillaires de l'épithélium. Dans le stroma, il existe un infiltrat lymphocytaire diffus avec formation de follicules lymphoïdes. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 120 (préparation de I.A. Kazantseva).
Oncocytome (adénome oncocytaire, adénome oxyphile)- une tumeur rare des glandes salivaires, survient principalement au niveau de la glande parotide, représentée par des cellules épithéliales différenciées du canal strié (Fig. 90).
Riz. 90. Oncocytome (adénome oncocytaire, adénome oxyphile). La tumeur est représentée par de grosses cellules légères avec un cytoplasme éosinophile granulaire avec un petit noyau, formant des structures alvéolaires solides. Il existe des champs représentés par des groupes distincts de cellules séparées par de fines couches de tissu conjonctif fibrillaire avec des vaisseaux de type capillaire. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 200 (préparation de I.A. Kazantseva)
Tumeurs épithéliales malignes des glandes salivaires (carcinome, cancer) représentent 21 à 46 %. La tumeur maligne la plus fréquente est le carcinome mucoépidermoïde.
Carcinome mucoépidermoïde (cancer mucoépidermoïde) survient au cours des 5e et 6e décennies de la vie, plus souvent chez les femmes. En termes de localisation, la glande salivaire parotide occupe la première place. Les ganglions tumoraux sont ronds ou ovales, tubéreux, d'un diamètre de 1,5 à 4 cm, souvent fusionnés, de section transversale jaunâtre ou grisâtre avec des couches brunes, de multiples kystes. Rarement encapsulé, ou la fine capsule n'est pas complètement formée. La consistance varie de molle à « pierreuse », et les ganglions denses et inactifs s'avèrent généralement mal différenciés lors de l'examen histologique (Fig. 91).

Riz. 91. Cancer mucoépidermoïde. La tumeur est représentée par un ganglion tubéreux d'environ 3 cm, délimité des tissus environnants, mais la fine capsule n'est pas complètement formée. La consistance de la tumeur est molle à certains endroits, « pierreuse » à d’autres. Sur la coupe, le tissu tumoral est gris jaunâtre avec des couches brunes ; il existe de multiples kystes, hémorragies et foyers de nécrose.
Les variantes tumorales peu différenciées se distinguent par un polymorphisme prononcé, des mitoses pathologiques, une hyalinose sévère du stroma, les kystes y sont difficiles à détecter et les cellules sécrétant du mucus sont rares. Modérément différencié - avec de petites zones de polymorphisme cellulaire, des microfoyers de nécrose, une hyalinose focale. Hautement différencié - sans polymorphisme cellulaire, nécrose, pas de mitoses, hyalinose stromale finement focale, nombreux macrokystes et cellules sécrétant du mucus. Pour vérifier le mucus, des réactions histochimiques (réaction PAS, coloration de Kreyberg) sont utilisées (Fig. 92, a, b).
| |
Riz. 92, a, b. Carcinome mucoépidermoïde. La tumeur est représentée par des cellules épidermoïdes avec un grand mélange de cellules sécrétant du mucus, la population de cellules intermédiaires est minime et des micro- et macrokystes sont présents. Hyalinose stromale finement focale. Le polymorphisme cellulaire, la nécrose et les mitoses sont modérément exprimés (cancer moyennement différencié). La réaction de Kreyberg (b) révèle des microkystes avec du mucus (1), cellules individuelles sécrétant du mucus. a - coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, b - coloration de Kreiberg, x 100 (a - préparation de I.A. Kazantseva).
Le pronostic dépend d'abord de la radicalité de l'ablation chirurgicale de la tumeur puis du degré de sa différenciation et de la profondeur de son invasion.
Carcinome adénoïde kystique (cylindrome) représente 1,2 à 10 % de toutes les tumeurs malignes des glandes salivaires et constitue le deuxième carcinome le plus fréquent. La localisation prédominante est celle des glandes salivaires mineures palatines et de la glande parotide. Elle survient plus souvent chez les femmes âgées de 60 à 70 ans, se développe lentement, mais une invasion périneurale accompagnée de douleur est notée précocement. La tumeur est représentée par des ganglions denses d'un diamètre de 1 à 5 cm, sur une coupe elle est jaune grisâtre, avec des limites peu claires. Sur la base de la structure histologique, on distingue trois variantes : cribriforme, tubulaire et solide. La cribose est caractérisée par la formation de structures en « treillis » par les cellules tumorales en raison de la présence parmi elles de nombreux kystes tapissés de cellules épithéliales canalaires atypiques. Les cellules myoépithéliales sont situées entre les kystes. Les conduits et les kystes contiennent une substance RAS-positive. Tubulaire est représenté par des structures en forme de conduit avec une sécrétion RAS-positive, des trabécules épithéliales entourées d'un stroma hyalisé. Le solide se distingue par de vastes champs constitués de petites cellules épithéliales cuboïdes ou ovales avec des noyaux hyperchromes, avec des mitoses ; structures cribriformes clairsemées, souvent avec nécrose centrale. Le stroma est peu développé (Fig. 93).
Riz. 93. Carcinome adénoïde kystique (cylindrome). La tumeur est représentée par des structures cribriformes, en « treillis » (dues à de nombreux petits kystes). Les kystes sont tapissés de cellules épithéliales canalaires atypiques (variante cribrotique). Entre les kystes se trouvent des cellules myoépithéliales. Croissance infiltrante prononcée des tissus environnants de la glande salivaire, du tissu musculaire et de la croissance périneurale. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 120 (préparation de I.A. Kazantseva).
La tumeur est agressive, des métastases peuvent être détectées plusieurs années après son ablation. Un signe de pronostic défavorable est considéré comme étant constitué de 30 % ou plus d'une composante solide.
Carcinome à cellules acine peut se développer dans toutes les glandes salivaires et à tout âge. Le carcinome mucoépidermoïde est beaucoup moins courant. Elle se caractérise par une croissance lente, souvent encapsulée, de consistance densément élastique, le diamètre ne dépasse généralement pas 1 cm. La tumeur est représentée par des structures solides, cystopapillaires et folliculaires avec de petits kystes, des structures acineuses avec une granularité basophile caractéristique du cytoplasme des cellules prédominent, bien que des tumeurs à cellules non granuleuses et légères soient décrites. Il existe des variantes de structure histologique solide, microkystique, papillaire, kystique et folliculaire, mais elles n'ont pas de signification pronostique (Fig. 94).
Riz. 94. Carcinome à cellules acine. La tumeur est représentée par des structures solides, cystopapillaires et folliculaires construites par des cellules tumorales acineuses. Le cytoplasme de nombreuses cellules tumorales est granulaire basophile, mais on trouve également des cellules non granuleuses et légères. De petits kystes, une hyalinose stromale et une croissance invasive sont détectés. Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, x 200 (préparation de I.A. Kazantseva).
Le pronostic dépend de la gravité de l’invasion et de la radicalité de l’opération. Caractérisé par des métastases hématogènes dans les poumons au cours de périodes imprévisibles de développement et de croissance tumorale.
Adénocarcinome polymorphe de bas grade localisé le plus souvent dans les glandes salivaires mineures palatines, il s'agit d'un nodule lobulaire non encapsulé, d'environ 2 cm de diamètre, souvent accompagné d'une ulcération de la muqueuse, à croissance infiltrante, mais métastase extrêmement rarement. Histologiquement, il s'agit d'une tumeur polymorphe de structure lobulaire, papillaire ou papillaire-kystique, souvent avec des structures cribriformes, trabéculaires et en forme de petits canaux.
Carcinome myoépithélial représente moins de 1% de tous les néoplasmes des glandes salivaires. Il se distingue par une croissance unicentrique, moins souvent multicentrique ; en cas de croissance invasive, il peut atteindre de grandes tailles. Une invasion périneurale et vasculaire partiellement encapsulée se produit. Dans 10 à 20 % des cas, la tumeur métastase aux ganglions lymphatiques du cou ; les métastases à distance sont rares. Histologiquement, il s'agit d'un carcinome bien différencié, constitué dans les cas classiques de deux types de cellules (épithéliales et myoépithéliales), formant des structures canalaires à deux couches. Il existe trois variantes histologiques : tubulaire, solide (principalement à cellules claires ou myoépithéliales) et sclérosante, avec hyalinose stromale (Fig. 95, a, b).

Riz. 95, a, b. Carcinome myoépithélial : a - coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, b - expression de la cytokératine 7 par une partie des cellules tumorales (méthode immunohistochimique), a - x 120, b - x 200 (préparations de I.A. Kazantseva)
Carcinome dans l'adénome pléomorphe représente 1,5 à 6 % de toutes les tumeurs des glandes salivaires et 15 à 20 % de leurs tumeurs malignes. Histologiquement, jusqu'à 35 % de ces tumeurs ont la structure d'un carcinome adénoïde kystique, jusqu'à 25 % d'un carcinome mucoépidermoïde ou d'un carcinome indifférencié et jusqu'à 15 à 20 % d'un adénocarcinome. Toutes les variantes sont caractérisées par la présence de nécrose, d'hémorragies et d'hyalinose stromale.
Ils sont représentés par des glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales appariées, ainsi que par des glandes salivaires mineures, dont le nombre peut atteindre 600 à 1 000.
Tous maladies des glandes salivaires sont divisés en néoplasiques (tumeur) et non tumoraux. Les maladies non néoplasiques sont divisées en maladies infectieuses, inflammatoires, non infectieuses et non inflammatoires.
Maladies non néoplasiques des glandes salivaires
1. Inflammatoire infectieux:
Sialadénite bactérienne aiguë
Sialadénite virale aiguë
Infections granulomateuses
2. Inflammatoire non infectieuse:
Sialolithiase
Sialadénite radique
Le syndrome de Sjogren
Sarcoïdose
3. Non inflammatoire:
Sialorrhée (ptialisme)
Xérostomie
Sialose
Kystes
Mucocèle
Blessures
Anatomie des glandes salivaires
Ils jouent un rôle essentiel dans l’hygiène bucco-dentaire, puisque la salive possède des propriétés antimicrobiennes et sert de barrière qui protège la muqueuse des irritants. La salive joue également un rôle dans l'articulation et la déglutition, agissant comme un lubrifiant.
Ainsi, dommages aux glandes salivaires peut se manifester de manières complètement différentes, depuis un défaut esthétique mineur jusqu'à une déficience fonctionnelle invalidante. La connaissance de l’anatomie des glandes salivaires est nécessaire pour comprendre les maladies dans ce domaine. Lors de l'examen, il est important de palper les glandes salivaires tant à l'extérieur qu'à travers la cavité buccale.
UN) Glande salivaire parotide. La glande salivaire parotide est la plus grande glande salivaire. Il sécrète une sécrétion majoritairement séreuse, qui est libérée par le canal sténonien, qui débouche sur la surface muqueuse de la joue au niveau de la deuxième molaire de la mâchoire supérieure.
La glande est située latéralement muscle masticateur et en avant de l'oreillette, au-dessus se trouve l'arcade zygomatique, et en dessous se trouve l'angle de la mâchoire inférieure. La queue postérieure de la glande s'enroule autour du muscle sternocléidomastoïdien. Le nerf facial divise la glande parotide en lobes superficiels et profonds.
Parasympathique innervation fourni par le nerf glossopharyngé (le nerf auriculotemporal, qui naît du ganglion de l'oreille). L'innervation sympathique de toutes les glandes salivaires est assurée par le ganglion cervical supérieur.
b) Glande salivaire sous-maxillaire. La glande salivaire sous-maxillaire est la deuxième plus grande glande salivaire. Il produit une sécrétion séreuse-muqueuse et s'ouvre jusqu'au plancher buccal par le canal de Wharton. La glande est située sur le muscle mylohyoïdien, dans le triangle sous-maxillaire situé entre les ventres du muscle digastrique.
L'innervation parasympathique du nerf sous-maxillaire et sublingual est assurée par le noyau salivaire supérieur à travers la corde tympanique (partie du nerf lingual) avant son entrée dans le ganglion sous-maxillaire.
V) Glande salivaire sous-maxillaire et glandes salivaires mineures. Les glandes salivaires sublinguales et mineures produisent une sécrétion mucineuse visqueuse avec un grand nombre de lysosomes et un effet antimicrobien plus prononcé.
La glande salivaire sublinguale est située superficiellement par rapport au muscle musculo-hyoïdien et s'ouvre jusqu'au plancher de la bouche par le canal rivinus (parfois ils fusionnent pour former le canal de Bartholin, qui se connecte au canal excréteur de la glande salivaire sous-maxillaire). Les glandes salivaires mineures sont situées sur toute la surface des voies respiratoires supérieures et digestives, chacune des glandes possède son propre canal excréteur.
 Principales glandes salivaires.
Principales glandes salivaires. Glande parotide (1) avec une petite glande accessoire (2) et un canal sténon (3).
Glande sous-maxillaire (4) avec processus unciné (5) et canal sous-maxillaire (Wharton) (6).
Glande sublinguale (7) avec papille sublinguale (8).
A - muscle masticateur ; B - muscle buccal ; B - muscle mylohyoïdien.