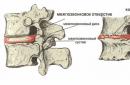Le choc est une condition spécifique dans laquelle il y a un manque brutal de sang dans les organes humains les plus importants : le cœur, le cerveau, les poumons et les reins. Ainsi, une situation se présente dans laquelle le volume de sang disponible n'est pas suffisant pour remplir le volume existant de vaisseaux sanguins sous pression. Dans une certaine mesure, le choc est un état qui précède la mort.
Causes
Les causes du choc sont dues à une violation de la circulation d'un volume fixe de sang dans un certain volume de vaisseaux capables de se rétrécir et de se dilater. Ainsi, parmi les causes de choc les plus fréquentes figurent une forte diminution du volume sanguin (perte de sang), une augmentation rapide des vaisseaux sanguins (les vaisseaux se dilatent, généralement en réponse à une douleur aiguë, à un allergène ou à une hypoxie), ainsi que l'incapacité du cœur pour remplir ses fonctions (contusion cardiaque suite à une chute, infarctus du myocarde, « courbure » du cœur lors d'un pneumothorax sous tension).
Autrement dit, le choc est l’incapacité du corps à assurer une circulation sanguine normale.
Parmi les principales manifestations du choc figurent un pouls rapide supérieur à 90 battements par minute, un pouls filiforme faible, une pression artérielle basse (jusqu'à son absence complète), une respiration rapide, dans laquelle une personne au repos respire comme si elle effectuait des travaux lourds. activité physique. Une peau pâle (la peau devient bleu pâle ou jaune pâle), un manque d'urine et une faiblesse grave dans laquelle une personne ne peut ni bouger ni parler sont également des signes de choc. Le développement d'un choc peut entraîner une perte de conscience et une absence de réponse à la douleur.
Types de choc
Le choc anaphylactique est une forme de choc caractérisée par une forte dilatation des vaisseaux sanguins. La cause du choc anaphylactique peut être une certaine réaction à un allergène pénétrant dans le corps humain. Il peut s’agir d’une piqûre d’abeille ou de l’injection d’un médicament auquel la personne est allergique.
Le développement d'un choc anaphylactique se produit lorsqu'un allergène pénètre dans le corps humain, quelle que soit la quantité dans laquelle il pénètre dans le corps. Par exemple, peu importe le nombre d'abeilles qui ont mordu une personne, car le développement d'un choc anaphylactique se produira de toute façon. Cependant, l'emplacement de la morsure est important, car si le cou, la langue ou la zone du visage sont touchés, le développement d'un choc anaphylactique se produira beaucoup plus rapidement qu'avec une morsure à la jambe.
Le choc traumatique est une forme de choc caractérisée par un état extrêmement grave du corps, provoqué par un saignement ou une irritation douloureuse.
Parmi les causes les plus courantes de choc traumatique figurent la peau pâle, la sueur collante, l’indifférence, la léthargie et un pouls rapide. D'autres causes de choc traumatique comprennent la soif, la bouche sèche, la faiblesse, l'anxiété, la perte de conscience ou la confusion. Ces signes de choc traumatique s’apparentent dans une certaine mesure aux symptômes d’une hémorragie interne ou externe.
Le choc hémorragique est une forme de choc dans laquelle se produit un état d'urgence du corps qui se développe à la suite d'une perte de sang aiguë.
Le degré de perte de sang a un impact direct sur la manifestation du choc hémorragique. En d'autres termes, la force de la manifestation du choc hémorragique dépend directement de la quantité de diminution du volume sanguin circulant (CBC) sur une période de temps assez courte. Une perte de sang de 0,5 litre, survenant au cours d'une semaine, ne provoquera pas le développement d'un choc hémorragique. Dans ce cas, la clinique de l'anémie se développe.
Le choc hémorragique survient à la suite d'une perte de sang d'un volume total de 500 ml ou plus, soit 10 à 15 % du volume sanguin circulant. Une perte de 3,5 litres de sang (70 % du volume sanguin) est considérée comme mortelle.
Le choc cardiogénique est une forme de choc caractérisée par un complexe de conditions pathologiques dans le corps, provoquées par une diminution de la fonction contractile du cœur.
Parmi les principaux signes de choc cardiogénique figurent les interruptions du fonctionnement du cœur, qui sont une conséquence des arythmies cardiaques. De plus, en cas de choc cardiogénique, le fonctionnement du cœur est interrompu, ainsi que des douleurs thoraciques. L'infarctus du myocarde se caractérise par un fort sentiment de peur accompagné d'embolie pulmonaire, d'essoufflement et de douleur aiguë.
D'autres signes de choc cardiogénique comprennent des réactions vasculaires et autonomes qui se développent à la suite d'une diminution de la pression artérielle. Des sueurs froides, une pâleur suivie d'un bleuissement des ongles et des lèvres, ainsi qu'une faiblesse sévère sont également des symptômes d'un choc cardiogénique. Il y a souvent un sentiment de peur intense. En raison du gonflement des veines, qui se produit après que le cœur cesse de pomper le sang, les veines jugulaires du cou deviennent enflées. En cas de thromboembolie, la cyanose survient assez rapidement et des marbrures de la tête, du cou et de la poitrine sont également notées.
En cas de choc cardiogénique, une perte de conscience peut survenir après l'arrêt de la respiration et de l'activité cardiaque.
Premiers secours en cas de choc
Une assistance médicale rapide en cas de blessure grave et de blessure peut empêcher le développement d'un état de choc. L'efficacité des premiers secours en cas de choc dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle ils sont prodigués. Les premiers secours en cas de choc consistent à éliminer les principales causes du développement de cette affection (arrêt du saignement, réduction ou soulagement de la douleur, amélioration de la respiration et de l'activité cardiaque, refroidissement général).
Ainsi, tout d'abord, lors du processus de fourniture des premiers soins en cas de choc, il convient de s'attaquer aux causes qui ont provoqué cet état. Il faut libérer la victime des décombres, arrêter le saignement, éteindre les vêtements en feu, neutraliser la partie du corps endommagée, éliminer l'allergène ou prévoir une immobilisation temporaire.
Si la victime est consciente, il est recommandé de lui proposer une anesthésie et, si possible, de boire du thé chaud.
Lors des premiers soins en cas de choc, il est nécessaire de desserrer les vêtements serrés sur la poitrine, le cou ou la ceinture.
La victime doit être placée dans une position telle que la tête soit tournée sur le côté. Cette position permet d'éviter la rétraction de la langue, ainsi que l'étouffement avec le vomi.
Si le choc survient par temps froid, la victime doit être réchauffée et si par temps chaud, elle doit être protégée de la surchauffe.
De plus, lors des premiers soins en cas de choc, si nécessaire, la bouche et le nez de la victime doivent être débarrassés des corps étrangers, après quoi un massage à cœur fermé et une respiration artificielle doivent être effectués.
Le patient ne doit pas boire, fumer, utiliser des coussins chauffants ou des bouillottes, ni être seul.
Attention!
Cet article est publié à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas du matériel scientifique ni un avis médical professionnel.
Inscrivez-vous pour un rendez-vous avec le médecin
Une maladie qui se développe rapidement dans le contexte d’une blessure grave, qui constitue une menace directe pour la vie d’une personne, est communément appelée choc traumatique. Comme son nom l'indique déjà, la cause de son développement est de graves dommages mécaniques et une douleur insupportable. Dans une telle situation, vous devez agir immédiatement, car tout retard dans la fourniture des premiers soins peut coûter la vie au patient.
Table des matières:Causes du choc traumatique
La cause peut être des blessures graves - fractures de la hanche, blessures par balle ou au couteau, rupture de gros vaisseaux sanguins, brûlures, lésions des organes internes. Cela peut inclure des blessures aux zones les plus sensibles du corps humain, comme le cou ou le périnée, ou aux organes vitaux. En règle générale, leur apparition est due à des situations extrêmes.
note
Très souvent, un choc douloureux se développe lorsque de grosses artères sont blessées, entraînant une perte de sang rapide et le corps n'a pas le temps de s'adapter aux nouvelles conditions.
Choc traumatique : pathogenèse
 Le principe du développement de cette pathologie est une réaction en chaîne d’états traumatiques qui ont des conséquences graves sur la santé du patient et s’aggravent les uns après les autres par étapes.
Le principe du développement de cette pathologie est une réaction en chaîne d’états traumatiques qui ont des conséquences graves sur la santé du patient et s’aggravent les uns après les autres par étapes.
Pour une douleur intense et insupportable et une perte de sang importante, un signal est envoyé à notre cerveau qui provoque une grave irritation. Le cerveau libère soudainement une grande quantité d'adrénaline, une telle quantité n'est pas typique de l'activité humaine normale, et cela perturbe le fonctionnement de divers systèmes.
En cas de perte de sang soudaine Un spasme des petits vaisseaux se produit, cela aide d'abord à économiser une partie du sang. Notre corps est incapable de maintenir cet état pendant une longue période ; par la suite, les vaisseaux sanguins se dilatent à nouveau et la perte de sang augmente.
En cas de blessure fermée le mécanisme d'action est similaire. Grâce aux hormones libérées, les vaisseaux bloquent l'écoulement du sang et cet état n'est plus une réaction défensive, mais au contraire est à la base du développement d'un choc traumatique. Par la suite, une quantité importante de sang est retenue et il y a un manque d'apport sanguin au cœur, au système respiratoire, au système hématopoïétique, au cerveau et autres.
Par la suite, une intoxication du corps se produit, les systèmes vitaux tombent en panne les uns après les autres et une nécrose des tissus des organes internes se produit en raison du manque d'oxygène. En l’absence de premiers secours, tout cela conduit à la mort.
Le développement d'un choc traumatique dans le contexte d'une blessure accompagnée d'une perte de sang intense est considéré comme le plus grave.
Dans certains cas, la récupération du corps avec un choc douloureux léger à modéré peut se produire d'elle-même, bien qu'un tel patient doive également recevoir les premiers soins.
Symptômes et stades du choc traumatique
Les symptômes du choc traumatique sont prononcés et dépendent du stade.
Stade 1 – érectile
Dure de 1 à plusieurs minutes. La blessure qui en résulte et la douleur insupportable provoquent un état atypique chez le patient : il peut pleurer, crier, être extrêmement agité et même résister à l'aide. La peau devient pâle, une sueur collante apparaît et le rythme respiratoire et cardiaque est perturbé.
note
A ce stade, il est déjà possible de juger de l'intensité du choc douloureux manifesté : plus il est brillant, plus l'étape suivante du choc se manifestera plus fort et plus rapidement.
Étape 2 – torpeur
A un développement rapide. L'état du patient change brusquement et devient inhibé, la conscience disparaît. Cependant, le patient ressent toujours de la douleur, les premiers secours doivent être effectués avec une extrême prudence.
La peau devient encore plus pâle, une cyanose des muqueuses se développe, la tension artérielle chute fortement et le pouls est à peine perceptible. La prochaine étape sera le développement d'un dysfonctionnement des organes internes.
Degrés de développement du choc traumatique
Les symptômes du stade de torpeur peuvent avoir une intensité et une gravité différentes, en fonction de cela, on distingue les degrés de développement du choc douloureux.
1er degré
État satisfaisant, conscience claire, le patient comprend clairement ce qui se passe et répond aux questions. Les paramètres hémodynamiques sont stables. Une légère augmentation de la respiration et de la fréquence cardiaque peut survenir. Cela se produit souvent avec des fractures de gros os. Un choc traumatique léger a un pronostic favorable. Le patient doit recevoir une assistance en fonction de la blessure, des analgésiques et être emmené à l'hôpital pour y être soigné.

2ème degré
Le patient est marqué par la léthargie ; il peut mettre beaucoup de temps à répondre à la question posée et ne comprend pas immédiatement quand on lui parle. La peau est pâle, les membres peuvent prendre une teinte bleutée. La tension artérielle est réduite, le pouls est fréquent mais faible. Le manque d'assistance appropriée peut provoquer le développement du prochain degré de choc.
3ème degré
Le patient est inconscient ou dans un état de stupeur, il n'y a pratiquement aucune réaction aux stimuli, la peau est pâle. Forte baisse de la pression artérielle, le pouls est fréquent, mais faiblement palpable même dans les gros vaisseaux. Le pronostic de cette affection est défavorable, surtout si les procédures effectuées ne conduisent pas à une dynamique positive.
4ème degré
Évanouissement, pas de pouls, tension artérielle extrêmement basse ou inexistante. Le taux de survie pour cette condition est minime.
Traitement
Le principe principal du traitement du développement d’un choc traumatique est une action immédiate pour normaliser l’état de santé du patient.
Les premiers secours en cas de choc traumatique doivent être prodigués immédiatement, avec une action claire et décisive.
Premiers secours en cas de choc traumatique
Les actions spécifiques nécessaires sont déterminées par le type de blessure et la cause du choc traumatique ; la décision finale est basée sur les circonstances réelles. Si vous êtes témoin du développement d'un choc douloureux chez une personne, il est recommandé de prendre immédiatement les mesures suivantes :

Un garrot est utilisé en cas de saignement artériel (le sang jaillit) et est appliqué au-dessus du site de la plaie. Il peut être utilisé en continu pendant 40 minutes maximum, puis il doit être détendu pendant 15 minutes. Lorsque le garrot est correctement appliqué, le saignement s'arrête. Dans d’autres cas de blessure, un bandage de gaze compressive ou un tampon est appliqué.
- Fournir un libre accès à l’air. Retirez ou détachez les vêtements et accessoires contraignants, retirez les corps étrangers des voies respiratoires. Le patient inconscient doit être placé sur le côté.
- Procédures de réchauffement. Comme nous le savons déjà, le choc traumatique peut se manifester par une pâleur et un froid des extrémités, auquel cas le patient doit être couvert ou un accès supplémentaire à la chaleur doit être assuré.
- Analgésiques. L'option idéale dans ce cas serait l'injection intramusculaire d'analgésiques.. Dans une situation extrême, essayez de donner au patient un comprimé d'analgine par voie sublinguale (sous la langue pour une action plus rapide).
- Transport. En fonction des blessures et de leur localisation, il est nécessaire de déterminer le mode de transport du patient. Le transport ne doit être effectué que dans les cas où l'attente d'une assistance médicale peut prendre très longtemps.
Interdit!
- Déranger et exciter le patient, le faire bouger !
- Déplacer ou déplacer le patient de
Le choc est une forme d'état critique de l'organisme, se manifestant par un dysfonctionnement de plusieurs organes, se développant en cascade sur la base d'une crise circulatoire généralisée et se terminant, en règle générale, par la mort sans traitement.
Le facteur de choc est tout effet sur le corps qui dépasse en force les mécanismes adaptatifs. Pendant le choc, les fonctions respiratoires, le système cardiovasculaire et les reins changent, les processus de microcirculation des organes et des tissus et les processus métaboliques sont perturbés.
Étiologie et pathogenèse
Le choc est une maladie de nature polyétiologique. Selon l'étiologie de leur apparition, les types de choc peuvent être différents.
1. Choc traumatique :
1) pour les blessures mécaniques - fractures osseuses, plaies, compression des tissus mous, etc. ;
2) pour les brûlures (brûlures thermiques et chimiques) ;
3) lorsqu'il est exposé à basse température - choc thermique ;
4) en cas de blessures électriques – choc électrique.
2. Choc hémorragique ou hypovolémique :
1) se développe à la suite d'un saignement, d'une perte de sang aiguë ;
2) à la suite d'une perturbation aiguë de l'équilibre hydrique, une déshydratation du corps se produit.
3. Choc septique (bactérien-toxique) (processus purulents généralisés provoqués par une microflore à Gram négatif ou à Gram positif).
4. Choc anaphylactique.
5. Choc cardiogénique (infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque aiguë). Considéré dans la section sur les conditions d'urgence en cardiologie.
Dans tous les types de choc, le principal mécanisme de développement est la vasodilatation et, par conséquent, la capacité du lit vasculaire augmente, l'hypovolémie - le volume de sang circulant (CBV) diminue, car il existe divers facteurs : perte de sang, redistribution du liquide entre le sang et les tissus, ou écart entre le volume sanguin normal augmentant la capacité du lit vasculaire. L'écart qui en résulte entre le volume sanguin et la capacité du lit vasculaire est à l'origine de la diminution du débit cardiaque et des troubles de la microcirculation. Ce dernier entraîne de graves changements dans le corps, car c'est ici que s'effectue la fonction principale de la circulation sanguine - l'échange de substances et d'oxygène entre la cellule et le sang. Un épaississement du sang se produit, sa viscosité augmente et une microthrombose intracapillaire se produit. Par la suite, les fonctions cellulaires sont perturbées jusqu’à leur mort. Dans les tissus, les processus anaérobies commencent à prédominer sur les processus aérobies, ce qui conduit au développement d'une acidose métabolique. L'accumulation de produits métaboliques, principalement d'acide lactique, augmente l'acidose.
Une caractéristique de la pathogenèse du choc septique est une violation de la circulation sanguine sous l'influence de toxines bactériennes, qui contribue à l'ouverture des shunts artérioveineux, et le sang commence à contourner le lit capillaire et se précipite des artérioles vers les veinules. En raison d'une diminution du flux sanguin capillaire et de l'action des toxines bactériennes spécifiquement sur la cellule, la nutrition cellulaire est perturbée, ce qui entraîne une diminution de l'apport d'oxygène aux cellules.
Lors d'un choc anaphylactique, sous l'influence de l'histamine et d'autres substances biologiquement actives, les capillaires et les veines perdent leur tonus, tandis que le lit vasculaire périphérique se dilate, sa capacité augmente, ce qui conduit à une redistribution pathologique du sang. Le sang commence à s'accumuler dans les capillaires et les veinules, provoquant un dysfonctionnement cardiaque. Le CBC résultant ne correspond pas à la capacité du lit vasculaire et le débit cardiaque (débit cardiaque) diminue en conséquence. La stagnation du sang qui en résulte dans la microvascularisation entraîne un trouble du métabolisme et de l'oxygène entre la cellule et le sang au niveau du lit capillaire.
Les processus ci-dessus conduisent à une ischémie du tissu hépatique et à une perturbation de ses fonctions, ce qui aggrave encore l'hypoxie aux stades sévères de développement du choc. La détoxification, la formation de protéines, la formation de glycogène et d'autres fonctions du foie sont perturbées. Le trouble du flux sanguin principal régional et de la microcirculation dans le tissu rénal contribue à la perturbation des fonctions de filtration et de concentration des reins avec une diminution de la diurèse de l'oligurie à l'anurie, ce qui conduit à l'accumulation de déchets azotés dans le corps du patient. , comme l'urée, la créatinine et d'autres substances métaboliques toxiques. Les fonctions du cortex surrénalien sont perturbées, la synthèse des corticostéroïdes (glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, hormones androgènes) est réduite, ce qui aggrave les processus en cours. Un trouble circulatoire dans les poumons explique la perturbation de la respiration externe, les échanges gazeux alvéolaires diminuent, un shunt sanguin se produit, une microthrombose se forme et, par conséquent, le développement d'une insuffisance respiratoire, qui aggrave l'hypoxie tissulaire.
Clinique
Le choc hémorragique est la réaction de l’organisme à la perte de sang qui en résulte (une perte de 25 à 30 % du volume sanguin entraîne un choc sévère).
En cas de choc de brûlure, le rôle dominant est joué par le facteur douleur et la perte massive de plasma. Oligurie et anurie à développement rapide. L'évolution du choc et sa gravité sont caractérisées par le volume et le taux de perte de sang. Sur la base de ce dernier, on distingue le choc hémorragique compensé, le choc réversible décompensé et le choc irréversible décompensé.
Avec un choc compensé, on note une peau pâle, des sueurs froides et collantes, le pouls devient faible et fréquent, la pression artérielle reste dans les limites normales ou est légèrement réduite, mais seulement légèrement, et la miction diminue.
En cas de choc réversible non compensé, la peau et les muqueuses deviennent cyanosées, le patient devient léthargique, le pouls est faible et fréquent, il y a une diminution significative de la pression artérielle et veineuse centrale, une oligurie se développe, l'indice d'Algover est augmenté et le L'ECG montre une perturbation de l'apport d'oxygène au myocarde. En cas de choc irréversible, il n’y a pas de conscience, la pression artérielle chute à des niveaux critiques et peut ne pas être détectée, la peau est de couleur marbrée et une anurie se développe – arrêt de la miction. L'indice Algover est élevé.
Pour évaluer la gravité du choc hémorragique, la détermination du volume sanguin et du volume de perte de sang est d'une grande importance.
La carte d'analyse de la gravité du choc et l'évaluation des résultats obtenus sont présentées dans le tableau 4 et le tableau 5.
Tableau 4
Graphique d'analyse de la gravité des chocs
Tableau 5
Évaluation des résultats sur la base du total des points

L'indice de choc, ou indice d'Algover, représente le rapport entre la fréquence du pouls et la pression systolique. En cas de choc du premier degré, l'indice d'Algover ne dépasse pas 1. En cas de deuxième degré - pas plus de 2 ; avec un indice supérieur à 2, la condition est caractérisée comme incompatible avec la vie.
Types de chocs
Choc anaphylactique est un complexe de diverses réactions allergiques de type immédiat, atteignant un degré de gravité extrême.
Il existe les formes suivantes de choc anaphylactique :
1) forme cardiovasculaire, dans laquelle se développe une insuffisance circulatoire aiguë, se manifestant par une tachycardie, souvent accompagnée de troubles du rythme cardiaque, d'une fibrillation ventriculaire et auriculaire et d'une diminution de la pression artérielle ;
2) forme respiratoire, accompagnée d'une insuffisance respiratoire aiguë : essoufflement, cyanose, respiration stridoreuse et bouillonnante, râles humides dans les poumons. Cela est dû à une altération de la circulation capillaire, à un gonflement du tissu pulmonaire, du larynx et de l'épiglotte ;
3) forme cérébrale, causée par une hypoxie, une altération de la microcirculation et un œdème cérébral.
En fonction de la gravité de l'évolution, il existe 4 degrés de choc anaphylactique.
Le degré I (léger) se caractérise par des démangeaisons cutanées, l'apparition d'une éruption cutanée, des maux de tête, des étourdissements et une sensation de sensation de tête.
Degré II (modéré) – aux symptômes mentionnés précédemment s’ajoutent un œdème de Quincke, une tachycardie, une diminution de la tension artérielle et une augmentation de l’indice d’Algover.
Le degré III (sévère) se manifeste par une perte de conscience, une insuffisance respiratoire et cardiovasculaire aiguë (essoufflement, cyanose, respiration sifflante, pouls faible et rapide, forte diminution de la pression artérielle, indice d'Algover élevé).
Le degré IV (extrêmement sévère) s'accompagne d'une perte de conscience, d'une insuffisance cardiovasculaire sévère : le pouls n'est pas détectable, la tension artérielle est basse.
Traitement. Le traitement est réalisé selon les principes généraux du traitement de choc : restauration de l'hémodynamique, du flux sanguin capillaire, utilisation de vasoconstricteurs, normalisation du volume sanguin et de la microcirculation.
Des mesures spécifiques visent à inactiver l'antigène dans le corps humain (par exemple, la pénicillinase ou la b-lactamase en cas de choc provoqué par des antibiotiques) ou à prévenir l'effet de l'antigène sur le corps - antihistaminiques et stabilisants membranaires.
1. Perfusion intraveineuse d'adrénaline jusqu'à stabilisation hémodynamique. Vous pouvez utiliser de la dopmine à raison de 10 à 15 mcg/kg/min, et pour les symptômes du bronchospasme et des agonistes bêta-adrénergiques : alupent, bricanil par voie intraveineuse.
2. Thérapie par perfusion dans un volume de 2 500 à 3 000 ml avec inclusion de polyglucine et de rhéopolyglucine, à moins que la réaction ne soit provoquée par ces médicaments. Bicarbonate de sodium 4% 400 ml, solutions de glucose pour restaurer le volume sanguin et l'hémodynamique.
3. Stabilisateurs de membrane intraveineuse : prednisolone jusqu'à 600 mg, acide ascorbique 500 mg, troxevasine 5 ml, éthamsylate de sodium 750 mg, cytochrome C 30 mg (les doses quotidiennes sont indiquées).
4. Bronchodilatateurs : aminophylline 240-480 mg, noshpa 2 ml, alupent (bricanil) 0,5 mg goutte à goutte.
5. Antihistaminiques : diphenhydramine 40 mg (suprastin 60 mg, tavegil 6 ml), cimétidine 200 à 400 mg par voie intraveineuse (les doses quotidiennes sont indiquées).
6. Inhibiteurs de protéase : trasylol 400 000 unités, contrical 100 000 unités.
Choc traumatique est un état pathologique et critique du corps survenu en réponse à une blessure, dans lequel les fonctions des systèmes et organes vitaux sont perturbées et inhibées. Lors d'un choc traumatique, on distingue des phases de torpidité et d'érection.
Selon le moment de son apparition, le choc peut être primaire (1 à 2 heures) et secondaire (plus de 2 heures après la blessure).
Stade érectile ou phase d’émergence. La conscience demeure, le patient est pâle, agité, euphorique, inadéquat, peut crier, courir quelque part, éclater, etc. À ce stade, l'adrénaline est libérée, grâce à laquelle la pression et le pouls peuvent rester normaux pendant un certain temps. La durée de cette phase varie de quelques minutes et heures à plusieurs jours. Mais dans la plupart des cas, il est de courte durée.
La phase de torpeur remplace la phase érectile, lorsque le patient devient léthargique et adynamique, la tension artérielle diminue et une tachycardie apparaît. Les estimations de la gravité des blessures sont présentées dans le tableau 6.
Tableau 6
Évaluation du volume de gravité des blessures


Après avoir calculé les points, le nombre obtenu est multiplié par un coefficient.
Remarques
1. S'il existe des blessures non précisées dans la liste du volume et de la gravité de la blessure, un nombre de points est attribué selon le type de blessure, la gravité correspondant à l'une de celles énumérées.
2. En présence de maladies somatiques réduisant les fonctions adaptatives de l'organisme, la somme des points trouvée est multipliée par un coefficient de 1,2 à 2,0.
3. À l'âge de 50-60 ans, la somme des points est multipliée par 1,2, plus âgée par 1,5.
Traitement. Principales orientations du traitement.
1. Élimination de l'action de l'agent traumatique.
2. Élimination de l'hypovolémie.
3. Élimination de l'hypoxie.
Le soulagement de la douleur est obtenu en administrant des analgésiques et des narcotiques et en effectuant des blocages. Oxygénothérapie, intubation trachéale si nécessaire. Remboursement des pertes sanguines et des CBC (plasma, sang, rhéopolyglucine, polyglucine, érythromasse). Normalisation du métabolisme, à mesure que l'acidose métabolique se développe, du chlorure de calcium 10 % est administré - 10 ml, du chlorure de sodium 10 % - 20 ml, du glucose 40 % - 100 ml. Lutte contre les carences en vitamines (vitamines B, vitamine C).
Thérapie hormonale avec des glucocorticostéroïdes - prednisolone intraveineuse 90 ml une fois, puis 60 ml toutes les 10 heures.
Stimulation du tonus vasculaire (mésaton, noradrénaline), mais uniquement lorsque le volume de sang circulant est reconstitué. Les antihistaminiques (diphenhydramine, sibazon) interviennent également dans la thérapie anti-choc.
Choc hémorragique est une affection d'insuffisance cardiovasculaire aiguë qui se développe après la perte d'une quantité importante de sang et entraîne une diminution de la perfusion des organes vitaux.
Étiologie : blessures avec lésions des gros vaisseaux, ulcères gastriques et duodénaux aigus, rupture d'un anévrisme de l'aorte, pancréatite hémorragique, rupture de la rate ou du foie, rupture d'une trompe ou grossesse extra-utérine, présence de lobules placentaires dans l'utérus, etc.
Selon les données cliniques et l'ampleur du déficit volémique, on distingue les degrés de gravité suivants.
1. Non exprimé - aucune donnée clinique, le niveau de tension artérielle est normal. Le volume de perte de sang peut atteindre 10 % (500 ml).
2. Faible - tachycardie minime, légère diminution de la pression artérielle, quelques signes de vasoconstriction périphérique (mains et pieds froids). Le volume de perte de sang varie de 15 à 25 % (750-1 200 ml).
3. Modéré - tachycardie jusqu'à 100-120 battements par minute, diminution de la pression pulsée, pression systolique 90-100 mm Hg. Art., anxiété, transpiration, pâleur, oligurie. Le volume de perte de sang varie de 25 à 35 % (1 250 à 1 750 ml).
4. Sévère - tachycardie supérieure à 120 battements par minute, pression systolique inférieure à 60 mm Hg. Art., souvent non détecté par un tonomètre, stupeur, pâleur extrême, extrémités froides, anurie. Le volume de perte de sang est supérieur à 35 % (plus de 1 750 ml). Les tests de laboratoire ont montré une diminution du taux d'hémoglobine, des globules rouges et de l'hématocrite lors d'un test sanguin général. L'ECG révèle des modifications non spécifiques du segment ST et de l'onde T, provoquées par une circulation coronarienne insuffisante.
Traitement le choc hémorragique implique l'arrêt du saignement, l'utilisation d'un traitement par perfusion pour restaurer le volume sanguin et l'utilisation de vasoconstricteurs ou de vasodilatateurs, selon la situation. Le traitement par perfusion implique l'administration intraveineuse de liquide et d'électrolytes dans un volume de 4 litres (solution saline, glucose, albumine, polyglucine). En cas de saignement, une transfusion de sang et de plasma du même groupe est indiquée dans un volume total d'au moins 4 doses (1 dose correspond à 250 ml). L'administration de médicaments hormonaux, tels que des stabilisants membranaires (prednisolone 90-120 mg), est indiquée. En fonction de l'étiologie, un traitement spécifique est réalisé.
Choc septique– il s’agit de la pénétration d’un agent infectieux depuis son foyer d’origine dans le système sanguin et sa propagation dans tout l’organisme. Les agents responsables peuvent être : des bactéries staphylococciques, streptococciques, pneumococciques, méningococciques et entérococciques, ainsi que Escherichia, Salmonella et Pseudomonas aeruginosa, etc. Le choc septique s'accompagne d'un dysfonctionnement des systèmes pulmonaire, hépatique et rénal, d'une violation de la coagulation sanguine. système, ce qui conduit à l'apparition d'un syndrome thrombohémorragique (syndrome de Machabeli), qui se développe dans tous les cas de sepsis. L'évolution de la septicémie est influencée par le type d'agent pathogène, ce qui est particulièrement important avec les méthodes de traitement modernes. Les résultats de laboratoire indiquent une anémie progressive (due à l'hémolyse et à l'inhibition de l'hématopoïèse). Leucocytose jusqu'à 12 109/l, cependant, dans les cas graves, en raison du développement d'une forte dépression des organes hématopoïétiques, une leucopénie peut également être observée.
Symptômes cliniques du choc bactérien: frissons, température élevée, hypotension, peau sèche et chaude - initialement, puis froide et humide, pâleur, cyanose, troubles de l'état mental, vomissements, diarrhée, oligurie. La caractéristique est la neutrophilie avec un déplacement de la formule leucocytaire vers la gauche jusqu'aux myélocytes ; L'ESR augmente jusqu'à 30-60 mm/h ou plus. Le taux de bilirubine dans le sang augmente (jusqu'à 35-85 µmol/l), ce qui s'applique également à la teneur en azote résiduel dans le sang. La coagulation sanguine et l'indice de prothrombine sont réduits (jusqu'à 50 à 70 %), les niveaux de calcium et de chlorure sont réduits. Les protéines sanguines totales sont réduites, en raison de l'albumine, et le taux de globulines (alpha-globulines et b-globulines) augmente. L'urine contient des protéines, des leucocytes, des globules rouges et des cylindres. Le niveau de chlorure dans l'urine est réduit et le niveau d'urée et d'acide urique est augmenté.
Traitement est principalement de nature étiologique, par conséquent, avant de prescrire un traitement antibactérien, il est nécessaire de déterminer l'agent pathogène et sa sensibilité aux antibiotiques. Les agents antimicrobiens doivent être utilisés aux doses maximales. Pour traiter le choc septique, il est nécessaire d'utiliser des antibiotiques couvrant tout le spectre des micro-organismes à Gram négatif. La plus rationnelle est l'association de ceftazidime et d'impinem, qui se sont révélées efficaces contre Pseudomonas aeruginosa. Des médicaments tels que la clindamycine, le métronidazole, la ticarcilline ou l'imipinem sont utilisés comme médicaments de choix lorsqu'un agent pathogène résistant apparaît. Si des staphylocoques sont cultivés à partir du sang, il est impératif de commencer un traitement avec des médicaments à base de pénicilline. Le traitement de l'hypotension consiste dans la première étape du traitement à déterminer l'adéquation du volume de liquide intravasculaire. Utiliser des solutions cristalloïdes (solution isotonique de chlorure de sodium, Ringer lactate) ou des colloïdes (albumine, dextrane, polyvinylpyrrolidone). L'avantage des colloïdes est que lors de leur introduction, les pressions de remplissage requises sont atteintes le plus rapidement possible et le restent longtemps. S'il n'y a aucun effet, un soutien inotrope et (ou) des médicaments vasoactifs sont utilisés. La dopamine est le médicament de choix car c’est un bêta-agoniste cardiosélectif. Les corticostéroïdes réduisent la réponse globale aux endotoxines, aident à réduire la fièvre et ont un effet hémodynamique positif. Prednisolone à la dose de 60k 90 mg par jour.
L'état de choc est un phénomène complexe qui se produit en réaction à des dommages ou à des blessures graves, qui concernent presque tous les organes et systèmes internes du corps. Les organes circulatoires sont principalement touchés.
Les principaux signes de choc sont :
Douleur aiguë;
Intoxication sanguine, accompagnée d'une augmentation de la température corporelle ;
Ouverture du saignement ;
Refroidir le corps.
L'une des causes du choc est la toxicose provoquée par une compression prolongée ou un traumatisme des tissus mous. L'insuffisance rénale se développe en raison de lésions de la couche épithéliale des reins et de la fermeture des tubules rénaux. Des conclusions peuvent être tirées sur la puissance de l'état de choc en cas de lésions rénales sur la base d'une petite quantité d'urine ou de son absence totale, même si la pression artérielle est normale.
L'état de choc après une brûlure grave se caractérise par une diminution significative de la masse de sang en circulation due au fait que le plasma sanguin s'échappe à travers la peau endommagée.
La première étape du choc se caractérise par un degré extrême d'agitation de la victime, son incapacité à comprendre la gravité de l'état et les blessures subies. Au stade suivant du développement de l’état de choc, la réaction de la victime est inhibée, la personne devient apathique. La conscience est maintenue à toutes les étapes de l’état de choc. La peau et les muqueuses pâlissent.
Au premier stade du choc, la pression artérielle et la fréquence cardiaque ne changent pas.
Au cours de la deuxième étape du choc, la tension artérielle chute considérablement, le cœur commence à battre plus vite, la pâleur de la peau et des muqueuses visibles augmente et le système circulatoire périphérique est moins actif.
Au troisième stade du choc, un état extrêmement grave est observé. La pression artérielle est considérablement réduite, le cœur bat très vite et le pouls est caractérisé par un faible remplissage. A ce stade du choc, on observe une peau pâle et une transpiration froide. Avec le développement ultérieur de l'état de choc, la conscience commence à quitter la victime. Des taches commencent à apparaître sur une peau pâle. Le pouls ne peut être déterminé que dans les artères principales.
Lors du traitement d'un choc, les mêmes techniques sont utilisées que dans le cas d'un choc d'origine hémorragique. En cas de choc, il est extrêmement important de prodiguer les premiers soins à la victime avant l'arrivée de l'ambulance.
Tout d'abord, il est nécessaire de restaurer la perméabilité normale des voies respiratoires, c'est-à-dire de normaliser la position de la langue, si elle est coincée, d'utiliser le bouche-à-bouche. Après cela, il est nécessaire de rétablir une circulation sanguine normale à l'aide d'un massage fermé intensif du muscle cardiaque, d'un clampage des vaisseaux sanguins, d'injections intraveineuses du médicament polyglucine et du bicarbonate de sodium.
En plus des mesures ci-dessus, il faut :
Appliquer des pansements stériles sur les blessures ouvertes ;
Réparer les fractures si présentes ;
Positionner correctement la victime ;
Si la poitrine est blessée, placez la victime en position assise ;
Lorsqu'un traumatisme crânien survient, la victime est placée dans une position semi-assise ;
En cas de blessure abdominale, la victime doit être allongée horizontalement ;
Des injections d'antispasmodiques sont réalisées si nécessaire ;
Si nécessaire, il est nécessaire de relever les jambes de la victime dans une position surélevée ;
Fixation de fragments osseux dans les fractures ouvertes ;
Actions de réchauffement pour prévenir l'hypothermie de la victime ;
Donner à boire à la victime autant que possible, si l'estomac n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de vomissements ;
Emmenez la victime à l'hôpital dès que possible.
Avant d'utiliser les médicaments répertoriés sur le site Web, consultez votre médecin.
Le choc est une réaction générale du corps à une irritation extrêmement forte, par exemple douloureuse. Elle se caractérise par de graves troubles des fonctions des organes vitaux, des systèmes nerveux et endocrinien. Le choc s'accompagne de graves troubles de la circulation sanguine, de la respiration et du métabolisme. Il existe un certain nombre de classifications de choc.
Types de choc.
Selon le mécanisme de développement, le choc est divisé en plusieurs types principaux :
– hypovolémique (avec perte de sang) ;
– cardiogénique (avec altération sévère de la fonction cardiaque) ;
– redistribution (en cas de troubles circulatoires) ;
– des douleurs (en cas de blessure, infarctus du myocarde).
Le choc est également déterminé par les raisons qui ont provoqué son développement :
– traumatique (due à des blessures ou à des brûlures étendues, le principal facteur causal étant la douleur) ;
– anaphylactique, qui est la réaction allergique la plus grave à certaines substances entrant en contact avec l’organisme ;
– cardiogénique (se développe comme l'une des complications les plus graves de l'infarctus du myocarde) ;
– hypovolémique (pour les maladies infectieuses avec vomissements et diarrhées répétés, échauffement, perte de sang) ;
– toxique septique, ou infectieux (pour les maladies infectieuses graves) ;
– combiné (combine plusieurs facteurs causals et mécanismes de développement).
Choc douloureux.
Le choc douloureux est provoqué par une douleur qui dépasse le seuil de douleur individuel en intensité. Elle est plus souvent observée en cas de blessures traumatiques multiples ou de brûlures étendues. Les symptômes de choc sont divisés en phases et étapes. Dans la phase initiale (érectile) du choc traumatique, la victime éprouve de l'agitation, une peau du visage pâle, un regard agité et une évaluation inadéquate de la gravité de son état.
Il y a aussi une activité motrice accrue : il saute, essaie d'aller quelque part, et il peut être assez difficile de le retenir. Puis, à mesure que la deuxième phase de choc (torpidité) s'installe, un état mental déprimé, une indifférence totale à l'égard de l'environnement et une diminution ou une absence totale de réponse douloureuse se développent sur fond de conscience préservée. Le visage reste pâle, ses traits deviennent plus nets, la peau de tout le corps est froide au toucher et recouverte d'une sueur collante. La respiration du patient s'accélère considérablement et devient superficielle, la victime a soif et des vomissements surviennent souvent. Avec différents types de choc, la phase de torpeur diffère principalement par sa durée. Elle peut être grossièrement divisée en 4 étapes.
Choc I degré (léger).
L'état général de la victime est satisfaisant, accompagné d'une légère léthargie. Le pouls est de 90 à 100 battements par minute, son remplissage est satisfaisant. La pression artérielle systolique (maximale) est comprise entre 95 et 100 mm Hg. Art. ou un peu plus haut. La température corporelle reste dans les limites normales ou est légèrement réduite.
Degré de choc II (modéré).
La léthargie de la victime est clairement exprimée, la peau est pâle et la température corporelle diminue. La pression artérielle systolique (maximale) est comprise entre 90 et 75 mm Hg. Art., et le pouls est de 110 à 130 battements par minute (faible remplissage et tension, variable). La respiration est superficielle et rapide.
Degré de choc III (sévère).
La pression artérielle systolique (maximale) est inférieure à 75 mmHg. Art., pouls – 120-160 battements par minute, filiforme, faible remplissage. Cette étape de choc est considérée comme critique.
Choc de degré IV (appelé état préagonal).
La pression artérielle n'est pas déterminée et le pouls ne peut être détecté que dans les gros vaisseaux (artères carotides). La respiration du patient est très rare et superficielle.
Choc cardiogénique.
Le choc cardiogénique est l'une des complications les plus graves et potentiellement mortelles de l'infarctus du myocarde et des troubles graves du rythme et de la conduction cardiaques. Ce type de choc peut se développer au cours d'une période de douleur intense au niveau du cœur et se caractérise initialement par une faiblesse exceptionnellement soudaine, une pâleur de la peau et une cyanose des lèvres. De plus, le patient ressent du froid dans les extrémités, une sueur froide et collante recouvrant tout le corps et souvent une perte de conscience. La pression artérielle systolique descend en dessous de 90 mm Hg. Art., et la pression pulsée est inférieure à 20 mm Hg. Art.
Choc hypovolémique.
Le choc hypovolémique se développe à la suite d'une diminution relative ou absolue du volume de liquide circulant dans le corps. Cela entraîne un remplissage insuffisant des ventricules cardiaques, une diminution du volume systolique du cœur et, par conséquent, une diminution significative du débit sanguin cardiaque. Dans certains cas, la victime est aidée en « activant » un mécanisme compensatoire tel qu’une augmentation de la fréquence cardiaque. Une cause assez fréquente de choc hypovolémique est une perte de sang importante résultant d'un traumatisme important ou de lésions de gros vaisseaux sanguins. Dans ce cas, nous parlons de choc hémorragique.
Dans le mécanisme de développement de ce type de choc, le plus important est la perte de sang importante elle-même, qui entraîne une forte baisse de la pression artérielle. Les processus compensatoires, tels que les spasmes des petits vaisseaux sanguins, aggravent le processus pathologique, car ils conduisent inévitablement à une altération de la microcirculation et, par conséquent, à un déficit systémique en oxygène et à une acidose.
L'accumulation de substances sous-oxydées dans divers organes et tissus provoque une intoxication de l'organisme. Les vomissements et diarrhées répétés dus à des maladies infectieuses entraînent également une diminution du volume sanguin circulant et une baisse de la tension artérielle. Les facteurs prédisposant au développement d'un choc sont : une perte de sang importante, l'hypothermie, la fatigue physique, un traumatisme mental, la famine, l'hypovitaminose.
Choc toxique infectieux.
Ce type de choc est la complication la plus grave des maladies infectieuses et une conséquence directe de l'effet de la toxine pathogène sur l'organisme. Il existe une centralisation prononcée de la circulation sanguine, à cause de laquelle la majeure partie du sang s'avère pratiquement inutilisée et s'accumule dans les tissus périphériques. Il en résulte une altération de la microcirculation et un manque d’oxygène dans les tissus. Une autre caractéristique du choc toxique infectieux est une détérioration significative de l'apport sanguin au myocarde, qui entraîne rapidement une diminution prononcée de la pression artérielle. Ce type de choc est caractérisé par l’apparence du patient : les troubles de la microcirculation donnent à la peau un aspect « marbré ».
Principes généraux des soins d'urgence en cas de choc.
La base de toutes les mesures anti-choc est la fourniture en temps opportun de soins médicaux à toutes les étapes du déplacement de la victime : sur les lieux de l'incident, sur le chemin de l'hôpital, directement à l'intérieur de celui-ci. Les grands principes des mesures anti-choc sur les lieux d'un incident sont de mener un vaste ensemble d'actions dont l'ordre dépend de la situation spécifique, à savoir :
1) élimination de l'action de l'agent traumatique ;
2) arrêter le saignement ;
3) déplacer soigneusement la victime ;
4) lui donner une position qui atténue la condition ou évite des blessures supplémentaires ;
5) libération des vêtements contraignants ;
6) fermer les plaies avec des pansements aseptiques ;
7) soulagement de la douleur ;
8) utilisation de sédatifs ;
9) améliorer le fonctionnement des organes respiratoires et circulatoires.
En cas de choc, les priorités sont le contrôle des saignements et le soulagement de la douleur. Il convient de rappeler que le repositionnement des victimes, ainsi que leur transport, doivent être prudents. Les patients doivent être placés dans un transport en ambulance en tenant compte de la commodité des mesures de réanimation. Le soulagement de la douleur en cas de choc est obtenu par l'administration de médicaments neurotropes et d'analgésiques. Plus il est commencé tôt, plus le syndrome douloureux est faible, ce qui augmente l'efficacité de la thérapie antichoc. Ainsi, après l'arrêt du saignement massif, avant l'immobilisation, le pansement de la plaie et le positionnement de la victime, il est nécessaire de procéder à une anesthésie.
A cet effet, la victime reçoit par voie intraveineuse 1 à 2 ml d'une solution à 1% de promedol, diluée dans 20 ml d'une solution à 0,5% de novocaïne, ou 0,5 ml d'une solution à 0,005% de fentanyl, diluée dans 20 ml de une solution à 0,5 % de novocaïne ou 20 ml de solution de glucose à 5 %. Les analgésiques sont administrés par voie intramusculaire sans solvant (1 à 2 ml de solution de promedol à 1 %, 1 à 2 ml de tramal). L'utilisation d'autres analgésiques narcotiques est contre-indiquée car ils provoquent une dépression des centres respiratoires et vasomoteurs. De plus, en cas de blessures abdominales avec suspicion de lésions des organes internes, l'administration de fentanyl est contre-indiquée.
L'utilisation de liquides contenant de l'alcool dans les soins d'urgence en cas de choc n'est pas autorisée, car ils peuvent provoquer une augmentation des saignements, ce qui entraînera une diminution de la pression artérielle et une dépression des fonctions du système nerveux central. Il faut toujours se rappeler que dans des conditions de choc, des spasmes des vaisseaux sanguins périphériques se produisent. Par conséquent, les médicaments sont administrés par voie intraveineuse et, s'il n'y a pas d'accès à une veine, par voie intramusculaire.
L'anesthésie locale et le refroidissement de la partie endommagée du corps ont un bon effet analgésique. L'anesthésie locale est réalisée avec une solution de novocaïne, qui est injectée dans la zone endommagée ou blessée (dans les tissus intacts). En cas d'écrasement important des tissus, de saignements des organes internes, de gonflement croissant des tissus, il est conseillé de compléter l'anesthésie locale par une exposition locale au froid sec. Le refroidissement améliore non seulement l'effet analgésique de la novocaïne, mais a également un effet bactériostatique et bactéricide prononcé.
Afin de soulager l'agitation et de renforcer l'effet analgésique, il est conseillé d'utiliser des antihistaminiques, comme la diphenhydramine et la prométhazine. Pour stimuler la fonction respiratoire et la circulation sanguine, la victime reçoit un analeptique respiratoire - une solution à 25 % de cordiamine dans un volume de 1 ml. Au moment de la blessure, la victime peut être en état de mort clinique. Par conséquent, lorsque l'activité cardiaque et la respiration s'arrêtent, quelles que soient les raisons qui les ont provoquées, des mesures de réanimation sont immédiatement lancées - ventilation artificielle et massage cardiaque. Les mesures de réanimation ne sont considérées comme efficaces que si la victime commence à respirer de manière indépendante et a un rythme cardiaque.
Lors de la fourniture de soins d'urgence au stade du transport, le patient reçoit des perfusions intraveineuses de substituts de plasma à gros poids moléculaire qui ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières. La polyglucine et d'autres solutions moléculaires de grande taille, en raison de leurs propriétés osmotiques, provoquent un afflux rapide de liquide tissulaire dans le sang et augmentent ainsi la masse sanguine circulant dans le corps. En cas de perte de sang importante, il est possible de transfuser du plasma sanguin à la victime.
Lors de l'admission de la victime dans un établissement médical, l'exactitude de l'immobilisation et le moment opportun d'application d'un garrot hémostatique sont vérifiés. Si de telles victimes sont admises, la première étape consiste à arrêter complètement le saignement. Pour les blessures aux extrémités, un blocus selon Vishnevsky, effectué au-dessus du site de la blessure, est conseillé. L'administration répétée de promedol n'est autorisée que 5 heures après son administration initiale. Dans le même temps, ils commencent à inhaler de l'oxygène pour la victime.
L'inhalation d'un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène dans un rapport de 1 : 1 ou 2 : 1 à l'aide d'appareils d'anesthésie a un bon effet dans le traitement antichoc. De plus, pour obtenir un bon effet neurotrope, des médicaments cardiaques doivent être utilisés : cordiamine et caféine. La caféine stimule la fonction des centres respiratoires et vasomoteurs du cerveau et accélère et intensifie ainsi les contractions myocardiques, améliore la circulation coronarienne et cérébrale et augmente la pression artérielle. Les contre-indications à l'utilisation de la caféine sont uniquement des saignements incontrôlés, des spasmes sévères des vaisseaux périphériques et une augmentation de la fréquence cardiaque.
La cordiamine améliore l'activité du système nerveux central, stimule la respiration et la circulation sanguine. À des doses optimales, il contribue à augmenter la tension artérielle et à améliorer la fonction cardiaque. Dans les blessures graves, en cas de troubles graves de la respiration externe et d'un manque progressif d'oxygène (hypoxie respiratoire), ces phénomènes sont aggravés par des troubles circulatoires et une perte de sang caractéristique du choc - une hypoxie circulatoire et anémique se développe.
En cas d'insuffisance respiratoire légère, les mesures antihypoxiques peuvent se limiter à libérer la victime des vêtements serrés et à fournir un flux d'air pur ou un mélange humidifié d'oxygène avec de l'air pour l'inhalation. Ces activités sont nécessairement associées à une stimulation de la circulation sanguine. En cas d'insuffisance respiratoire aiguë, une trachéotomie est indiquée si nécessaire. Elle consiste à créer une fistule artificielle, qui permet à l'air de pénétrer dans la trachée par une ouverture à la surface du cou. Un tube de trachéotomie y est inséré. En cas d'urgence, il peut être remplacé par n'importe quel objet creux.
Si la trachéotomie et la toilette des voies respiratoires n'éliminent pas l'insuffisance respiratoire aiguë, les mesures thérapeutiques sont complétées par une ventilation artificielle. Ce dernier contribue non seulement à réduire ou éliminer l’hypoxie respiratoire, mais élimine également la congestion de la circulation pulmonaire et stimule simultanément le centre respiratoire du cerveau.
Les perturbations des processus métaboliques qui en résultent sont plus prononcées dans les formes de choc graves. Par conséquent, le complexe de thérapie antichoc et de réanimation, quelles que soient les raisons de l'état grave de la victime, comprend des médicaments ayant des effets métaboliques, qui comprennent principalement des vitamines hydrosolubles (B1, B6, C, PP), 40 % de glucose solution, insuline, hydrocortisone ou son analogue prednisolone.
En raison de troubles métaboliques dans le corps, les processus redox sont perturbés, nécessitant l'inclusion d'agents alcalinisants du sang dans la thérapie antichoc et la réanimation. Il est plus pratique d'utiliser des solutions à 4 à 5 % de bicarbonate de sodium ou de bicarbonate, qui sont administrées par voie intraveineuse à une dose allant jusqu'à 300 ml. Les transfusions de sang, de plasma et de certains substituts du plasma font partie intégrante de la thérapie antichoc.
Basé sur des éléments du livre « Aide rapide dans les situations d’urgence ».
Kashin S.P.