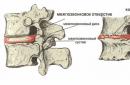L'inflammation granulomateuse est basée sur troubles immunitaires- principalement par type d'hypersensibilité retardée, de réactions allergiques et cytotoxiques. Selon A.A. Yarilina (1999), le développement d'un granulome sert généralement d'indicateur d'inefficacité défense immunitaire. L'apparition de granulomes au cours du processus inflammatoire est souvent associée à la défaillance des phagocytes mononucléés, incapables de digérer l'agent pathogène, ainsi qu'à la persistance de ce dernier dans les tissus.
En raison des particularités de la réaction du corps à un agent particulier, l'inflammation granulomateuse est également appelée spécifique. Elle se caractérise par un agent pathogène spécifique, un changement et un polymorphisme des réactions tissulaires en fonction de l'état. système immunitaire organisme, une évolution chronique ondulatoire, la prédominance d'une réaction productive de nature granulomateuse et le développement d'une nécrose de la coagulation dans les zones d'inflammation. Les maladies infectieuses caractérisées par la spécificité de la réaction comprennent la tuberculose, la syphilis, la lèpre et le sclérome. Le processus inflammatoire dans ces maladies comporte, comme d'habitude, toutes les composantes : altération, exsudation et prolifération, mais, en outre, un certain nombre de certaines caractéristiques morphologiques sous la forme d'un granulome - une accumulation assez clairement délimitée d'histiocytes ou de cellules épithélioïdes dans le derme sur fond d'infiltration inflammatoire chronique, souvent avec un mélange de cellules multinucléées géantes.
Les cellules épithélioïdes sont un type de macrophage, contiennent un réticulum endoplasmique granulaire, synthétisent de l'ARN, mais sont peu capables de phagocytose, mais elles présentent la capacité de pinocytoser de petites particules. Ces cellules ont une surface inégale en raison du grand nombre de microvillosités qui sont en contact étroit avec les microvillosités des cellules voisines, de sorte qu'elles sont étroitement adjacentes les unes aux autres dans le granulome. On pense que les cellules géantes sont formées de plusieurs cellules épithélioïdes en raison de la fusion de leur cytoplasme.
La classification de l’inflammation granulomateuse est extrêmement difficile. En règle générale, cela se base sur des critères pathogénétiques, immunologiques et critères morphologiques. W.L. Epstein (1983) divise tous les granulomes cutanés, en fonction du facteur étiopathogénétique, dans les types suivants : granulome à corps étranger, infectieux, immunitaire, associé à des lésions tissulaires primaires et non associé à Dommage tissulaire. O. Reyes-Flores (1986) classe l'inflammation granulomateuse en fonction de statut immunitaire corps. Il distingue l’inflammation granulomateuse immunocompétente, l’inflammation granulomateuse à immunité instable et l’immunodéficience.
I.A. Strukov et O.Ya. Kaufman (1989) a divisé tous les granulomes en 3 groupes : selon l'étiologie (infectieuse, non infectieuse, d'origine médicamenteuse, poussière, granulomes autour). corps étranger, étiologie inconnue) ; histologie (granulomes des macrophages matures, avec/sans cellules épithélioïdes ou multinucléées géantes, avec nécrose, changements fibreux etc.) et la pathogenèse (granulomes hypersensibles immunitaires, granulomes non immunitaires, etc.).
AVANT JC. Hirsh et W.C. Johnson (1984) a proposé classification morphologique, en tenant compte de la gravité de la réaction tissulaire et de la prédominance de l'un ou l'autre type de cellule dans ce processus, de la présence de suppuration, de modifications nécrotiques et de corps étrangers, ou Agents infectieux. Les auteurs distinguent cinq types de granulomes : tuberculoïde (cellule épithélioïde), sarcoïde (histiocytaire), à corps étranger, nécrobiotique (en forme de palissade) et mixte.
Les tuberculoïdes (granulomes à cellules épithélioïdes) surviennent principalement dans les infections chroniques (tuberculose, tuberculose tardive). syphilis secondaire, actinomycose, leishmaniose, rhinosclérome, etc.). Ils sont formés de cellules multinucléées épithélioïdes et géantes, parmi ces dernières les cellules de Pirogov-Langhans prédominent, mais on trouve également des cellules de corps étrangers. Ce type de granulome se caractérise par la présence d'une large zone d'infiltration d'éléments lymphocytaires autour d'accumulations de cellules épithélioïdes.
Le granulome sarcoïde (histiocytaire) est une réaction tissulaire caractérisée par une prédominance d'histiocytes et de cellules géantes multinucléées dans l'infiltrat. DANS cas typiques les granulomes individuels n'ont pas tendance à fusionner les uns avec les autres et sont entourés d'un bord de très petite quantité lymphocytes et fibroblastes, qui ne sont pas détectés dans les granulomes eux-mêmes. Les granulomes de ce type se développent avec la sarcoïdose, l'implantation de zirconium et le tatouage.
Les granulomes nécrobiotiques (en forme de palissade) se retrouvent dans le granulome annulaire, la nécrobiose lipoïdique, les nodules rhumatismaux, les maladies griffures de chat et lymphogranulome vénérien. Les granulomes nécrobiotiques peuvent être d'origines diverses, certaines d'entre elles s'accompagnent de modifications profondes des vaisseaux sanguins, souvent de nature primaire (granulomatose de Wegener). Le granulome à corps étranger reflète la réaction de la peau à un corps étranger (exogène ou endogène), caractérisée par des accumulations de macrophages et de cellules géantes de corps étrangers autour d'elle. Les granulomes mixtes, comme leur nom l'indique, combinent les symptômes différents types granulome.
L'histogenèse de l'inflammation granulomateuse est décrite en détail par D.O. Adams. Expérimentalement, cet auteur a montré que le développement du granulome dépend de la nature de l'agent causal et de l'état de l'organisme. DANS phases initiales processus, un infiltrat massif de jeunes phagocytes mononucléés apparaît, ressemblant histologiquement à l'image d'une inflammation chronique non spécifique. Au bout de quelques jours, cet infiltrat se transforme en granulome mature, et des agrégats de macrophages matures se localisent de manière compacte, ils se transforment en cellules épithélioïdes puis en cellules géantes. Ce processus s'accompagne de modifications ultrastructurales et histochimiques des phagocytes mononucléés. Ainsi, les jeunes phagocytes mononucléés sont des cellules relativement petites, possèdent des noyaux hétérochromatiques denses et un cytoplasme maigre, qui contient quelques organites : mitochondries, complexe de Golgi, réticulum endoplasmique granulaire et lisse et lysosomes. Les cellules épithélioïdes sont plus grandes, ont un noyau euchromatique situé de manière excentrique et un cytoplasme abondant, contenant généralement un grand nombre de organites
Examen histochimique en phagocytes mononucléés au début de leur développement, des granules peroxydase-positives sont révélés, rappelant ceux des monocytes ; dans les cellules éthpélioïdes, on note une dissolution progressive des granules primaires peroxydase-positives et une augmentation du nombre de peroxysomes. Au fur et à mesure que le processus progresse, des enzymes lysosomales telles que la bêta-galactosidase y apparaissent. Les changements dans les noyaux des cellules de granulome de petit hétérochromatique à grand euchromatique s'accompagnent généralement de la synthèse d'ARN et d'ADN.
En plus des éléments de granulome décrits ci-dessus, on y trouve des granulocytes neutrophiles et éosinophiles, des plasmocytes, des lymphocytes T et B en quantités variables. La nécrose est très souvent observée dans les granulomes, notamment en cas de forte toxicité des agents à l'origine de l'inflammation granulomateuse, tels que les streptocoques, le silicium, Mycobacterium tuberculosis, l'histoplasme. La pathogenèse de la nécrose des granulomes n'est pas connue avec précision, mais il existe des indications sur l'influence de facteurs tels que les hydrolases acides, les protéases neutres et divers médiateurs. De plus, l'importance est accordée aux lymphokines, à l'influence de l'élastase et de la collagénase, ainsi qu'aux spasmes vasculaires. La nécrose peut être fibrinoïde, caséeuse, parfois accompagnée d'un ramollissement ou d'une fonte purulente (formation d'abcès). Matière étrangère ou pathogène dans les granulomes. subissent une dégradation, mais ils peuvent déclencher une réponse immunitaire. Si produits dangereux sont complètement inactivés, le granulome régresse avec formation d'une cicatrice superficielle.
Si cela ne se produit pas, ces substances peuvent alors se trouver à l'intérieur des macrophages et être séparées des tissus environnants. capsule fibreuse ou séquestré.
La formation de l'inflammation granulomateuse est contrôlée par les lymphocytes T, qui reconnaissent l'antigène, se transforment en cellules blastiques capables d'informer d'autres cellules et organes lymphoïdes et participent au processus de prolifération grâce à la production de substances biologiquement actives (interleukine-2, lymphokines ), appelés facteurs chimiotactiques actifs sur les macrophages.
Informations sur la maladie "Déficience immunitaire primaire. Maladie granulomateuse chronique" (CGD). Les déficits immunitaires primaires sont des troubles associés à des défauts génétiques dans le développement du système immunitaire. Le plus souvent, les symptômes apparaissent dans les premiers mois de la vie, dans certains cas, les premières manifestations surviennent dans adolescence, ou, encore moins fréquemment, chez les adultes. Aujourd'hui à Classement international les maladies sont clairement identifiées comme unités nosologiques de 36 immunodéficiences primaires. Parallèlement, selon la littérature, environ 80 d'entre eux ont été décrits, et pour beaucoup d'entre eux, la structure moléculaire défaut génétique, qui est à l’origine du dysfonctionnement du système immunitaire. La maladie granulomateuse chronique (CGD) est déficit immunitaire primaire, dans lequel les phagocytes sont incapables de générer formes actives l’oxygène et « l’explosion d’oxygène » nécessaire à la destruction des bactéries et des champignons est perturbée. Le développement du CGD est provoqué par des défauts de ces molécules. La morphologie des neutrophiles et des monocytes ne change pas, les spécificités humorales et immunité cellulaire reste normale. Le type de transmission prédominant est lié à l'X (80 % des patients sont des hommes), les filles représentent environ 20 %. Pathogénèse. Le processus d'attachement bactérien et de phagocytose dans la maladie granulomateuse chronique se déroule normalement, mais les micro-organismes capturés au cours du processus de phagocytose ne sont pas davantage détruits. La prolifération des bactéries est supprimée, mais elles conservent la capacité de survivre à l’intérieur de la cellule, ce qui favorise leur persistance. processus infectieux. Les infections provoquent ligne entière bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Parmi les Gram positifs, ils prédominent Staphylococcus aureus, Les Gram négatifs sont souvent représentés par les espèces Serratla marcescens et Klebsiella. Les micro-organismes ne contenant pas de catalase, tels que le pneumocoque et le streptocoque H. influenzae, provoquent rarement des infections graves chez les patients atteints de maladie granulomateuse chronique en raison du fait qu'ils produisent du peroxyde d'hydrogène, ce qui les rend susceptibles d'être détruits même par des phagocytes défectueux. Caractéristiques cliniques. La maladie se manifeste dès la petite enfance par une hypertrophie prononcée des ganglions lymphatiques, notamment ceux cervicaux ; dermatite eczémateuse, infections purulentes destructrices voies respiratoires; hépatosplénomégalie avec abcès hépatique ; fièvre septique; ostéomyélite (généralement petits os des mains et des pieds) ; conjonctivite, rhinite, stomatite ulcéreuse, diarrhée chronique, paraproctite, péricardite. La cicatrisation des abcès de la peau et des muqueuses est fortement ralentie. Une leucocytose neutrophile est détectée, augmentation de l'ESR, anémie, concentration accrue immunoglobulines dans le sérum. 1/3 des patients décèdent avant l’âge de 7 ans. Des manifestations cliniques peuvent également survenir chez les enfants jeune âge(1-1,5 ans). Parfois, les adolescents développent des lésions cutanées purulentes (furoncles, anthrax, abcès à progression lente). La maladie se manifeste généralement sous la forme de maladies infectieuses récurrentes, affectant les organes respiration, peau, ganglions lymphatiques, foie, reins, etc. La survenue d'une lymphadénite et du BCG est caractéristique. De plus, chez 80 à 100 % des patients, des abcès du foie, des poumons et des abcès pararectaux sont détectés. Une hépatosplénomégalie se produit. Maladies infectieuses tube digestif sont graves et chez 25 % des enfants, la salmonellose peut être mortelle. Dans la maladie granulomateuse chronique, 15 à 30 % des patients développent une ostéomyélite des petits os des doigts et des orteils et une arthrose causée par un staphylocoque ou un aspergillus. Souvent, le processus granulomateux entraîne un épaississement des os, leur donnant un aspect « gonflé ». Lymphadénite purulente avec défaite prédominante Les ganglions lymphatiques cervicaux et axillaires sont détectés dans 75 à 100 % des cas de CGD. Diagnostique. Pour l'immunodiagnostic du CGD, on utilise des tests permettant d'identifier les troubles de la phagocytose, notamment avec le nitroblue tétrazolium. L'immunogramme révèle une diminution de la libération de superoxyde par les phagocytes stimulés jusqu'à 3 à 30 % de la normale. En plus des troubles phagocytaires, la plupart des patients ont niveau augmenté immunoglobulines sériques (IgA, IgM, IgG). Traitement. Pour la prévention et le contrôle maladies infectieuses, les patients atteints d'une maladie granulomateuse chronique nécessitent thérapie antibactérienne. À complications graves nommer administration intraveineuse médicaments antifongiques et des antibiotiques. Transplantation moelle- une méthode radicale, mais rarement utilisée, de traitement de la maladie, en raison de haute probabilité maladies infectieuses. La thérapie génique consiste à introduire le gène gp91phox normal dans les cellules souches de la moelle osseuse. Il existe des preuves des conséquences positives de cette opération et guérison complète d'une maladie granulomateuse chronique. Malheureusement, les statistiques montrent que de tels cas sont assez rares. De plus, il existe des rapports faisant état de diverses complications grâce au recours à la thérapie génique. Les technologies et les connaissances dans le domaine du génome humain s'améliorent constamment et on espère qu'à l'avenir thérapie génique aura plus de succès dans le traitement de la maladie granulomateuse chronique.
Maladie granulomateuse chronique (CGD ; granulomatose mortelle de l'enfance ; maladie granulomateuse chronique de l'enfance ; granulomatose septique progressive)
Description de la maladie granulomateuse chronique
La maladie granulomateuse chronique se développe lorsqu'un gène granulomateux spécifique est transmis des deux parents à l'enfant. Ce gène provoque une pathologie dans le développement des cellules du système immunitaire (en dans ce cas phagocytes). Les phagocytes tuent les bactéries étrangères qui pénètrent dans l'organisme. Lorsque l’on souffre d’une maladie granulomateuse chronique, les phagocytes ne fonctionnent pas correctement et l’organisme ne peut pas combattre certains types de bactéries. La maladie granulomateuse chronique augmente également le risque d'infections récurrentes.
Des infections dangereuses peuvent entraîner mort prématurée. Cause commune Les décès dus à cette maladie sont des infections pulmonaires répétées. Les soins et traitements préventifs peuvent réduire le risque d’infection et contrôler temporairement les infections.
La CGD est une maladie rare.
Causes de la maladie granulomateuse chronique
La maladie est généralement causée par un gène récessif. Cela signifie que deux gènes défectueux doivent être présents pour que la maladie survienne. Le gène de la maladie granulomateuse chronique est transmis sur le chromosome X. Pour que la maladie se développe, il faut que les deux parents soient porteurs de ce gène.
Facteurs de risque de maladie granulomateuse chronique
Les facteurs pouvant augmenter le risque de développer une maladie granulomateuse chronique comprennent :
- La présence d'un gène récessif chez les parents ;
- Sexe féminin.
Symptômes de la maladie granulomateuse chronique
Généralement, les symptômes commencent à apparaître dès l’enfance. Chez certains patients, ils peuvent n’apparaître qu’à l’adolescence.
Les symptômes de la maladie granulomateuse chronique comprennent :
- Ganglions lymphatiques hypertrophiés dans le cou ;
- Infections cutanées courantes difficiles à traiter :
- Abcès ;
- Furoncles ;
- Diarrhée prolongée ;
- Douleur osseuse;
- Douleur articulaire.
Diagnostic de la maladie granulomateuse chronique
Le médecin vous posera des questions sur vos symptômes et vos antécédents médicaux et effectuera check-up médical. Les tests peuvent inclure les éléments suivants :
- Etude des fluides et tissus corporels pour lesquels ils sont utilisés :
- Analyse sanguine générale ;
- Cytométrie en flux utilisant la dihydrorhodamine - un test sanguin qui détermine la présence dans les phagocytes substances chimiques, qui peut détruire les bactéries ;
- Vitesse de sédimentation des érythrocytes (ESR) - pour déterminer la présence d'une inflammation ;
- Des images de structures à l’intérieur du corps peuvent être prises en utilisant les méthodes suivantes :
- Scanner du foie.
Traitement de la maladie granulomateuse chronique
Les traitements de la maladie granulomateuse chronique comprennent :
Prendre des médicaments pour la maladie granulomateuse chronique
Pour le traitement de la maladie granulomateuse chronique, les produits suivants peuvent être prescrits :
- Antibiotiques – utilisés pour prévenir et traiter les infections ;
- Interféron gamma - réduit le risque de développer des infections, mais est inefficace en présence d'une infection active.
Une greffe de moelle osseuse
Un des meilleures options Le traitement de la maladie granulomateuse chronique est une greffe de moelle osseuse, qui permet dans la plupart des cas une guérison complète de la maladie.
Chirurgie
Une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour éliminer les abcès.
Vaccins
Certains êtres vivants sont à éviter vaccins viraux. Vous devriez parler à votre médecin avant de vous faire vacciner.
Prévention de la maladie granulomateuse chronique
CHB est maladie héréditaire. Il n’existe aucune mesure préventive pour réduire le risque de naître avec cette maladie. Dans certains cas, le conseil génétique peut être utile pour déterminer si gène défectueux. Diagnostic précoce la maladie granulomateuse chronique est vitale. Cela permettra de démarrer le traitement en temps opportun, ainsi que de rechercher rapidement un donneur pour une greffe de moelle osseuse.
Dans la maladie granulomateuse chronique, les neutrophiles et les monocytes conservent la capacité d'absorber les micro-organismes catalase-positifs, mais en raison du manque de métabolites de l'oxygène, ils ne les détruisent pas. Cette maladie est rare (4-5 : 1 000 000) et est héréditaire de manière récessive. La cause en est des mutations dans les gènes codant pour les composants de la NADP oxydase (un sur le chromosome X et trois gènes autosomiques).
Génétique et pathogenèse. L'activation de la NADPH oxydase dans les neutrophiles nécessite l'assemblage de sous-unités individuelles de l'enzyme dans la membrane cellulaire. Premièrement, la phosphorylation de la protéine cytoplasmique cationique p47phox (la protéine « phagocyte oxydase » avec masse moléculaire 47 kDa). Le p47phox phosphorylé, ainsi que deux autres composants cytoplasmiques de l'oxydase - le p67phox et la guanosine triphosphatase de faible poids moléculaire (Rac-2) - sont transloqués dans la membrane cellulaire, où toutes ces protéines interagissent avec les domaines cytoplasmiques du flavocytochrome transmembranaire b558, formant une oxydase active. (Fig. 185.5). Le flavocytochrome est un hétérodimère constitué de deux peptides - p22phoxp et gp91phox, riches en résidus glucidiques. Selon le modèle actuel, les trois domaines transmembranaires de la partie N-terminale de la flavoprotéine contiennent des résidus histidine qui déterminent la liaison à l'hème. Le peptide p22phox stabilise gp91phox. Le rôle de p40phox dans l’activation de l’oxydase reste flou. Le peptide gp91phox est nécessaire au transport des électrons impliquant les domaines de liaison NADP, flavine et hème. Le peptide p22pho stabilise non seulement gp91phox, mais contient également des sites de liaison pour les sous-unités cytoplasmiques de l'enzyme.
Les p47phox, p67phox et Rac-2 cytoplasmiques semblent jouer un rôle régulateur en activant le cytochrome b558.
Environ 2/3 des patients atteints de maladie granulomateuse chronique sont des hommes qui héritent de mutations du gène codant pour gp91phox situé sur le chromosome X, et 1/3 des patients héritent d'une mutation autosomique récessive du gène codant pour p47phox (chromosome 7). Environ 5 % des patients héritent de manière autosomique récessive de défauts des gènes p67phox (chromosome 1) et p22phox (chromosome 16).
La fonction phagocytaire normale des neutrophiles nécessite l'activation de la NADPH oxydase. Les électrons sont transférés du NADPH à la flavine, puis au groupe prothétique hème du cytochrome b558, et enfin à l'oxygène moléculaire, entraînant la formation d'O2-. Si ce système fonctionne de manière inefficace, l’O2- n’est pas produit.
Les perturbations du métabolisme oxydatif des neutrophiles dans la maladie granulomateuse chronique créent les conditions nécessaires à la survie des microbes. L'environnement dans les vacuoles des phagocytes reste acide et les bactéries ne sont pas digérées (Fig. 188.2). La coloration des macrophages à l'hématoxyline-éosine révèle un pigment doré, reflétant l'accumulation de matière absorbée dans les cellules, qui est à l'origine de la granulomatose diffuse, qui donne le nom à cette pathologie.
Manifestations cliniques. Une maladie granulomateuse chronique doit être suspectée chez tout patient présentant une lymphadénite répétée ou inhabituelle, des abcès hépatiques, une ostéomyélite multiple, des infections fréquentes du histoire de famille ou des infections causées par des microbes catalase-positifs (par exemple, S. aureus).
Les signes et symptômes cliniques peuvent survenir aussi bien pendant la petite enfance qu’au début de l’âge adulte. L'incidence et la gravité des maladies infectieuses sont très variables. L'agent causal est généralement S. aureus, bien qu'une infection par tout autre micro-organisme catalase-positif soit possible. Les agents infectieux courants comprennent Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, Aspergillus, Candida albicans et Salmonella. Une pneumonie, une lymphadénite et des lésions cutanées surviennent généralement. Complications infections chroniques comprennent l'anémie, la lymphadénopathie, l'hépatosplénomégalie, la dermatite chronique suppurée, les troubles restrictifs, la gingivite, l'hydronéphrose et la sténose pylorique. La possibilité d'une maladie granulomateuse chronique est également indiquée par la paraproctite et les infections cutanées répétées, notamment la folliculite, les granulomes et le lupus érythémateux discoïde. Granulomes et processus inflammatoires S'ils provoquent une sténose du pylore, un rétrécissement de l'urètre ou des fistules rectales ressemblant à la maladie de Crohn, une confirmation rapide du diagnostic est requise.
Recherche en laboratoire. Le test de réduction du nitroblue tétrazolium est encore largement utilisé dans le diagnostic de la maladie granulomateuse chronique, mais il est rapidement remplacé par la cytofluorométrie en flux à la dihydrorhodamine 123. Cette méthode détecte la production d'oxydants, car l'oxydation de la dihydrorhodamine 123 avec du peroxyde d'hydrogène améliore la fluorescence.
Prévision. La maladie granulomateuse chronique tue chaque année 2 patients sur 100. Le taux de mortalité le plus élevé est observé chez les jeunes enfants. Le pronostic à long terme s’est considérablement amélioré au cours des 20 dernières années. Cela peut être attribué à une meilleure compréhension de la biologie de la maladie, au développement de schémas thérapeutiques efficaces pour la prévention et la détection des infections, ainsi qu'à des interventions chirurgicales et chirurgicales actives. méthodes conservatrices leur traitement.
Les maladies granulomateuses sont un groupe hétérogène de maladies (formes nosologiques) d'étiologies diverses, dont la base structurelle est une inflammation granulomateuse. Ces maladies ont un certain nombre de caractéristiques communes : la présence d’une inflammation granulomateuse ; perturbation de l'homéostasie immunologique; polymorphisme des réactions tissulaires ; penchant pour évolution chronique avec des rechutes fréquentes; dommages vasculaires fréquents sous forme de vascularite.
Classification. Basé sur l'étiologie de la maladie. Il existe : les maladies granulomateuses d'étiologie établie :
Maladies granulomateuses étiologie infectieuse(rage, encéphalite virale, maladie des griffes du chat, typhus, fièvre paratyphoïde, la fièvre typhoïde, yersiniose, brucellose, tularémie, morve, rhumatismes, rhinosclérome, tuberculose, syphilis, lèpre, paludisme, toxoplasmose, leishmaniose, actinomycose, candidose, schistosomiase, trichinose, alvéococcose) ;
Maladies granulomateuses d'étiologie non infectieuse (silicose, talcose, aluminose, bérylliose). Les maladies répertoriées appartiennent au groupe des pneumoconioses, maladies causées par l'exposition aux poussières industrielles, et seront abordées dans le chapitre. « Maladies professionnelles » ;
Maladies granulomateuses d'étiologie inconnue (sarcoïdose, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, granulomatose de Wegener, panniculite de Weber-Christian, pyélonéphrite xanthogranulomateuse, thyroïdite granulomateuse à cellules géantes de Quervain).
La sarcoïdose (maladie de Besnier-Beck-Schaumann) est une maladie granulomateuse systémique chronique affectant de nombreux organes, cependant, les poumons avec les organes hilaires et médiastinaux sont le plus souvent touchés. ganglions lymphatiques (90%).
Le substrat morphologique de la sarcoïdose est le granulome à cellules épithélioïdes, dont la structure est très similaire à celle de la tuberculose. nécrose caséeuse il manque (Fig. 48 sur la couleur incl.). L’issue d’un tel granulome est généralement une hyalinose. Parfois, les granulomes ont deux autres caractéristiques caractéristique histologique: dépôts lamellaires de chaux et de protéines - Corps de Schaumann ; les inclusions en forme d'étoile sont des corps stéroïdes. Ces formations se trouvent dans le cytoplasme des cellules géantes.
La maladie de Crohn (iléocolite granulomateuse-ulcéreuse) est une maladie granulomateuse chronique dont l'étiologie et la pathogenèse n'ont pas été établies.
Le principal substrat morphologique de la maladie est le granulome, qui apparaît dans la membrane muqueuse et plus encore. couches profondes murs de n'importe quel département tube digestif, mais plus souvent dans la région iléo-cæcale. Le granulome dans la maladie de Crohn est construit selon principe général: ses cellules principales sont des marqueurs de la réponse immunitaire - cellules épithélioïdes situées autour du centre de nécrose. Plus loin se trouvent les macrophages, les lymphocytes, les granulocytes et plasmocytes. Les cellules Pirogov-Langhans sont situées plus près du centre. Le plus souvent, ces changements se trouvent dans la section terminal iléon. Toute l’épaisseur est affectée paroi intestinale qui devient enflée et épaissie. La membrane muqueuse apparaît grumeleuse, ressemblant à une rue pavée, associée à une alternance d'ulcères étroits et profonds situés en rangées parallèles le long de l'intestin avec des zones de membrane muqueuse normale.
La maladie de Horton (artérite temporale à cellules géantes) est une maladie des organes élastiques et type musculaire(principalement les artères temporales et occipitales) avec atteinte de la tunique médiale des vaisseaux. Les personnes âgées sont plus souvent touchées. Il existe une opinion sur la nature infectieuse-allergique de la maladie, ainsi qu'une prédisposition génétique à cette artérite chez les personnes présentant une expression de l'antigène BU4.
Histologiquement, une nécrose des fibres musculaires et des membranes élastiques est détectée dans les vaisseaux affectés. Autour des foyers nécrotiques, une réaction productive se développe avec la formation de granulomes à partir de cellules plasmatiques, épithélioïdes et géantes de type Pirogov-Langhans ou de cellules de corps étrangers.
Dans l’intima des vaisseaux sanguins, des tissus lâches se développent tissu conjonctif, ce qui entraîne un rétrécissement de la lumière du vaisseau et la formation de thrombus.
La granulomatose de Wegener est une vascularite nécrosante systémique caractérisée par une granulomatose touchant principalement les artères de moyen et petit calibre, ainsi que les vaisseaux microvasculaires des voies respiratoires et des reins. Les deux sexes sont concernés, image clinique On distingue les symptômes de pneumopathie, de sinusite chronique, d'ulcération de la muqueuse nasopharyngée et de lésions rénales.
Les modifications vasculaires de la granulomatose de Wegener se composent de trois phases : altérée (nécrotique), exsudative et productive avec une réaction granulomateuse prononcée. Le résultat est une sclérose et une hyalinose des vaisseaux sanguins avec le développement anévrismes chroniques ou une sténose pouvant aller jusqu'à l'oblitération complète de la lumière. Dans les artères de moyen calibre (type musculaire), l'endartérite est plus fréquente et dans les artères de petit calibre, la panartérite. Les vaisseaux de la microvascularisation sont touchés avec une grande cohérence (artériolite destructrice et destructrice-productive, capillarite). Les dommages causés à ces mêmes vaisseaux sont à l'origine de la formation de granulomes, qui fusionnent pour former des champs de tissu granulomateux qui subissent une nécrose. La granulomatose nécrosante est d'abord détectée dans les voies respiratoires supérieures, accompagnée d'une image de rhinopharyngite, de déformation du nez en forme de selle, de sinusite, de sinusite frontale, d'ethmoïdite, d'amygdalite et de stomatite.
Pathognomonique est inflammation purulente avec formation d'ulcères et de saignements. Dans certains cas, ces symptômes sont la seule manifestation de la maladie (forme localisée de granulomatose de Wegener). Au fur et à mesure de son évolution, une forme généralisée se développe avec formation de granulomatose nécrosante au niveau de la trachée, des bronches, Tissu pulmonaire. Sauf voies respiratoires les granulomes peuvent être trouvés dans les reins, la peau, les articulations, le foie, la rate, le cœur et d'autres organes.
Les granulomes se développant à l'intérieur et à l'extérieur des vaisseaux sont similaires à ceux de périartérite noueuse, cependant, chez eux atteints de granulomatose
La nécrose de Wegener se développe, parfois avec une cavité dans la partie centrale. Les granulomes sont entourés à l'extérieur de fibroblastes, parmi lesquels se trouvent des cellules géantes et des leucocytes.
À la suite de lésions granulomateuses, une sclérose et une déformation des organes se développent.
Un trait caractéristique de la granulomatose de Wegener est la glomérulonéphrite, qui est généralement représentée par des formes mésangioprolifératives ou mésangiocapillaire avec nécrose fibrinoïde des anses capillaires et des artérioles glomérulaires et des réactions extracapillaires (formation de croissants caractéristiques).
La panniculite granulomateuse de Weber-Christian (WPC) est une panniculite nodulaire rare. La panniculite est une inflammation productive limitée du tissu sous-cutané. Les principaux signes de GPVC sont l'évolution récurrente, la fièvre, la localisation dans tissu sous-cutané des membres inférieurs, ainsi que la composition la plus diversifiée de foyers d'inflammation (histiocytes à cytoplasme mousseux, lymphocytes, neutrophiles, cellules multinucléées géantes).
Pyélonéphrite xanthogranulomateuse - variété rare chronique productive néphrite interstitielle, dont l'un des traits caractéristiques est la présence dans tissu rénal foyers de cellules de xanthome. Les cellules de xanthome (mousse) sont caractérisées par un cytoplasme mousseux, dans lequel de multiples petites gouttelettes lipidiques sont révélées lorsqu'elles sont colorées au Soudan. On trouve parfois des cellules multinucléées géantes de type xanthome.
Les foyers de xanthomatose alternent avec des infiltrats lymphoplasmocytaires avec un mélange de leucocytes polymorphonucléaires. Sur la base des données morphologiques, on distingue deux formes de pyélonéphrite xanthogranulomateuse : diffuse (la plus courante) et nodulaire (semblable à une tumeur).
La maladie est plus fréquente chez les femmes âgées de 30 à 50 ans, mais elle a été observée dans l'enfance.